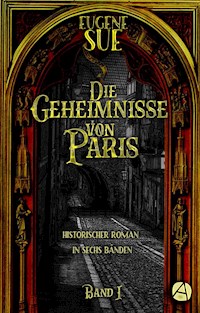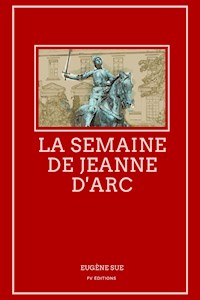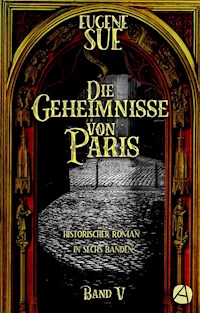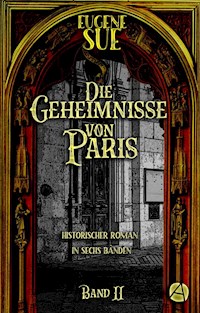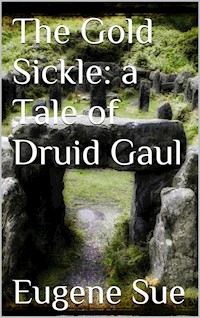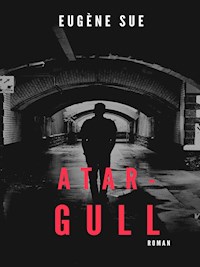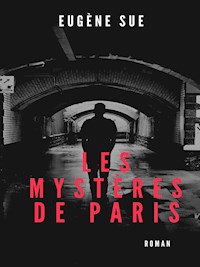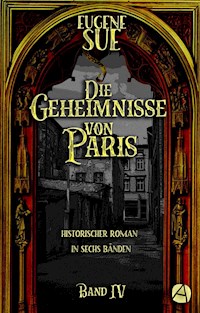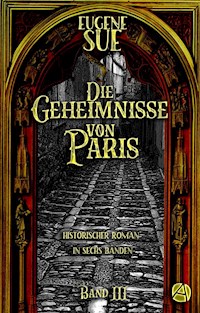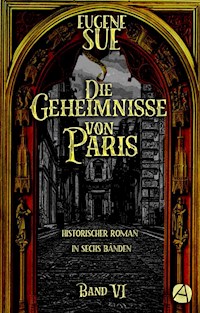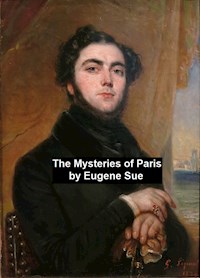Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Martin, abandonné dès son plus jeune âge par son père, un comte autoritaire, dépravé, sans coeur, connaîtra la vie des enfants trouvés de cette époque. Mais grâce à son bon fond, il surmontera sa vie cauchemardesque, et retrouvera son père. Épilogue très moral... Eugène Sue nous expose dans ces quatre volumes sa thèse socialiste, dénonce l'affreuse misère des travailleurs et nous décrit de manière peu flatteuse la classe des nantis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin, l'enfant trouvé
Martin, l'enfant trouvéSEPTIÈME VOLUMEHUITIÈME VOLUMEÉPILOGUE.Page de copyrightMartin, l'enfant trouvé
Eugène Sue
SEPTIÈME VOLUME
CHAPITRE I. LE THÉ.
Je fus accueilli avec beaucoup de bienveillance par la société de Mlle Juliette ; celle-ci me présenta à ses invités en leur disant :
– C’est M. Martin, notre nouveau valet de chambre.
Puis m’indiquant à mesure les personnages qu’elle me nommait, Mlle Juliette ajouta :
– Mlle Isabeau, de chez Mme Wilson.
– J’ai déjà eu le plaisir de voir Mademoiselle ce matin, – dis-je en m’inclinant.
– Mme Lambert, de chez Mme la marquise d’Hervieux, – ajouta Mlle Juliette, en me signalant une jeune femme d’une figure très-agréable, coiffée en cheveux et mise avec goût.
Je me rappelai qu’à dîner, le prince avait annoncé à sa femme qu’il allait à la chasse avec le marquis d’Hervieux. M. d’Hervieux était le mari de cette jeune et charmante femme que j’avais vue sur le perron du Musée, si cruellement exposée aux lazzis effrontés des domestiques.
Mlle Juliette termina sa nomenclature féminine en me disant en souriant :
– Mlle Astarté, de chez Mme la ministre de la justice.
Je saluai Mlle Astarté, dont le nom était si prétentieux ; la physionomie de cette fille me parut impertinente et moqueuse. Astarté avait environ trente-six ans. Elle devait avoir été remarquablement jolie ; ses cheveux étaient beaux et très-noirs, ses dents charmantes, sa taille d’une élégance parfaite ; la plus grande dame n’eût pas été mise avec plus de goût et de simplicité que Mlle Astarté. Elle portait, sur ses cheveux lissés en bandeaux, un charmant bonnet de soirée en tulle garni de petites grappes de fleurs cerises ; sa robe de velours noir était montante, et son pied, cambré et chaussé de satin noir, me rappelait celui de la princesse.
– Nous attendions Mme Gabrielle, la femme de charge du comte Duriveau, – me dit Mlle Juliette, – mais son maître est un si affreux tyran, qu’on ne sait jamais sur quoi compter avec lui.
À ces mots, je me félicitai doublement d’assister à cette soirée.
Le personnel masculin de la société était moins nombreux ; il se réduisait à deux de mes confrères ; Mlle Juliette me les présenta de la sorte :
– Monsieur Benard, homme de confiance de M. Lebouffi, le fameux député ; M. Charles dit Leporello, valet de chambre de M. le baron de Saint-Maurice, le lion des lions, surnommé don Juan.
Il y avait entre les dehors, la mise, la figure de ces deux serviteurs, la même différence qui devait exister entre leurs maîtres. L’homme de confiance de M. Lebouffi, le célèbre député, était un grand homme, de noir vêtu, grave, composé, satisfait de soi, à cheveux gris et rares. Il me rendit mon salut avec une suffisance toute parlementaire.
Leporello (surnom qui me prouvait que l’antichambre n’était pas sans quelque littérature), loin de ressembler du reste au type du valet trembleur de Don Juan, était un jeune et joli garçon, à la figure éveillée, hardie, à la tournure leste, aux manières cavalières ; il portait assez élégamment des habits ayant sans doute appartenu à son maître ; il me parut être la coqueluche de ces dames, et se montrer fort assidu auprès de Mlle Astarté, la reine de la soirée.
– Nous attendions bien encore le beau Fœdor, – me dit Mlle Juliette après cette présentation en formes, – mais il ne faut pas plus compter sur lui que sur Mme Gabrielle, la femme de charge du comte Duriveau.
– Son maître, – dis-je à Juliette, tâchant de me mettre au ton médisant de notre réunion, – son maître est-il donc aussi tyran que le comte Duriveau ?
Ma question fut accueillie par un éclat de rire général. Me voyant un peu déconcerté, l’homme de confiance du député vint officieusement à mon secours, et dit d’un air capable :
– Notre honorable collègue ignorant sans doute quelle est la personne que sert le beau Fœdor, sa question est toute naturelle.
– C’est vrai, c’est vrai, – dirent plusieurs voix.
– Mon cher, – me dit Leporello d’un air dégagé, – le beau Fœdor n’a pas de maître, mais il a une maîtresse… qui est la sienne… Comprenez-vous ?
– Ah !… Leporello ! Leporello ! – s’écrièrent plusieurs voix d’un ton de reproche, – êtes-vous mauvaise langue !
– Dire cela… tout de suite à M. Martin…
– Voyez, vous le confusionnez.
En effet, par un rapprochement stupide, j’avais involontairement songé à Régina… le rouge m’était monté au front, et, malgré mes efforts pour répondre d’une voix assurée à Leporello, je balbutiai :
– En effet… je… ne… je ne comprends pas bien.
– Voilà la chose, mon cher, – reprit Leporello avec un aplomb insolent, – le beau Fœdor est au service de Mme la marquise Corbinelli, il a cinq pieds sept pouces… vingt-cinq ans ; il est frais comme une rose et a de superbes favoris aussi noirs que les cheveux d’Astarté. Maintenant, surmontez-moi ce physique de sa vieille marquise italienne de cinquante ans, qui porte des diamants dans le jour, du rouge comme en carnaval, une perruque brune à raies de chair, et vous comprendrez, mon cher, pourquoi je dis que la maîtresse du beau Fœdor… est la sienne. Ah çà ! vrai ? est-ce que cela vous étonne ?
– Ma foi, oui, ça m’étonne, – repris-je en surmontant mon trouble, – et il me semble que cela doit paraître fort étonnant à tout le monde ! N’est-ce pas, Mesdames ? – ajoutai-je, espérant généraliser la conversation et échapper à l’attention dont j’étais l’objet.
– Étonnant ? mais non… pas si étonnant, – dit Astarté, – ça n’est peut-être pas si commun que de voir des maîtres avoir pour maîtresses nous autres femmes de chambre de leur légitime… mais ça se rencontre… et sans aller plus loin, quand j’étais chez la duchesse de Rullecourt, il y a eu la fameuse histoire de la baronne de Surville avec le grand Laforêt, le piqueur de son mari ; mais il faut dire aussi que la baronne aimait beaucoup la chasse.
– Du reste, – reprit le vieux Louis, valet de chambre du prince de Montbar, – je me suis laissé dire par mon père, qui avait été élevé dans la maison de Soubise, que sous l’ancien régime bien des dames de la cour avaient des valets de chambre coiffeurs, et que les gaillards… enfin… suffit.
– Sous l’ancien régime… je crois bien, – dit l’homme de confiance du député, en gonflant ses joues, – il n’y avait pas de mœurs, c’était le temps du droit du seigneur, du Parc-aux-Bœufs et de l’Œil-de… Cerf, non… du Parc-aux-Cerfs, de l’Œil-de-Bœuf et des talons rouges…
– Bon, – dit Leporello, en riant, – voilà le vieux Benard parti… comme son maître…
– À propos de ça, – dit Benard, – ma belle Astarté, vous pouvez prévenir la femme de votre ministre, que demain son époux n’a qu’à se tenir ferme…
– Comment ça ?
– Monsieur a péroré et gesticulé aujourd’hui pendant plus de deux heures dans le cabinet de toilette de Madame, devant sa psyché.
– Ah, la bonne farce ! – dit Astarté.
– Une vraie comédie – reprit l’homme de confiance de l’homme politique. – Pour figurer la tribune, il avait mis la baignoire de Madame en travers, et il était là à taper sur le couvercle en faisant les grands bras devant la glace comme un imbécile, se lançant à lui-même des regards foudroyants, se montrant le poing, enfin, ayant l’air de se traiter comme le dernier des derniers.
– Il répétait donc sa parade ? – dit Astarté, – la scène qu’il doit faire demain à notre ministre !
– Certainement, – reprit Benard, – d’autant plus qu’il parlait avec son organe de tribune, comme il dit… il a répété plus de vingt fois… et même c’en était embêtant à la fin, car je l’entendais de l’antichambre : C’est sous l’empire d’une émotion soudaine, que j’accours à cette tribune… La France est là… Je veux qu’elle m’entende… Il paraît que c’est surtout les mots : Émotion soudaine qu’il ne pouvait pas arracher au naturel… À la fin… il les a tirés…
– Parole d’honneur, – dit Leporello, – ça serait à payer sa place.
– Et quand il disait : La France est là !… il faisait un grand geste en montrant la porte de la garde-robe de Madame, – ajouta l’homme de confiance de l’homme politique, en partageant l’hilarité que causait ce récit.
– Et dire… – reprit Astarté en riant aux éclats, – que votre maître travaille comme ça pour rien… pour le ridicule… voilà tout… C’est pas comme tant d’autres ; car j’ai entendu dire à mon ministre qu’on trouvait pour mille écus par an… de très-bons petits députés, qui ne parlaient pas encore trop mal…
– Et à ta ministresse, lui rends-tu toujours la vie dure ? – demanda Mlle Juliette à Astarté.
– Tiens, je crois bien ;… ainsi, ce soir, elle ne voulait sortir qu’à dix heures pour aller au bal de l’intérieur. Ah ! bien oui, moi qui voulais être ici à huit, je lui ai dit que j’avais à sortir, et je vous l’ai fait s’habiller en sortant de table, et plus vite que ça… C’était pour en crever, car elle mange comme un ogre… Et maintenant, parée comme une châsse, elle est à attendre devant sa pendule l’heure d’aller au bal… Et quelle toilette ! quel paquet ! comme c’est fagoté !…
– Vous avez donc un talisman, Mademoiselle, – dis-je à Astarté, – pour faire ainsi ce que vous voulez de votre maîtresse ?
– Son talisman – dit Juliette, en riant – c’est qu’elle a été pendant quinze ans première femme de Mme la duchesse de Rullecourt, la beauté la plus à la mode de la Restauration, et que Mme Poliveau, c’est le nom de la ministresse d’Astarté, se trouve si fière, si honorée d’avoir à son service une première femme de chambre de duchesse, qu’Astarté fait tout ce qu’elle veut dans cette maison, où on est trop heureuse de l’avoir.
– Ah ! maintenant je comprends – dis-je à Astarté.
– Voilà tout mon secret – me répondit-elle. – Mais, ces gens-là ! c’est si bourgeois, si bête, si encrassé !… Il n’y a rien à en faire… Du reste, c’est très-drôle : quand il vient une des collègues de ma ministresse la voir, comme qui dirait Mme Galimard, du commerce, ou Mme la ministresse de l’intérieur, dont le grand-père du côté maternel était portier, ma maîtresse me sonne sous prétexte de me donner un ordre, et puis elle dit à demi-voix à ses collègues, en se rengorgeant, et en me montrant du coin de l’œil :
– C’est ma femme de chambre ; elle a été pendant quinze ans chez la fameuse duchesse de Rullecourt, et ma ministresse fait la roue pendant que les autres enragent.
– Oh ! comme c’est ça ! – s’écria Leporello en éclatant de rire. – Je connais un imbécile de maître qui salue toujours son cocher le premier, parce que cet Anglais a servi chez le fameux lord Chesterfield.
– Autre comédie, – reprit Astarté. – Du matin au soir, ma maîtresse est à me dire : Ma chère petite (elle est familière… – dit Astarté en manière de parenthèse avec une incroyable insolence), ma chère petite, comment s’habillait Mme la duchesse ? comment se coiffait Mme la duchesse ? quel linge portait Mme la duchesse ? quels bonnets de nuit portait Mme la duchesse ?… Je crois, Dieu me pardonne ! qu’un jour elle me demandera comment Mme la duchesse…
Un éclat de rire général interrompit à propos la verve d’Astarté, qui reprit :
– Et le ministre donc ! c’est la même chanson sur un autre air. Comme ce bourgeois est aussi vaniteux qu’ignorant du savoir-vivre, il est toujours à me dire : – Ma bonne (épicier, va ! !) ma bonne, est-ce que ça se faisait comme ça chez M. le duc ?… Ma bonne, comment s’habillait M. le duc, le soir ? Ma bonne, comment servait-on à table chez M. le duc ?
– Vous ne nous dites pas tout, belle Astarté, – dit galamment l’homme de confiance de l’homme politique. – Je suis sûr que votre ministre vous a dit : Ma bonne, est-ce que M. le duc ne vous faisait pas la cour ?
– Il n’y a pas de doute, – reprit Astarté ; – il a un jour voulu batifoler, et m’a dit : Ma bonne, je suis sûr que M. le duc vous trouvait charmante, et qu’il vous le prouvait.
– Non, Monsieur, – ai-je répondu à ce gros homme, – car, pour le prouver, M. le duc aurait commencé par me meubler un appartement et me donner une centaine de mille francs pour m’établir. – Là-dessus, le ministre est resté coi, a fait hum ! hum ! et s’est esquivé ; pourtant ça aurait été drôle de faire l’éducation d’un ministre de la justice, et de lui apprendre les belles manières ; mais il est si laid, si crasseux, si avare, que je l’ai menacé de tout dire à sa femme s’il insistait, et même s’il n’insistait pas. Aussi, grâce à ma vertu, je fais du ménage ce que je veux, je donne des places de garçons de bureau et d’huissiers comme s’il en pleuvait. Qui est-ce qui en veut ?
– Ma foi ! ça n’est pas de refus dans l’occasion pour un intime, – dit Leporello.
– J’avais même une de mes amies qui servait une femme dont le mari était sous-chef dans nos bureaux, je l’ai fait nommer chef par une injustice atroce… Et voilà !
– Je réclame ta protection pour le frère d’une de mes camarades, – dit la femme de chambre de la marquise d’Hervieux. – Je te reparlerai de cela, Astarté.
– Tu n’as qu’à demander… je n’aurai qu’à dire à mon ministre : – M. le duc, qui était gentilhomme de la chambre de Charles X, n’aurait jamais refusé une grâce à quelqu’un de sa maison. Je vous dis qu’il n’y a rien de plus orgueilleux que ces parvenus.
– Et quand je pense, – reprit notre maître d’hôtel, – que j’avais un cousin, brave et digne garçon, commis-marchand de son état, qui, avant la révolution de juillet, était d’une société secrète, où l’on jurait sur des poignards haine aux rois, aux nobles et aux prêtres… et qu’il a vu cent fois votre ministre, Astarté, qui était alors M. Poliveau tout court, jurer et rejurer, comme un enragé, haine aux rois, aux nobles et aux prêtres !
– C’est donc pour ça, – reprit Astarté, – qu’il est à plat-ventre devant la moindre robe noire, et qu’hier encore il me disait en roulant des yeux : – Ma bonne, M. le duc allait tous les dimanches à la messe, n’est-ce pas ? – Oui, Monsieur, il allait à la messe, mais il faisait tous les ans pour 25,000 fr. d’aumônes dans ses terres. – À cela le crasseux bourgeois a encore fait hum ! hum ! et a rentré sa grosse tête dans ses épaules rondes comme un colimaçon borgne dans sa coquille.
Cet entretien fut interrompu par l’arrivée de notre cuisinier : ce personnage fit une entrée magistrale, suivi de son aide de cuisine, portant sur un plateau cinq ou six assiettes de petits gâteaux sortant du four. L’assemblée accueillit cette galanterie culinaire avec une faveur marquée. Les gâteaux furent placés sur une table, à côté d’un service de thé en fort jolie porcelaine anglaise ; l’aide de cuisine, soumis aux lois de la hiérarchie, sortit en jetant un regard de convoitise sur les gâteaux et sur les invitées de Mlle Juliette.
– Je vous demande pardon. Messieurs et Mesdames, – dit le cuisinier, – de me présenter en uniforme, – et il montra sa veste blanche et son bonnet de coton ; il était resté fidèle, disait-il, à ce bonnet traditionnel et classique, méprisant la toque de percaline blanche des novateurs, des romantiques, – disait-il.
– Vous excuserez donc la tenue d’un soldat qui sort du feu… – ajouta-t-il.
– Voilà votre meilleure excuse, Monsieur le chef, – dit gracieusement Astarté, en montrant les petits gâteaux élégamment montés sur les assiettes.
– Je crois, en effet, que les dames la goûteront, mon excuse, – riposta le cuisinier ; – je vous recommande… vanité à part… ces bergères à la crème, piquées aux fraises ; c’est un entremets de primeur. Le grand Carême, sous les ordres duquel j’avais l’honneur de servir au congrès de Vienne, les avait inaugurées sur la table de S. E. M. l’ambassadeur de France… la veille de ce fatal dîner…
– Voyons, chef, en faveur de M. Martin, qui ne connaît pas l’histoire, – dit Juliette en riant, – nous l’écouterons encore une fois.
– Quelle histoire ? – dit Leporello.
– Ça fait deux qui ne la connaissent pas, – reprit Astarté en riant ; – allez, Monsieur le chef, allez de confiance.
– J’ai le plus grand désir pour ma part d’entendre ce récit, – lui dis-je.
– Si je reviens si souvent sur cette histoire, – reprit le cuisinier d’un ton pénétré, – c’est pour protester toujours, protester sans cesse contre une lâcheté, une trahison dont je maintiens un cuisinier français absolument incapable.
– Diable, c’est grave, – dit Leporello.
– Il y allait de notre honneur, Monsieur ! – s’écria ce cuisinier formaliste qui savait, d’ailleurs, parfaitement son monde ; – en deux mots voici le fait. Nous étions à Vienne, j’avais l’honneur de servir sous les ordres du grand Carême, chez M. l’ambassadeur de France ; MM. les membres du corps diplomatique dînaient alternativement les uns chez les autres ; ils avaient la bonté d’appeler cela dîner en France, en Angleterre, en Russie, etc., etc. ; et vous concevez quelle rivalité existait entre MM. les chefs de cuisine… La veille de la signature des traités, on dînait chez Mgr le prince de Metternich : c’était conséquemment la séance, c’est-à-dire le dîner le plus important du congrès… si important que Mgr le prince de Metternich avait daigné corriger le menu de sa main, et ajouter au bas : traiter ce dîner comme un dîner de têtes couronnées… J’ai vu l’autographe… j’en ai une copie dans mes papiers.
– Cela devient très-intéressant, – dis-je au cuisinier, – on dirait qu’il s’agit d’une affaire d’État.
– Il s’agissait d’une affaire d’Europe, Monsieur !… – s’écria le cuisinier diplomatique, – et vous allez voir pourquoi : il y avait eu jusqu’alors, comme je vous l’ai dit, une rivalité terrible entre MM. les chefs de cuisine de MM. les ambassadeurs, mais une rivalité loyale… Malheureusement cette loyauté eut son terme ; le jour de ce dîner solennel… un lâche, un infâme, au lieu de combattre à ciel… ou plutôt à fourneau découvert, soudoie à prix d’or un des aides du chef des cuisines de Mgr le prince de Metternich… je ne sais quelle abominable drogue fut mélangée à la plupart des mets de ce dîner royal… traité avec tant d’amour, tant de respect par le chef des cuisines du prince… et…
– Oh ! oh !… je devine la chose, – dit Leporello en riant.
– On n’était pas au dessert, – s’écria le cuisinier dans son indignation généreuse contre un si indigne procédé, – que déjà plusieurs de MM. les membres du corps diplomatique ressentant de graves incommodités, étaient obligés de quitter la table… Quelques légères indispositions s’ensuivirent, la signature des traités fut reculée de plusieurs jours… et Dieu sait les intrigues qui se croisèrent pendant ces trois jours ! – ajouta le cuisinier d’un ton mystérieux et diplomatique.
– Le fait est que c’était faire aller un peu drôlement la diplomatie, – dit Leporello.
– Le pis de l’affaire… – ajouta tristement le cuisinier, – c’est que l’auteur de cette infamie n’ayant jamais été connu, les soupçons ont tour à tour plané sur l’Angleterre, sur la Russie, sur la France ! !… Sur la France… oh ! jamais, je proteste… je protesterai toujours… si je me permettais d’accuser quelqu’un, j’accuserais la Prusse, car son chef de cuisine était un malheureux fouille-au-pot… digne à peine de fricoter… c’est le mot, pour un de vos ministres. Mademoiselle Astarté.
– Je crois bien… dîner de ministre, c’est tout dire, – reprit Astarté.
– Sauf un… – reprit le cuisinier, – car il faut être juste… S. E. Mgr le comte M*** a été le seul ministre, lorsqu’il avait l’honneur de diriger les affaires étrangères, chez qui on ait jamais mangé un dîner de cinquante couverts chaud à point et exquis ; mais cela s’explique, M. le comte M*** est un grand seigneur qui a conservé les bonnes traditions. Du reste, après les dîners de ministre, ce que j’ai vu de plus atroce… ce sont les dîners de famille d’un Américain colossalement riche, chez qui je me suis fourvoyé pendant trois mois… gigot aux haricots, pièce de bœuf aux choux, flan aux pommes de terre, tel était le menu de tous les jours… mais six fois par mois des dîners… oh ! des dîners dignes du grand Carême… il est vrai que le lendemain on vendait la desserte aux restaurateurs de moyen ordre… Ces extrêmes n’allaient pas à ma manière de travailler, et j’ai déserté… Il y a, du reste, beaucoup de maisons pareilles… – ajouta philosophiquement le cuisinier, – tout pour paraître… rien pour être…
– C’est comme beaucoup de nos élégants, – reprit Leporello, – je dis élégants, – ajouta-t-il avec suffisance, – parce qu’il n’y a plus que les femmes de notaire ou de ministre qui disent lions, ces gaillards-là ont un compte de cent francs chez la lingère et de deux mille chez le tailleur… je ne dis pas ça pour mon maître, car après M. le maréchal S***, mon maître est le plus grand homme de linge qui existe ; à propos de mon maître, je vous dirai que je lui ai tout bonnement sauvé la vie ce matin… car, sans moi, demain il se battait à mort avec M. de Blinval… et il était tué… aussi vrai que vous avez les plus beaux yeux du monde, Astarté…
– Ah ! mon Dieu ! contez-nous donc ça, Leporello, – dit Juliette.
– Ah çà !… c’est bien entre nous… comme toujours ? – dit Leporello, avant de commencer son récit, et se posant carrément devant la cheminée, les deux pouces passés dans les entournures d’un gilet flamboyant, – c’est tout-à-fait entre nous ?…
– Parbleu ! – lui fut-il répondu tout d’une voix.
– Mon maître, – reprit Leporello, – est, comme vous savez, l’amant de Mmes de Beaupréau et de Blinval, mais plus communément de Mme de Blinval…
– Tiens, de Mme de Beaupréau aussi ? – dit la femme de chambre de la marquise d’Hervieux, – c’est donc du fruit nouveau ?
– Du 17 novembre, dans l’après-midi, – répondit Leporello. – J’ai été faire du feu le matin de ce jour-là dans un second petit appartement que mon maître a été obligé de louer à cause de l’augmentation de sa clientèle ; mais pour en revenir à M. de Blinval, il est nécessairement l’ami intime de mon maître, vu que mon maître est l’amant de sa femme.
– Ce n’est pas comme chez nous, – dit la femme de chambre de la marquise d’Hervieux, cette charmante jeune femme blonde que j’avais remarquée sur le perron du musée, – M. le marquis ne peut pas souffrir M. de Bellerive.
– À propos de ta maîtresse, – dit Juliette à sa compagne, – quand Leporello aura fini son histoire, fais-moi penser à te dire quelque chose qui lui fera plaisir…
– Bon… continuez, Leporello.
– Ce matin donc j’avais quitté l’appartement de mon maître pour aller donner un ordre à l’écurie ; le frotteur était resté en haut pendant mon absence. M. de Blinval arrive, on lui ouvre et il entre chez mon maître ; je rentre, l’imbécile de frotteur ne me dit rien, et voilà qu’au bout de dix minutes arrive un commissionnaire avec une lettre de Mme de Blinval. C’est très-pressé, me dit le commissionnaire, il faut tout de suite une réponse. Ne me doutant pas le moins du monde que M. de Blinval fût là, j’entre avec la lettre et je vois le mari fumant tranquillement son cigare avec mon maître, et riant comme un… bossu.
– Ah ! mon Dieu !
– Comment vous êtes-vous tiré de là, Leporello ? – s’écrièrent les femmes avec intérêt.
– Mais pas trop mal… – dit Leporello avec fatuité, – pas trop mal… mon maître, me voyant entrer avec la lettre sur mon plateau, tend la main pour la prendre, en me disant : – De qui est cette lettre ? – Le mari était si près, qu’il devait nécessairement reconnaître l’écriture… très-reconnaissable… des jambages longs de ça…
– Mais achevez donc, Leporello ; comme vous nous faites languir ! moi, je suis toute saisie, – dit Juliette.
– Donner un faux nom… ne m’avançait à rien, – reprit Leporello, – la diable d’écriture était toujours là.
– Mais achevez donc, au nom du ciel.
– Reculant alors le plateau hors de la portée de mon maître, et conséquemment hors de la vue du mari, je dis à mon maître en riant : – je ne peux pas donner cette lettre à M. le baron… devant M. le vicomte. – Pourquoi cela ? – me dit mon maître tout bêtement. – Parce que M. le vicomte connaît l’écriture de cette lettre, – ai-je répondu en souriant. – Voyez-vous ce drôle de Leporello ? quel aplomb de Frontin ! – dit le mari en riant aux éclats, tandis que mon maître, averti par un coup d’œil de moi, se lève, prend la lettre et la met dans sa poche, après l’avoir vite parcourue.
– Bravo ! Leporello, – fut-il crié tout d’une voix.
– Pendant le temps que mon maître lisait, – reprit-il, – le mari disait en levant le nez en l’air et en se frottant les jambes devant le feu : – Voyons… je connais l’écriture ?… De qui diable ça peut-il être ? – Puis tout-à-coup il s’écrie : – Je parie que c’est une lettre de Fifine ?… – Fifine est un rat de l’Opéra, drôle de petit corps, qui est un peu la maîtresse de tous ces Messieurs du club. – Tu devines tout ! Blinval ! on ne peut rien te cacher – répondit mon pauvre maître, dont le front était couvert de gouttes de sueur. – Eh bien ! – ajouta Leporello, – avouez que, sans mon aplomb, et j’ose dire sans mon intelligence, il arrivait de beaux malheurs, car M. de Blinval est brave comme un lion ; il tire le pistolet comme un dieu, et demain mon maître était mort… si le mari avait vu cette lettre ; ce qui n’empêche pas qu’on dit de nous : Ces canailles de domestiques !
– Ça me rappelle un admirable trait de sang-froid du dernier amant de la duchesse de Rullecourt, – dit Astarté, – et vous pourrez donner, dans l’occasion, la recette à votre maître, Leporello… Cet amant reçoit une lettre de la duchesse dans des circonstances absolument pareilles… sauf qu’il n’avait pas un intelligent Leporello pour le servir… L’imbécile de valet de chambre apporte donc la lettre de la duchesse. – Tiens… – dit le duc à l’amant – une lettre de ma femme ? Elle t’écrit donc ? – L’amant ne répond rien, lit la lettre avec un sang-froid superbe, et répond ensuite au duc : – Que le diable l’emporte, va ! ta femme ! – Comment ! – Tiens, tu feras la commission. – Et l’amant prend sur sa cheminée deux louis qu’il donne au mari. – Pourquoi ces deux louis ? – dit celui-ci. – Eh pardieu, pour une de ces insupportables quêtes dont toutes les dames patronnesses nous poursuivent, et ta femme ne m’a pas manqué. – Ce disant, l’amant jette la lettre au feu…
– Bravo…
– C’est très-fort, – dirent plusieurs voix.
CHAPITRE II. LE THÉ. (Suite.)
Plus j’entrais avant dans le milieu de ma condition, plus j’appréciais la justesse de la réflexion de Leporello. Évidemment, la plupart des invités de Mlle Juliette possédaient des secrets effrayants pour le repos et l’honneur de bien des familles. Cette pensée fut justifiée presque aussitôt par Mme Lambert, femme de chambre de la marquise d’Hervieux.
– Leporello a bien raison, – dit-elle ; – le plus souvent les maîtres nous traitent mal, et pourtant bien des fois il ne tiendrait qu’à nous de mettre le feu dans je ne sais combien de ménages, de causer des séparations, des procès, des duels à mort…
– C’est pourtant vrai, – dirent plusieurs voix.
– Pour ma part, – reprit Mme Lambert, – je connais quelqu’un qui pourrait faire aller… au criminel et même je crois aux galères, c’est comme je vous le dis, un des personnages les plus huppés de ce temps-ci… et sa femme aussi, qui est toute la journée dans les églises, et qui fait sa grande dame.
– Ah bah ! dirent plusieurs voix avec surprise.
– Et de plus, – poursuivit Mme Lambert, – ruiner complètement le ménage qui est encore plus avare qu’hypocrite, et qui a plus de trois cent mille livres de rentes.
– Dis donc comment ?
– Il fallait pour que le ménage dont je vous parle, héritât d’un oncle immensément riche, que la femme eût un enfant. Voyant qu’elle ne pouvait pas parvenir à être grosse, elle est convenue, d’accord avec son mari, de simuler une grossesse. Il a bien fallu que ma maîtresse, car après tout, c’est de moi que je parle, il a bien fallu que ma maîtresse me mît dans la confidence, moi, sa femme de chambre. Je me suis occupé de trouver une femme grosse, je l’ai logée dans une maison isolée. Ça se passait à la campagne ; ma maîtresse a feint d’être en mal d’enfant dès que l’autre femme a été sur le point d’accoucher ; et c’est moi qui ai reçu l’enfant… un beau garçon, ma foi… Je l’ai apporté dans un carton à chapeau, et quand une bête de sage-femme de campagne, qu’on est allé exprès chercher trop tard, est arrivée, elle a trouvé un gros poupon criant comme un brûlé pour téter la nourrice dont on s’était précautionné.
– En voilà des roués ! – dit Leporello.
– Eh bien ! – reprit Mme Lambert, – vous me croirez si vous voulez, on m’a renvoyée de la maison pour cause… de moralité, parce qu’on avait surpris le cocher dans ma chambre ; ça m’a outrée… J’ai menacé ma maîtresse ; je lui ai dit que je pouvais parler sur bien des choses… Savez-vous ce qu’elle m’a répondu ?
– Quoi donc ?
– Parlez si vous voulez, ma chère,… les complices sont autant punis que les coupables.
– La coquine ! – dit Astarté.
– Et ça ne quitte pas les églises ! – reprit Juliette.
– Elle avait raison, – reprit Mme Lambert ; – je la perdais et moi aussi. Après cela, je me fais plus méchante que je n’en ai l’air ; j’aurais pu me venger sans me perdre, que je ne l’aurais pas fait… Mais à propos, – reprit la femme de chambre de la marquise d’Hervieux, en s’adressant à Juliette, – tu m’avais dit que tu savais quelque chose qui ferait plaisir à ma maîtresse.
– Elle le sait peut-être déjà ; mais enfin voilà ce que c’est : Le prince part cette nuit pour Fontainebleau ; il va chasser cinq ou six jours avec le mari de ta maîtresse.
– Cet homme-là est-il sournois ! – s’écria Mme Lambert, – on n’en savait rien ce soir chez nous ; mais il n’en fait jamais d’autres. Quand le marquis s’en va, il ne veut qu’on soit content qu’au dernier moment. Ah ! pour çà oui, Madame va être contente. Pendant cette absence-là, voilà sa vie de presque tous les jours : Le matin son bain, après ça son déjeuner, et puis vite un petit fiacre, et en voilà pour jusqu’à six heures, où elle rentrera à l’hôtel pour dîner ; après dîner elle écrira une lettre de huit pages, que je porterai le lendemain matin (M. de Surville y répondra par un billet de deux lignes), et, la lettre écrite, elle s’habillera pour aller dans le monde revoir son trésor. Ses plus jolies, ses plus fraîches toilettes sont pour ce soir-là.
– Je les croyais brouillés ? – dit Juliette.
– Oui, pendant six mois, cette pauvre Madame… (elle est si bonne !) a manqué d’en mourir ; elle se fanait que c’était pitié… mais, maintenant, elle est redevenue charmante, son amant lui va si bien !
– C’est bien fait, – dit Astarté, – un mari si bête !…
– Et si sale ! – dit Mme Lambert. – Nous voyons cela, nous autres… Tenez, si le monde savait ce que nous savons, on excuserait les trois quarts des femmes qui ont des amants.
– Je les excuse toujours, moi d’abord, – dit Astarté, – ce sont les meilleures maîtresses à servir… ça vous les rend d’une douceur… d’un onctueux !… Et chez vous, Isabeau, y a-t-il du nouveau ?
– Oh ! chez nous, – reprit la femme de chambre de Mme Wilson, – on est toujours gaie, toujours folle ; on dit bonjour et bonsoir au père Wilson, qui ne met pas le nez hors de ses bureaux… et on adore un ange de petite fille… voilà tout.
– C’est drôle, – dit Astarté.
– Le fait est, – reprit Leporello, – que je n’ai jamais entendu rien dire sur Mme Wilson chez mon maître ; et Dieu sait comment on y habille les femmes du monde.
– C’est peut-être aussi parce que ces Messieurs en déshabillent beaucoup, – dit Astarté.
– Bravo ! – fit Leporello.
– Et ici ? – dit Astarté en interrogeant du regard la femme de chambre de Régina.
J’éprouvais une angoisse singulière en attendant la réponse de Juliette, qui dit tout-à-coup :
– Tiens, où est donc le père Louis ?
C’était le vieux valet de chambre du prince ; tous les yeux se tournèrent vers la place que cet ancien serviteur avait occupée ; il avait discrètement disparu, sans que l’on eût remarqué son départ.
– Il aura filé, bien sûr, – reprit Juliette, – quand il a vu la soirée tourner aux cancans ; il les déteste… Après tout, tant mieux, il est gênant, et puis on n’en peut rien tirer de lui… sur notre maître.
Je fus en effet frappé de la discrétion de ce domestique, le seul qui fût sans doute dans le secret des excursions nocturnes du prince de Montbar ; je me demandai par quel prodige d’adresse il avait pu cacher jusqu’alors aux autres domestiques de la maison les absences de son maître qui, je l’ai su depuis, se renouvelaient assez fréquemment.
– Vous avez raison, Juliette, – reprit la femme de chambre de Mme Wilson, – le vieux Louis nous aurait gênées… Eh bien ! je vous disais ; et ici, depuis que la princesse court les bals et les fêtes avec ma maîtresse…
– Voilà tout ? rien de nouveau ? – dit Astarté.
– Ma foi non ; Madame reçoit le matin la fleur des pois des élégants, comme dit Leporello ; elle fait toujours de superbes toilettes ; on lui envoie des bouquets sans nom, comme ce soir, et elle porte de préférence celui de sa fleuriste. Je n’en sais ni plus ni moins. Après cela, si les femmes de chambre, pour bien des raisons… savent souvent la fin des choses, elles en ignorent les commencements… ça regarde les valets de chambre. Dam ! ils annoncent les visites, ils peuvent donc remarquer celles qui sont plus ou moins longues,… selon que Madame est seule ou avec du monde,… ils peuvent encore observer la figure triste ou gaie que les assidus font en sortant,… s’ils sont rouges ou s’ils sont pâles, et surtout si, ayant leurs gants en entrant, ils les ont encore en sortant… C’est très-important… J’ai entendu dire au vieux Lapierre, qui avait été long-temps chez la fameuse princesse Romanof, que presque toujours on se dégantait chez elle au cinquième ou sixième tête-à-tête.
– C’est très-vrai d’observation, – dit Astarté. – Allez donc prendre la main d’une femme avec des gants.
– Aussi, – ajouta Juliette, – quant au nouveau qu’il pourrait y avoir ici, je vous dirais : adressez-vous à M. Martin que voilà, mais il n’est valet de chambre de Madame que d’aujourd’hui.
– Ma foi, Mademoiselle, – dis-je à Juliette, – je vous assure qu’il faudrait que les choses me crèvent les yeux ; je ne suis pas fort pour l’observation.
– Bah ! bah ! – me dit Juliette en riant, – on voit ça malgré soi. Honoré, qui était ici avant vous, M. Martin, n’était pas malin, ça n’empêche pas qu’il avait remarqué que M. le capitaine Just… ce beau grand jeune homme, était venu trois fois à l’heure où Madame ne reçoit habituellement personne.
– Ah ! ah ! voyez-vous ça, – dit Astarté en éclatant de rire, – et vous nous disiez, Juliette, qu’il n’y avait rien de nouveau ici.
– Je suis de l’avis de Mlle Juliette, – dis-je à Astarté, – il y a peu de temps que M. le capitaine Just a perdu son père qui était l’ami de Madame, et elle disait au prince aujourd’hui même à dîner, que le capitaine Just était encore si triste qu’il craignait de rencontrer du monde chez elle ; voilà sans doute pourquoi Madame le reçoit à une heure différente de ses autres visites.
– C’est égal, – dit en riant Astarté, – il n’y a rien de plus traître que les beaux grands garçons mélancoliques ; je vous recommande ce jeune homme-là, Monsieur Martin, et lorsque vous me ferez le plaisir de venir prendre une tasse de thé au ministère de la justice, vous aurez aussi votre petit cancan à faire ; écoutez donc, chacun son écot.
– Et ce sont nos maîtres qui paient, – dis-je en riant à Astarté, afin de cacher la pénible émotion que me causaient ces malignes remarques.
– Après ça, – reprit Astarté, – c’est, vous le voyez, en tout bien, tout honneur. Entre nous, tout se dit, mais rien ne se sait au dehors. Tous, tant que nous sommes ici, nous pourrions être des domestiques terribles, comme dirait M. Gavarni… Eh bien ! je suis sûre que parmi nous personne n’a à se reprocher d’avoir abusé d’un secret contre un maître.
– C’est vrai, – dit l’homme de confiance du député… – Pourtant… si l’on voulait !
– Ah bah ! – dit Leporello, en éclatant de rire, – votre crâne de député a donc des fâmes… vous pourriez donc le livrer à une foule de maris furieux.
– Non, farceur… mais à la rage de ses électeurs, qui sont aussi venimeux… que des maris. Tenez, ce matin, j’annonce à Monsieur le plus fort d’entre ses électeurs, le bélier du troupeau, comme dit mon maître, il l’appelle toujours comme ça avec Madame… le bélier ; en apprenant donc que le bélier était là : – Que le diable vous emporte ! – me dit mon maître en fureur, – je vous ai dit que je ne recevais jamais ces gens-là qu’une fois sur cinq ; mon Dieu ! que c’est assommant !… Allons, puisque vous avez dit que j’y étais, faites entrer ; – et une fois que le bélier est entré, il fallait voir les poignées de main, et entendre les : comme vous êtes rare, mon cher Monsieur ! on ne vous voit jamais ! etc., ce qui n’a pas empêché Monsieur de me dire, une fois que le bélier a eu les talons tournés : – Si vous avez le malheur de recevoir ce Monsieur-là avant quinze jours d’ici… je vous laisse avec lui… et vrai, ça m’a fait peur… seul avec le bélier ! !
– Ah ! fameux, le bélier ! – s’écria Leporello en éclatant de rire. – Fameux ! le mot restera ! ça me rappelle qu’il y a un an je cherchais un petit appartement pour les rendez-vous de mon maître ; j’entre dans une maison superbe… trop superbe pour la chose ; c’est égal, je parle au portier.
– Avant tout, mon garçon, – me dit cet animal de loge, je dois vous prévenir que le propriétaire tient à ce que sa maison soit parfaitement propre. – Après. – Votre maître a-t-il des chiens ? – Non. – Des enfants ? – Il en fait, mais il n’en a pas, vu qu’il y en a qui en ont et qui n’en font pas. – Est-il député ? – Non plus ; mais pourquoi, diable ! cette question ? – dis-je au portier. – Parce que nous avons logé un député au cinquième, – me répond le cerbère, – et en deux mois ses gredins d’électeurs limousins ont fait une telle procession avec leurs souliers crottés, qu’ils nous ont perdu l’escalier ; c’était une boue comme dans la rue.
La gaieté causée par le récit de Leporello fut interrompue par l’arrivée de Mme Gabrielle, femme de charge du comte Duriveau.
La venue de cette femme excita au plus haut degré mon inquiétude et mon attention. Ses moindres paroles, sa physionomie, furent pour moi l’objet d’un examen pénétrant.
– Ah ! bonsoir, ma chère ; comme vous venez tard ! – lui dit Juliette. – Les gâteaux sont tout froids, et le thé aussi.
– Je suis encore bien heureuse d’avoir pu venir, allez ! ! – répondit cette femme assez âgée, grande, forte, à la figure virile, – je n’y comptais plus… Monsieur est un si fameux tyran ! !
– C’est ce que je disais à ces dames, – reprit Juliette, – mais par quel heureux hasard avez-vous pu vous échapper ?
– Hasard est le mot, un vrai hasard : Figurez-vous que, depuis quelques jours, – reprit la femme de charge du comte Duriveau, – Monsieur était d’une humeur de dogue, à-peu-près comme à son ordinaire ; il a par là-dessus la manie, vous le savez, de ne pas vouloir souffrir qu’on mette le pied hors de l’hôtel sans lui en demander la permission, toujours pour la chose d’exercer sa tyrannie…
– Quel homme !… quel homme ! – dit Astarté.
– Quant à ça, Juliette, – dit la femme de charge du comte Duriveau, – votre maîtresse peut brûler une fière chandelle à je ne sais quel saint, de n’avoir pas épousé mon maître…
– Je crois bien, on dit qu’elle ne pouvait pas le voir, – reprit Juliette, – et, depuis le mariage de Madame, il n’a pas mis les pieds ici.
– Et il enrage, j’en suis sûre. Enfin pour en revenir à mon affaire, je lui demande donc ce matin à sortir ce soir : – Non ! – me répondit-il durement, et avec une figure… une figure noire comme de l’enfer. Bien obligé, que je me dis, et je remonte chez moi quatre à quatre ; car, avec lui, non, c’est non. Ce soir, après dîner, comme il allait chez son fils, il me rencontre dans l’escalier… ce n’était plus le même homme, il était rayonnant, je ne lui ai jamais vu qu’une fois l’air aussi gai, c’était le lendemain du duel où il avait cassé la cuisse à ce pauvre marquis de Saint-Hilaire, qui en est mort.
– Ah ! oui… un duel dans le parc du marquis, – dit Astarté. – J’ai entendu parler de cela dans le temps… M. Duriveau était alors l’amant de la marquise.
– Justement, – dit la femme de charge, – ça se passait à la campagne chez le marquis. Celui-ci les a surpris. Ils se sont battus, et Monsieur, qui met à soixante pas une balle dans une carte, lui a flanqué son affaire, à ce pauvre marquis. Finalement, ce soir, Monsieur avait la même figure de jubilation que le lendemain de ce duel-là, il avait l’air d’être d’une joie… d’une joie atroce… Quoi !… – Vous m’avez demandé à sortir et je vous ai refusé, ma chère Madame Gabrielle, – m’a-t-il dit. – Oui, Monsieur le comte, – Eh bien ! sortez si vous voulez, je suis content, je veux qu’on soit content, – et il a continué de monter l’escalier.
– Et qu’est-ce qui pouvait donc le rendre si content ? – demanda Juliette.
– C’est ce que je me suis dit, – reprit Mme Gabrielle. – Il y a donc du nouveau, dans Landerneau ; il faut que je tâche de le savoir, ça fera mon écot pour le thé de chez Juliette ; je cours dare dare chez le valet de chambre de Monsieur, nous sommes très-bien ensemble parce que je lui fournis du linge de l’hôtel pour sa famille qui loge dehors. – Eh bien ! Balard, que je lui dis. – Qu’est-ce qu’il y a donc ? Monsieur avait tantôt l’air méchant comme un diable, et ce soir, il est gai comme un chat-huant qui va croquer une souris ? – Je ne sais pas, – me répond Balard. – Il avait l’air aussi fou de joie à dîner. – Mais à propos de quoi cette joie-là ? – Je n’en sais rien de rien… parole d’honneur. – Voyons, Balard, entre amis ? – Je vous jure, ma chère, que tout ce que je sais, c’est qu’au moment où Monsieur allait se mettre à table, un commissionnaire a apporté une lettre, vilain papier, vilaine écriture, et je crois même cachetée avec du pain mâché. Je remets cette lettre à Monsieur ; il la lit et s’écrie : enfin !… d’un air aussi content que si tous ceux qu’il déteste avaient la corde au cou, et qu’il n’ait plus qu’à la tirer ; enfin, après avoir jeté la lettre au feu et l’avoir vue brûler, il s’est mis à marcher ou plutôt à sauter dans sa chambre, en se frottant les mains et le menton, en riant… en riant, mais tout de même d’un drôle de rire… – Et voilà tout ce que vous savez ? – dis-je à Balard. – Voilà tout, ma chère Madame Gabrielle, je vous le jure… par la dernière douzaine de taies d’oreiller en batiste de rebut que vous m’avez délicatement donnée pour mon épouse – m’a répondu Balard. – Il fallait bien le croire… Et voilà, pour ce qui est de chez nous, tout ce que j’ai de plus frais à vous servir… Là-dessus, donnez-moi une tasse de thé avec un peu de rhum, ma petite Juliette, car j’étrangle de soif.
Étrange pressentiment… je fus effrayé de ce que je venais d’apprendre par la femme de charge du comte Duriveau. Je ne sais quel instinct me disait que la joie atroce de cet homme, ainsi qu’avait dit Mme Gabrielle, avait pour cause la réussite de quelque détestable projet ; que peut-être il se voyait sûr de sa vengeance contre Régina. Cette lettre, qui avait causé une joie folle au comte Duriveau ; cette lettre, écrite et cachetée d’une manière si vulgaire, et ensuite soigneusement brûlée par lui… me semblait significative ; ne trahissait-elle pas des relations complètement en dehors des relations habituelles de M. Duriveau ? Et s’il machinait une basse vengeance contre Régina, n’était-ce pas dans quelque milieu ténébreux qu’il devait chercher ses complices, ainsi que l’avait redouté le docteur Clément ?… Enfin, l’espérance ou même la certitude d’une vengeance éloignée, n’eût pas causé une joie si vive à M. Duriveau. Sans doute, il croyait toucher au but qu’il poursuivait depuis long-temps ; mais si mon pressentiment ne me trompait pas, ce but, quel était-il ? cette vengeance, où et comment devait-elle s’accomplir ?
Prévenir directement la princesse de se tenir sur ses gardes m’était impossible ; ma position envers Régina m’imposait la réserve la plus absolue ; je compromettais tout en laissant voir à la princesse l’intérêt extraordinaire, inexplicable pour elle, que je portais à tout ce qui la touchait… Sa défiance s’éveillait alors, et la moindre imprudence me faisait à l’instant chasser de la maison. J’aurais pu lui écrire d’être en défiance, mais contre quoi ? et puis quelle créance accorderait-elle à un écrit anonyme, alors qu’elle n’avait tenu compte des vives appréhensions du docteur Clément, se plaisant, au contraire, – disait-elle, – à braver les ressentiments de M. Duriveau. Si j’avais eu quelque renseignement positif, précis, j’aurais pu à la rigueur, et dans une si grave conjoncture, écrire anonymement au prince, le défenseur naturel de sa femme, mais il était malheureusement parti dans la soirée pour Fontainebleau.
Ces pensées m’effrayèrent tellement, qu’un moment je voulus croire à la vanité de mes craintes, et je continuai d’écouter attentivement, sans avoir le courage d’y prendre part, l’entretien des invités de Mlle Juliette, tâchant de pénétrer si la femme de chambre du comte Duriveau n’était pas envoyée par lui, enfin si les récriminations de cette femme au sujet de la dureté de son maître n’étaient pas une feinte adroite ; malgré mon attention, il me fut impossible de rien découvrir à ce sujet. Les invités de Mlle Juliette quittèrent l’hôtel vers les une heure du matin sans que le beau Fœdor, l’amant de la marquise italienne, eût paru.
La princesse m’avait ordonné d’attendre son retour. Je venais de descendre à son appartement, d’aviver le feu de son parloir, et d’allumer ses bougies, lorsque le bruit d’une voiture entrant dans la cour m’annonça le retour de Régina. Lorsque je lui ouvris la porte de l’antichambre, je fus saisi de l’expression de sa physionomie.
J’avais vu la princesse partir avec Mme Wilson, riante, la joue animée, l’œil brillant, le front superbe ; je la voyais rentrer morne, pâle, la fatigue et l’ennui peints sur tous les traits…
Le docteur Clément ne se trompait donc pas ? Cette ardeur de plaisir, qui entraînait la princesse au milieu des fêtes, était donc véritablement factice ? En présence de Mme Wilson, comme en présence du monde, Régina avait donc, ainsi qu’on le dit vulgairement : Fait la brave. Et à cette heure que, rentrant chez elle, il lui était inutile de feindre, elle retombait dans son douloureux abattement… ou bien avait-elle déjà été atteinte par la vengeance du comte Duriveau ?
Ces pensées me vinrent si rapides, qu’elles s’étaient présentées à mon esprit pendant le temps que mit Régina à gagner son parloir. Après avoir jeté son manteau sur un fauteuil, elle me dit :
– Vous n’oublierez pas, ainsi que je vous l’ai recommandé, d’aller demain matin, à huit heures, vous informer des nouvelles de mon père…
– Je ne l’oublierai pas. Madame la princesse.
Régina ne me donnant pas d’autre ordre, je m’éloignai ; elle me rappela et me dit :
– Comme vous ne serez peut-être pas revenu à l’heure où je voudrai sortir, vous recommanderez à la porte que l’on me fasse avancer un fiacre pour huit heures et demie…
– Alors, Madame la princesse ira chez la femme Lallemand ? – dis-je à Régina.
Elle était debout devant la cheminée, lorsque je lui fis cette question ; elle se retourna vers moi d’un air à la fois si étonné, si altier, que je compris l’indiscrète familiarité de ma demande ; je baissai les yeux tout interdit. Probablement la princesse s’aperçut de ma confusion, car elle me dit avec bonté :
– N’oubliez pas d’aller chez mon père ; à votre retour, vous vous occuperez de soigner cet appartement et mes fleurs, ainsi que je vous l’ai dit ce matin.
Je sortis après avoir laissé retomber la portière du parloir.
Je restai involontairement une seconde à peine, ce temps me suffit pour entendre Régina, tombant dans un fauteuil, s’écrier avec un accent de lassitude, d’ennui, de douleur inexprimable :
– Seule… mon Dieu !… toujours seule… oh ! quelle vie !… quelle vie !…
Effrayé de l’espèce de secret que je venais de surprendre, je me hâtai de quitter l’appartement de la princesse, je fermai soigneusement la porte extérieure, et je remontai dans ma chambre, oserai-je me l’avouer à moi-même ? avec des pensées moins amères que lorsque j’avais vu Régina partir pour le bal dans tout l’éblouissant éclat de sa parure et de sa beauté.
CHAPITRE III. LA DÉCOUVERTE.
Après une nuit presque entièrement passée dans l’insomnie, occupé de chercher vainement le moyen de deviner et de conjurer le péril qui, je le pressentais, menaçait Régina, je me levai, ne comptant plus que sur le hasard d’une heureuse inspiration ; je me rendis chez le baron de Noirlieu, où je n’étais pas retourné depuis la commission que j’avais faite auprès de Melchior, le mulâtre, pour Robert de Mareuil ; j’étais préparé à l’inconvénient de me voir reconnu par Melchior, il n’en fut rien.
– Je viens, Monsieur, – lui dis-je, – de la part de Madame la princesse de Montbar, au service de qui je suis entré depuis hier, savoir des nouvelles de M. le baron de Noirlieu.
– M. le baron est toujours dans le même état, – me répondit brusquement le mulâtre, – vous ferez part de cela à Madame la princesse.
Melchior avait l’air si rogue, si peu communicatif, qu’il me paraissait difficile d’engager quelque conversation avec lui ; néanmoins je repris :
– Je porterai cette réponse à Madame la princesse, qui en sera sans doute affligée.
– C’est probable, – me dit brusquement le mulâtre en me tournant le dos, après m’avoir du geste montré la porte-cochère, car ceci se passait sur le perron du vestibule.
J’allais me retirer, lorsque je vis venir le baron du fond de l’antichambre ; il portait une robe de chambre de flanelle grise et s’appuyait sur une canne ; il me parut encore plus abattu, plus cassé que lorsque je l’avais vu une année auparavant à la porte du Musée. La même farouche expression de tristesse contractait les traits du vieillard.
En entendant les pas traînants de son maître, Melchior parut vivement contrarié aussi, quoiqu’il m’eût impérieusement répété à voix basse :
– Allez-vous-en… allez-vous-en.
Je restai, et j’entendis le baron dire à Melchior en m’apercevant :
– Melchior… Quel est cet homme ?
– Allez-vous-en donc, – me répéta encore tout bas le mulâtre.
Puis se retournant vers son maître, il lui dit d’un ton de reproche affectueux :
– Rentrez donc, Monsieur le baron… il fait très-froid ce matin… Venez, venez.
Et il fit un pas pour emmener le baron, qui lui obéissait machinalement, lorsque, m’approchant, je dis à haute voix à M. de Noirlieu :
– Je viens de la part de Mme la princesse de Montbar m’informer des nouvelles de M. le baron.
Le père de Régina tressaillit. Son visage me parut trahir le pénible effort d’une lutte intérieure ; puis, revenant sur ses pas, tandis que le mulâtre me lançait des regards courroucés :
– Comment se porte ma fille ? – me dit le vieillard avec une émotion qu’il voulait en vain dissimuler.
– Mme la princesse est toujours souffrante, Monsieur le baron.
– Souffrante ! Régina ? – s’écria le vieillard.
Et regardant Melchior d’un air surpris et défiant, il ajouta :
– On ne m’avait pas dit cela !
Puis, s’adressant à moi de nouveau, il me demanda avec empressement :
– Depuis quand ma fille est-elle malade ? Qu’a-t-elle ? Est-elle alitée ? Répondez… répondez donc.
Melchior me coupa la parole, et dit à son maître avec un sourire sardonique :
– Je peux rassurer Monsieur le baron, hier encore Mme la princesse est allée au bal ; son indisposition n’est donc, heureusement, que fort légère.
– Madame de Montbar est allée hier au bal ? – me demanda le vieillard.
– Oui, Monsieur le baron, – lui dis-je, – mais, au retour, Mme la princesse semblait bien abattue… bien fatiguée.
– Fatiguée ?… d’avoir dansé ?… – reprit le baron, et une ironie amère remplaça sur ses traits l’expression d’intérêt dont ils avaient été empreints en parlant de sa fille. Le mulâtre offrit son bras à son maître d’un air triomphant, et tous deux rentrèrent dans l’intérieur de la maison.
Malgré la mauvaise issue de mon entrevue avec le père de la princesse, je m’applaudis d’avoir découvert que le baron, quoique malheureusement persuadé que Régina n’était pas sa fille, avait conservé pour elle un attachement qui devait souvent lutter dans son cœur contre l’aversion qu’il s’efforçait de lui témoigner ; de plus je remarquai que Melchior paraissait haïr Régina et user de l’influence qu’il devait avoir sur le baron pour l’irriter contre sa fille.
Je quittai la maison de M. de Noirlieu, heureux de penser que peut-être le récit du petit incident dont j’avais été témoin, ferait plaisir à Régina en lui prouvant que le baron conservait toujours un fond d’affection pour elle.
À cette bonne espérance, j’avais presque oublié mes préoccupations au sujet du comte Duriveau, lorsque un incident imprévu, insignifiant en apparence, vint changer mes soupçons en une certitude effrayante :
Le baron de Noirlieu demeurait faubourg du Roule ; j’étais revenu au faubourg Saint-Germain par le pont Louis XV et le quai d’Orsay ; j’atteignais le milieu de la rue de Beaune, lorsque je vis venir à moi, marchant très-vite, Mme Gabrielle, la femme de charge du comte Duriveau ; celui-ci demeurait rue de l’Université, l’hôtel de Montbar était situé rue Saint-Dominique. Je n’attachai d’abord aucune importance à ma rencontre avec Mme Gabrielle ; seulement me trouvant bientôt en face de cette femme que j’avais vue la veille, je pus d’autant moins me dispenser de l’aborder, qu’elle me reconnut et me dit :
– Ah ! Monsieur Martin, bien le bonjour, je ne m’attendais pas à vous rencontrer sitôt, et surtout de si matin…
– En effet, Madame, il est à peine neuf heures.
– C’est ce qui me désole, car il faudra que j’aille au diable vert pour trouver un fiacre ; dans cette saison ils n’arrivent sur place que fort tard, et Monsieur en attend un avec une impatience de damné.
– Comment ? lui qui a tant de chevaux, il sort en fiacre ? et c’est vous qu’il envoie chercher une voiture, tandis qu’il a tant de domestiques ?
– Je ne suis pas non plus la seule à le chercher, ce maudit fiacre ! le maître-d’hôtel et le valet de chambre sont à la recherche de leur côté. Dam… c’est qu’un fiacre, dans notre quartier à cette heure, et le lendemain d’un dimanche encore, c’est aussi rare qu’un merle blanc.
– Si votre maître est si pressé, que ne fait-il atteler une de ses voitures ?
– Il a ses raisons, sans doute, pour préférer un fiacre… il y a quelque chose là-dessous… Balard m’a dit qu’une lettre sur gros papier, pareille à la lettre d’hier soir, vous savez…
– Parfaitement ; c’était très-drôle… cette grosse lettre cachetée avec du pain mâché, et qui a rendu votre maître si content.
– Eh bien ! il en est arrivé une autre toute pareille, ce matin à huit heures, avec recommandation au commissionnaire d’éveiller tout de suite Monsieur ; alors carillon d’enfer, et ordre de lui trouver un fiacre à tout prix… sans compter que Balard m’a dit que la joie d’hier continuait ce matin… en augmentant, si c’est possible.
Une idée qui me donna presque le vertige, me traversa l’esprit.
Mon émotion fut si visible, que la femme de charge me dit :
– Qu’avez-vous donc, Monsieur Martin ?
Ces mots me rappelèrent à moi ; je répondis à cette femme qui répétait avec une surprise croissante :
– Mais, qu’avez-vous donc ?
– Mon Dieu, Madame Gabrielle, je réfléchis qu’au lieu de vous faire perdre là votre temps, je peux vous épargner une corvée. J’ai passé tout-à-l’heure sur le quai Voltaire, j’ai vu deux ou trois fiacres sur la place… je vais y courir et en amener un pour vous à la porte de l’hôtel Duriveau.
– Ah ! par exemple, Monsieur Martin, vous êtes trop aimable… vous déranger ainsi…
– Cela ne me dérange pas, – lui dis-je en m’éloignant, – nous sommes voisins… dans dix minutes, le fiacre sera à votre porte.
Et je m’élançai dans la direction du quai Voltaire pendant que Mme Gabrielle me criait de loin :
– Merci, Monsieur Martin.
Cette idée qui m’avait presque donné le vertige était celle-ci :
– Un piége horrible est tendu à Régina, rue du Marché-Vieux ; on s’est adressé à la bienfaisance de la princesse pour l’attirer dans un guet-apens ; dans cette maison située au fond d’un quartier perdu, il n’y a pas de portier, il n’y a d’autres locataires que cette femme prétendue paralytique. Une des deux lettres reçues par le comte Duriveau a dû lui annoncer que Régina allait se rendre le matin même dans cette maison, où il comptait surprendre la princesse. Que se passerait-il ensuite entre elle et cet homme d’un caractère impitoyable, d’une volonté de fer, et… capable de tout sacrifier à sa haine et à ses passions ?… Je frémissais d’y songer.
Comment d’inductions en inductions, basées sur les plus vagues probabilités, en étais-je arrivé à une certitude absolue ? je ne puis encore m’en rendre compte, mais je savais… mais je sentais que je ne me trompais pas.
En proposant mes services à la femme de charge du comte Duriveau, j’avais eu deux motifs ; ôter au comte une des chances de trouver une voiture, et profiter moi-même de cette voiture, car en effet j’avais par hasard, en revenant, remarqué un fiacre sur le quai Voltaire.
Avertir Régina qu’elle allait tomber dans un piége, je n’y pouvais songer. D’ailleurs elle était sans doute déjà partie pour la rue du Vieux-Marché, puis c’était me trahir ; à l’appui de mes craintes, je n’avais d’autres preuves à lui donner que mes pressentiments. Aller moi-même rue du Marché-Vieux, c’était risquer de m’y rencontrer avec la princesse, et cette démarche dont il m’aurait fallu expliquer l’origine, le but, compromettait pour jamais ma position envers Régina : je ne devais lui rendre en apparence aucun de ces services éclatants qui attirent l’attention, et souvent une reconnaissance trop grande, car alors, par gêne ou par respect humain, on n’ose garder comme domestique un homme à qui l’on doit tant.
Ceci explique mon embarras à l’endroit de trouver un moyen de secourir la princesse ; malheureusement encore le prince était absent… lui, le défenseur naturel de sa femme. À qui donc m’adresser ?
Une étreinte de jalousie involontaire me brisa le cœur… Je venais de songer au capitaine Just.
Donner à un autre… à un autre… jeune, beau… brave et généreux, le moyen de sauver la femme que l’on aime avec la plus folle passion… il faut pour cela plus que du courage… J’eus ce courage.
En réfléchissant ainsi, j’étais arrivé à la place de fiacres du quai Voltaire, je ne m’étais pas trompé, j’y vis deux voitures… et le cocher de l’une d’elles était… Providence inespérée !… l’excellent homme qui m’avait autrefois empêché de mourir de faim, et qui avait reconduit Régina chez elle, après la scène du faux mariage.
– Bonne journée pour moi… puisque je vous rencontre ce matin, mon brave, – me dit joyeusement Jérôme, en me tendant la main, – voilà du temps que…
– Il y va de la vie de quelqu’un que j’aime comme ma mère, – dis-je à Jérôme, en l’interrompant ; et m’élançant dans sa voiture, – je n’ai pas le temps à présent de vous dire un seul mot… Avez-vous sur vous du crayon, du papier ?
– Voilà le portefeuille où j’inscris mes courses, – me dit Jérôme en me remettant cet objet.
– Maintenant, – reprit-il, – où allons-nous ?
– Rue Saint-Louis, en l’île… au coin du quai. Ventre à terre !
– Vitesse de chemin de fer ! – reprit Jérôme en sautant sur son siége ; et ses chevaux, heureusement frais, partirent comme la foudre.
Pendant le trajet, enlevant un feuillet du portefeuille de Jérôme, j’écrivis au crayon ce qui suit :
Un grand danger menace la princesse de Montbar, le comte Duriveau l’a fait tomber dans un piége infâme. Allez, sans perdre une seconde, rue du Marché-Vieux, 11. Montez au troisième, demandez Mme Lallemand ; si l’on ne vous répond pas, brisez la porte, armez-vous au besoin. La princesse doit être retenue dans cette demeure ; il y a sans doute quelque porte masquée communiquant à d’autres chambres que celles occupées par la femme Lallemand. Un fiacre vous attend, le cocher est un homme sûr.
Un ami inconnu.
Le fiacre s’arrêta au coin du quai ; je descendis de voiture, je remis à Jérôme le billet que je venais d’écrire et lui dis :
– Allez au numéro 17 de cette rue.
– Bon.
– Demandez le capitaine Just.
– Bon.
– Dites qu’on lui porte à l’instant ce billet.
– Bon.
– Car c’est une question de vie ou de mort.
– Diable !
– Si le capitaine vous demande qui vous a envoyé avec ce billet, vous direz… vous direz… un homme âgé, à cheveux blancs.
– Très-bien !
– Vous conduirez le capitaine rue du Marché-Vieux, près la rue d’Enfer n° 11.
– Je vois ça d’ici.
– Repasserez-vous par le quai ?
– Oui, c’est mon chemin.
– Si vous ramenez le capitaine, ne vous arrêtez pas ; mais ne vous étonnez pas si je monte derrière votre voiture.
– C’est entendu…
– Et ensuite, rue du Marché-Vieux… bride abattue.
– Vitesse de chemin de fer, j’ai Lolo et Lolotte, soyez calme…
Et Jérôme allait fouetter de nouveau ses chevaux, mais se ravisant :
– Et si le capitaine n’y est pas ?
– Revenez toujours par ici… alors je remonterai dans votre voiture.
– En route ! – dit Jérôme, et il détourna la rue au grand trot de ses chevaux.
J’attendis avec angoisse le retour de Jérôme. En cas d’absence du capitaine Just, je me serais décidé à aller rue du Marché-Vieux, et à agir malgré les funestes conséquences que mon intervention pouvait avoir pour mes projets.
Caché dans l’ombre d’une porte-cochère ouverte, de crainte d’être reconnu par le capitaine, j’écoutais si je n’entendais pas revenir la voiture…
Neuf heures sonnèrent lentement à Notre-Dame… Régina partie de chez elle à huit heures et demie sans doute, devait être alors bien près de la rue du Marché-Vieux, si l’un des domestiques, du comte Duriveau avait trouvé un fiacre plus tôt que sa femme de charge, le comte était aussi sur le point d’arriver dans cette maison où devait se dénouer cette scène redoutable.
Enfin le roulement rapide d’une voiture se rapprocha de ma cachette, j’avançai la tête avec précaution… bonheur du ciel ! Le capitaine était dans le fiacre, ses habits de deuil rendaient plus frappante encore la pâleur de ses beaux traits altérés par une violente émotion.
CHAPITRE IV. LA RUE DU MARCHÉ-VIEUX.
Lorsque la voiture qui emmenait le capitaine, eut dépassé la porte où je me tenais, je m’élançai afin de rejoindre le fiacre et de monter derrière… Alors, il m’arriva une chose à la fois cruelle et ridicule… la palette où je comptais me tenir debout, était défendue, ainsi que cela se voit souvent, par un demi-cercle de fer hérissé de pointes aiguës… Le fiacre, lancé sur une descente, marchait si rapidement que je ne pouvais espérer de le suivre long-temps en courant, ainsi que je faisais en m’attachant des deux mains aux ressorts de derrière… Je pris une résolution désespérée, appelant à mon aide mon ancienne agilité de saltimbanque et à mon souvenir le saut des baïonnettes, souvent exécuté dans mon enfance, au risque de retomber sur les pointes aiguës du demi-cercle de fer… Je tentai de le franchir… Par un bonheur inespéré, je réussis… à-peu-près, car un cahot de la voiture, me faisant trébucher au moment où je retombais sur la palette, après avoir sauté par-dessus les pointes de fer, une d’elles me laboura profondément la jambe ; ne trouvant pas de courroie pour me soutenir, je me cramponnai, comme je le pus, à l’impériale, les genoux collés à la caisse, et comprenant parfaitement que le moindre manque d’équilibre pouvait me faire tomber à la renverse sur les piquants de fer.
Soudain le fiacre s’arrêta, Jérôme se rappelant sans doute alors le danger ou l’impossibilité qu’il y avait pour moi à monter derrière sa voiture, se dressa sur son siége, et sa loyale et bonne figure se tourna vers moi avec inquiétude.
Je lui fis de la main signe de continuer sa route ; au même instant, j’entendis la voix du capitaine Just lui crier :
– Cocher… qu’y a-t-il ?… Marchez donc, sacredieu… Quarante francs pour votre course… et ventre à terre.
– En route, – cria Jérôme.
Mais tout en activant ses chevaux de la voix, le brave homme trouva moyen de se retourner, d’attacher au dossier de son siége une des longes de rechange de ses chevaux et de me jeter l’autre bout en me disant :
– Tenez-vous à cela… il y aura moins de danger.
Le bruit des roues couvrant la voix de Jérôme, le capitaine ne l’entendit pas, sans doute, et je me maintins sans tomber, grâce à l’ingénieux secours du cocher, secours d’autant plus urgent pour moi que ma blessure me faisait cruellement souffrir, je ne pouvais m’appuyer sur ma jambe ; je sentais mon sang couler sous mes vêtements.
Lorsque je vis la voiture à peu de distance de la rue du Marché-Vieux, de crainte d’être aperçu par le capitaine Just je voulus descendre, calculant alors ma distance et mon élan, je me retournai, d’un bond je franchis de nouveau le cercle hérissé de pointes de fer, je tombai d’aplomb. La voiture continua sa route pendant quelques secondes, puis détourna à l’angle de la rue du Marché-Vieux. Je pris mon mouchoir, je le nouai très-serré autour de ma jambe, ce qui me causa, momentanément du moins, un très-grand soulagement.
J’allais entrer dans la petite rue, lorsque, arrêté à quelques pas de son tournant, je remarquai un fiacre dont les chevaux ruisselaient d’écume.
– Cocher, – dis-je à cet homme, – n’avez-vous pas amené ici un monsieur… grand et brun, que vous avez pris rue de l’Université ?
– Oui, mon garçon, une fameuse course, mes chevaux n’en peuvent plus… Mais dix francs de pourboire… ça en valait la peine. Je laisse souffler mes bêtes avant de m’en retourner… et…
– Y a-t-il long-temps que vous êtes là ?