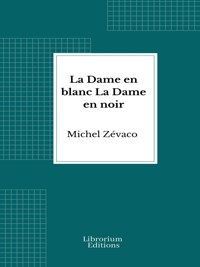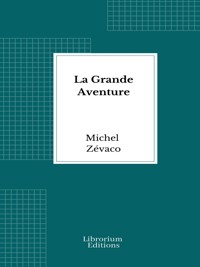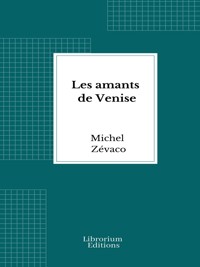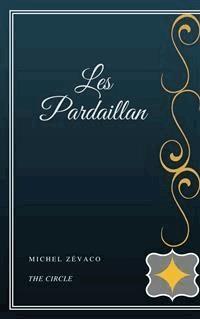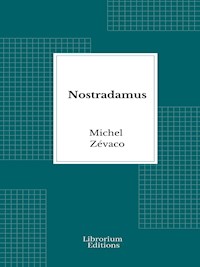3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Pardaillan, tu vas mourir... Non parce que tu t'es dressé devant ma puissance... Tu vas mourir parce que je t'aime ! » La fantastique procession de la Sainte-Ligue est arrivée à Chartres où s'est réfugié Henri III. C'est dans cette ville que le moine Jacques Clément, armé par Fausta, doit assassiner le roi de France pour permettre au duc de Guise de monter sur le trôné. Mais le moine ne frappe pas. Tout était si bien réglé qu'il avait fallu quelque miracle pour sauver Henri III ! Ce miracle, c'est le chevalier de Pardaillan, qui se retrouve face à face avec Fausta. Vivant ! Bouleversée, Fausta fait alors à Jean de Pardaillan des propositions enflammées... qu'il repousse une fois de plus. Jean aime toujours Loïse, morte il y a seize ans... et quelques vieilles dettes à liquider le réclament. Bien que folle de rage, Fausta murmure froidement : « Soit !... la lutte continue ! En fin de compte, la victoire doit me rester. Et, pour commencer... » Passions, drames, histoire haute en couleur, Les Aventures du chevalier de Pardaillan forment un cycle palpitant de romans de cape et d'épée qui a obtenu, dès sa parution en feuilleton, un succès considérable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 877
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Les Pardaillan, tome 4 : Fausta vaincue
Pages de titreLes Pardaillan IVIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIVXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIPage de copyrightMichel Zévaco
Fausta vaincue
Michel Zévaco
Les Pardaillan IV
La série des Pardaillan comprend :
1. Les Pardaillan.
2. L’épopée d’amour.
3. La Fausta.
4. Fausta vaincue.
5. Pardaillan et Fausta.
6. Les amours du Chico.
7. Le fils de Pardaillan.
8. Le fils de Pardaillan(suite).
9. La fin de Pardaillan.
10. La fin de Fausta.
Fausta vaincue
Édition de référence :
Robert Laffont, coll. Bouquins.
Édition intégrale.
I
La flagellation de Jésus
Une foule immense était rassemblée sur la Grève, non plus cette fois pour y voir un beau spectacle de pendaison, une jolie estrapade1 ou une intéressante grillade d’hérétiques, mais simplement pour assister au départ de la grande procession organisée pour porter au roi Henri III les doléances de la bonne ville de Paris.
Pour la grande majorité des Parisiens, il s’agissait de réconcilier le roi avec sa capitale, en obtenant bien entendu un certain nombre d’avantages parmi lesquels on plaçait au premier rang le renvoi du duc d’Épernon et du Seigneur d’O qui avaient quelque peu abusé du droit de pressurer les bourgeois.
Pour une autre catégorie moins nombreuse et initiée à certains projets de Mgr de Guise, il s’agissait d’imposer à Henri III une terreur salutaire et d’obtenir de lui, moyennant la soumission de Paris et son repentir de la journée des Barricades, une guerre à outrance contre les huguenots, c’est-à-dire leur extermination.
Pour une troisième catégorie, moins nombreuse encore et initiée plus avant dans les projets des chefs de la Ligue, il s’agissait de s’emparer du roi, de l’enfermer en quelque bon couvent, et de le déposer après l’avoir préalablement tondu.
Enfin, pour une quatrième catégorie réduite à une douzaine d’initiés, il s’agissait de tuer Henri III.
Tout le monde était donc content.
Non seulement la Grève était noire de monde, mais encore les rues avoisinantes regorgeaient de bourgeois qui, la salade2 en tête, la pertuisane d’une main, un cierge de l’autre et le chapelet autour du cou, se disposaient à processionner jusqu’à Chartres. Ajoutons qu’en dehors des ligueurs qui, pour une des raisons énumérées plus haut, voulaient pénétrer dans la ville où s’était réfugié Valois, en dehors de ces étranges processionneurs armés jusqu’aux dents, un nombre considérable de mendiants s’étaient mis de la partie.
En effet, le voyage à Chartres, en tenant compte des lenteurs d’un pareil exode, devait durer quatre jours. Le duc de Guise avait fait crier qu’il avait disposé trois gîtes d’étapes le long du chemin, et qu’à chacun de ces gîtes on tuerait cinquante bœufs et deux cents moutons pour nourrir le peuple en marche. Tout ce qu’il y avait de mendiant à Paris avait donc vu dans cette procession une rare occasion à ripaille et franche lippée.
Ce jour-là, donc, vers huit heures du matin, les cloches des innombrables paroisses de Paris se mirent à carillonner. Sur la place de Grève vinrent se ranger successivement les délégués de l’Hôtel de Ville, les représentants des diverses églises, curés ou vicaires, puis les confréries, les théories de moines tels que Feuillants, Capucins, et enfin les Pénitents blancs qu’on remarquait spécialement. En effet, c’était Henri III lui-même qui un lendemain de débauche avait fondé la confrérie des Pénitents blancs.
Enfin, vers huit heures, le Te Deum ayant été chanté à Notre-Dame en présence du lieutenant général de la Ligue, c’est-à-dire d’Henri le Saint, la procession s’ébranla parmi d’immenses acclamations, des cris frénétiques de « Vive la Ligue ! Vive le Grand Henri ! » et dans le tumulte des bombardes éclatant sur les remparts.
Parmi les files interminables de cierges et d’arquebuses, on vit dans cette procession des choses magnifiques. D’abord les douze apôtres en personne, revêtus d’habillements tels qu’on en portait du temps de Jésus-Christ. Seulement ces dignes apôtres, sous leurs tuniques à la romaine, laissaient voir la cuirasse, et ils ne s’étaient pas gênés pour se coiffer de casques à panaches, ce qui les faisait paraître bien plus beaux.
Après les apôtres venaient quelques soldats romains portant les instruments de supplice de Jésus-Christ. L’un agitait une lance ; un autre tenait une perche au bout de laquelle était fixée une éponge ; un troisième portait un seau. Mais le plus beau venait ensuite.
En effet, Jésus-Christ lui-même était représenté par un personnage qui traînait une immense croix. Ce personnage n’était autre qu’Henri de Bouchage, duc de Joyeuse, lequel, comme on sait, avait pris l’habit de capucin sous le nom de frère Ange, et devait plus tard rejeter le froc pour guerroyer, puis rentrer encore en religion.
Le duc de Joyeuse, donc, ou frère Ange, comme on voudra, portait sur ses épaules une croix qui par bonheur était en carton : sur sa tête, une couronne d’épines également en carton peint, et autour du cou, par un bizarre anachronisme, le chapelet des ligueurs. Il avait la figurebarbouillée de rouge pour figurer le sang. Près de lui marchaient deux jeunes capucins dont l’un représentait Madeleine et l’autre la Vierge.
Derrière Joyeuse déguisé en Christ, venaient deux grands gaillards qui le fouettaient ou faisaient semblant de le fouetter, ce qui soulevait dans la foule des cris d’indignation. Et cette indignation, vraie ou feinte comme le reste, prenait des proportions de rage lorsque, par un anachronisme plus bizarre encore (mais on n’y regardait pas de si près), les deux flagellants, tous les quinze ou vingt pas, s’écriaient :
– C’est ainsi que les huguenots ont traité Notre Seigneur Jésus !
– Mort aux parpaillots ! reprenait la foule, de très bon cœur cette fois.
Moines, prêtres, ligueurs, cierges, arquebuses, flagellants, apôtres et Jésus, tout ce monde sortit de Paris et prit la route d’Orléans, c’est-à-dire la route de Chartres, parmi les cantiques et les cris de guerre.
À une vingtaine de pas derrière Jésus, ou frère Ange, ou duc de Joyeuse, marchaient côte à côte quatre pénitents qui, se tenant par le bras, tête baissée, capuchon sur le visage, se faisaient remarquer par leurs énormes chapelets et par leur piété extraordinaire. Peu à peu le désordre s’étant mis dans les rangs de la procession, ces quatre pénitents finirent par se trouver derrière Jésus au moment où celui-ci, d’une voix retentissante, criait :
– Mes frères, mort aux huguenots maudits qui m’ont flagellé !...
Une acclamation salua ces paroles du Christ qui, ayant essuyé la sueur qui coulait de son front, continua :
– Puisque nous allons voir Hérode...
– Le roi ! interrompit une voix impérieuse. Dites : le roi, messire, puisque Paris se réconcilie avec Sa Majesté !
– C’est juste, sire de Bussi-Leclerc ! reprit Jésus-Christ. Donc, mes frères, puisque nous allons voir le roi, nous devons avant tout obtenir qu’il renvoie ses Ordinaires !... Mort aux Ordinaires !
– Très juste, dit Bussi-Leclerc. Mort aux Quarante-Cinq !
– À mort ! À mort ! reprit la foule des pénitents.
– En route, donc, dit Jésus.
Et la procession, dont la marche s’était trouvée interrompue, reprit son cours. Elle s’étendait sur une longueur d’une bonne lieue. Et quelques heures après avoir quitté Paris, tout ce monde marchait à sa convenance, sans ordre arrêté.
Bien en avant de ce troupeau, Guise, Mayenne et leur frère, à cheval, entourés d’une cinquantaine de gentilshommes bien armés, s’entretenaient à voix basse de choses mystérieuses.
Quant aux quatre pénitents que nous avons signalés, ils causaient entre eux sans précautions ; en effet, tels étaient les cris, les chants de guerre et les cantiques qu’il leur était difficile de s’entendre.
– Dis donc, Chalabre, disait l’un, as-tu entendu frère Ange ?
– Par les cornes du beau duc, je crois bien, Sainte-Maline !
– J’ai envie de frotter un peu les côtes de messire Jésus ! dit un troisième pénitent.
– Calme-toi, Montsery, reprit Chalabre, Joyeuse nous payera son discours plus cher qu’il ne pense !
– Messieurs, dit le quatrième, jouons bien notre rôle jusqu’à ce soir, et puis nous verrons.
– Es-tu bien rétabli, mon cher Loignes ?... Ta blessure ?
– Eh ! le coup fut bien appliqué. Le cher duc n’y va pas de main morte quand il frappe. J’ai cru que j’étais mort. Et sans ce digne astrologue... n’importe ! je veux que Guise reçoive de ma main le même coup qu’il m’a porté...
– Tu es ingrat, Loignes ! dit Montsery. Comment serions-nous sortis de Paris s’il n’avait eu l’idée d’aller en procession voir notre sire ?...
– Oui, fit sourdement Loignes. Il va à Chartres. Mais du diable s’il en revient !
– Il y va pour demander nos têtes au roi ! ricana Chalabre.
– Et les offrir ensuite à Bussi-Leclerc et à Joyeuse ! continua Sainte-Maline.
– Messieurs, dit Loignes, Joyeuse a crié tout à l’heure : « Mort aux Ordinaires ! » Bussi-Leclerc a crié : « Mort aux Quarante-Cinq ! »... Joyeuse est un misérable fou et ne vaut pas son coup de poignard. Quant à Leclerc, il n’arrivera pas à Chartres. Est-ce dit ?...
– C’est dit ! reprirent les trois autres.
Laissant les quatre spadassins – quatre des Ordinaires d’Henri III – à leurs projets de vengeance et de meurtre, nous laisserons s’éloigner la fantastique procession en marche sur Chartres et nous rejoindrons une litière fermée qui vient à quelques centaines de toises derrière la colonne.
Cette litière était entourée par une douzaine de cavaliers qui jetaient sur quiconque approchait un regard si menaçant que les plus curieux ou les plus audacieux s’écartaient à l’instant même. Dans cette litière se trouvaient deux femmes : Fausta et Marie de Montpensier.
– L’homme ? demanda Fausta au moment où nous rejoignons la litière.
– Confondu dans la foule des pénitents, il chemine en silence, débattant sans doute avec lui-même comment il parviendra jusqu’à Hérodes.
– Vous êtes bien sûre que ce moine se trouve dans la procession ? insistait Fausta.
– Je l’ai vu, répondit la duchesse, vu de mes yeux.
Fausta soupira et murmura :
– Pardaillan m’avait dit vrai. Jacques Clément, libre, marche à sa destinée. Allons ! Valois est condamné. Rien ne peut le sauver maintenant...
– Que dites-vous, ma belle souveraine ? Il me semble que vous avez prononcé un nom... celui du sire de Pardaillan...
– Oui ! dit Fausta en regardant fixement la duchesse.
– C’est que ce nom, mon frère et ses gentilshommes le prononcent bien souvent depuis trois ou quatre jours...
– Eh bien ! si vous voulez que votre frère ne prononce plus ce nom...
– Moi ? Cela m’est égal, je vous jure !... fit Marie en riant.
Elle était très gaie, la jolie duchesse. Elle gazouillait, fredonnait, jouait avec ses ciseaux d’or et, somme toute, marchait à l’assassinat d’Henri III comme à une fête. En revanche, Fausta, dont le visage ne témoignait d’ordinaire d’aucune agitation, paraissait bien sombre.
– Oui, reprit-elle, cela vous est égal, à vous. Mais il est nécessaire que le duc de Guise ait l’esprit libre pour ce qui va être entrepris. Et pour qu’il ait l’esprit libre, il faut qu’il n’ait plus ce nom de Pardaillan sur les lèvres. Et pour qu’il ne le prononce plus...
– Eh bien ? demanda Marie.
– Dites-lui, faites-lui savoir, dès que nous serons entrés dans Chartres, que Pardaillan est mort !... Et afin qu’il n’ait point de doute, dites-lui que c’est moi qui l’ai tué...
Ayant ainsi parlé, Fausta baissa la tête et ferma les yeux comme pour indiquer qu’elle voulait se renfermer dans ses pensées. Et ces pensées devaient être funèbres, car son visage, dans son immobilité, semblait refléter la mort...
Nos personnages sont donc ainsi disposés : en tête de ce long serpent de foule qui se déroule sur la route, un groupe de cavaliers : Guise, ses frères, ses gentilshommes. Près de lui, Maineville insoucieux et Maurevert inquiet, le regard sans cesse en alarme. Quant à Bussi-Leclerc, il s’intéresse à la procession, sans doute, car il en parcourt les rangs, et on le voit tantôt sur un point, tantôt sur un autre.
Puis, derrière cette bande de seigneurs, à une certaine distance, commence la procession, la théorie des moines et des prêtres escortés de ligueurs, flanqués de mendiants.
Puis viennent les apôtres et Joyeuse qui continue à crier que les huguenots le meurtrissent. Puis, presque sur les talons de Jésus, marchent Loignes, Sainte-Maline, Chalabre et Montsery, déguisés en pénitents.
Puis, presque à la queue de la colonne, un moine marche seul, le capuchon sur la figure, et ses mains croisées serrent avec ferveur contre sa poitrine une dague solide : c’est Jacques Clément.
Enfin, très en arrière, c’était la litière de Fausta.
De ce peuple en marche montait une sourde rumeur composée de prières, de cris, d’éclats de rire, de chants bachiques et de cantiques religieux. Et cette rumeur attirait les gens des hameaux et des villages. De toutes parts, les manants accouraient pour voir ce spectacle extraordinaire.
Nous ne suivrons pas la procession sur tout le chemin qu’elle parcourut dans ces quatre journées de marche ; disons seulement que le quatrième jour, vers onze heures du matin, elle apparut devant la porte Guillaume après avoir contourné une partie des murailles de Chartres. Mais avant de l’y rejoindre, signalons un événement qui se passa la veille.
Le troisième jour, la procession se reposa dans le village de Latrape l’un des gîtes d’étape organisés par le sieur Crucé, promu au rang de maréchal des logis de cet exode. Les pénitents y étaient arrivés vers quatre heures, et aussitôt s’étaient mis à table, c’est-à-dire qu’ils avaient envahi une immense prairie où ils s’étaient assis dans l’herbe.
Naturellement, Guise et sa suite avaient pris leurs logis dans les meilleures maisons du village.
Dans la prairie, les gens de Latrape allaient et venaient, empressés à faire bon accueil aux pénitents. Ces braves gens avaient fait cuire d’innombrables fournées de pain, avaient mis en perce une trentaine de tonneaux de cidre ou de vin, et avaient allumé de grands feux dans la prairie. Devant ces feux rôtissaient des moutons entiers, des quartiers de bœuf suspendus à des cordes, des cochons qui, accrochés à des perches en faisceau, tournoyaient lentement au-dessus des flammes, et enfin un régiment de dindons et de poules.
Après cette énorme ripaille que nous regrettons de n’avoir pas le temps de décrire, chacun s’enveloppa de son manteau et chercha un coin pour dormir. La nuit était venue en effet, et c’était à la lueur des torches qu’on avait vidé les derniers brocs, poussé les derniers cris de : « Mort aux huguenots ! À bas d’Épernon ! Sus aux Ordinaires d’Hérode... » Puis les dernières torches s’éteignirent. Dix heures sonnèrent au petit clocher du village.
À ce moment, dans l’avant-dernière maison en allant vers Chartres, deux hommes dormaient côte à côte, étendus sur des bottes de paille de la grange.
Ou du moins, si l’un de ces deux hommes, en proie à quelque insomnie, soupirait et se retournait sur la paille, l’autre dormait pour deux, et comme on dit, à poings fermés...
Dans cette même maison, non plus dans la grange ni sur la paille, mais dans une chambre assez convenable du rez-de-chaussée et sur un bon lit, dormait un autre personnage. Celui-ci ronflait à rendre des points au roi Henri de Navarre qui, comme chacun sait, était le plus terrible ronfleur de son époque. Et qui se fût approché de cet enragé dormeur, pour qui le sommeil était une façon de musique à outrance, eût reconnu l’un des plus fidèles, des plus solides et des plus brillants gentilshommes du duc de Guise, c’est-à-dire messire de Bussi-Leclerc en personne.
Comme dix heures venaient de tinter lentement au clocher, quatre hommes s’approchèrent de la maison que nous venons de signaler : c’étaient les quatre fidèles d’Henri III qui, profitant de la procession pour rejoindre le roi sans danger d’arrestation, avaient jusque-là voyagéavec elle. C’étaient Montsery, Sainte-Maline, Chalabre et Loignes qui guettaient depuis le premier jour l’occasion d’exercer leurs talents de spadassins sur la poitrine du sire de Bussi-Leclerc. Et comme Bussi-Leclerc était considéré à bon droit comme la première lame du royaume, il leur semblait qu’ils n’étaient pas trop de quatre pour mener à bonne fin leur entreprise, maintenant que l’occasion attendue semblait enfin se présenter.
Ainsi que nous l’avons dit, la maison où Bussi-Leclerc avait trouvé un gîte était l’avant-dernière, sur la grand-route. Elle était assez éloignée du reste du village pour qu’on ne pût entendre le bruit d’une lutte, si lutte il y avait. Les quatre spadassins marchèrent résolument à la maison.
– Tu es sûr que c’est là ? demanda Sainte-Maline.
– Je ne l’ai pas perdu de vue, répondit Chalabre. Sûrement, nous allons trouver le sanglier dans sa bauge.
Ils s’arrêtèrent devant la chaumière et tinrent conseil à voix basse.
– Comment allons-nous procéder ? demanda Montsery.
– Moi, je veux me battre avec lui, dit Sainte-Maline. Je m’en charge.
– Et s’il te tue ?
– Vous me vengerez...
– C’est cela ! firent Chalabre et Montsery, bataille !...
– Messieurs, dit Loignes, je crois que vous perdez la tête. Il s’agit bien de duel et de combat ! Il s’agit bien de faire ici les mignons ! Parce que ce maroufle vous a injuriés de son mieux, quand il vous tenait à la Bastille, vous voulez, par-dessus le marché, qu’il nous étripe l’un après l’autre...
Loignes était le plus âgé des quatre ; c’était un homme sérieux et positif, exerçant en conscience son métier d’assassin royal ; on l’eût bien surpris en lui parlant de pitié ou de loyauté ; la ruse la mieux ourdie, le coup de poignard le plus sûr, voilà les garanties morales qu’il prisait par-dessus tout.
Les trois autres, tout jeunes, comme nous avons dit, avaient encore quelques préjugés. Certes, ils pouvaient se vanter déjà de plus d’un coup de dague doucement administré à quelque détour de ruelle, dans le dos de quelque ennemi de Sa Majesté, mais ils n’étaient pas au degré de perfection atteint par le comte de Loignes. Devant les sages observations de leur aîné – leur maître en guet-apens – ils baissèrent donc la tête.
– Que faut-il faire ? demandèrent-ils.
– C’est bien simple. Nous allons l’appeler comme si son duc le mandait à l’instant. Nous aurons nos dagues à la main. Et quand il sortira, nous le larderons proprement jusqu’à ce qu’il rende sa belle âme au diable.
Il faut rendre cette justice aux trois jeunes écervelés qu’ils se rallièrent instantanément à ce plan si limpide.
– Par où entre-t-on ? reprit le comte de Loignes.
– Il faut faire le tour, dit Chalabre qui toute la journée avait guetté pas à pas Bussi-Leclerc. Suivez-moi, messieurs !
Chalabre enfila aussitôt un sentier, et à vingt pas de la route sauta lestement par-dessus une porte à claire-voie. Les autres le suivirent. Ils se trouvaient alors dans une cour dont le sol disparaissait sous le fumier. Derrière eux, ils avaient une grange où, sur la paille, dormaient les deux inconnus que nous avons signalés tout à l’heure. Sur leur droite, au fond, c’étaient des étables et un poulailler. Devant eux, la maison, ou plutôt la chaumière, divisée en deux parties : à droite, le logis assez vaste des maîtres de céans, et à gauche une chambre isolée, avec sa porte particulière ; c’était là, dans cette pièce qui était comme la salle d’honneur de cette pauvre maison de paysans, c’était là, donc, que de tout son cœur dormait Bussi-Leclerc. Chalabre désigna la porte du doigt.
– Il est bien capable de se sauver par la fenêtre ! gronda Loignes.
– Il n’y a pas de fenêtre, dit Chalabre.
C’était vrai. Les fenêtres étaient alors un luxe. Dans la plupart des chaumières, la porte, divisée en deux parties, servait à éclairer et aérer les pièces enfumées ; il n’y avait pour cela qu’à laisser ouverte la partie supérieure.
– Admirable ! dit Loignes. Attention !
Tous les quatre dégainèrent leurs dagues ; Sainte-Maline et Montsery se placèrent à gauche de la porte, le long du mur, prêts à bondir sur Bussi-Leclerc dès qu’il apparaîtrait. Chalabre se plaça à droite. Puis Loignes, ayant jeté un coup d’œil satisfait sur ce dispositif d’attaque, heurta rudement à la porte du pommeau de son épée. La lune, bien qu’en son dernier quartier, éclairait suffisamment ce tableau.
– Holà ! holà ! messire de Bussi-Leclerc ! vociféra le comte de Loignes.
– Qui va là ? dit une voix de l’intérieur.
– Vite ! éveillez-vous et courez à monseigneur qui vous mande à l’instant !
– Au diable monseigneur ! grommela Bussi-Leclerc. Attendez-moi, monsieur, je m’habille...
– Non, non ! Je cours réveiller M. de Maineville que le duc mande également. Hâtez-vous donc !...
Là-dessus, Loignes s’effaça contre le mur, près de Chalabre. Leclerc, habitué à ces alertes continuelles, ne pouvait avoir aucune défiance. Les quatre, ramassés sur eux-mêmes, la dague à la main, attendaient. Tout à coup, ils entendirent le bruit que faisait Bussi-Leclerc en commençant à ouvrir la porte.
– Bonsoir, messieurs ! dit à ce moment une voix très calme et sans nulle raillerie apparente. Il paraît que vous voulez meurtrir ce bon M. de Bussi-Leclerc, gouverneur de la Bastille ?...
– Ouais ! gronda Leclerc, qui à l’intérieur s’arrêta d’ouvrir, que veut dire cela ?
– Trahison ! Trahison ! hurla le comte de Loignes.
– À mort ! crièrent les trois autres en s’élançant le poignard levé sur l’homme qui venait de parler, et qui sortant de la grange, s’avança en saluant poliment et répétait :
– Bonsoir monsieur de Chalabre ; bonsoir, monsieur de Sainte-Maline ; bonsoir, monsieur de Montsery.
Les poignards levés s’abaissèrent ; les trois jeunes gens s’arrêtèrent, reculèrent et saluèrent très bas. Un rayon de lune se jouait sur le fin visage audacieux et paisible de celui qui venait d’intervenir, et ce visage, ils venaient de le reconnaître...
Loignes, ne comprenant rien à cette scène imprévue, aussi rapide qu’un éclair, Loignes, ivre de fureur, fit un bond pour s’élancer sur ce défenseur de Bussi-Leclerc. Mais en même temps, il se sentit saisi à bras le corps et solidement contenu par ses trois amis.
– C’est notre sauveur ! dit Chalabre...
– C’est celui qui nous a tirés de la Bastille ! dit Montsery.
– C’est le chevalier de Pardaillan ! dit Sainte-Maline.
Loignes recula d’un pas, se découvrit et dit :
– Eussiez-vous été le pape en personne que vous eussiez tâté de mon fer pour le mal que vous faites ici ; mais vous êtes M. de Pardaillan, et je n’ai rien à dire. Retirez-vous donc, chevalier, et laissez-nous accomplir notre besogne.
– Si je vous laisse faire, maintenant ! cria la voix narquoise de Bussi-Leclerc, derrière la porte.
– Bon, bon ! patiente un peu, et tu verras comme on défonce une porte et une poitrine ! répondit Loignes. Monsieur, ajouta-t-il en s’adressant à Pardaillan, c’est Bussi-Leclerc qui est là ; c’est votre ennemi autant que le nôtre ; je pense que si vous ne voulez pas nous aider, vous nous laisserez du moins occire en paix ce sacripant.
– Messieurs, dit Pardaillan en s’adressant aux trois jeunes gens, lorsque j’eus le bonheur de vous tirer des mains du digne gouverneur de la Bastille, vous m’avez promis, en échange des vôtres, trois vies et trois libertés...
– C’est vrai ! firent d’une seule voix Chalabre, Montsery et Sainte-Maline.
– J’ai donc l’honneur de vous prier de payer cette nuit le tiers de votre dette : je vous demande la vie et la liberté de M. de Bussi-Leclerc.
Les trois spadassins, d’un seul mouvement, s’inclinèrent. Loignes lui-même rengaina aussitôt sa dague et son épée qu’il avait tirée : c’étaient des gens d’honneur. Et si ce mot vous choque, lecteur, mettez-en un autre à la place.
– Je n’ai rien à dire ! grogna Loignes, mais j’enrage.
– Monsieur, dit Sainte-Maline en saluant galamment, nous vous cédons Bussi-Leclerc.
– Reste à deux, observa tranquillement le chevalier.
– Très juste, dit Montsery, et nous tiendrons parole jusqu’au bout. Cependant, un bon conseil : réservez pour vous-même une des deux vies qui nous restent à payer ; car c’est un mauvais tour que vous jouez ce soir à Sa Majesté, et elle pourrait bien nous donner l’ordre de vous tuer ce que nous serions désolés de faire si nous ne vous devions plus rien.
– Vous êtes trop bon, monsieur, dit Pardaillan qui salua de son geste le plus gracieux ; mais quittez tout souci en ce qui me regarde, et puisque vous êtes si bons payeurs, messieurs, veuillez me laisser le champ libre.
Les quatre hommes saluèrent et se retirèrent sans répondre à Bussi-Leclerc, qui derrière sa porte criait :
– Au revoir, messieurs ! Je vais vous faire préparer un cabanon digne de vous, à la Bastille !
Mais Sainte-Maline revint brusquement sur ses pas :
– Monsieur le chevalier, fit-il, y aurait-il de l’indiscrétion à vous demander pourquoi vous sauvez ce damné Leclerc, qui, somme toute, vous veut autant de mal qu’à nous ?...
– Aucune, monsieur, répondit Pardaillan. Je suis aussi bon payeur que vous, voilà tout le secret de ma conduite. J’ai formellement promis sa revanche à M. de Bussi-Leclerc. Or, comment aurais-je tenu ma promesse, si je l’avais laissé tuer ce soir ?
Sainte-Maline regarda avec étonnement le chevalier qui souriait, salua, et se hâta de rattraper ses compagnons.
– Maintenant, il s’agit de fuir, dit Loignes. Dans quelques minutes, Leclerc va ameuter toute la damnée procession.
Loignes était furieux contre Pardaillan, contre ses trois amis, contre lui-même ; mais comme la fureur ne pouvait remédier à rien, il la ravalait... c’était un homme pratique.
– Eh bien ! fit Chalabre, prenons à pied le chemin de Chartres.
Loignes se mit à ricaner et conduisit ses trois compagnons à un champ où les chevaux de Guise et de son escorte étaient attachés au piquet par le bridon. Chacun d’eux se glissa vers un cheval, le détacha, et sans le seller sauta dessus. Quelques instants plus tard, au milieu des vociférations, des cris de : « Arrête ! Arrête ! », les quatre spadassins s’élançaient ventre à terre sur la route de Chartres, et disparaissaient dans la nuit.
Pendant ce temps, Pardaillan s’était approché de la porte derrière laquelle se trouvait Bussi-Leclerc et avait frappé du poing en criant :
– Monsieur ! hé ! monsieur de Bussi-Leclerc !
– Que désirez-vous, sire de Pardaillan ? demanda Leclerc, goguenard.
– Moi ? Rien. Je veux simplement vous dire que maintenant je suis seul, très seul.
– Et alors ?
– Alors, s’il vous convient d’essayer de prendre cette revanche aprèslaquelle vous courez depuis si longtemps, eh bien ! je suis votre homme.
– Bon ! je préfère attendre...
– Comme il vous plaira, monsieur.
– Soyez tranquille, vous n’y perdrez rien.
– Ce n’est pas bien sûr, monsieur le gouverneur, dit Pardaillan.
– Bah ! fit Leclerc toujours narquois, vous croyez donc que je n’oserai pas affronter votre rapière ?
– Non pas ! Je vous tiens pour aussi brave qu’habile aux armes. Mais j’ai tant de chances d’être tué par d’autres qu’il ne vous en reste guère de me retrouver. Qui sait si j’arriverai seulement jusqu’à Chartres ?
– Si vous mourez d’ici là, reprit Bussi-Leclerc avec, cette fois, une sorte de grondement haineux, soyez sûr que je le regretterai, car c’est ma plus douce espérance, maintenant, que de penser à l’heureux moment où je vous mettrai les tripes au vent !
– Merci, dit Pardaillan. Qui donc vous empêche, en ce cas, d’essayer de satisfaire cette douce envie à l’instant ?
– Ah ! reprit Leclerc, c’est que je ne suis pas égoïste, moi. Je vais vous dire. Nous sommes quatre qui vous haïssons, et nous avons lié partie pour vous mettre à mal. Je puis même vous dire comment les choses se passeront.
– Je serai flatté de l’apprendre...
– Vous allez voir comme c’est simple : d’abord, comme je vous l’ai dit, je vous passerai mon épée au travers du ventre, sans vous tuer toutefois ; puis Maineville vous attachera à l’aile du premier moulin ; c’est une manie, chez lui, vous comprenez ? Puis quand vous aurez tourné suffisamment, c’est-à-dire jusqu’à ce que mort s’ensuive, Maurevert vous arrachera le cœur, car il a fait gageure de le manger sauté aux petits lards ; enfin, Mgr de Guise abandonnera votre carcasse au bourreau pour la tirer à quatre chevaux.
Pardaillan comprit que Bussi-Leclerc, en parlant ainsi, devait écumer. Il l’entendit grincer des dents.
– Vous comprenez, reprit Leclerc, que si je vous tuais tout de suite à moi tout seul, mes trois associés m’en voudraient la male mort. Tâchez donc de vivre encore quelques jours, jusqu’à ce que nous puissions mettre la main sur vous...
– Je tâcherai, fit doucement Pardaillan. Mais vraiment, je vous répète que je crains de ne pas arriver vivant jusqu’à Chartres. Vous devriez profiter de l’occasion...
– Non ! rugit Bussi-Leclerc.
– Allons donc, c’est que tu as peur, Leclerc !
La porte, à l’intérieur, fut labourée de coups de poignard. Il y eut un trépignement, une série de grognements furieux.
– Bussi-Leclerc a peur ! cria Pardaillan à haute voix.
– Par le pied fourchu du démon ! Par le sang du Christ ! Par le ventre de ma mère !...
– Tu me fais pitié, à t’entendre pleurer et trembler de peur...
– Truand de sac et de corde ! Si Maurevert te mange le cœur, je te mangerai le foie !...
Bussi-Leclerc se mit à frapper la porte à coups de dague. Pardaillan haussa les épaules, et dans la cour, sur le fumier, à la clarté de la lune, il vit les gens de la chaumière qui, réveillés par le bruit, étaient sortis et, livides d’effroi, assistaient à cette fantastique conversation. Au mouvement que fit Pardaillan, ces gens reculèrent jusqu’à l’étable. Sans s’inquiéter d’eux, sans les voir peut-être, le chevalier se dirigea vers la grange et à l’entrée, trouva son compagnon qui, l’épée à la main, attendait les événements.
– Oh ! murmurait le jeune duc d’Angoulême, c’est affreux.
– Quoi donc ?...
– Les menaces de cet homme.
– Oui, c’est assez hideux. Partons, monseigneur ; l’air de ce village est malsain pour nous maintenant. Et quant à Maurevert, nous le retrouverons sûrement à Chartres.
Les deux hommes s’enveloppèrent de leur manteau et, d’un pas rapide, prirent la route de Chartres. Bussi-Leclerc continuait à sacrer et à faire derrière sa porte un vacarme extraordinaire. Au bout de dix minutes, les paysans s’approchèrent de la porte, et le maître du logis, ôtant son bonnet, cria :
– N’ayez plus peur, monseigneur, il est parti !
– Par l’enfer ! vociféra Leclerc en entrouvrant la porte, qui a dit que j’ai peur ?... Est-ce toi, manant ?... Veux-tu que je te fasse pendre à cette branche pour t’apprendre qu’un gentilhomme n’a jamais peur ?
Les manants tremblèrent et se mirent à balbutier force excuses, car la menace n’était pas vaine ; alors, Bussi-Leclerc, la dague et l’épée aux poings, sortit et grogna :
– Où est-il ?
Le paysan voulut rentrer en grâce et répondit :
– Je ne sais par où il a pris, monseigneur ; mais le fait est qu’il a fui, et il doit être loin.
Leclerc rengaina ses armes et grommela :
– Il n’a pas plus fui que je n’ai eu peur...
Bussi-Leclerc ne mentait pas : il n’avait pas eu peur... peur d’être blessé ou tué. C’était un de ces rudes batailleurs pour qui le mot « mort » était vide de sens... mais il avait eu peur d’une nouvelle défaite. Son amour-propre saignait. Et l’effroyable explication qu’il avait donnée à Pardaillan était exacte : Guise, Maurevert, Maineville et Leclerc avaient résolu de s’unir pour terrasser Pardaillan et de ne rien tenter l’un sans l’autre.
Bussi-Leclerc sortit donc en toute hâte de la chaumière, et par un chemin de traverse que lui indiquèrent ses hôtes, gagna la place de l’Église, au coin de laquelle se dressait un grand calvaire. Autour de ce calvaire, quelques tentes avaient été dressées, et le duc de Guise dormait dans l’une d’elles sur un lit de camp, tandis que Maurevert et un autre officier dormaient sur des bottes de paille. Quant à Maineville, il avait, comme Bussi, cherché gîte dans le village.
Leclerc envoya chercher Maineville qui, une demi-heure plus tard, arriva en pestant fort contre l’interruption de son sommeil. Alors, il fit également réveiller le duc, et, ayant eu la permission d’entrer dans la tente, les quatre se trouvèrent réunis. Et Bussi-Leclerc fit le récit de ce qui venait de se passer. Guise proféra une imprécation de rage ; Maineville sortit sa dague et en tâta la pointe ; Maurevert prononça ces étranges paroles :
– Puisqu’il en est ainsi, monseigneur, le voyage à Chartres est inutile : nous ferions mieux de retourner à Paris.
– Pourquoi ? s’écrièrent Maineville et Bussi-Leclerc.
– Parce que, dit sourdement Maurevert, si Pardaillan est dans la procession, la procession est maudite ! Parce que ce n’est pas Henri III qui sera tué, mais nous !
Et ces quatre hommes également braves, dont l’un était tout puissant, passèrent le reste de la nuit à discuter comment ils se débarrasseraient de l’aventurier. Guise, sombre et pensif, écoutait sans rien dire ses trois fidèles conseillers. Mais comme le jour se levait, il donna l’ordre de se mettre en route.
– Pour Paris ? demanda Maurevert.
– Pour Chartres ! répondit le duc.
– Pardieu ! firent Bussi et Maineville. C’est tout simple !
Maurevert haussa les épaules et s’assura que sa cotte de mailles était solidement bouclée.
La procession se mit en marche, dans le même ordre que nous avons dit, avec les mêmes chants et les mêmes cris ; tout ce monde s’engouffra par la porte Guillaume dans la bonne ville de Chartres et se dirigea vers la cathédrale.
Ce qu’on appelle aujourd’hui la ville haute n’existait pour ainsi dire pas à cette époque. En revanche, la ville basse a gardé à peu près l’aspect qu’elle avait alors, avec ses ruelles tortueuses, ses maisons à pignons gothiques, chargées de sculptures en bois, hérissées de tourelles.
Une fois la porte franchie, la tête de la procession se trouva en présence d’une nombreuse troupe armée. Guise reconnut Crillon à cheval, qui venait à sa rencontre.
– Monseigneur, dit Crillon, Sa Majesté m’a fait l’honneur de me charger de vous venir souhaiter la bienvenue, ainsi qu’aux fidèles sujets qui vous escortent.
Un grand silence s’établit. Guise jeta un sombre regard sur les ruelles avoisinantes qui regorgeaient d’hommes d’armes. Crillon reprit :
– Sa Majesté, pour vous faire honneur, voulait absolument que je vinsse à votre rencontre avec huit mille arquebusiers et les trois mille cavaliers que nous avons assemblés autour de Chartres. Mais j’ai fait observer à Sa Majesté que deux ou trois mille hommes suffisaient pour escorter une procession...
– Vous avez bien fait, messire. Où et quand pourrai-je voir le roi avec les échevins de Paris ?
– Le roi est en ce moment à la cathédrale.
– Allons donc à la cathédrale ! dit Guise.
– Monseigneur, je vous montre le chemin. Il serait inutile que ces dignes pénitents essayassent d’en trouver un autre que celui par où je vais avoir l’honneur de vous conduire. En effet, toutes les rues sont pleines de nos gens d’armes qu’a attirés une légitime curiosité, sans compter les bourgeois de cette bonne ville qui attendent le roi pour l’acclamer...
– Allez, messire ! dit Guise. Nous sommes venus en fidèles sujets, et nous joindrons nos acclamations à celles de la ville.
Et levant sa toque empanachée et ornée d’un triple rang de perles, Guise, d’une voix forte, cria :
– Vive le roi !
Mais derrière lui, une immense acclamation répondit :
– Vive Henri le Saint !...
C’était la procession qui donnait ainsi son avis, si bien que Crillon se demanda un instant s’il ne ferait pas mieux de fermer les portes et de laisser hors des murs les trois quarts des pénitents qui attendaient. Mais Crillon, brave amoureux du danger, se dit qu’il serait ridicule d’avoir l’air de redouter des porteurs de cierges. Ordonnant donc à ses hommes, d’un coup d’œil, de surveiller étroitement les arrivants, il se dirigea vers la cathédrale. Guise suivait avec ses gentilshommes. Derrière ce groupe venait la procession des Parisiens que les gens de la ville, du haut de leurs fenêtres, examinaient curieusement, et non sans une certaine sympathie.
L’apparition de Jésus, suant sous son énorme croix de carton et plus flagellé que jamais, fut saluée par un long murmure de pitié, d’autant plus que Jésus criait à pleine voix :
– Sire ! Sire roi de France, où êtes-vous ? N’êtes-vous pas le fils aîné de l’Église ? Me laisserez-vous ainsi maltraiter par les damnés huguenots ?...
– Mort aux parpaillots ! crièrent d’enthousiasme les bourgeois à leurs fenêtres.
Guise devint radieux ; le front de Crillon s’assombrit.
Devant la cathédrale, la foule était plus serrée, plus nerveuse, et Guise put lire sur tous ces visages de bons provinciaux la curiosité passionnée qu’il inspirait. En effet, Henri III, après sa fuite, avait été accueilli par les habitants de Chartres avec courtoisie, mais sans enthousiasme. Là comme dans tout le royaume, le nom de Guise était populaire et celui du roi méprisé ou détesté. Le duc comprit alors la faute terrible qu’il avait commise en perdant un temps précieux. S’il s’était fait couronner le lendemain de la journée des Barricades, la France entière le reconnaissait et l’acclamait. Il avait cru ne tenir que Paris. Il avait eu peur des provinces...
– Ô Fausta, murmura-t-il, comme vous aviez raison ! Et pourquoi ne me suis-je pas confié à votre profonde sagesse ?... Mais il n’est pastrop tard !... Un coup de poignard peut tout réparer !...
Et il jeta les yeux autour de lui, comme pour chercher s’il n’apercevrait pas le moine. À ce moment, les portes de l’immense cathédrale s’ouvraient, et une foule de gentilshommes en sortaient, refoulant les bourgeois. En même temps les soldats de Crillon, par une habile manœuvre, coupèrent la procession et ne laissèrent autour de Guise qu’une dizaine de ses familiers.
– On se méfie de nous, ici ! dit le duc en fronçant le sourcil.
– Non pas, monseigneur, on vous rend les honneurs, répondit Crillon.
Joyeuse, quelques-uns de ses apôtres et ses deux flagellants se trouvaient dans ce cercle formé par les gens d’armes, les gentilshommes royaux et la foule.
– Frappez ! Frappez ! dit Joyeuse.
Les deux flagellants se mirent à frapper à tour de bras, avec leurs fausses lanières.
– Sire ! s’écria Jésus, Sire roi de France, où êtes-vous ? Voyez ce que font les huguenots ! et pourtant, je ne me plains pas !...
Un grondement de la foule des bourgeois répondit à ces paroles. Et déjà, comme à Paris, les cris de : « Vive Henri le Saint ! » éclataient, lorsque Jésus, c’est-à-dire Joyeuse, se mit à pousser des lamentations qui, cette fois, n’avaient rien de feint. En effet, quatre pénitents venaient de s’approcher de lui, et s’étaient mis à le flageller, non plus avec des lisières de drap ou des lanières de carton, mais avec de bonnes et solides étrivières de cuir. Du coup, Joyeuse laissa tomber sa croix ; il voulut bondir, s’échapper ; mais les quatre le tenaient, et les coups tombaient sur ses épaules, sur ses reins, sur sa tête...
– Miséricorde ! hurlait l’infortuné. Au meurtre ! Au feu ! À moi ! On me tue !...
Cela dura quelques minutes, pendant que les soldats contenaient la foule, pendant que Guise, pâle et stupéfait, se demandait s’il n’était pas venu se jeter dans la gueule du loup. Les quatre enragés frappaient de plus belle, et Joyeuse ne laissait plus entendre qu’un gémissement plaintif.
– Assez ! dit tout à coup une voix forte.
Un homme venait de paraître sous le porche de la cathédrale et s’avançait vers Jésus. Les quatre flagellants cessèrent aussitôt leur besogne, et s’étant précipités dans l’église où ils se dépouillèrent de leurs frocs, apparurent sous les traits de Chalabre, Montsery, Loignes et Sainte-Maline...
L’homme qui venait de surgir s’avançait avec une sorte de dignité vers le malheureux Joyeuse. À son aspect un grand silence s’établit, les gens de Crillon présentèrent les armes, Guise mit pied à terre et, se découvrant, s’inclina profondément...
Cet homme, c’était le roi de France.
Estrapade : supplice qui consistait à hisser le coupable à une certaine hauteur puis à le laisser tomber plusieurs fois violemment.
La salade est une sorte de casque en forme de voûte, ouverte ou fermée, d’origine italienne.
II
Henri III
Le roi, sans faire attention à Guise, s’arrêta devant Joyeuse et, s’agenouillant, cria dans le silence :
– Mon Seigneur Jésus, vous m’avez appelé, moi, pauvre roi que ses sujets ont frappé, abandonné, chassé ! Me voici, mon doux Seigneur Jésus ! Et puisque vous avez tant fait que de m’appeler à votre aide, laissez-moi essuyer le précieux sang qui coule de vos plaies !...
À ces mots, Henri III se releva, saisit son mouchoir et se mit à essuyer Joyeuse qui balbutiait :
– Sire !... Sire !... que d’honneur !...
La foule est mobile dans ses sentiments. À la vue du roi s’agenouillant devant le figurant qui représentait Jésus, s’incorporant pour ainsi dire à la procession parisienne et adoptant d’emblée ses pensées, des applaudissements furieux éclatèrent. Le roi leva les bras pour commander le silence.
– Qu’on saisisse ces deux misérables ! cria-t-il en désignant les deux flagellants effarés ; qu’on les jette en prison et qu’on les flagelle à leur tour, et puis qu’on les pende haut et court !
– Mais, Sire, bégaya Joyeuse, Votre Majesté fait erreur... ce ne sont pas eux...
– Mon Seigneur Jésus vous fait grâce de la pendaison ! reprit Henri III. Vous serez donc seulement emprisonnés et flagellés ! Qu’on les emmène...
Les deux infortunés figurants furent saisis, et malgré leurs cris de miséricorde, aussitôt entraînés.
– Ainsi seront traités les ennemis de Dieu et de l’Église ! cria Henri III. Une immense acclamation salua ces paroles, et cette fois, ce fut un grand cri de « Vive le roi ! » qui monta jusqu’au ciel. Henri III, à ce grand cri de « Vive le roi ! » qu’il avait fini par oublier, eut un éclair dans les yeux. Alors, il se tourna vers le duc de Guise :
– Mon cousin, dit-il, allons louer et bénir le Seigneur de la grande joie qu’il nous accorde en ce jour. Et puis, nous écouterons en l’hôtel de messieurs les échevins de cette bonne ville les plaintes que nos Parisiens vous ont chargé de nous transmettre. Qu’on laisse entrer mes chers Parisiens dans la cathédrale...
Et tournant le dos à Guise, avant que celui-ci eût ouvert la bouche pour répondre, il se dirigea le premier vers le portail central large ouvert à deux battants.
« Oh ! gronda Guise en lui-même, ce fantôme de roi ose me braver et se moquer de moi ! Et j’hésitais !... Patience ! J’aurai ma revanche, et elle sera terrible !... »
Il suivit avec ses gentilshommes et pénétra dans l’énorme église, où la messe d’action de grâces fut aussitôt commencée. Le roi avait donné l’ordre de laisser entrer les pénitents venus de Paris. Mais, en réalité, la cathédrale se trouvait si bien remplie de ses gentilshommes et de ses gens d’armes que c’est à peine si une vingtaine des familiers de Guise purent trouver place dans la nef.
Le roi s’était assis sur un trône couvert d’un dais et entouré de gardes. Dehors, la foule des pénitents parisiens et des bourgeois de Chartres confondus prenait de cette messe ce qu’elle pouvait en prendre, c’est-à-dire ce qui lui arrivait de cantiques et de bénédictions par les portes ouvertes.
Quand la messe fut terminée, Henri III, toujours entouré de gardes, sortit de l’église et se dirigea vers l’hôtel des échevins, où il recevait de la ville de Chartres une hospitalité sinon royale, du moins très suffisante pour un roi sans royaume. Il n’avait pas adressé un mot à Henri de Guise.
Sur le parvis, le duc s’était arrêté, incertain de ce qu’il ferait, dévorant sa rage et se demandant s’il n’allait pas reprendre à l’instant le chemin de Paris.
À ce moment, l’un des gentilshommes d’Henri III, le marquis de Villequier, s’approcha de lui et, l’ayant salué, lui dit :
– Monsieur le duc, le roi mon maître m’a chargé de vous dire qu’il vous recevra demain matin, à neuf heures, en audience à l’hôtel de ville, ainsi que les robins et bourgeois qui vous servent d’escorte...
Un murmure menaçant éclata parmi les gentilshommes de Guise. Mais celui-ci les calma d’un geste :
– Dites à Sa Majesté, répondit-il, que je la remercie de l’audience qu’elle veut bien m’accorder et que je m’y trouverai à l’heure dite. Mais dites-lui que je ne la remercie pas d’avoir choisi un messager tel que vous...
Villequier était en effet aussi haï et détesté des Guisards que d’Épernon lui-même.
– Je ferai votre commission, monsieur le duc, dit-il simplement, avec un mince sourire.
Là-dessus, Guise et ses gens se dirigèrent vers l’hôtellerie du Soleil-d’Or, sise aux bords de ce bras de l’Eure qui traverse la ville, tandis que l’autre bras coule hors des murs. Quant au cardinal de Guise, quant à Mayenne, ils s’y étaient rendus directement et ne s’étaient pas montrés depuis l’entrée de la procession à Chartres. Au moment où Guise et ses gentilshommes entraient dans l’hôtellerie, Maurevert saisit le bras de Maineville près de lui, et lui montrant une figure dans la foule, lui dit en pâlissant :
– Regarde !...
– Qu’est-ce ? fit Maineville insoucieux.
– Non, ce n’est pas lui ! reprit alors Maurevert en passant la main sur son front... mais il m’a semblé d’abord que c’était Pardaillan...
Le duc entendit ces mots et tressaillit.
– Où est-il ? demanda-t-il d’une voix basse et rauque.
– Il est mort ! répondit quelqu’un près de lui. Ne vous en inquiétez plus !...
Guise, Maineville, Bussi-Leclerc, Maurevert, d’un même mouvement, se retournèrent et virent la duchesse de Montpensier qui souriait. Elle fit signe à Guise de la suivre.
– Pardieu ! grogna Bussi-Leclerc, s’il est mort, il n’y a pas longtemps ! Le duc, troublé, avait marché jusqu’à l’appartement qui lui était destiné, entraîné par sa sœur.
– Mon frère, lui dit celle-ci quand ils furent seuls, vous devez cesser désormais de vous enquérir de ce Pardaillan, qui plus que de raison vous a mis la cervelle à l’envers.
– Vous dites qu’il est mort ? Comment le savez-vous ?
– Je le sais par celle qui sait tout, qui jusqu’ici ne s’est jamais trompée, ne nous a jamais trompés...
– Fausta ? fit le duc en tressaillant.
– Voici ses paroles : « Dites au duc que Pardaillan est mort ; et s’il s’étonne, ajoutez que c’est moi qui l’ai tué. » Voilà les paroles que je devais vous répéter dès que vous seriez entré dans Chartres.
– Et depuis que nous sommes dans Chartres, elle ne vous a rien dit ?
– Elle vient de me confirmer la chose.
Guise demeura pensif. Bussi-Leclerc s’était-il trompé ?... Mais après tout, Bussi-Leclerc n’avait pas vu Pardaillan ; il l’avait entendu seulement. Non, Fausta ne se trompait jamais ! Sans doute, elle savait que Pardaillan était dans la procession. Sans doute elle avait établi quelque piège où cette nuit même le chevalier était tombé. Pardaillan avait donc été tué par les gens de Fausta au cours de la dernière nuit, après sa rencontre avec Leclerc.
Guise dissimula soigneusement ses impressions. Mais le profond soupir qui lui échappa prouva à sa sœur quel soulagement il éprouvait de cette nouvelle.
– Laissons cela, reprit-il. Que cet aventurier soit mort ou vif, la question est de maigre importance. Où est l’homme ?
– Dans Chartres, répondit tranquillement la duchesse. Il est venu avec la procession.
Quelle que fut l’insensibilité de Guise, il ne put s’empêcher de frissonner à la pensée que l’assassin d’Henri III avait voyagé avec lui et qu’à cette heure même, le moine s’apprêtait à porter le coup mortel au roi.
– Êtes-vous prêt, mon frère ? reprit Marie de Montpensier.
– Prêt ?... Qu’entendez-vous par là ? fit le duc en frémissant. Je ne veux, d’aucune façon, être mêlé à ce qui va se passer. Je suis perdu si jamais on apprend...
– Soyez donc tranquille ! La mort du roi ne sera qu’un de ces accidents que Dieu permet parfois, que l’histoire enregistre aveuglément et que les peuples accueillent comme des événements de délivrance. Nul ne saura. Jacques Clément lui-même ne sait pas. Seulement soyez prêt, mon frère !...
– Quand aura lieu... l’accident ?
Marie de Montpensier regarda fixement son frère et répondit :
– Demain !...
Le duc tressaillit, passa la main sur son front et murmura :
– Si tôt !...
– Le plus tôt est le mieux, fit sourdement la duchesse dont le visage si riant d’ordinaire prit une effrayante expression de haine. Les jours de Valois sont comptés. À quoi bon prolonger son agonie et la nôtre ?
– Oui, oui, vous avez raison... balbutia le duc.
– Demain, après l’audience, Valois se rendra à la cathédrale, en procession, les pieds nus, un cierge à la main et couvert d’un sac. C’est un vœu qu’il a fait s’il se réconciliait avec Paris. Or, demain la réconciliation sera parfaite. Le moine marchera près du roi, car dans ces processions, il est accessible à tous. Le coup lui sera porté devant la cathédrale. Vous, cependant, vous réunirez hors des murs ce que vous avez de gentilshommes et de ligueurs... le reste vous regarde !
Marie de Montpensier s’enveloppa alors d’une capuche qu’elle rabattit sur sa tête, fit un dernier signe à son frère et, étant sortie, retrouva dehors deux gentilshommes qui se mirent à l’escorter : c’étaient deux de ces cavaliers qui pendant le voyage de Paris à Chartres avaient entouré la mystérieuse litière qui marchait en queue de la colonne.
Quant au duc de Guise, ayant fait appeler Mayenne et le cardinal, il conféra longtemps avec eux. Puis, vers le soir, il se mit à table, et voulut que Maurevert, Leclerc et Maineville prissent place à ses côtés. Et malgré la gravité de la situation, malgré l’acte terrible qui se préparait dans l’ombre, ce fut encore de Pardaillan qu’ils causèrent. Bussi-Leclerc se rappela fort à propos que le chevalier lui avait dit :
– Je n’arriverai peut-être pas jusqu’à Chartres !...
Il ne fallait plus en douter : Pardaillan était mort et bien mort.
– Ma foi, je le regrette ! fit Maineville. J’eusse eu plaisir à le lier sur une aile de moulin.
– Moi aussi, dit Bussi-Leclerc.
Quant à Maurevert, il se contenta de sourire.
Vers cette heure-là, et comme la nuit tombait, celui qui faisait l’objet, de ces pensées railleuses ou sinistres dînait tranquillement avec le duc d’Angoulême dans une petite auberge, à une table accotée contre une fenêtre basse. En face de l’auberge se dressait un de ces mornes hôtels comme on en voit encore à Chartres et, de temps à autre, Pardaillan, soulevant les rideaux de la fenêtre, jetait un rapide coup d’œil sur la façade de l’hôtel où tout était éteint et clos.
– À qui appartient cet hôtel ? demanda Pardaillan à la servante, en soulevant encore une fois le rideau.
La servante s’arrêta de marcher, regarda, sourit et dit :
– Cet hôtel ?... Ah ! dame... il appartient comme qui dirait à personne. C’est-à-dire, dans les temps jadis, c’était l’hôtel des sires de Bonneval, à ce qu’on dit du moins. Mais depuis que je vis, et il y a vingt-neuf ans de cela, je n’ai jamais vu personne entrer là-dedans, jamais la porte ou les fenêtres s’ouvrir.
– Oui, murmura Pardaillan, mais en ce moment, des gens sont rassemblés là-dedans. Et je voudrais bien savoir ce qu’ils font...
– Que voulez-vous qu’ils fassent, cher ami ? grommela le duc d’Angoulême. Que voulez-vous qu’ils fassent, si ce n’est de conspirer quelque mauvais coup, puisque c’est la Fausta qui les a assemblés là ?...
– C’est vrai. J’ai vu ma belle tigresse et ses gens se glisser dans l’hôtel par la porte du jardin. Sans doute, ils conspirent, mais quoi ?...
– Pardaillan, fit le jeune duc avec un soupir, comme nous sommes loin de...
– De Violetta, hein ?... Patience, mon prince, patience ! Il y a deux êtres au monde qui peuvent nous faire savoir de quel côté nous devons nous tourner : c’est Fausta... et c’est Maurevert. Nous les suivons. Nous les tenons. Il faudra bien que l’un ou l’autre tombe dans nos mains. En tout cas, nous sommes sur un lit de roses, si je compare notre situation à celle où je me trouvais quand j’étais dans la nasse de Mme Fausta.
Pardaillan eut une grimace de la bouche plissée, ce qui indiquait combien peu lui était agréable le souvenir qu’il venait d’évoquer.
– Cher ami, dit le duc d’Angoulême, voici trois ou quatre fois que je vous entends dire : « Quand j’étais dans la nasse ». En somme le prince Farnèse ne m’a rien dit, sinon que je devais vous attendre à la Devinière.
– Où je vous ai rejoint après être sorti de la nasse, fit Pardaillan qui jeta un nouveau regard dans la rue.
– La nasse ! reprit Charles. Encore la nasse ! Expliquez-moi...
– Comment, monseigneur, vous ne savez pas ce que c’est qu’une nasse ? Moi, j’en ai vu en Provence, aux environs de Marseille. Figurez-vous une grande cage en osier avec une porte par où l’on peut entrer, mais par où l’on ne peut plus sortir. Les pêcheurs plongent cette cage au fond de la mer, avec une corde au bout de laquelle se trouve un signal en liège qui flotte pour faire reconnaître l’endroit. Avez-vous mangé des langoustes, monseigneur ? C’est délicieux.
– Certes, fit Charles, qui ne s’habituait pas à suivre cet esprit en apparence audacieux et au fond si simple. Mais que viennent faire ici les langoustes ?
– C’est pour vous expliquer la nasse, dit Pardaillan vraiment étonnéde la question. Suivez la langouste au fond de la mer, que fait-elle ? Ellesent l’appât que le pêcheur a mis dans la nasse. Elle s’approche de cette cage d’osier, elle tourne autour, très ennuyée de ne pouvoir entrer s’emparer de l’appât. À force de tourner, elle se glisse à travers uneouverture. Mais notez que pour cela elle est obligée d’écarter les brins d’osier placés en entonnoir... Encore un petit effort et l’entonnoir s’ouvre, les osiers s’écartent... Mais dès qu’elle est entrée, les osiers reprennent leur position primitive : elle ne peut plus sortir... elle est dans la nasse !... Eh bien, moi aussi, j’étais dans la nasse. Il y avait bien un trou pour y entrer, mais il n’y avait plus moyen de sortir par le trou. Maintenant, figurez-vous que la nasse, au lieu d’être en osier était en fer, un solide treillis en fer, et que, dans chaque maille, je pouvais à peine passer les bras... Heureusement il y avait des cadavres, sans quoi je serais encore dans la nasse... C’est une jolie invention de Mme Fausta, que Dieu veuille me garder saine et sauve, car j’ai résolu de lui rendre épouvante pour épouvante...
Le jeune duc frissonna. Il entrevoyait, à travers l’explication de Pardaillan, une de ces hideuses aventures auxquelles succombent les esprits les plus fermes.
– Monseigneur, reprit le chevalier en soulevant son chapeau, dites-moi, est-ce que mes cheveux n’ont pas blanchi ?
– Non, mon ami ; je les vois tels que je les ai toujours vus, d’un beau châtain foncé.
– Ah ! Cela m’étonne ! Car, j’ai eu peur, j’ai connu la peur, dans ce qu’elle a d’affolant, avec ce délire qu’elle fait monter à la cervelle. Heureusement, comme je vous le disais, il y avait les cadavres... Ah ! ah ! s’interrompit Pardaillan, le voici ! Attention !...
Le chevalier n’avait cessé de regarder à travers les petits vitraux ronds et verts de la fenêtre. Charles regarda, lui aussi, et, dans la nuit de la ruelle, vit une ombre qui s’avançait.
– Je savais bien qu’il viendrait ! Et qu’il viendrait là ! murmura Pardaillan.
L’ombre se rapprochait de la grande porte de l’hôtel qui, d’après la servante, était inhabité depuis de si longues années. C’était un homme enveloppé d’un manteau qui lui cachait la figure. Mais, sans doute, Pardaillan le reconnaissait à la taille et à la démarche, car il répéta :
– C’est lui !
L’homme ne heurta pas le marteau de la porte, mais frappa dans ses mains. La grande porte s’entrouvrit aussitôt et l’inconnu se glissa dans l’intérieur. Pardaillan sourit comme un homme enchanté de voir ses prévisions se réaliser.
– Qui est-ce ? demanda Charles.
– Vous le saurez tout à l’heure, dit Pardaillan en laissant retomber le rideau. Lorsque je me réveillai, j’étais assis, vous le savez, à califourchon sur deux poutres dont l’une plongeait dans l’eau et dont l’autre partait en diagonale pour aller soutenir le plancher de la salle où se tenait le trou carré... l’entrée de la nasse. J’avais dormi. Comment ? Je n’en sais rien, mais je crois qu’il m’eut été impossible de ne pas dormir, tant j’avais la tête fatiguée au moment où, pour éviter les cadavres, j’atteignis la fourche. Alors, je vis qu’il faisait à peu près jour ; la lumière entrait par-dessus le plancher qui était au-dessus de ma tête, et je vis que j’étais entouré de poutres qui s’enlaçaient comme les madriers d’un échafaudage : « Pardieu ! me dis-je, je n’ai qu’à gagner de poutre en poutre jusqu’à l’extérieur ! » Et je me suis mis en chemin, c’est-à-dire que je voulus gagner la poutre voisine qui me rapprochait de la grande ouverture par où coulaient tout à la fois l’eau du fleuve et la lumière du jour. Ce fut alors que je me heurtais au treillis de fer... J’avais oublié la nasse !...
Charles vida son verre, comme pour se donner le courage d’entendre ce récit.
– Alors, continua Pardaillan, j’examinai cette machine à prendre les hommes. Et je vis que j’étais perdu. En effet, la nasse formait comme un puits en treillis de fer, qui partait du plancher même pour aller plonger dans l’eau. Je dus abandonner l’idée qui m’était venue de me hisser de maille en maille pour arriver à passer par-dessus, puisque, en me hissant, j’aboutissais au plancher. L’idée inverse me parut la bonne : c’est-à-dire que je m’accrochais aux mailles, et que je me mis à descendre, dans l’espoir que je pourrais passer par-dessous en plongeant. Arrivé au ras de l’eau, je fus heurté de nouveau par les cadavres. Mais je fusse passé à travers une légion de fantômes d’enfer. Je sentais ma gorge en feu et mes cheveux se hérisser sur ma tête ; j’avais une soif à vider un tonneau ; mais, la seule pensée de m’humecter seulement les lèvres avec cette eau où les cadavres avaient dansé toute la nuit me donnait d’insupportables nausées. Enfin, comprenant que la folie allait me gagner si je ne sortais au plus tôt, je me laissai glisser parmi les cadavres. Et alors, oh ! alors, je compris pourquoi les cadavres ne s’en allaient pas, pourquoi ils ne plongeaient pas !... Lorsque j’eus de l’eau jusqu’aux épaules, je sentis avec mes pieds que, de toutes parts, le treillis de fer se rejoignait dans l’eau et que cela formait comme le fond d’une bouteille !... Pas moyen de sortir par en haut ! Pas moyen de sortir par en bas !... Je me hissai le long des mailles de fer pour éviter l’attouchement des cadavres, et, accroché à une certaine hauteur, je m’arrêtai, et j’eus la pleine horreur de ma situation : j’étais destiné à mourir lentement dans ce puits de fer !...
– C’est horrible ! dit Charles en frémissant.
– Justement. Comme vous dites, c’était horrible, et je voudrais bien voir la figure que ferait Mme Fausta si elle se trouvait dans une situation pareille... Je n’avais plus de souffle, plus de pensée, plus rien en moi qu’une sorte de sentiment de vertige, si bien qu’après quelques heures je pris la résolution de grimper jusqu’en haut et de frapper au plancher jusqu’à ce qu’on m’entendit, jusqu’à ce qu’on achevât de me tuer !
– Et comment êtes-vous sorti ? demanda Charles avec une sorte d’avidité.
Pardaillan se mit à rire et répondit :
– C’est bien simple ; je suis sorti avec les cadavres.
– Avec les cadavres !... Oh ! mon ami, je vous écoute ; et il me sembleentendre le récit d’un rêve fantastique, d’un hideux cauchemar !
– C’est à peu près l’effet que cela me produit à moi-même, dit Pardaillan. Je n’y pensais plus, aux cadavres ! Heureusement, Fausta y pensait, elle ! Sans doute, cela ne devait pas lui être fort agréable de dormir au-dessus de ces morts. Pour cette raison, ou pour d’autres, il est certain que si les morts étaient prisonniers dans la nasse, Fausta devait avoir la pensée de leur rendre la liberté. Et comment rendre libres ces cadavres prisonniers ? En les repêchant l’un après l’autre ? Non, non ! Fausta est la femme des combinaisons simples ! Pour délivrer les morts, il n’y avait qu’à les laisser partir au fil de l’eau !
Pardaillan se mit à rire, puis jeta à l’extérieur un coup d’œil inquiet.
– Il ne faut pas manquer la sortie de notre homme, dit-il.
– L’homme qui est entré là, dans cet hôtel ?
– Oui, il prend les derniers ordres de la belle Fausta... Donc, comme je vous l’ai dit, j’étais, depuis plusieurs heures, accroché au treillis de fer, à demi assis sur une poutre, et je luttais contre les pensées de folie, lorsque j’entendis au-dessus de moi une sorte de grincement ; et en même temps, de l’autre côté du treillis, je vis une chose que je n’avais pas remarquée encore : une corde !... et cette corde montait ! D’en haut, on la tirait. Levant les yeux, je vis qu’elle passait à travers un trou pratiqué dans le plancher. Alors, d’un coup d’œil, je suivis la corde de haut en bas, et je fus à l’instant même rassuré... En effet, monseigneur, la corde soulevait un pan, un carré de treillis qui se rabattait en haut, et laissait béante, dans l’eau, une large ouverture. Dans le même instant, je vis les cadavres qui s’en allaient en se bousculant comme s’ils eussent eu hâte de sortir. Au bout de deux minutes ils étaient tous partis entraînés par le fleuve. Je pense que vous devinez le reste...
Pardaillan avala un grand gobelet de vin et ajouta :
– Je fis comme eux... voilà tout !
– Voilà tout ! murmura Charles tout pâle.
– Je fis ce que n’importe qui eût fait à ma place ; je descendis... non : Je me laissai tomber dans l’eau, je franchis l’ouverture d’une brassée frénétique, et me trouvai hors de la nasse. Dix minutes plus tard, j’abordais au point où sont commencés les travaux du nouveau pont1...
Un long silence suivit ces paroles... Charles ne pouvait digérer la simplicité avec laquelle Pardaillan lui avait fait ce récit d’horreur, et considérait son compagnon avec une sorte d’effroi. La servante s’était endormie au coin de l’âtre où elle avait commencé à filer une quenouille, assoupie par le ronflement ouaté de son rouet et le murmure des voix de ces deux étrangers. Le chevalier sifflotait entre ses dents, et regardait toujours par la fenêtre.
– Il est temps de sortir, dit-il enfin. Eh ! la belle enfant !
La servante se réveilla en sursaut et vint à l’appel.
– Dites-moi, mon camarade et moi, nous voudrions prendre l’air avant de nous coucher dans la chambre hospitalière que vous nous offrez. Comment ferons-nous pour rentrer ? Je dis : rentrer sans frapper, ni réveiller personne...
– Dame ! mon digne gentilhomme, vous passerez par les écuries, que je laisserai ouvertes ; et une fois dans la cour, vous n’aurez qu’à monter l’escalier de bois qui est à l’intérieur.
Pardaillan s’était sans doute rendu compte de la disposition des lieux, car il approuva d’un signe de tête, s’enveloppa de son manteau et, suivi de Charles, sortit par la porte de l’auberge qui, aussitôt, se referma derrière eux. Dans la rue, ou plutôt dans la ruelle étroite et tortueuse où ils se trouvaient, Pardaillan fit une dizaine de pas, puis s’arrêta dans un renfoncement.
– Attendons ici, murmura-t-il ; notre homme ne saurait tarder à sortir.
– Qui est-ce ? demanda Charles pour la deuxième fois.
– Vous ne l’avez pas reconnu ?... C’est le moine ! C’est Jacques Clément ! C’est l’homme qui, à l’auberge du Pressoir de fer, était assis près de nous et nous écoutait...
– L’homme qui a dit qu’il vous vengerait en se vengeant...
– Oui : de Catherine de Médicis !...
– Qu’il se vengerait en frappant la vieille reine au cœur !...
– C’est-à-dire en assassinant son fils Henri III, dit froidement le chevalier. Qu’avez-vous à frissonner ainsi, monseigneur ?
– Pardaillan ! fit le jeune duc, ceci est affreux.
– Eh quoi ! vous vous plaignez ! Songez que votre père a été poussé au désespoir, à la folie, à la mort par trois êtres qui étaient : sa mère Catherine, son frère le duc d’Anjou, aujourd’hui roi de France, et enfin monseigneur le duc de Guise ! Le hasard veut qu’un homme, un de ces êtres que la fatalité marque dès leur enfance, se trouve et qu’il vous épargne la besogne ! Vous voulez, vous cherchez un terrible châtiment contre le roi ?
En parlant ainsi, Pardaillan cherchait à étudier le visage de Charles.
– Oui, dit celui-ci. J’ai toujours pensé que mon oncle Henri de France tomberait un jour sous la morsure imprévue de l’une de ces douleurs qu’il a semées sur la route de sa vie. Mais si cela dépend de moi, Pardaillan, Jacques Clément ne frappera pas le roi. Ce n’est pas cela que je voulais !...
– Ainsi, monseigneur, si vous le pouvez, vous arrêterez le bras du moine ?