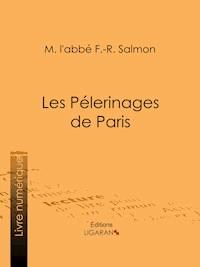
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est bien le plus modeste de tous les sanctuaires, c'est, dans une chambre disposée en chapelle, un tout petit oratoire dont presque personne ne connaît l'existence, qui seul rappelle aujourd'hui le souvenir du martyre de saint Denis, sur les lieux qui en furent témoins. Il se trouve au versant occidental de la colline de Montmartre, dans une maison sans apparence de la rue Marie-Antoinette, qui sert d'asile à de jeunes enfants."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’auteur soussigné, voulant se soumettre entièrement au décret porté par la Sacrée-Congrégation et renouvelant la déclaration qu’il a faite précédemment, remet purement et simplement son ouvrage au jugement du Saint-Siège et à la correction de l’Église catholique, apostolique et romaine, dont il est et veut rester à jamais le fils très soumis.
Paris, 18 septembre 1874.
Dans le Tour du monde religieux, il convenait de donner une place à part et la première aux pèlerinages majeurs et aux sanctuaires fameux qui, dans l’antiquité chrétienne, ont été les grands centres autour desquels ont rayonné les peuples de tout l’univers catholique. La Terre-Sainte, Rome et Saint-Jacques de Compostelle avaient droit à la primauté de rang et d’honneur que l’Église leur a toujours reconnue. Voilà pourquoi nous avons voulu étudier tout d’abord ces illustres pèlerinages et les présenter à nos lecteurs au triple point de vue de l’histoire des arts et de la religion.
Cette tâche remplie, quelques autres points qui brillent encore comme des astres de première grandeur au firmament du monde catholique, ont attiré nos regards et sollicité notre attention. Nous aurions voulu les saisir tous, placer Notre-Dame de Lorette, Notre-Dame d’Einsilden, Notre-Dame del Pilar, etc., à côté de Saint-Martin de Tours, de Notre-Dame de Chartres et de la cathédrale de Cologne. Mais il fallait se borner. Ces six monographies avaient donné déjà la matière de deux volumes qui ont formé une première-série et paru sous ce titre : Les grands pèlerinages et leurs sanctuaires.
Le cycle des grands pèlerinages n’est pas clos et il faudra y revenir quelque jour. En attendant, le tour du monde religieux doit être poursuivi dans les pays catholiques et spécialement en France. Il convient de commencer par les pèlerinages de Paris, non seulement à cause de l’importance et de l’intérêt qui s’attache aux souvenirs religieux de la capitale, mais surtout parce que Paris, avec le réseau de chemins de fer qui l’enserre, est le centre naturellement indiqué de tous les voyages. C’est de là que les pieuses pérégrinations peuvent rayonner dans tous les sens et sur toutes les lignes, à l’Ouest et à l’Est, au Nord et au Midi ; c’est de là qu’il faut partir pour aller explorer avec quelque régularité toutes les contrées où se dressent des sanctuaires fameux, tous les lieux de bénédiction chers encore à la piété chrétienne et qui ont vu à diverses époques les populations accourir de loin et venir prier à l’abri des saintes murailles, danse quelque temple privilégié.
Nous donnons donc aujourd’hui la seconde série de nos pèlerinages qui comprend, en deux volumes, Paris et les environs de Paris jusqu’aux limites du diocèse de Versailles.
La troisième série qui embrassera tous les pèlerinages de l’Ouest, sera prochainement offerte au public religieux.
Jamais le temps ne fut plus favorable à ces belles études où la poésie, les arts, la science et la religion se rencontrent et se donnent la main ; jamais, grâce à la tournure des esprits et aux circonstances que nous traversons, il n’y eut plus d’opportunité à les poursuivre et à mettre en relief ce côté de l’histoire chrétienne. Le mouvement des pèlerinages qui se dessinait à peine, lorsque nous commencions, au lendemain des horreurs de la Commune, nos premiers travaux, avec le pressentiment que les malheurs de l’Église et de la France allaient faire monter vers les cieux un immense concert de supplication, que, pour répondre à des scandales publics, la piété voudrait avoir des manifestations publiques et reprendrait les voies des augustes sanctuaires, a dépassé toutes les prévisions et pris des proportions inouïes qui enveloppent aujourd’hui tout l’univers catholique. Partout, la vie religieuse s’est manifestée sous cette forme, si active, si féconde et si multipliée, que notre siècle de positivisme et d’indifférence a changé de caractère et a donné la main, à travers les âges aux siècles de foi où les pèlerinages furent le plus en honneur.
Cette disposition des esprits, l’élan qu’elle a produit dans les âmes, les entraînements des foules vers les sanctuaires fameux, auraient suffi à nous encourager dans nos études. Le charme et l’intérêt qui s’attachent à ces questions nous ont captivés d’ailleurs, et nous avons eu l’espoir en même temps qu’une œuvre qui répond aux préoccupations les plus vives de notre époque ne pourrait manquer d’exercer une influence salutaire sur les âmes. Les nombreux témoignages qu’on a bien voulu nous accorder, spécialement ceux que nous avons eu l’honneur de recevoir de la part de plusieurs éminents prélats nous ont fortifié dans notre dessein et aidé dans nos travaux. Depuis lors, une voix, la plus auguste qui soit au monde, a daigné nous faire entendre que ces études ne seraient pas sans utilité. Dès ce moment, la parole du Souverain Pontife et sa bénédiction apostolique ont été les stimulants les plus forts et les meilleurs de la tâche que nous avons entreprise. Voici le bref que Sa Sainteté a bien voulu nous adresser.
Perillustris. et adm. Rndo. Dno. obsmo. Dno. F. Salmon canonico honorario Catalaunensi. Parisios.
PERILLUSTRIS ET ADM. RNDE. DNE.D. OBSME.,
Libenter perspexit illmus. dominus Pius IX tùm ex tuis litteris eximio devotionis sensu conscriptis, tùm ex argumento operis à te elucubrati sub titulo : Les grands pèlerinages et leurs sanctuaires, te occasionem cepisse è publicarum supplicationum officiis, quae per pias peregrinationes tantâ cum fidelium aedificatione in Galliis peracta sunt et peraguntur, ut illustria majorum exempla in hâc re pietatemque proferres, et de religiosis sanctuariis quae catholicus orbis honorat, in opere à te edito dissereres. Quamquam supremi Pontificatus curae non siverint Bmo. Patri, ut posset tui operis lectione frui, tamen gratissimus habuit studium, quod ad hujusmodi argumentum pertractandum contulisti, ac sperat tuam in hâc re industriam et eruditionem ad nutriendum et fecundandum spiritum precum et religionis sensus conditioni temporum congruentes apprimè profuturam. Dùm autem tibi gratias agit pro officio oblationis quod erga Ipsum adhibere voluisti, hujus gratî animi et paternae suae dilectionis testes tibi esse cupit has litteras, quas meo ministerio ad te dari mandavit, simulque apostolicam benedictionem quam in auspicium omnis coelestis praesidii et divinarum gratiarum tibi pro tuâ in Ipsum filiali pietate et obsequio peramanter impertivit.
Ego autem pontificiis mandatis obsequutus hâc occasione libenter utor, ut meae sincerae existimationis et observantiae sensus profitear, queis sum ex animo
Tuî, perill. et adm. Rndo. Dno. obsmo.,
Devotissimus servus.
CAROLUS NOCELLA,
SSmi. Dni. ab eplis. latinis.
Romae, die 9 Julii an 1873.
À Monsieur l’abbé F. Salmon, chanoine honoraire de Châlons, à Paris.
MONSIEUR,
Le très illustre Pontife Pie IX a vu avec plaisir par votre lettre écrite dans un sentiment profond de dévotion et par le sujet de l’ouvrage que vous avez composé sous ce titre : Les grands pèlerinages et leurs sanctuaires, que vous avez pris occasion des prières publiques qui se sont faites et se font encore en France, sous forme de pèlerinages, à la grande édification des fidèles, pour rapporter les illustres exemples et la piété de nos pères à cet égard et pour parler dans votre ouvrage des sanctuaires religieux que vénère l’univers catholique.
Bien que les soins du suprême Pontificat n’aient pas permis au Saint-Père de lire votre livre, Sa Sainteté n’en a pas moins pour très agréable le soin que vous avez mis à traiter ce sujet ; Elle espère qu’en cela, vous contribuerez par votre talent et par votre érudition à entretenir et à propager l’esprit de prière et le sentiment d’une dévotion qui convient si bien aux circonstances du temps présent.
Le Saint-Père vous remercie du soin que vous avez pris de lui offrir votre ouvrage et veut que vous ayez un témoignage de sa reconnaissance et de sa paternelle affection dans cette lettre qu’il me charge de vous adresser ; en même temps, il vous accorde avec amour, en retour de votre filiale tendresse, sa bénédiction apostolique comme un gage de la protection céleste et des grâces divines.
Ayant ainsi rempli les ordres du Souverain Pontife, je profite avec plaisir de cette occasion pour vous témoigner ma sincère considération et les sentiments de respect avec lesquels je suis de cœur
Votre très dévoué serviteur,
CHARLES NOCELLA,
Secrétaire du S.-Père pour les lettres latines.
Rome, le 9 juillet 1873.
C’est bien le plus modeste de tous les sanctuaires, c’est, dans une chambre disposée en chapelle, un tout petit oratoire dont presque personne ne connaît l’existence, qui seul rappelle aujourd’hui le souvenir du martyre de saint Denis, sur les lieux qui en furent témoins. Il se trouve au versant occidental de la colline de Montmartre, dans une maison sans apparence de la rue Marie-Antoinette, qui sert d’asile à de jeunes enfants.
Si les origines qu’on réclame en sa faveur sont bien certaines, il n’y a pas de lieu plus saint dans toute la cité, et ce devrait être le premier pèlerinage de Paris. C’est à cette place même que saint Denis aurait eu la tête tranchée, avec ses deux compagnons, le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère ; c’est ici que se serait ouverte la voie sanglante dans laquelle ont dû marcher plusieurs de ses illustres successeurs, qu’on a vue se continuer naguère jusqu’aux barricades de la place de la Bastille devenues à jamais mémorables par la mort de Mgr Affre, et qui vient aboutir aujourd’hui au chemin de ronde de la prison de la Roquette, rougi du sang de Mgr Darboy.
Tout le monde sait qu’avant la Révolution, une antique chapelle dont nous allons faire l’histoire et qu’on appelait le Martyrium ou le Saint-Martyre, s’élevait sur le terrain qui avait été sanctifié par la passion du fondateur de l’église de Paris. Chose étrange, non seulement il n’en reste plus aucune trace, mais personne ne pouvait, il y a quelques années, dire la place qu’elle avait occupée. Il a fallu, pour arriver à la connaître, recourir aux plans très exacts de l’ancienne abbaye de Montmartre. On y a trouvé la chapelle du martyre faisant face à la porte d’entrée du couvent et l’on a cru pouvoir en marquer remplacement sur le terrain avec une précision rigoureuse. Il faut dire toutefois que les fouilles qui ont été faites, pour découvrir au moins quelques vestiges d’une ancienne crypte fameuse, sont restées inutiles. L’œuvre de destruction avait été complète. On n’en a pas moins acheté le terrain suffisamment désigné comme ayant été le lieu du martyre ; et M. l’abbé Le Rebours, aujourd’hui curé de la Madeleine, y a fait élever, il y a environ trois ans, un petit oratoire dans lequel Mgr l’Archevêque a voulu célébrer la sainte messe, le 3 octobre 1872, jour de la fête de saint Denis. Inutile de remarquer que l’insuffisance même d’un pareil sanctuaire est un appel à la piété des fidèles qui ne peut manquer de reprendre les sentiers du pèlerinage et de remplacer par un monument plus digne la chapelle qui a disparu.
Si l’on s’en tenait aux seules données de l’histoire, sans avoir égard aux décisions récentes qui paraissent avoir tranché la question, il serait difficile de dire avec certitude à quelle époque saint Denis fut envoyé dans les Gaulés par le pontife romain. Les uns tiennent pour le premier siècle et appuient sur des raisons très graves la croyance qui reconnaît, dans le premier évêque de Paris, l’aréopagite Denis, converti par saint Paul, établi par lui sur le siège épiscopal d’Athènes et plus tard dirigé vers nos contrées par le pape saint Clément. D’autres, avec des arguments qui paraissent également sérieux, démontrent qu’il est impossible de faire remonter jusque-là les origines de notre Église, et acceptent la date indiquée par saint Grégoire de Tours, d’après laquelle la mission de saint Denis dans les Gaules serait fixée à la moitié du troisième siècle. C’est une question beaucoup trop complexe au point de vue de la science pour qu’il soit possible de l’étudier ici, et trop sérieuse pour qu’il soit permis de se prononcer sans en avoir fait un examen approfondi. Elle n’a, du reste ; qu’une importance secondaire relativement au sujet qui nous occupe ; elle est fixée d’ailleurs au point de vue de la foi dans le sens de la première opinion qui est celle de l’Église romaine.
Il est certain qu’au temps où saint Denis arriva dans la Gaule, Paris qu’on appelait alors Lutèce, Lutetia Parisiorum, n’était qu’un village tout entier renfermé dans cette île de la Seine qu’on appelle encore aujourd’hui la Cité. La résistance que cette bourgade avait opposée aux armées de César l’avait déjà rendue célèbre et sa position exceptionnelle lui donnait une importance qui semblait préluder aux grandeurs de son avenir. Les habitants, depuis qu’ils étaient soumis aux Romains, abandonnaient peu à peu leurs anciennes croyances druidiques pour suivre la religion des vainqueurs. Dieu préparait ainsi les voies à son apôtre, car le culte national eût été un grand obstacle à la propagation de l’Évangile. La crise religieuse qui avait mis le paganisme à sa place avait du même coup déraciné toute conviction, rendu les esprits sceptiques, de telle sorte que la vérité, venant à se montrer au milieu de ce vide, avait chance d’être accueillie par tous les esprits sincères. La prédication de saint Denis fut couronnée bientôt de fruits abondants. Il avait évangélisé déjà plusieurs contrées de notre pays, aucune ne lui parut meilleure et plus mûre pour la moisson que le territoire de Lutèce et de ses environs. Ce fut le motif qui l’engagea à s’y fixer et à faire de la petite cité le siège de son épiscopat, le centre de sa mission qui rayonna non seulement dans tout le Parisis, mais encore jusqu’à Meaux et à Rouen et dans quelques autres villes de la Gaule Belgique.
Les anciens actes de saint Denis nous disent qu’il put bâtir une église dans sa ville épiscopale, y établir des clercs, y ordonner des prêtres ; et la prose de la liturgie parisienne nous le montre construisant le temple du Christ, prêchant par ses paroles et par ses exemples : « Hic, constructo Christi templo, verbo docet et exemplo. » Il serait superflu de rechercher à quel endroit de la cité s’éleva cette première église. Ce fut peut-être, comme l’ont prétendu certains auteurs, sur l’emplacement de la métropole actuelle, mais on ne peut faire que des conjectures à cet égard.
Nous avons des données moins incertaines sur d’autres sanctuaires dans lesquels le pontife dut réunir quelquefois les premiers fidèles. C’est en dehors de l’enceinte primitive qu’il faut en chercher la trace. Ce n’étaient d’ailleurs ni des églises ni des basiliques, mais simplement des cryptes ou des catacombes comme celles que Denis avait pu voir à Rome, beaucoup moins vastes sans doute, mais qui servaient aux mêmes usages, à la célébration des saints mystères comme aussi à des sépultures chrétiennes. Il nous plaît de voir dans notre Église, fille aînée de la sainte Église romaine, ce trait de ressemblance avec sa mère. Elle fut donc, comme elle, persécutée à sa naissance, comme elle obligée de cacher dans l’ombre des souterrains ses prières et ses cérémonies sacrées.
Une de ces grottes entre autres est désignée par une très ancienne tradition comme ayant servi aux premières réunions chrétiennes et comme ayant été sanctifiée par la présence de saint Denis. C’est la crypte de l’ancienne église de Notre-Dame-des-Champs qui se trouve actuellement chez les Carmélites du quartier Saint-Jacques, 65, rue d’Enfer : ou plutôt c’est, suivant l’abbé Lebœuf, une cave située sous cette crypte, d’une très haute antiquité et dans laquelle on a découvert des sépulcres romains. Cette église avait, appartenu longtemps aux Bénédictins. Elle fut acquise, en l’an 1604, par la bienheureuse Marie de l’Incarnation qui y fonda son monastère du Carmel. Le souvenir de nos origines chrétiennes tenait alors peu de place dans la pensée des âmes même les plus pieuses. Les professions illustres dans l’ordre du Carmel, la grande voix de Bossuet et des autres orateurs, les cérémonies rehaussées par la présence des prélats, des princes et des princesses donnaient trop d’éclat au présent pour qu’on se souciât du passé, et nul de ceux ou de celles qui priaient alors dans cette église ne songeait qu’elle avait vu naître, au milieu des épreuves, cette religion qui était devenue le plus beau titre du roi très chrétien et le plus beau fleuron de la couronne de la France.
Le Moyen Âge ne s’était pas montré oublieux à ce point. Au douzième siècle, pendant toute l’octave de saint Denis, cette église était, en raison des souvenirs attachés à ces lieux, brillamment illuminée. Une rente prise sur le douaire de la reine Adélaïde, femme de Louis le Gros, faisait les frais du luminaire.
L’église a disparu dans la tourmente révolutionnaire. Les religieuses carmélites ayant été chassées de leur couvent, le sanctuaire fut abattu, et la crypte vénérable qu’on voyait en plusieurs endroits taillée dans le roc a été déplorablement mutilée par les nouveaux propriétaires qui essayèrent de l’agrandir au moyen de la mine. Malgré cela, quand les temps furent devenus moins mauvais et que d’anciennes carmélites purent racheter une partie des terrains de leur communauté, la crypte reprit sa destination religieuse. C’est aujourd’hui une chapelle souterraine qu’il faut visiter. Il est bon de réveiller l’écho des souvenirs de la chrétienté naissante, d’évoquer les figures héroïques des premiers apôtres de notre pays, de rechercher leurs traces et de se trouver avec eux par la pensée dans les lieux mêmes où nos ancêtres se pressaient pour écouter leur parole, recevoir le baptême, se nourrir du pain des forts pour braver les périls et ne pas fléchir devant les violences de la persécution.
La paix, en effet, n’avait pas été de longue durée dans l’Église parisienne. Les édits des empereurs avaient été renouvelés dans les Gaules. Il y avait, pour les exécuter à Lutèce, un homme bien connu par sa haine contre les chrétiens. C’était le préfet Sisinnius Fescennius. Il en voulait surtout à Denis et le faisait rechercher activement. L’apôtre avait quitté la ville pour tromper sa vigilance et s’était retiré dans la campagne voisine. Il avait un jour réuni ses disciples les plus fidèles dans la grotte du mont qui s’appelait alors Leucotitius et qui est devenu la montagne Sainte-Geneviève. D’anciennes traditions rapportent qu’il fut dénoncé par une femme nommée Larcia qui trahit le lieu de sa retraite. Il y fut arrêté avec le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère. Tous les trois furent conduits à Lutèce et jetés dans la prison attenante au tribunal.
Il est permis, sinon avec une entière certitude, au moins avec quelque vraisemblance, de désigner le lieu où furent enfermés et chargés de chaînes les trois illustres captifs. La prison devait être au nord de la cité à l’endroit où vient aboutir aujourd’hui le pont Notre-Dame. À une époque très reculée, voisine peut-être du temps de saint Denis, on y avait construit une église qui s’appelait, en mémoire de la captivité de l’apôtre, Saint-Denys de la Chartre, sanctus Dionysius a carcere. Elle a disparu depuis longtemps et il n’en reste plus aucune trace ; mais tout près de là, si ce n’est sur le même emplacement, une autre église consacrée au même souvenir fut bâtie au treizième siècle, et la place en est connue avec précision. On a bien prétendu que les fidèles des anciens temps ont pu se tromper et désigner à faux Saint-Denys de la Chartre comme le lieu de la prison, mais les raisons qu’on en donne ne paraissent pas sérieuses.
Ce serait donc dans un des cachots de cette prison appelé par Hilduin carcer Glaucinus, que le saint évêque aurait passé ses derniers jours. Suivant une vieille et touchante tradition, il y aurait reçu la visite de Nôtre-Seigneur qui aurait daigné lui apporter la sainte communion. Enfin, les saints confesseurs, avant de marcher au supplice, furent, au dire des récits les plus anciens, tourmentés et battus de verges ; cette scène sanglante dut se passer à l’endroit où se trouve le chevet de Notre-Dame ; car il y avait là, bien avant le neuvième siècle, une église qui s’appelait Saint-Denys du Pas, c’est-à-dire sanctus Dionysius a passione, suivant l’étymologie la plus probable.
La sentence de Fescennius à l’égard des apôtres qui avaient confessé la foi de Jésus-Christ dans leur prison et dans leurs tourments ne pouvait être douteuse. Tous les trois furent condamnés à avoir la tête tranchée. L’exécution devait avoir lieu en dehors de la ville. On leur fit prendre un chemin que Denis connaissait pour l’avoir suivi bien des fois, et qui reliait la cité à la colline voisine du côté du nord, nommée alors la montagne de Mars ou de Mercure, parce que deux temples s’y élevaient en l’honneur de ces fausses divinités. L’apôtre de Paris y était venu combattre le paganisme par la vertu de la croix ; et près de ces autels de l’idolâtrie, il avait élevé un autel au vrai Dieu dans une crypte pareille à celle qui s’ouvrait dans les flancs du mont Leucotitius.
L’histoire de cette crypte est trop curieuse et trop importante dans le sujet qui nous occupe, pour qu’il soit possible de la passer sous silence. Ce souterrain avait été très célèbre et très fréquenté aux premiers siècles de notre Église. Peu à peu, par la suite des temps, on le négligea, comme on fit à Rome pour les catacombes ; il finit par devenir entièrement inconnu, et l’on ne supposait pas qu’il pût exister, alors même qu’au-dessus s’élevait un sanctuaire où le culte de saint Denis était en grand honneur.
En 1611, Marie de Beauvillers, abbesse du prieuré de Montmartre, entreprit la restauration de la chapelle et fut aidée, dans ses projets, par les libéralités d’Henri IV. Elle fit faire des fondations pour les agrandissements du monument, et, dans ces fouilles, on découvrit cette ancienne crypte fermée depuis très longtemps. L’évènement fit sensation à Paris. La cour et la ville s’empressèrent de visiter le souterrain ; la reine, Marie de Médicis, fut une des premières à s’y rendre en compagnie de plusieurs dames de qualité. Une gravure au burin, dessinée par Halbeeck, fut exécutée et répandue dans le public en mémoire de cette découverte, en même temps que le procès-verbal en fut soigneusement dressé. On y trouve la description minutieuse du souterrain, « ainsi que des inscriptions, figures et mots escrits de pierre noire sur le roc ou imprimés dans la pierre avec la pointe d’un poinsson ou couteau ou autre ferrement. »
Ces inscriptions étaient restées sans explication jusqu’à nos jours. On savait seulement qu’au rapport des anciennes traditions, saint Denis avait, dans le temps de persécution, célébré les saints mystères dans une crypte de Montmartre : ce devait être celle qu’on venait de découvrir sous la chapelle même du Saint-Martyre. Pour changer ces conjectures en certitude, il a fallu que l’érudition moderne, en dehors même de l’inspection des lieux qui ont été, sans doute, totalement bouleversés, à l’aide du procès-verbal tout seul, vînt donner la signification des caractères que les rédacteurs de la pièce avaient reproduits sans les comprendre.
Un savant antiquaire, M. Leblant, a rapproché les signes tracés sur les parois de la grotte de ceux qu’on trouve dans les catacombes romaines, écrits à la pointe du style ou simplement au charbon. M. de Rossi venait justement de relever plus de trois cents de ces inscriptions découvertes sous d’anciennes basiliques et sous une chapelle où des martyrs avaient été ensevelis au troisième siècle, M. Leblant, dont les travaux sur l’épigraphie chrétienne font autorité, a signalé la plus grande analogie entre ces inscriptions et celles de la crypte de Montmartre. Les formules acclamatoires qui s’adressent aux martyrs dans le cimetière de Saint-Calixte ont été comparées à celles de Paris. « Si nous examinons, à cette heure, les fragments d’inscriptions que nous a transmis le procès-verbal, dit M. Leblant, nous y reconnaîtrons sans peine de semblables acclamations. Dans les conditions constatées, les syllabes † MAR… DIO… semblent indiquer les mots : MARtyres…, DIOnysie,… débuts de prières adressées aux saints de la crypte. Quant au nom presque entier de CLEMINs, j’y vois, en le comparant aux actes de visite de saint Sixte, soit le nom d’un pèlerin, soit celui d’un des saints martyrs inconnus qui ont souffert au même lieu. La croix tracée isolément, dont parle encore le procès-verbal, me paraît figurer, suivant l’usage antique, comme signe de la présence d’un visiteur illettré. »
Les conclusions de cette étude sont évidemment qu’il s’agit ici d’un sanctuaire chrétien remontant au moins au troisième siècle de notre ère ; rapprochées des données de la tradition, elles ne laissent aucun doute sur le passage de saint Denis en ces lieux et sur la destination qu’il leur donna. Elles ne sont pas moins propres à nous fixer sur l’emplacement du martyre ; elles confirment ce que par son nom la chapelle proclamait déjà, que c’est bien là que l’apôtre a versé son sang. Ainsi se trouvent réduites à néant les conjectures de critiques téméraires qui, comme Launoy, ont cherché partout ailleurs le théâtre de cette passion glorieuse.
La tête des trois confesseurs roula sous le glaive et leur sang rougit, dit-on, les eaux d’une fontaine voisine. Quelle que soit la popularité de la légende qui raconte que le corps mutilé du saint évêque se releva en présence de ses bourreaux épouvantés, qu’il prit sa tête dans ses mains et la porta l’espace de plusieurs milles jusqu’au lieu où une dame encore païenne, nommée Catulla, devait l’ensevelir, il faut reconnaître qu’on ne la trouve pas dans les auteurs les plus anciens, qu’elle n’a pas de graves autorités en sa faveur, qu’elle s’est répandue à l’aide des actes faussement attribués à saint Méthode, sur les assertions peu fondées d’Hilduin et grâce à ce besoin de merveilleux qui fut, en dehors de la vraie critique, la passion dominante de certains âges.
Les anciens actes latins qui ont pour titre Passion des saints Denis, Rustique et Éleuthère, avaient dit simplement des saints martyrs : « Ils sont allés au Seigneur en lui rendant un tel témoignage, qu’on eût dit, lors même que le glaive leur eût tranché la tête, que leur langue palpitante confessait encore le Seigneur. » Bientôt ce qui n’était qu’une figure fut donné comme une réalité et pieusement embelli. Les Grecs eux-mêmes accueillirent la légende, et contribuèrent peut-être à la former. On lit dans leur Ménologe : « Par un prodige qui plongea dans la stupeur ceux qui en furent témoins, Denis prit sa tête entre ses mains et la porta à deux milles de là jusqu’à ce qu’il la remit à une femme nommée Catulla. »
Les actes latins disent que les bourreaux, pour enlever les corps des saints martyrs à la piété des fidèles, se disposaient à les jeter au plus profond de la Seine, qu’une dame encore païenne détourna leur attention en leur faisant servir à manger et à boire, et qu’en même temps elle fit enterrer, à six milles de Paris, les corps des saints confesseurs dans un champ labouré où la moisson grandit subitement et déroba à tous les regards le lieu de leur sépulture.
Avant de suivre les destinées de ces restes sacrés, il faut voir comment a fleuri bientôt le culte de saint Denis au lieu même de son martyre, sur le versant occidental de la colline de Montmartre. D’abord la montagne perdit la désignation païenne sous laquelle elle avait été connue jusque-là. Ce n’est pas le nom de Mars, mais bien celui des martyrs qu’elle porta désormais : Montmartre, mons martyrum. Au neuvième siècle, Hilduin et Abbon l’ont encore désignée sous le nom de mons Martis, mais pour rappeler, sans doute, ses origines païennes plutôt que pour se servir de la véritable appellation usitée déjà de leur temps. Bien avant cette époque, et dès le temps le plus voisin de la mort de saint Denis, sitôt que la persécution eut pris fin, la crypte ne suffit plus à contenir les fidèles qui y venaient en foule et qui y laissaient, gravée sur les murs, la trace de leurs pieux pèlerinages. Une chapelle s’éleva bientôt au-dessus de la grotte, et, dès ce moment, on l’appela le Saint-Martyre, Sanctum Martyrium. Ce nom, qu’elle a toujours conservé depuis, est à lui seul une preuve incontestable de la haute antiquité des traditions qui ont désigné ce lieu comme étant celui du martyre. On sait, en effet, que les premiers chrétiens avaient l’habitude d’ériger, à la place qu’avait rougie de son sang un martyr illustre, un monument en son honneur qu’on appelait le Martyrium. Cette expression, très commune dans le langage des Pères, désigne toujours la basilique d’un martyr ; mais elle n’a guère été en usage après eux : dès le temps de Grégoire de Tours et de Fortunat, le mot avait disparu du langage ; d’où il faut conclure qu’un monument antique qui porte ce titre doit être au moins contemporain des Pères du quatrième siècle.
S’il nous restait des documents remontant à ces premiers âges, nous y trouverions, sans aucun doute, bien des preuves de la vénération dont le Saint Martyre était l’objet et de la grande affluence qu’on y voyait. Mais l’acte le plus ancien que nous ayons se rapportant à ce sanctuaire, c’est le titre de la donation qui en fut faite, au temps de Louis le Gros, par des laïques, auxquels il avait appartenu jusque-là, à l’abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Cette pièce établit que les religieux possèderont désormais la petite église qui est sur le versant du Mont des Martyrs et qui s’appelle vulgairement le Sanctum Martyrium ; elle témoigne aussi que la chapelle était visitée par de nombreux fidèles et recevait beaucoup d’offrandes. Dans le même temps le seigneur de Montmorency, Bouchard, qui était propriétaire de l’église principale de Montmartre et de grands terrains à l’entour, voulut arrondir la petite propriété qui venait d’être cédée aux religieux de Saint-Martin et leur fit don de toute cette partie de la colline. Le roi Louis le Gros ne tarda pas à s’en rendre l’acquéreur dans le dessein d’y établir un couvent de Bénédictines. En l’année 1133, de concert avec Alix de Savoie, son épouse, il fit construire au sommet de la colline, à la place d’une très ancienne église qui s’y trouvait et qui tombait en ruines, celle qu’on y voit encore aujourd’hui. La maison du couvent s’élevait en même temps que l’église et à ses côtés, par les soins du pieux monarque qui fit reconstruire encore la chapelle du martyre, déjà trop vieille à cette époque pour qu’il fût possible de la conserver.
L’église de Montmartre était bâtie depuis quelques années quand le pape Eugène III, forcé de s’éloigner de Rome à la suite des troubles politiques, vint chercher un refuge en France. Il se rendit à Montmartre le lundi de Pâques, après avoir célébré la solennité de la veille dans la basilique de saint Denis. Le pape, pour rendre honneur au saint martyr, voulut consacrer lui-même l’église de Montmartre ; il fut assisté dans cette auguste cérémonie par saint Bernard et par Pierre le Vénérable ; la consécration toutefois ne s’étendit, ce jour-là, qu’à la partie occidentale de l’église destinée aux fidèles. Le souverain Pontife se rendit ensuite à la chapelle du Martyre pour en consacrer l’autel. Saint Bernard, qui l’assistait encore comme diacre dans cette cérémonie, témoigna de sa piété envers saint Denis, par le don qu’il fit à la chapelle de la tunique en drap d’argent dont il s’était servi. Après l’Ascension, Eugène III revint faire la dédicace de l’église et consacrer la partie orientale réservée aux religieuses.
Ces sanctuaires, si chers à la population parisienne à cause des grands souvenirs qui s’y rattachaient, avaient déjà vu se former autour d’eux une agglomération considérable qui couvrait, du côté de l’ouest, les flancs de la colline et qui ne tarda pas à s’étendre jusqu’à ses pieds. Elle nécessita la construction d’une nouvelle église dans le quartier des Porcherons, laquelle devint, dans la suite, Notre-Dame de Lorette.
L’histoire de la chapelle du Martyre est assez étroitement liée à celle de l’abbaye dont elle était une dépendance ; elle eut toujours cependant sa place à part dans l’esprit et dans la vénération des fidèles. C’est elle qui recevait les pieuses visites des pèlerins de saint Denis. On n’oubliait pas que ses fondements avaient été cimentés avec le sang de l’apôtre et c’est à elle que s’adressaient d’ordinaire les dons et les fondations des grands et du peuple. Constance, comtesse de Toulouse et fille de Louis le Gros, se montra très libérale envers le sanctuaire qu’avait réédifié son père. Philippe le Bel lui fit aussi des largesses ; et son écuyer, Hermer, disposa, par son testament, de tous ses biens en sa faveur.
La dévotion des rois de France envers saint Denis ne se démentit pas, et cette modeste chapelle en est la preuve aussi bien que la somptueuse basilique dont nous aurons à parler bientôt. Elle les vit maintes fois agenouillés dans son enceinte, y implorant l’assistance de monseigneur saint Denis pour eux et pour leur royaume. Le peuple s’associait à tous ces témoignages de piété envers le Saint-Martyre ; la foule, à chaque instant, envahissait le sanctuaire et ne pouvait être contenue en ses murs trop resserrés, qui ne furent cependant jamais agrandis d’une manière notable.
La vraie basilique du patron de Paris était ailleurs ; il n’avait là qu’un humble sanctuaire où la prière pouvait se faire, en quelque sorte plus intime et plus confiante. Toute la ville s’y rendait cependant en certaines circonstances, spécialement dans les jours de détresse publique. Quand Charles VI, tombé dans la démence, laissa flotter les rênes du gouvernement qu’il gardait cependant et que personne n’osait lui enlever, au temps où la France se vit plongée, presque sans espérance, dans l’abîme des plus horribles malheurs, il se fit au sanctuaire de Montmartre une affluence à nulle autre pareille. Tout un peuple en larmes venait y demander la guérison de son roi. Même concours s’y produisit encore quand on apprit à Paris que François Ier venait d’être fait prisonnier à la bataille de Pavie. En un mot, la chapelle du martyre fut intéressée à tous les grands évènements de notre histoire. Elle recueillit également, dans les temps plus heureux, l’écho des allégresses nationales et les actions de grâces de la population reconnaissante.
En l’année 1559, un incendie dévora les bâtiments de l’abbaye ; on ne put les relever qu’en partie les religieuses furent obligées de se séparer : les unes restèrent auprès de la grande église, les autres s’établirent aux environs de la petite chapelle qui devint, plus tard, un prieuré. Une galerie couverte fut construite, en 1644, aux frais de l’abbesse, Mme de Guise, pour relier les deux parties du monastère, l’une au bas, l’autre au sommet de la colline.
Ce ne furent pas seulement les peuples et les rois qui témoignèrent leur pieux empressement envers les lieux sanctifiés par le martyre de saint Denis ; une foule d’autres personnages illustres par leur condition et par leur sainteté y vinrent à toutes les époques pour y demander les grandes inspirations qui rendent la vie féconde et y puiser le secret des actes héroïques et des nobles dévouements. Quel autre foyer eût été plus propre à enflammer le zèle des âmes généreuses par l’influence de souvenirs plus entraînants et plus saints ?
C’est dans la crypte de Montmartre que saint Ignace de Loyola voulut jeter les fondements de la célèbre compagnie de Jésus qui allait bientôt rayonner sur le monde entier et se placer au premier rang des sociétés religieuses par la science, par les vertus et par le succès de son apostolat. Il n’était pas prêtre encore, et déjà, il avait groupé autour de lui six disciples dont les noms sont restés fameux, Jacques Lainez, Alphonse Salmeron, Nicolas Bobadilla, Simon Rodriguez, Pierre Lefebvre et François Xavier. Le jour de l’Assomption de l’année 1534, il les conduisit à la chapelle du Martyre, pour y faire avec eux ses premiers vœux et placer son entreprise sous les auspices de saint Denis. Pierre Lefebvre célébra la sainte messe et fit communier ses collègues. Ils s’engagèrent ensuite à dévouer à l’apostolat leur vie toute entière, à faire préalablement le pèlerinage de la Terre-Sainte ou, s’ils en étaient empêchés, à aller se prosterner aux pieds du souverain Pontife.
En souvenir de cette mémorable visite, les Jésuites firent placer plus tard, au-dessus du maître-autel, un tableau qui représentait la scène de la prononciation des vœux en présence de la sainte hostie tenue entré les mains du prêtre. Près du tableau fut apposée une plaque de bronze doré portant une inscription latine dont voici le sens : « Arrête-toi, voyageur, et vois dans ce tombeau des martyrs le berceau de notre ordre. La société de Jésus qui reconnaît saint Ignace de Loyola pour père, eut pour mère la ville de Paris, l’an du salut 1534, le 15 août. Elle a pris naissance ici-même, le jour où Ignace et ses compagnons, unis par la sainte communion, se consacrèrent à Dieu par des vœux perpétuels. » Les religieux de la compagnie ont gardé pieusement le souvenir de leur origine et l’ont témoigné en mainte occasion. La chapelle du Martyre a reçu la visite de ses membres les plus illustres.
Si modeste que fut ce sanctuaire, les guerres de religion ne l’épargnèrent pas. En 1598, il avait été entièrement dévasté. L’autel était démoli, la couverture et les voûtes étaient renversées. Mais la découverte de la crypte en l’année 1611 et le grand concours qu’elle attira y amenèrent des offrandes qui permirent de reconstruire à neuf la chapelle. L’année suivante, alors qu’elle sortait à peine de ses ruines, elle reçut la visite du cardinal de Berulle qui venait y demander la bénédiction de l’apôtre pour la congrégation de l’Oratoire qu’il allait fonder. Il y conduisit bientôt après une sainte veuve, Mme Acarie, qui se disposait à prendre le voile et à faire profession au Carmel d’Amiens. Ce fut aussi le sanctuaire de prédilection de saint Vincent de Paul. Il aimait à y prier, et sans doute il y puisa quelques-unes des inspirations de dévouement et de charité qui furent le mobile de toute sa vie. Ce fut encore un asile de recueillement et de prière pour un jeune homme qui allait être un des saints les plus illustres et les plus aimables des temps modernes, François de Sales, qui, tandis qu’il était étudiant à Paris, n’avait rien de plus à cœur que de visiter souvent le cher sanctuaire. La chapelle du Martyre devait le revoir dans une circonstance plus solennelle. Il était alors évêque de Genève ; au moment où il allait fonder l’institut des dames de la Visitation, il crut devoir, à l’exemple de saint Ignace, venir y recommander à Dieu l’œuvre qu’il consacrait à sa gloire. Enfin, marchant sur les traces de ces illustres fondateurs, M. Ollier, déjà tout entier à la grande mission que Dieu l’appelait à remplir, s’y présenta en l’année 1642 avec deux autres pieux fondateurs de Vaugirard, M. Foix et M. Picoté. Tous les trois y prirent la résolution de se dévouer entièrement à l’instruction et à la sanctification du clergé. M. Ollier y revint plus tard encore avec de nouveaux associés pour y renouveler ses engagements et y rendre grâce à Dieu : son œuvre avait été visiblement bénie et avait pris de grands développements. Il apportait avec lui, pour les présenter au premier évêque de Paris, sur le lieu même où son sang avait coulé, les plans de cette illustre maison de Saint-Sulpice dans laquelle se sont formés tant de prêtres selon le cœur de Dieu.
Ce sont là des faits entre mille autres du même genre dont la trace est aujourd’hui perdue. Il faudrait y joindre le souvenir de ces stations qui chaque année réunissaient toutes les paroisses de Paris et des environs à la chapelle du Martyre, nouvelle et touchante ressemblance entre notre Église et sa mère, l’Église de Rome. Les mêmes processions qui se sont faites à Rome pendant de longs siècles dans les basiliques des martyrs, ont été pratiquées chez nous jusqu’aux mauvais jours de la Révolution, elles ont tous les ans amené des milliers et des milliers de fidèles au lieu qui fut consacré par le sang de notre premier évêque, et les générations se sont transmis fidèlement le legs de vénération et d’amour qui leur avait été laissé par les premiers chrétiens convertis à la voix de saint Denis.
La chapelle était devenue, avant la Révolution, sans cesser d’être le rendez-vous d’une foule de pieux pèlerinages, l’église des dames bénédictines. Elles avaient abandonné la leur pour le service religieux de la paroisse. Le cataclysme dans lequel tout s’abima en 93, fit disparaître jusqu’aux dernières traces de l’antique chapelle du Saint-Martyre. Comprise à titre de bien national dans le domaine de l’abbaye, elle fut vendue à un plâtrier qui la rasa avec tous les bâtiments de la communauté. L’église paroissiale resta seule debout pour subir le pillage et la profanation. La Terreur ouvrit les tombeaux des abbesses, jeta leurs cendres au vent et fit une halle de la maison de Dieu. Enfin, ces murs consacrés par un souverain Pontife ne furent sauvés de la destruction que parce qu’on jugea à propos d’y établir un télégraphe.
La Commune devait renouveler ces horreurs. Tandis qu’on traînait en prison le clergé de Montmartre ; on appliquait sur les portes du temple fermé d’odieux placards, signés d’un nom qui ne doit pas souiller ces pages.
Puisse le Seigneur se venger par des miséricordes ! Quoiqu’on fasse, le sol de Montmartre reste à jamais béni. Un calvaire s’y est dressé pour remplacer celui qui avait été établi sur le Mont-Valérien. Les stations de la croix environnent le vieux temple, la neuvaine du Calvaire y attire tous les ans des foules empressées, et si les souvenirs de saint Denis n’y sont plus aussi vivants qu’autrefois, il y a, dans le triomphe de la croix, une compensation à cet oubli regrettable. Ce n’est pas assez ; un honneur qui sera le digne couronnement de toutes ses gloires est réservé à la sainte montagne. L’Église du Sacré-Cœur doit s’y élever bientôt. La foi ne peut manquer d’y refleurir, la gloire de saint Denis sera de nouveau proclamée sur les coteaux qu’il a arrosés de son sang et les populations en foule reprendront les sentiers du pèlerinage.
À 12 kilomètres de la gare Saint-Lazare, sur le chemin de fer de Saint-Germain, au pied d’un coteau couvert de vignes que domine le Mont-Valérien, se trouve un village dont le nom est fameux dans toute la France et au-delà. Ce n’est certes pas son importance qui a jamais pu lui donner cette célébrité, ce ne sont pas même ses rosières qui ont pourtant une certaine renommée, qui l’ont fait connaître dans le monde c’est, dans un passé bien lointain, un de ces souvenirs que la religion rend immortels, c’est l’illustration de la sainteté qui désigne cette humble bourgade au respect et à l’amour des peuples. Nanterre a vu naître, il y a quinze siècles bientôt, la sainte bergère Geneviève, la patronne de Paris.
On connaît d’une manière précise le lieu de sa naissance. La maison qui s’élève sur cet emplacement porte une inscription qui rappelle la mémoire de ce grand évènement, dont la date est fixée à l’année 422.
À cette époque déjà, les provinces de l’empire romain étaient envahies de toutes parts. Les Francs avaient passé le Rhin, ils pénétraient chaque jour plus avant dans les Gaules, y fondaient des établissements, et peu à peu refoulaient les Romains, domptaient les habitants du pays et soumettaient à leurs armés des contrées qui, sous Clovis, allaient former un grand royaume.
Il plut au Seigneur de placer au berceau de cette monarchie nouvelle entre les figures des rudes conquérants qui la fondaient, une simple fille des champs, une bergère, qui devait présider à ses destinées dans l’avenir, pareille à ces fées bienfaisantes qu’on trouve toujours dans les récits qui s’adressent aux enfants, à la naissance des princes, chargées de les protéger ; seulement la fiction ici n’entre pour rien, nous sommes sur le terrain de l’histoire et les bienfaits de Geneviève, pas plus que la protection dont elle a couvert son pays, n’ont rien de légendaire.
On peut voir à Nanterre les lieux auxquels s’attache son souvenir, tellement vivant encore qu’on dirait que les faits viennent de se passer. Hélas ! on n’y voit non plus guère autre chose. Sur une terre pareillement sanctifiée devrait s’élever une grande église à la gloire de la patronne de Paris, c’est à peine si l’on y trouve un petit oratoire, une humble chapelle en son honneur.
L’église paroissiale n’est pas consacrée à sainte Geneviève et n’a rien qu’une chapelle qui lui soit dédiée. Les innombrables ex-voto qui y sont suspendue attestent que la sainte bergère est toujours l’objet de la confiance populaire et que la prière est toujours abondante à son autel. Tout près de l’église, s’ouvre le jardin du presbytère et se trouve remplacement de la maison qu’habitaient les parents de Geneviève. Ce fut là sans doute que saint Germain d’Auxerre se rendant à Paris l’aperçut alors qu’elle n’était âgée que de dix à douze ans. Les parents de Geneviève qui étaient de bons chrétiens avaient dû se placer avec leur fille au seuil de leur porte pour voir passer le saint évêque et recevoir sa bénédiction.
Germain eut à la vue de Geneviève une de ces intuitions dont Dieu favorise quelquefois ses serviteurs. Toute une vie d’éminente sainteté, tout un rayon de grâce céleste lui apparut sur le visage de cette humble fillette ; il félicita les parents d’avoir une pareille enfant, la prit par la main, se rendit à l’église avec elle, y récita none et vêpres, tenant sa main posée sur la tête de Geneviève, comme pour faire descendre d’en haut la plénitude de ces bénédictions qu’il savait déjà devoir être le partage de cette enfant privilégiée.
Le saint évêque la revit le lendemain, reçut d’elle la promesse qu’elle consacrerait toute sa vie au Seigneur et comme il allait s’éloigner, il découvrit à terre une petite pièce de cuivre sur laquelle était la figure de la croix : il la mit au cou de la jeune fille et Geneviève ne la quitta jamais plus.
Sur le terrain qui dépendait de la maison où vécut la sainte, se trouve encore un puits qui est, de la part des fidèles, l’objet d’une grande vénération. Un oratoire des plus modestes, ayant la forme d’une petite chapelle avec une statue de sainte Geneviève, a été construit, il y a quelques années, par les soins du curé de Nanterre, à côté de ce puits qui attirait autrefois un nombre prodigieux de pèlerins. C’est pour eux qu’on fabriquait les gâteaux de Nanterre et l’on en vendait chaque année pour des sommes fabuleuses. Aujourd’hui, on vient toujours au puits de sainte Geneviève avec un pieux empressement. On y compte encore annuellement près de trente mille personnes qui emportent de l’eau, en boivent avec dévotion pour obtenir quelque grâce particulière, en l’appliquant sur les yeux malades, pour qu’ils soient guéris.
Le 3 janvier 1536, la reine Anne d’Autriche y vint en pèlerinage pour obtenir que Dieu, par l’intercession de sainte Geneviève, lui accordât un fils.
C’est que cette eau a été sanctifiée par les prières et par les larmes de Geneviève et qu’elle a été l’instrument de son premier miracle. Voici à quelle occasion. C’est le récit d’un vieil auteur, Thomas Benoist, que nous donnons ; il a dans son langage tout un charme de grâce et de naïveté qu’il serait fâcheux d’altérer.
« Il avint que Geronce, mère de la sainte pucele, en un jour de feste aloit au moustier et dist à sa fille qu’el gardast l’ostel. La pucelote aloit après, criant et disant que la foi qu’el avoit promise à saint Germain, el garderoit à l’aide de Dieu et que souvent iroit au moustier afin qu’el deservit estre espouse Jesu-Christ et que digne fust trouvée de s’amour. La mère se courouça et li donna une paumée. Dieu vengea l’enfant, qui la mère aveugla. XXI mois ne vit goute. Quand la mère eut esté longuement en celle peine qui mout li ennuioit, si li souvint du bien que saint Germain avoit dit de sa fille. Si l’appella et li dist : Ma fille, alez au puis et me aportes de l’yaue. La pucelote y ala bonne aleure. Quand au puis fu, el commença à plourer de ce que sa mère avoit perdu la veue pour elle. El print de l’yaue et la porta à sa mère. La mère tendit les mains au ciel, et en grant foi et révérence, print l’yaue et la fit signer à sa fille du signe de la croiz. El en lava ses yex. El commença à veoir un tantet. Quand II fois ou III les out lavés, la veue li revint comme devant. »
Le puits de sainte Geneviève a la forme de ceux qu’on fait à la campagne, il a douze à quinze pieds de profondeur : Il occupait autrefois le fond de la chapelle aujourd’hui détruite qui s’élevait sur l’emplacement de la maison. Du jardin on peut descendre vers la gauche près de l’enceinte de l’ancienne chapelle, dont il reste encore des traces, en un souterrain qui devait être la cave, et dans lequel, dit-on, la pieuse jeune fille avait coutume de se retirer pour y prier dans la solitude et le recueillement. On y avait construit anciennement un oratoire avec un autel qui fut réparé encore au dix-septième siècle et qui a disparu depuis.
Ces lieux n’ont rien de fictif dans les souvenirs qu’on y rattache. Une tradition sûre et constante permet d’en suivre les traces à différentes époques. Paul Beurrier cite entre autres un titre du 17 avril 1488, par lequel la femme d’un potier d’étain demeurant à Paris, par reconnaissance de ce qu’elle descend de la même lignée que sainte Geneviève, donne une maison, avec cour, jardin et cave, attenant à la chapelle, en considération que ces lieux avaient appartenus autrefois aux parents de la sainte.





























