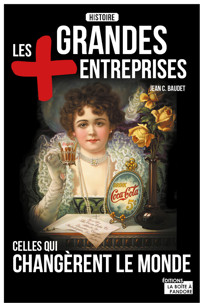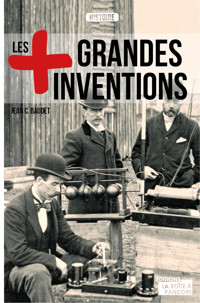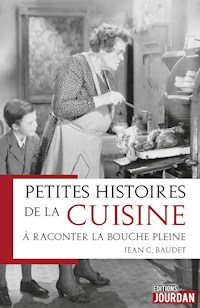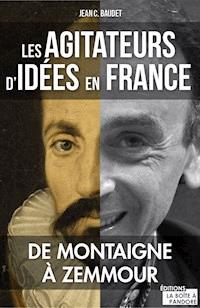Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Les plus grandes découvertes scientifiques qui n'auraient jamais dû voir le jour !
Saviez-vous qu’une observation astronomique d’un très sérieux père jésuite est à l’origine de la croyance en l’existence d’extraterrestres ? Saviez-vous que, déjà au XVIIe siècle, des médecins ont tenté de réaliser des transfusions sanguines pour soigner des maladies mentales, et cela, en utilisant du sang de chien ou de mouton ? La « mémoire de l’eau », la « fusion froide », la « formule du benzène », la « fureur lobotomiste » sont autant d’affaires extraordinaires à propos desquelles les scientifiques ont mené des recherches hasardeuses qui ont donné lieu à de grandes inepties et à de grossiers mensonges.
Des récits, présentés comme de véritables enquêtes policières, qui nous apprennent que même les plus savants des hommes peuvent se tromper ou dissimuler la vérité.
Les récits passionnants des « erreurs scientifiques » et leurs conséquences inattendues !
EXTRAIT :
La science est vérifiable mais elle n’a pas réponse à tout. Il existe d’autres discours, qui ont une réponse à toutes nos questions. Mais ces discours à prétention de vérité universelle ne sont pas vérifiables !
Ce n’est pas une boutade. Ce n’est pas une petite phrase, prononcée pour faire passer le temps ou pour égayer l’atmosphère, au comptoir, en buvant un petit blanc ou en dégustant son café noir avec un cube de saccharose cristallisé. C’est, très exactement, et très tragiquement, la situation de l’intelligence en ce début de siècle, également partagée (paraît-il, mais est-ce vérifiable ?) entre presque sept milliards de représentants (mâles et femelles) d’une espèce vivante que les zoologistes du XIXe siècle, gens fort optimistes à l’époque, ont baptisée, évidemment en latin, Homo sapiens, l’homme sage, raisonnable, prudent, judicieux. Car le français propose plusieurs traductions de sapiens, qui a la même racine que sapidus, ce qui signifie « qui a de la saveur, du goût ». Mais l’Homo sapidus ne concerne que les anthropophages.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des horreurs du cannibalisme. Mais, quand même, je vous entretiendrai de quelques erreurs-horreurs. En soi, elles ne sont peut-être pas bien tragiques, ne dit-on pas, en latin, errare humanum est, l’erreur est humaine ? Mais justement, de l’erreur à l’illusion, il n’y a qu’un pas, et ce pas nous conduit tout droit vers les horreurs, le mot n’est hélas pas trop fort, du « bourrage des crânes », de l’intolérance et du fanatisme. Non, ce n’était pas une simple boutade ! Il y a cette situation ultra-tragique, qui est la nôtre, celle de presque sept milliards d’hommes et de femmes généralement fort mal armés pour s’en rendre compte, cette situation que d’un côté il y a la science, la pensée réfléchie et prudente, dont les propositions sont vérifiables, mais qui hélas ne répond pas à toutes les questions qui hantent l’humanité, et que de l’autre côté il y a de nombreuses idéologies, religions, superstitions et constructions mythiques qui ont réponse à tout, définitivement, dogmatiquement, et pour les siècles des siècles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les + grandes erreurs de la science
Jean C. Baudet
INTRODUCTION
La science est vérifiable mais elle n’a pas réponse à tout. Il existe d’autres discours, qui ont une réponse à toutes nos questions. Mais ces discours à prétention de vérité universelle ne sont pas vérifiables !
Ce n’est pas une boutade.
Ce n’est pas une petite phrase, prononcée pour faire passer le temps ou pour égayer l’atmosphère, au comptoir, en buvant un petit blanc ou en dégustant son café noir avec un cube de saccharose cristallisé. C’est, très exactement, et très tragiquement, la situation de l’intelligence en ce début de siècle, également partagée (paraît-il, mais est-ce vérifiable ?) entre plus de sept milliards de représentants (mâles et femelles) d’une espèce vivante que les zoologistes du XIXe siècle, gens fort optimistes à l’époque, ont baptisée, évidemment en latin, Homo sapiens, l’homme sage, raisonnable, prudent, judicieux. Car le français propose plusieurs traductions de sapiens, qui a la même racine que sapidus, ce qui signifie « qui a de la saveur, du goût ». Mais l’Homo sapidus ne concerne que les anthropophages.
Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des horreurs du cannibalisme. Mais, quand même, je vous entretiendrai de quelques erreurs-horreurs. En soi, elles ne sont peut-être pas bien tragiques, ne dit-on pas, en latin, errare humanum est, l’erreur est humaine ? Mais justement, de l’erreur à l’illusion, il n’y a qu’un pas, et ce pas nous conduit tout droit vers les horreurs, le mot n’est hélas pas trop fort, du « bourrage des crânes », de l’intolérance et du fanatisme. Non, ce n’était pas une simple boutade ! Il y a cette situation ultra-tragique, qui est la nôtre, celle de plus de sept milliards d’hommes et de femmes généralement fort mal armés pour s’en rendre compte, cette situation que d’un côté il y a la science, la pensée réfléchie et prudente, dont les propositions sont vérifiables, mais qui hélas ne répond pas à toutes les questions qui hantent l’humanité, et que de l’autre côté il y a de nombreuses idéologies, religions, superstitions et constructions mythiques qui ont réponse à tout, définitivement, dogmatiquement, et pour les siècles des siècles.
Nous sommes loin de l’humour de comptoir. Nous sommes au cœur de la condition humaine, inquiétante et tragique. Que savons-nous ? Et ce que nous savons, qu’est-ce que ça vaut ? Quelle est la valeur de la science ?
Je vais répondre en vous racontant quelques anecdotes, bien connues des spécialistes, mais souvent oubliées, et assez drôles, en somme.
Je vais vous montrer, en puisant quelques exemples dans l’histoire – une histoire qui dure depuis plus de 25 siècles, si on admet que la pensée scientifique apparaît avec Thalès de Milet –, je vais vous signaler quelques erreurs de la pensée humaine quand elle veut aller trop vite pour connaître et pour comprendre. Quelques cafouillages de cet édifice surprenant, un édifice existant à plus de six milliards d’exemplaires, que les biologistes et les médecins appellent le SNC, le « système nerveux central », qui est formé de deux hémisphères cérébraux de substance molle, d’une moelle épinière et de quelques annexes. Ce SNC que l’on appelle aussi l’esprit humain, l’intelligence, la raison, ratio en latin, logos en grec. Ce que certains discours invérifiables, mais ayant réponse à toutes les questions, appellent l’âme.
Je ne vais pas établir le vaste, presque infini, tableau des divagations de l’âme humaine, c’est-à-dire du cerveau, formé de quelques milliards de neurones inter-connectés en un grand « réseau pensant ». Cette « âme » est faite pour produire des idées, et rien ne la limite dans ses « idéations ». Elle conçoit, avec une grande facilité, des monstres plus monstrueux que les iguanodons ou les tyrannosaures, elle imagine des utopies et des uchronies, elle invente un âge d’or ou des lendemains qui chantent, elle crée des valeurs, des droits et des devoirs, des astres plus brillants que les étoiles, des gouffres plus profonds que les océans. Ce n’est pas ce travail d’imagination qui nous « interpelle », où l’on retrouve les naïvetés de l’enfant, les constructions bizarres du rêveur, les terreurs du primitif, les fantasmes de l’exalté, les enchantements du poète, les illuminations du mystique et les hallucinations du fou.
Tout cela forme l’immense bric-à-brac des dossiers psychiatriques et des rapports d’enquêtes des ethnographes et des historiens. C’est intéressant, certes, c’est même passionnant, mais en somme cela n’a rien d’étonnant. Quand on rêve, quoi de plus naturel, de plus normal que de fixer des ailes à un cheval, d’imaginer des êtres invisibles mais agissants, d’inventer des entités extraordinaires ? Les bandes dessinées, les religions et les romans d’aventures sont pleins jusqu’à l’indigestion de héros fabuleux, de vampires, de fantômes, de voyages intergalactiques, d’âmes mortes, de dieux, d’esprits, de démons, de diables, d’influences astrales, de pierres magiques, de métempsychoses, d’hommes invisibles, de sorcières, d’extraterrestres, de soucoupes volantes, d’araignées géantes, de fées, de saints et de martyrs…
Le surnaturel est tout naturel, si l’on comprend bien que l’esprit humain est doté d’un simple mais immense pouvoir, qui est de donner un nom à chaque chose, et même de donner un nom à des choses qui n’existent pas !
Ce n’est donc pas des innombrables facettes de l’imagination humaine que nous nous occuperons, dont l’étrangeté est finalement bien pauvre. Quoi de plus « normal » qu’un esprit comme celui des hommes imagine des entités mystérieuses, des pactes avec le diable, des morts revenant effrayer les vivants, des êtres immortels, des pierres sacrées dotées de je ne sais quel étrange pouvoir ? Ce qui va nous intéresser, c’est qu’au sein de la science, parmi ces hommes très rares qui, au cours du temps, ont construit la science, au cours de quelques siècles après des millénaires de pensée « archaïque », voire après (pour nos plus lointains ancêtres) pas de pensée du tout, ce qui va retenir notre attention c’est qu’au sein de ce savoir scientifique produit avec d’immenses précautions méthodologiques, savoir devenu immense et décisif pour le sort même de l’humanité, il s’est produit quelques dysfonctionnements, parfois simples errements vite corrigés par la communauté scientifique, parfois lourdes erreurs qui aveugleront pendant des années, pendant même de longs siècles, la plus haute pensée des hommes !
Ce qui est intéressant, ce ne sont pas les inévitables fantasmagories de la pensée la plus ordinaire, mais les étonnants ratages de la pensée la plus exigeante.
La science, qui a mis des millénaires pour apparaître parmi les hommes, qui ne va jamais concerner directement qu’une infime proportion parmi les humains, mais qui va influencer le sort de tous, cette science qui est la lente construction de la vérité, va de temps en temps retomber dans les erreurs, les fantasmes et les illusions.
Voici quelques-uns de ces errements.
LES QUATRE (OU CINQ ?) ÉLÉMENTS
L’erreur est inhérente à la recherche. Demandez-le au commissaire Maigret ou à un de ces inspecteurs de police des séries télévisées : ils cherchent l’assassin mais ils commencent souvent par soupçonner des innocents. Ainsi va toute recherche du vrai, et même la recherche scientifique de la vérité, la plus haute activité intellectuelle chez les humains, fonctionne avec le risque constant de l’erreur.
Mais au fait, c’est quoi, « la science », la « recherche scientifique » ?
C’est précisément en étudiant comment elle a commencé, comment elle est apparue parmi les hommes, que nous découvrirons sa nature, qui en réalité est très simple. Les spécialistes, qui ont étudié les textes « scientifiques » du début du XXIe siècle, puis qui ont étudié les textes du XXe siècle (notamment les ouvrages d’Albert Einstein), puis les textes du XIXe siècle (Charles Darwin), puis les textes du XVIIIe siècle (Antoine-Laurent de Lavoisier), puis les textes du XVIIe siècle (Isaac Newton), puis les textes du XVIe siècle (Nicolas Copernic) et ainsi de suite, en remontant le temps, ces spécialistes ont achevé leur quête des origines en remontant jusqu’au tout début du VIe siècle avant notre ère. Ils s’accordent pour affirmer qu’alors paraissent les premiers textes « scientifiques » et, donc, que tous les textes antérieurs, par exemple l’Iliade et l’Odyssée, qui datent du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, ne méritent pas cet adjectif « scientifique ». Les textes encore plus anciens, écrits en hiéroglyphes, que l’on a découverts dans les tombeaux égyptiens, ou écrits en cunéiformes, que les archéologues ont extraits des sables de Mésopotamie, tous ces textes très anciens ne sont pas davantage des œuvres scientifiques. La science est née tardivement – deux millénaires et demi après l’invention de l’écriture, dix millénaires après les commencements de l’agriculture et de l’élevage – dans l’histoire des hommes. Elle est née en Grèce, à Milet, en Ionie (aujourd’hui l’Ionie est un territoire possédé par les Turcs), au début du VIe siècle, il n’y a même pas trois mille ans. Les pyramides d’Égypte sont plus anciennes…
Que s’est-il passé ? Un homme – il s’appelait Thalès – s’est posé des questions. Cela n’est pas nouveau. Et il a voulu répondre par lui-même, il a eu l’extrême audace de rejeter toutes les réponses proposées par d’autres et de prétendre trouver les réponses par sa seule réflexion. Cela est inouï, jamais vu, d’une novation absolue !
Eh bien, c’est cela, la science ! Et aussi la philosophie, car à l’époque de Thalès de Milet, la distinction entre science et philosophie n’est pas encore clairement établie. Thalès de Milet est le premier savant et le premier philosophe.
La science, c’est la décision de résoudre les problèmes en rejetant résolument toutes les solutions proposées par les traditions, par « les autres », c’est vouloir répondre en ne faisant appel qu’à sa propre intelligence, à ses propres facultés mentales, à la raison. Balayer, d’un même mouvement décisif, les traditions religieuses – c’est-à-dire Homère et Hésiode, mais aussi toutes ces mystérieuses croyances des Égyptiens (Isis et Osiris), des Mésopotamiens (Nanna, Utu et Inanna) et des autres « Barbares ». La science a commencé quand certains hommes ont cessé de croire aux injonctions des prêtres, aux récits des poètes, aux explications des anciens, aux codes des législateurs, aux exhortations des prophètes, aux promesses des démagogues, aux enseignements des gurus… Insistons bien, depuis Thalès de Milet jusqu’aux laboratoires et observatoires de nos jours, la science est produite et partagée par un très petit nombre d’hommes.
C’est vraiment très simple ! La science et la philosophie, c’est-à-dire la pensée rationnelle (du latin ratio), la pensée logique (du grec logos), la pensée réfléchie, c’est la tradition qui rejette toutes les traditions. C’est une tradition, bien sûr, puisque c’est une histoire, et Platon recueille les idées de Thalès, et Aristote a reçu les enseignements de Platon, et bien plus tard encore, Planck se basera sur Maxwell, puis Einstein se basera sur Planck, puis les physiciens d’aujourd’hui se baseront sur ces physiciens d’hier, mais pas pour accepter pieusement les idées de leurs prédécesseurs comme une sainte et intouchable tradition, mais tout au contraire en examinant cet ensemble d’idées de manière impitoyablement critique, et que l’on acceptera ou que l’on réfutera. Voilà la toute simple différence entre la pensée philosophique, rationnelle, scientifique, et la pensée spontanée, archaïque, toujours respectueuse des traditions. Je ne vais pas développer ici cette idée que j’ai développée dans d’autres ouvrages, mais il y a là un fait historique et psychologique d’une extrême simplicité. De tous les peuples des temps anciens dont on connaît des textes, seuls les Grecs – ou, du moins, certains Grecs – ont osé mettre en doute et rejeter leurs traditions. C’est pourquoi il n’y a, parmi les nombreuses productions idéologiques des hommes, que celles issues de la pensée grecque que l’on peut considérer comme « scientifiques ». Il y a une science « occidentale » qui va, en droite ligne, de Thalès de Milet à Einstein et aux prix Nobel de notre temps. Si l’on a bien compris la signification du mot « science », on comprend facilement qu’il n’y a pas eu de science arabe, pas plus que de science latine, au Moyen Âge. Les médiévaux, tant en pays musulman et en arabe qu’en pays chrétien et en latin, n’ont pas eu l’audace de rejeter le Coran ou les Évangiles, et pendant dix siècles il n’y eut pas de véritable pensée scientifique. Il n’y a pas eu davantage de « science chinoise », de « science indienne » ou de « science maya ». Ce qui, évidemment, ne signifie pas que les Chinois, les Indiens, les Mayas ou les Égyptiens de la période pharaonique ou les Sumériens ou même les aborigènes les plus primitifs, n’avaient pas certains « savoirs ». Mais savoir faire du feu, savoir tailler des pierres, savoir noter le mouvement des étoiles et savoir faire des additions et des multiplications, est-ce déjà de la science ? À ce compte-là, dans nos écoles primaires, les bambins de dix ans qui calculent le volume d’un cylindre ou d’un cube sont de grands scientifiques…
Donc, la science commence avec Thalès de Milet.
Il se pose la grande question : de quoi est fait le monde, quel est le constituant de l’Univers, d’où viennent tous ces objets infiniment divers qui nous entourent, pierres, plantes, animaux, nuages dans le ciel, étoiles ? Il rejette les cosmogonies mythiques qui font intervenir des dieux créateurs ou organisateurs du cosmos, il rejette toutes ces traditions transmises par des prêtres et des poètes et il se propose de répondre lui-même à cette question. Il a confiance dans les capacités de l’intelligence humaine. Il observe et compare. Il sait qu’un même homme peut engendrer des enfants tous différents. Il sait qu’un forgeron peut transformer le bronze en fusion en une hache, un glaive ou une statue. Il sait qu’une racine se différencie en tiges, en feuilles, en fruits. Il sait qu’une source se transforme en un mince filet d’eau, puis en une rivière, parfois même en un puissant fleuve. Il se convainc donc que la multiplicité peut venir de l’unité, qu’une « source », une « racine » unique doit être à l’origine des choses les plus diverses. Ses observations se succèdent, ses raisonnements se développent, et il arrive à cette conclusion, qu’il doit uniquement à sa propre réflexion, que toutes les choses du monde, malgré leur diversité immense, ne sont finalement faites que d’une seule réalité ultime, qui est l’eau, c’est-à-dire une substance liquide, versatile, qui contient en puissance toutes les substances cosmiques.
Ne cherchez pas encore l’erreur.
Bien sûr, pour l’homme du XXIe siècle, le raisonnement de Thalès semble bien naïf. Il est étonnamment moderne et puissant, au contraire. Le Milésien a compris que l’on peut expliquer le multiple par l’unique, il a élaboré l’idée du monisme (une seule chose expliquant toutes les choses), il a surtout entamé ce processus, qui ne s’arrêtera plus, qui consiste à observer et à réfléchir pour connaître, c’est-à-dire pour construire des réponses.
Thalès (625-548, dates incertaines) eut des successeurs, que l’on appelle les physiciens de Milet, parce qu’ils étudièrent la nature des choses, et que nature se dit « physis » en grec. Certains acceptèrent la leçon de Thalès, d’autres poursuivront la réflexion. Anaximène de Milet pensera que le constituant ultime du cosmos est l’air, plutôt que l’eau. Héraclite d’Éphèse pensera que le feu est à l’origine de toutes choses. Xénophane de Colophon, lui, pensera que c’est la terre qui est le constituant universel du monde. Il arrivera qu’un penseur grec, Empédocle d’Agrigente (mort vers 430), fera la synthèse des idées des Milésiens. Empédocle, en effet, admettra qu’il existe non pas un constituant universel à l’origine de tout, mais qu’il en existe quatre. Il y a quatre principes, quatre éléments, quatre racines de toutes choses, et les choses diffèrent les unes des autres par les proportions des éléments qui les constituent. Les substances légères – comme les fumées, par exemple – contiennent une grande quantité d’air, alors que les substances lourdes sont surtout formées de terre. Les substances brillantes contiennent plus de l’élément feu que les substances ternes et ainsi de suite.
Ne cherchez toujours pas l’erreur. L’idée d’Empédocle est naïve, bien sûr, par rapport à nos conceptions modernes, mais c’est une idée « qui se tient », c’est l’idée – opposée au monisme de Thalès – que le multiple ne peut être expliqué que par le multiple. Nous sommes en tout cas très loin des fables cosmogoniques d’un Hésiode chez les Grecs, du Poème de la Création chez les Sumériens ou de la Genèse des Hébreux, où interviennent des dieux et des esprits invisibles.
En Grèce, les penseurs succèdent aux penseurs, et on commence à les appeler des « philosophes ». L’histoire nous amène en 387, toujours avant notre ère, à Athènes. Dans les jardins d’Académos, un philosophe qui s’appelle Platon (mort en 347) fonde une école de philosophie, que l’on appellera l’Académie, et qui connaîtra un vif et très long succès. Elle ne fermera ses portes qu’au début du VIe siècle après Jésus-Christ, ce qui fait une fort belle longévité pour une institution de l’Antiquité.
L’œuvre de Platon est considérable. C’est un savant universel, qui va s’intéresser, pendant sa longue vie, à toutes sortes de problèmes. Il fut très respecté de son temps et est indiscutablement très respectable. On l’admire encore, aujourd’hui, dans certains milieux intellectuels. Cependant, si on analyse attentivement son œuvre, on y découvre des errements inexcusables.
En voici un…
Platon adopte la théorie des quatre éléments d’Empédocle d’Agrigente. Peut-être aurait-il été mieux inspiré d’adopter la théorie concurrente de Démocrite d’Abdère (mort vers 370), qui disait qu’il n’y a pas quatre éléments, mais qu’il y en a des centaines, sous la forme de particules extrêmement petites et insécables, ce qui se dit atomes en grec. Car voici l’erreur. Une erreur incroyable, qui va être proposée au monde savant avec une telle vigueur qu’elle va être adoptée pour mille ans, et même pour plus de mille ans !
Platon expose sa théorie dans un texte intitulé le Timée, parce que c’est un dialogue où un des protagonistes s’appelle Timée, un astronome par ailleurs très mal connu. L’erreur ne consiste pas dans l’idée qu’il y a quatre éléments, mais dans la tentative de démontrer qu’il y en a quatre, et seulement quatre. Empédocle a réuni pour les harmoniser les idées de ses prédécesseurs. Ce n’est certes pas une garantie de véracité, mais c’est une démarche assez compréhensible. Platon veut prouver qu’il y a quatre éléments. Et il tombe dans une incroyable ratiocination.
À vrai dire, ce n’est pas de Platon qu’il faut se moquer, mais des générations de commentateurs qui ont admiré la dialectique platonicienne ! Encore actuellement, si je suis bien informé, il y a de très sérieux professeurs de philosophie qui enseignent la doctrine du Timée, avec une révérence qui me semble suspecte.
Je ne vais pas reproduire in extenso le raisonnement de Platon. Il est fort long et inutilement subtil. En voici les principales articulations.
Platon part du fait que les choses sont visibles et tangibles, ce qui est vrai – du moins pour les choses accessibles par la vue et le toucher – et il en conclut qu’il doit donc exister, au sein des choses, un élément de visibilité et un élément de tangibilité. C’est-à-dire qu’il faut au moins deux éléments, le feu (visibilité) et la terre (tangibilité). Cela semble très raisonnable, mais il ne faut pas réfléchir longtemps pour se demander pourquoi Platon n’est pas allé jusqu’au bout de son raisonnement. Il y a cinq sens et non deux, Platon le savait bien. Alors pourquoi pas cinq éléments ? Ne faut-il pas aussi admettre un principe de sonorité (l’ouïe), un autre d’olfactibilité (l’odorat), un troisième de sapidité (le goût) ?
Le fondateur de l’Académie ne suit pas cette direction. Après avoir « démontré » qu’il doit exister deux principes au moins, il entame une extraordinaire explication esthétique. Pour faire le monde beau comme il est, il faut une harmonie entre les éléments, et on ne peut pas obtenir une telle harmonie avec deux éléments seulement, il en faut au moins trois. Et puis, même avec trois, ce n’est pas encore assez, et il en faut quatre. Voilà pourquoi il y a quatre éléments !
Platon explique : Mais avec deux principes seuls faire une belle composition, sans un troisième c’est impossible ; il y faut en effet un lien, un moyen terme, pour concilier les deux. Or, des liens, le plus beau est celui qui à soi-même et aux termes qu’il relie impose la plus complète unité, et c’est ce que, par nature, la proportion accomplit de façon parfaite. Toutes les fois, en effet, que de trois nombres, ou masses ou forces quelconques, le moyen a cette propriété que ce que le premier est à lui-même, lui-même l’est au dernier (…) alors, le moyen peut prendre la place du premier et du dernier, le dernier et le premier à eux deux la place du moyen ; tous, de la sorte, c’est une conséquence nécessaire, ont un rôle équivalent (…) donc, entre le feu et la terre, le dieu plaça comme intermédiaires l’eau et l’air, et de leurs rapports mutuels, dans la mesure du possible, il réalisa une proportion, ce que le feu est à l’air, l’air étant à l’eau, et ce que l’air est à l’eau, l’eau l’étant à la terre ; les unissant d’un tel lien, il constitua un ciel visible et tangible. Et c’est par ces procédés, et à partir de ces principes, ainsi faits et au nombre de quatre, que le corps du monde fut engendré, mis d’accord par la proportion.
Cette invraisemblable démonstration a convaincu, et c’est cela qui est le plus invraisemblable ! Alors que la science devrait être le rejet de toute autorité, l’autorité de Platon sera telle que l’on acceptera, pendant des siècles, la théorie extravagante de Platon.
LES CINQ POLYÈDRES
Cette première « erreur de la science » (mais peut-on vraiment parler de science ?) va dominer la pensée scientifique et philosophique jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Elle va véritablement « bloquer » la réflexion. Pourquoi réfléchir à la constitution ultime de la matière si Platon, le divin Platon, a résolu le problème de façon définitive ? Le platonisme est ainsi (et pas seulement par sa théorie des quatre principes) non pas une étape de l’histoire de la science, mais un retour de l’esprit religieux ou, du moins, du respect de certaines traditions. Quand la science n’avance pas, elle recule.
Mais ce n’est pas tout. Platon ne se contente pas de démontrer de manière proprement farfelue qu’il y a et qu’il ne peut y avoir que quatre éléments. Il poursuit sa « réflexion ». Il sait que les géomètres ont démontré qu’il ne peut exister que cinq polyèdres réguliers, c’est-à-dire cinq figures inscriptibles dans une sphère, formées de faces toutes égales.
Les cinq polyèdres réguliers
Ces polyèdres sont le tétraèdre (pyramide ayant quatre faces qui sont des triangles), le cube (six faces qui sont des carrés), l’octaèdre (huit faces qui sont des triangles), le dodécaèdre (douze faces qui sont des pentagones) et l’icosaèdre (vingt faces qui sont des triangles). C’est assez remarquable ! Les géomètres grecs étaient parvenus à identifier ces corps, étaient parvenus à démontrer que les sommets de ces corps se trouvent sur une même sphère et ils étaient même arrivés à démontrer de manière irréfutable qu’il n’existe aucun autre polyèdre régulier de ce genre, quel que soit le nombre de ses faces ! Un bel exemple du niveau atteint par la science grecque au IVe siècle avant notre ère…
Eh bien, voici la deuxième et lamentable erreur de Platon, pourtant un des plus brillants esprits d’Athènes, à l’époque où Athènes pouvait se prétendre le centre de l’intelligence humaine. Non seulement, par ses raisonnements parfaitement futiles, Platon « démontre » qu’il n’y a que quatre éléments mais, en outre, il veut absolument qu’il y ait une correspondance entre les éléments et les polyèdres.
Voici le passage du Timée qui expose cette idée réellement bizarre : Les genres dont notre discours a tout à l’heure montré la genèse, répartissons-les entre le feu, la terre, l’eau et l’air. À la terre, précisément, attribuons la forme cubique : le plus immuable, en effet, des quatre genres, c’est la terre et, des corps, le plus plastique (…). L’eau, à son tour, se verra attribuer des formes restantes la plus difficilement mobile ; la plus facilement mobile sera pour le feu, la forme intermédiaire pour l’air. De même, le corps le plus petit reviendra au feu, le plus grand au contraire à l’eau, le moyen à l’air ; le plus aigu, enfin, ira pour le feu, le second à cet égard pour l’air, le troisième pour l’eau (…). Concluons donc que, selon la droite raison comme selon la vraisemblance, le solide en forme de pyramide est le principe et le germe du feu ; le second dans l’ordre de la genèse, disons qu’il est celui de l’air ; le troisième, celui de l’eau.
Platon caractérise donc chaque principe par une figure géométrique, qui est un polyèdre régulier. Est-ce convaincant ? Est-ce vraiment un résultat obtenu selon la droite raison comme selon la vraisemblance ? Il me semble que non. Pourquoi d’ailleurs une substance primordiale correspondrait-elle à une forme polyédrique ? Pourquoi pas à une couleur ou à un goût ? Et d’ailleurs, il y a un problème. S’il y a bien cinq polyèdres réguliers (et cela, c’est indiscutablement démontré par les géomètres), pourquoi n’y a-t-il que quatre éléments ?
Nous possédons de nombreux dialogues de Platon, ou attribués à Platon. On connaît ainsi un dialogue, Epinomis, dont l’attribution au maître est douteuse. Si ce n’est pas Platon qui a écrit l’Epinomis, c’est certainement un de ses disciples. Voici un passage qui va nous intéresser : Il existe cinq corps solides, au moyen desquels on pourrait façonner les choses les plus belles et les meilleures. (…) Puisque nous avons distingué cinq espèces de corps, il faut maintenant dire que ce sont le feu et l’eau, nommer l’air comme la troisième espèce, la terre comme la quatrième, l’éther enfin comme la cinquième (…).
Donc Platon ou, plus vraisemblablement, un de ses élèves a vu la faille du raisonnement et a conclu qu’il y a bien un cinquième élément, l’éther, qui est comme une espèce de feu subtil, constitutif des régions « éthérées », c’est-à-dire les régions du ciel les plus élevées.
La tradition, de Platon jusqu’au XVIIIe siècle et même presque jusqu’à nos jours, voit dans cette théorie des quatre ou cinq éléments rattachés aux cinq polyèdres « platoniciens » une des plus subtiles découvertes de la philosophie. Mais ne nous leurrons pas. Il n’y a là qu’un simulacre de raisonnement, qu’une découverte parfaitement illusoire, qu’une lamentable erreur. Par sa naïve confiance en ses raisonnements, Platon a fait régresser la pensée. Avec le Platon du Timée, on en revient aux fantasmes d’un Hésiode ou d’un cosmogoniste sumérien ou égyptien. Croire que l’on peut découvrir l’origine de toutes choses par quelques réflexions. Pendant des siècles, les meilleurs des « intellectuels » vont baser leur vision du monde sur les cinq éléments et les cinq polyèdres !
Évidemment, il nous est facile d’ironiser, et je suis peut-être injuste en me moquant si cruellement du fondateur et maître de l’Académie. Il nous est facile à nous, hommes du XXIe siècle, de nous moquer, entourés de bibliothèques immenses où l’on peut consulter tout (ou presque) ce qui a été écrit depuis Platon jusqu’aux derniers numéros de l’American Journal of Physics, du Journal of the American Chemical Society ou de l’International Journal of Theoretical Physics ou de bien d’autres revues scientifiques. Nous savons qu’il n’y a ni quatre ni cinq éléments. Nous savons que l’existence de cinq polyèdres réguliers (dans ce que les mathématiciens d’aujourd’hui appellent l’espace euclidien à trois dimensions) n’a rien à voir avec la constitution de la matière. Mais nous savons aussi à quel point il est difficile pour l’esprit humain de se détacher des traditions, de se méfier de ses propres idées, d’éviter de tomber dans des conclusions hâtives à partir de quelques vagues correspondances.
Bref, Platon s’est trompé, et lourdement.
Son meilleur élève, Aristote de Stagire (384-322), se trompera aussi. Il acceptera sans hésiter la théorie des éléments de son maître, il adoptera même clairement l’idée du cinquième élément et il ajoutera sa propre autorité à celle de Platon pour faire accepter cette théorie. Pendant plus de mille ans, je le répète, personne, absolument personne n’en doutera : le monde est formé par la réunion de cinq principes, l’eau, l’air, le feu, la terre et l’éther.
Aristote « perfectionnera » même la théorie d’Empédocle et de Platon. Il prétendra qu’il y a un lieu naturel pour chacun des éléments. Il affirmera que le lieu naturel de l’élément terre est au centre de la Terre, ce qui explique que les corps pesants (qui contiennent beaucoup de terre) tombent selon une verticale. Il expliquera que le lieu naturel de l’air est par contre le Ciel, ce qui est prouvé par le fait que les fumées (contenant beaucoup d’air) montent dans l’atmosphère.
Je dois signaler une autre erreur de l’Antiquité grecque, étroitement liée à l’erreur des quatre éléments.
Il s’agit de médecine.
On sait que la médecine, au IVe siècle avant notre ère, à l’époque de Platon et d’Aristote, était un mélange de ferveur religieuse, d’esprit magique et d’observations chirurgicales et pharmaceutiques. On connaissait un peu d’anatomie, on connaissait quelques médicaments (surtout d’origine végétale) plus ou moins efficaces et on ne doutait pas que les maladies étaient provoquées par des esprits malveillants, et on menait les malades dans les temples en espérant la bienveillance des dieux. Bref, une médecine traditionnelle, en rien différente de celle des Égyptiens au début de l’ère pharaonique ou même de ce qu’ont pu observer les ethnographes chez les peuples primitifs. Une médecine de guérisseurs, magico-religieuse, pas une médecine de médecins. En tout cas, pas encore une médecine « scientifique ».
Et voilà que, vers 425, Hippocrate (mort en 370) fonde une école de médecine dans sa ville natale, à Cos. Cet Hippocrate a écrit de nombreux traités de médecine et on connaît donc bien ses conceptions. On peut, réellement, le considérer comme le fondateur de la médecine scientifique : il rejette les traditions, en particulier tout ce qui touche à des interventions d’esprits et de dieux, et il envisage la maladie de façon exclusivement rationnelle. Pour soigner un malade, il ne faut pas prier les dieux mais il faut observer le malade, étudier les symptômes du mal, essayer de comprendre le mécanisme morbide et utiliser les connaissances acquises dans l’étude des maladies pour tenter une action thérapeutique.
Mais il arrive à Hippocrate ce qui arrive à Platon. Sa théorie commence bien – n’admettre que des faits d’observation – mais finit mal – avoir trop confiance dans le raisonnement.
Impressionné par la théorie des quatre éléments, Hippocrate admet en effet que la santé est un équilibre du corps entre quatre constituants principaux, les quatre « humeurs ». C’est vraiment le même processus psychologique que celui d’Empédocle ou de Platon. On part d’observations – il y a, effectivement, des liquides (eau), des solides (terre)… – et on tire des conclusions vraiment rapides. Observation correcte : le corps humain contient des liquides, le sang, la lymphe, la bile. Raisonnement illusoire : il doit y avoir quatre liquides, quatre humeurs, puisqu’il y a quatre éléments, et donc le corps humain doit sa santé à l’équilibre entre le sang, la lymphe, la bile et… l’atrabile. Hippocrate n’a pas observé l’atrabile, pour la raison que l’atrabile n’existe pas. Mais, puisqu’il y a quatre éléments, il doit y avoir quatre humeurs ! Ce qu’on ne voit pas, on l’invente !
La théorie hippocratique des quatre humeurs sera acceptée par un nombre considérable des médecins et dominera les conceptions médicales pendant des siècles.
LES SEPT MÉTAUX
Nous avons déjà rencontré trois erreurs de la science, et pas de petites erreurs, ce sont des erreurs qui vont être enseignées pendant des siècles : les quatre éléments (Platon), les cinq polyèdres (Platon), les quatre humeurs (Hippocrate). Eh bien, l’Antiquité grecque est aussi à l’origine d’une quatrième erreur, qui va bloquer pendant longtemps le progrès scientifique mais dont, cette fois, il est difficile de déterminer la paternité.
En effet, si on connaît bien Platon et Hippocrate, parce que l’on possède leurs textes et les textes de nombreux commentateurs, on ne sait rien, absolument rien, de l’erreur – énorme – dont je vais parler maintenant.
On ne sait pas où elle est née.
On ne sait pas comment elle est née.
On ne sait pas quand elle est née.
On ne sait pas qui l’a formulée pour la première fois.
Mais on sait qu’elle apparaît, peut-être à Alexandrie, en tout cas en territoire grec, après les conquêtes d’Alexandre le Grand, un peu avant l’avènement de l’Empire romain, c’est-à-dire au Ier siècle avant Jésus-Christ, peut-être même déjà au IIe siècle.
C’est encore une fois l’idée d’une correspondance. Comme il y eut la correspondance (illusoire) entre les éléments et les humeurs ou entre les éléments et les polyèdres.
À cette époque, les Grecs connaissaient sept planètes, c’est-à-dire sept corps célestes qui ont un mouvement propre dans le ciel, contrairement aux étoiles qui se déplacent toutes ensemble et qui, donc, restent toujours fixes les unes par rapport aux autres, formant ainsi les « constellations ». Ces astres « mobiles » sont le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Bien. Pas d’erreur. Ces sept corps se distinguent bel et bien des étoiles.
Les Grecs savaient aussi qu’il existe sept métaux, qui sont l’or, l’argent, le vif-argent, le cuivre, l’étain, le plomb et le fer. Pas d’erreur non plus. Il y avait certes d’autres métaux, comme par exemple le bronze, mais les Grecs avaient su faire la distinction entre les métaux proprement dits (les sept) et les alliages que ces métaux peuvent former si on fait certains mélanges. Ainsi le bronze est-il un alliage de cuivre et d’étain.