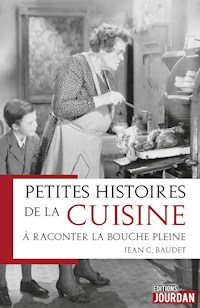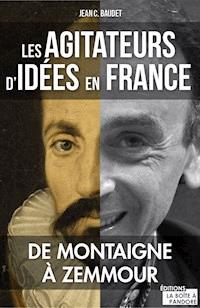
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Plus de trois-cents « intellectuels » sont ainsi replacés dans l’Histoire, formant plus qu’un simple dictionnaire des grands auteurs.
La présentation des plus grands représentants de la Pensée française – depuis François Ier jusqu’à nos jours – constitue un voyage passionnant dans l’Histoire des grandes idées en France. Il s’agit en réalité d’une analyse de l’évolution de l’activité intellectuelle en France, depuis l’avènement de l’imprimerie jusqu’au développement actuel de la communication audio-scripto-visuelle. C’est en outre l’occasion d’analyser la notion si française d’« intellectuel » (avant et après Émile Zola).
L’ouvrage peut se lire à la fois comme le « roman de l’intelligence » ou comme un dictionnaire des grands penseurs.
EXTRAIT :
Qu’est-ce qu’un intellectuel ?
Qui sont les intellectuels français ? Quelle est leur mission sociale – à quoi servent-ils ? Quels sont les fondements de leur pensée ? Quel fut et quel est leur impact sur l’évolution de la société française, et peut-être même du monde, au moins du monde où l’on lit le français ? Quelle est leur part de responsabilité dans les maux d’aujourd’hui (et de demain, car cela risque d’aller de mal en pis1) de la France en crise ? Le chômage, la violence et l’insécurité, l’abêtissement et les déraisons allant jusqu’au fanatisme, tout cela n’est pas propre à la France, mais les intellectuels de France ont-ils, sur ces phénomènes, une influence, et est-elle positive ou funeste ?
Voilà les questions de ce livre.
Elles me paraissent essentielles, décisives même, car il s’agit de déterminer comment, en France, l’intelligence et l’érudition sont mises – ou ne le sont pas – au service des améliorations économiques et sociales nécessaires et d’une organisation politique bénéfique pour la majorité des Français. C’est, dit de manière plus abstraite, le problème du rapport entre le Savoir et le Pouvoir. C’est la belle et difficile question de la relation entre la Connaissance (des philosophes et des experts) et l’Action (des politiques). C’est encore la rencontre entre le Singulier (du penseur, toujours de son époque et de ses conditionnements) et l’Universel (de la vérité, c’est-à-dire de l’adéquation des discours divers avec le réel unique).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les agitateurs d’idées en France
Jean C. Baudet
QUESTIONS
Qu’est-ce qu’un intellectuel ?
Qui sont les intellectuels français ? Quelle est leur mission sociale – à quoi servent-ils ? Quels sont les fondements de leur pensée ? Quel fut et quel est leur impact sur l’évolution de la société française, et peut-être même du monde, au moins du monde où l’on lit le français ? Quelle est leur part de responsabilité dans les maux d’aujourd’hui (et de demain, car cela risque d’aller de mal en pis1) de la France en crise ? Le chômage, la violence et l’insécurité, l’abêtissement et les déraisons allant jusqu’au fanatisme, tout cela n’est pas propre à la France, mais les intellectuels de France ont-ils, sur ces phénomènes, une influence, et est-elle positive ou funeste ?
Voilà les questions de ce livre.
Elles me paraissent essentielles, décisives même, car il s’agit de déterminer comment, en France, l’intelligence et l’érudition sont mises – ou ne le sont pas – au service des améliorations économiques et sociales nécessaires et d’une organisation politique bénéfique pour la majorité des Français. C’est, dit de manière plus abstraite, le problème du rapport entre le Savoir et le Pouvoir. C’est la belle et difficile question de la relation entre la Connaissance (des philosophes et des experts) et l’Action (des politiques). C’est encore la rencontre entre le Singulier (du penseur, toujours de son époque et de ses conditionnements) et l’Universel (de la vérité, c’est-à-dire de l’adéquation des discours divers avec le réel unique).
A ce questionnement, nous tenterons de répondre par l’examen de l’Histoire. Nous allons situer les intellectuels français dans le Temps. Nous allons suivre, au cours de quelques siècles, depuis le royaume de France de Charles VIII (1483-1498) jusqu’à la République Française de François Hollande (2012-?), les œuvres successives de ceux que l’on n’appelait pas encore des « intellectuels » au XVIe siècle, mais qui l’étaient déjà, et donc on peut dire que voici une histoire de l’intelligentsia française présentée sous forme de notices biographiques successives. Car je ne sais pas si « l’Esprit souffle où il veut », mais il me semble que l’intelligence et les connaissances se développent dans des consciences, c’est-à-dire chez des hommes et des femmes en chair et en os (et avec des neurones) parfaitement repérables dans le temps et dans l’espace. J’irais même plus loin. Pour l’historien et pour le philosophe, l’esprit ou la pensée sont des abstractions inobservables, et même les hommes et les femmes qui développèrent des idées novatrices ne sont plus atteignables, mais il reste leurs écrits effectivement publiés. Nous ne savons pas ce qu’a vraiment pensé Montaigne, mais nous possédons les textes des éditions successives de ses Essais, et nous ne pouvons guère parler de Sartre ou de Voltaire, qui sont morts et enterrés, mais nous pouvons lire leurs livres.
La question peut sembler différente pour les intellectuels encore vivants, que l’on peut en principe interroger directement. Mais comment faire, en pratique ? Et puis, il est facile de constater qu’un intellectuel ne compte dans les débats de société qu’après la publication d’un livre au moins, et l’on revient à la lecture !
Bref, tous les intellectuels sont des essayistes, même si tous les essayistes ne deviennent pas des intellectuels.
Voici donc une « histoire de la pensée en France ». Non pas une histoire de la littérature, ce qui serait trop vaste : il y a des poètes, des romanciers, des dramaturges, et non des moindres, qui « ne pensent pas ». Je veux dire qu’ils se contentent d’élaborer des œuvres d’art, parfois somptueuses, voire sublimes – comment ne pas évoquer les comédies de Molière, ou les romans de Marcel Proust ? –, mais qu’ils ne passent pas à l’expression d’idées générales sur l’humain et sur les sociétés humaines. Décrire un avare, un hypocondriaque ou une famille bourgeoise, ce n’est pas encore « penser » les vices, les maladies ou les structures sociales. Et ceci n’est pas non plus une histoire de la philosophie en France, ce qui serait trop restrictif, car il n’y a pas que les philosophes qui pensent.
Au demeurant, les limites qui séparent le philosophe de l’intellectuel ou qui distinguent l’intellectuel du littérateur sont bien floues.
J’ai rassemblé à peu près 300 noms. Parmi les morts, j’en ai évidemment oublié beaucoup. Et parmi les vivants, j’en ai omis plus encore. Ma « galerie de portraits » est subjective. Mais quel est le collectionneur de tableaux qui n’acquiert pas des toiles en fonction de sa subjectivité ?
Voici donc un aperçu subjectif du PIF, du Paysage Intellectuel Français : les hommes et les femmes les plus intelligents d’hier et d’aujourd’hui. Mais puisqu’ils sont les plus intelligents, les plus experts, les plus délicats dans leurs raisonnements, les plus subtils dans leurs analyses, les plus raffinés dans leurs discours, les mieux informés, je me le demande, pourquoi n’arrivent-ils pas à s’accorder et à convaincre ? Car le PAP proposé par le PIF, c’est-à-dire le Prêt À Penser, est divers et avarié, avarié par une Pensée Unique qui, de plus en plus, en menace la richesse contradictoire. Car la vraie valeur de la pensée, c’est le doute. Et l’on doute de moins en moins, au sein du PIF…
1. Voir N. Polony : Le pire est de plus en plus sûr. Enquête sur l’école de demain. Mille et une nuits, Paris, 110 p., 2011. Et il n’y a pas que l’éducation nationale (la réduction nationale au plus bas) qui soit en crise !
DÉFINITIONS
Pour étudier les intellectuels, il faut disposer d’une définition, comme l’ornithologue doit savoir distinguer un oiseau des autres animaux pour commencer ses observations. Mais pour définir un objet quelconque, il faut connaître ses caractéristiques, et cela ressemble à un cercle vicieux. Comment savoir si tous les oiseaux ont des plumes avant d’avoir examiné tous les oiseaux ?
Les difficultés de ce genre sont facilement surmontées par l’esprit pratique. Nous ne voulons pas établir la liste exhaustive des intellectuels français. Il nous suffira de connaître les plus « importants ». Et pour cela, on peut commencer par en examiner quelques-uns, ceux qui ont reçu la consécration scolaire et, avec ou sans définition, on commencera par insérer dans la liste Montaigne, Voltaire, Sartre et quelques autres. Ayant pris en compte ces grands noms, on peut alors, dans une bonne bibliothèque1, rechercher des noms de moindre grandeur, mais dont les œuvres ressemblent aux Essais de Montaigne (1580), ou aux Réflexions sur la question juive de Sartre (1947).
Bref, c’est de manière tout empirique que, dans la liste, j’ai placé Albert Camus ou Simone de Beauvoir. Discutable ? En effet, j’ai fait des choix ! Mais cela m’a quand même conduit à tenter une définition. Voyons cela.
Tout le monde sait que le substantif même « intellectuel » est entré dans le lexique français en janvier 1898, lors de l’affaire Dreyfus, avec la très célèbre lettre ouverte au président de la République, publiée par le romancier Émile Zola dans le journal L’Aurore, intitulée « J’accuse ».
Rappelons les faits.
Le 15 octobre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus est arrêté. Il est soupçonné d’avoir livré des documents secrets à l’Empire allemand. Dreyfus, qui proclame son innocence, passe devant le Conseil de guerre le 19 décembre. Le Conseil délibère et, le 22 décembre, condamne l’officier, pour trahison, à la déportation perpétuelle au bagne de Guyane. Dreyfus arrive à l’île du Diable en mai 1895. Quelques doutes se sont élevés sur sa culpabilité, mais l’officier est bien vite oublié. Cependant, le 21 janvier 1896, le colonel Georges Picquart, un des hauts responsables du contre-espionnage en France, découvre que le vrai coupable de l’affaire Dreyfus est le commandant Ferdinand Esterhazy. Celui-ci est appréhendé, comparaît devant le Conseil de guerre et, le 10 janvier 1898, est acquitté. Cette fois, le public ne reste pas indifférent. Alfred Dreyfus est juif, et bien des personnes ayant suivi les procès soupçonnent fort les juges d’avoir succombé à des pressions antisémites. Le 13 janvier, un texte paraît en première page du journal L’Aurore, avec pour titre « J’accuse ! ». C’est une lettre ouverte au président de la République Félix Faure, demandant la révision du procès de Dreyfus. Le signataire est Émile Zola, un des romanciers à succès de l’époque. Le lendemain, L’Aurore publie un deuxième texte, intitulé « Manifeste des intellectuels », signé par Zola, par Anatole France et par quelques autres écrivains, et qui prend position pour Dreyfus. Les deux textes rencontrent une audience exceptionnelle, et l’opinion publique commence à se passionner pour la question de la culpabilité ou de l’innocence du « traître » ou de la « victime » Dreyfus. Il y aura désormais deux sortes de Français, les dreyfusards et les antidreyfusards. Ou bien, faut-il désormais distinguer les intellectuels et le public, car c’est avec le Manifeste de Zola et de ses amis dreyfusards que le mot « intellectuel » apparaît dans le vocabulaire de la langue française.
Alfred Dreyfus quittera l’île du Diable en juin 1899. Il sera reconnu innocent et réintégrera l’armée. Mais une erreur judiciaire, sur fond d’antisémitisme, lui aura fait passer quatre années de sa vie dans un enfer épouvantable.
On aura compris qu’un intellectuel, depuis l’affaire Dreyfus, est un écrivain ou un journaliste, plus généralement quelqu’un qui dispose d’un certain capital intellectuel par sa formation ou par son activité professionnelle, qui s’exprime dans les médias – au temps de Zola, il n’y avait guère que les journaux –, de manière à influencer l’opinion dans l’un ou l’autre débat de société. C’est un travailleur intellectuel, mais il ne devient « intellectuel » que s’il expose son avis sur des questions politiques. Jean-Paul Sartre précise même2 que « l’intellectuel est quelqu’un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». La formule est pertinente : dans la France des années 1890, sous la Troisième République, c’est-à-dire en régime démocratique, dans un État de droit, la question de la culpabilité d’un homme, dans quelque affaire que ce soit, relève des cours et des tribunaux (qu’ils soient civils ou militaires), et un individu quelconque, même « intelligent et cultivé », même auteur de nombreux livres, n’a pas à interférer avec la Justice. C’est une question de compétence parfaitement réglée par les textes organisant la séparation des pouvoirs selon des principes tout à fait démocratiques. Zola est un romancier, la société attend de lui qu’il écrive des romans, et non qu’il se mêle d’une question de justice. Il y a des juristes et des magistrats pour ça…
Poursuivons la lecture de Sartre, très éclairante. L’intellectuel, écrit-il, « prétend contester l’ensemble des vérités reçues et des conduites qui s’en inspirent au nom d’une conception globale de l’homme et de la société, puisque les sociétés de croissance se définissent par l’extrême diversification des modes de vie, des fonctions sociales, des problèmes concrets ».
Sociétés de croissance ? En effet ! L’apparition des intellectuels est un phénomène moderne (d’ailleurs antérieur à 1898, car la chose a existé avant le mot), et leur prolifération actuelle un symptôme de la postmodernité. On n’imagine pas un intellectuel apache ou cheyenne haranguant une foule d’Amérindiens pour contester une décision du sachem, et il n’y a pas d’intellectuels dans les sociétés archaïques.
Dans l’ouvrage que j’ai évoqué de Jean-Paul Sartre, celui-ci fait une analyse historique très intéressante de l’apparition des intellectuels, qu’il situe au XVIIIe siècle, c’est-à-dire au Siècle des Lumières ou, comme on dit aussi, au siècle des philosophes. Le processus social, d’après Sartre, commence à la fin du Moyen Âge. Le développement du commerce a entraîné une complexification de la structure sociale de la France, et à côté des trois grandes classes que sont les nobles, les clercs et les paysans, il s’est développé un groupe de plus en plus nombreux d’artisans et de commerçants, ce que l’on appellera la bourgeoisie. Ce phénomène correspond aussi au développement de l’habitat urbain et à l’agrandissement des villes. Bref, la société du XVe siècle est beaucoup plus complexe, en France, que celle de Philippe Auguste et, a fortiori, que celle de Charlemagne. La bourgeoisie a remplacé l’acquisition de richesse par la violence (méthode dont les origines remontent à la nuit des temps) par l’acquisition de richesse par le travail et le commerce, ce que l’on appelle le « profit ». Les barons rançonnent leurs serfs à la pointe de l’épée. Les bourgeois vendent ce qu’ils ont acheté, en encaissant une plus-value, à des clients, libres d’ailleurs d’acheter ou de ne pas acheter les marchandises proposées.
Cette complexification sociale, où le commerce remplace de plus en plus la confiscation, entraîne l’apparition de ce que Sartre appelle des « techniciens du savoir pratique » : « Les flottes commerciales impliquent l’existence de savants et d’ingénieurs ; la comptabilité en partie double réclame des calculateurs qui donneront naissance à des mathématiciens ; la propriété réelle et les contrats impliquent la multiplication des hommes de loi, la médecine se développe et l’anatomie est à l’origine du réalisme bourgeois dans les arts. Ces experts de moyens naissent donc de la bourgeoisie et en elle ». Et c’est bien vrai qu’à la fin du Moyen Âge, en Italie d’abord puis de proche en proche dans toute l’Europe chrétienne, les ingénieurs, les constructeurs de chariots et de navires, les comptables, les juristes, les chimistes capables d’analyser les minerais métalliques, de distiller les parfums, les apothicaires et les herboristes connaissant les médicaments, tous ces spécialistes deviennent de plus en plus nombreux. C’est en leur sein qu’apparaîtront les intellectuels, ceux qui, nantis de savoirs spécialisés, voudront utiliser leur méthode de travail (documentation, libre examen, comparaison, mesures…) pour discuter de questions sociales et politiques, sortant ainsi de leur compétence. Et, très judicieusement, Sartre fait encore observer que les « philosophes » du Siècle des Lumières étaient d’abord des spécialistes. Montesquieu était juriste, Diderot et Voltaire étaient écrivains, d’Alembert était mathématicien, Helvétius était fermier général…
Nous sommes bien d’accord avec Sartre pour analyser comme il l’a fait le passage du Moyen Âge à la Renaissance : ce fut en effet la multiplication des spécialistes, et j’ajouterais des spécialistes formés hors des universités (et donc hors de l’Église), qui formaient les juristes, les médecins et les théologiens, et qui avaient même le monopole de ces formations. Mais Sartre ne peut s’empêcher – comme tant d’intellectuels français – d’analyser les choses avec les lunettes marxistes, et donc de faire un peu précipitamment une interprétation politique de ces phénomènes dans le cadre de la lutte des classes.
Il nous a semblé, depuis longtemps déjà, qu’il convient d’aller plus au fond des choses, de concevoir la politique comme une superstructure de réalités plus fondamentales, et d’analyser épistémologiquement les innovations de la Renaissance. Selon nous, il apparaît en effet des spécialistes des moyens pratiques. Mais il faut distinguer ceux qui ne font que croître en nombre (les juristes et les médecins) et ceux qui correspondent à une novation absolue, les ingénieurs, du moins ceux qui construisent des machines vraiment nouvelles, et qui sont d’ailleurs plus liés à la noblesse qu’à la bourgeoisie. La véritable innovation socialement et politiquement structurante des XIVe et XVe siècles, ce n’est pas la construction navale (les caravelles), ni les chariots ou les moulins à vent, ni la comptabilité utilisant les chiffres décimaux, c’est l’artillerie pyrotechnique, c’est-à-dire le canon, la poudre noire et les boulets. C’est la construction des armes à feu qui a véritablement suscité le développement de la corporation des ingénieurs, et c’est véritablement la poudre à canon qui a changé les rapports sociaux. Certes, quelques comptables et quelques juristes plus nombreux vont aider le développement de la bourgeoisie. Mais c’est l’apparition des ingénieurs des mines (pour le charbon et les métaux), des ingénieurs mécaniciens (pour construire les canons aux alésages précis pour des boulets bien calibrés), des ingénieurs artilleurs (pour calculer les trajectoires des projectiles), des ingénieurs des fortifications (pour essayer de résister à l’impact des boulets), rémunérés par les princes, qui va conduire à la véritable grande innovation de la Renaissance : l’apparition de la science instrumentale, qui utilise des instruments (lunettes astronomiques, thermomètres…) pour observer, pour mesurer, et pour mettre le monde en équations. Sartre, nourri de littérature, de marxisme et d’obsession politique, ne pouvait que voir les aspects politiques et littéraires de la Renaissance puis du Siècle des Lumières. Il cite Voltaire et Diderot. Mais il oublie Copernic au XVIe siècle, Newton au XVIIe, et Lavoisier au XVIIIe…
Curieux oubli.
C’est peut-être cet oubli qui est le péché originel des intellectuels français, l’oubli de la science, de la « vraie » science, celle qui observe avec des instruments et qui raisonne avec des moyens mathématiques. Pas la linguistique, la sociologie ou la critique littéraire, qui ne sont que des sciences en construction, très loin encore de la scientificité, mais la physique, la chimie et la biologie.
Car pour vraiment décider des affaires politiques et sociales, car avant de promouvoir des projets de société, il faut connaître l’homme, et pas l’homme en société, l’homme social, qui est déjà un complexe, mais l’homme nu, l’homme dans et contre la nature, l’homme étudié par les biologistes et par les philosophes avant de l’être – un peu vite – par les sociologues, les linguistes et les romanciers. C’est ce que nous appelons l’exigence philosophique. Avant de faire, il faut savoir, et avant de savoir, il est indispensable de connaître les modalités de l’acquisition de connaissances. Que cela plaise ou non, la question épistémologique est toujours préjudicielle, et la question de l’apparition de la science me paraît plus importante que celle de l’émergence de la bourgeoisie.
Toujours est-il que nous avons maintenant une assez bonne définition de l’intellectuel. C’est, évidemment, quelqu’un de formé intellectuellement, et l’on peut retenir la formule de Sartre : un spécialiste des savoirs pratiques. Et l’on peut être formé intellectuellement par la comptabilité comme par l’ethnologie, par la médecine comme par l’histoire, par la sociologie comme par la psychologie. L’essentiel est d’avoir appris à penser, et peut-être faut-il savoir que cela ne s’apprend pas n’importe comment. Que l’intellectuel soit issu de la bourgeoisie, Sartre dans son livre en fait toute une affaire. Mais d’où pourrait-il venir ? La noblesse n’existe pratiquement plus en France, et le prolétariat n’a pas les ressources suffisantes pour faire de longues études, car, je le répète, il faut beaucoup de temps pour apprendre à penser.
Donc, l’intellectuel est un travailleur utilisant plus ses facultés mentales que ses capacités musculaires, appartenant aux classes moyennes, et qui sort de sa spécialité pour expliquer au public comment il faut faire pour améliorer la société. Pour s’adresser au public, il y eut d’abord la publication de livres – et l’on ne s’étonnera pas des rapports historiques que l’on découvre entre l’invention de l’imprimerie (1451) et l’apparition des premiers intellectuels. C’est-à-dire des premières utopies. Thomas More fait imprimer son ouvrage De optimo rei publicae statu, deque nova insula Utopia par Thierry Martens, à Louvain, en 1516, décrivant l’île d’Utopie où se trouve une république idéale (cela veut dire impossible). Mais Thomas More était un intellectuel anglais, et nous ne nous intéresserons qu’aux intellectuels de France.
Notre définition est-elle suffisante ?
Dans une copieuse biographie d’Alain – un intellectuel français, comme nous le verrons –, Thierry Leterre3 propose la définition suivante. « L’intellectuel est celui qui sort de son champ social pour s’adresser à l’ensemble d’une société, secouer l’opinion publique, dénoncer le scandale de situations où la politique est directement intéressée.
Dans ce sens, éminemment français, démocratique et protestataire, l’intellectuel ne cesse de quitter la tour d’ivoire des concepts et des œuvres pour affronter le grand espace de la réalité et de l’action. »
Cherchons encore, sans vouloir étudier toute la littérature consacrée aux intellectuels4. En 2000, deux professeurs canadiens publiaient les actes d’un colloque universitaire international consacré à l’inscription sociale des intellectuels5. J’y trouve la contribution d’un Belge, Paul Aron, qui tente de répondre à la question de savoir s’il existe des intellectuels en Belgique. Question qui n’est pas inintéressante, car elle éclaire cette idée assez répandue que l’intellectuel est une exception française. Aron déclare que l’intellectuel est « un homme instruit, occupant une place en vue dans le monde de l’art, de la science ou de la littérature, et qui s’oppose à la société ou à certaines de ses valeurs au nom d’un argument de vérité ou de morale. Cet intellectuel est dans l’ensemble dépourvu de responsabilité sociale et politique, de pouvoir personnel effectif, mais il investit une part de sa réputation dans le politique […] le modèle français suppose que les individus concernés aient accumulé, dans leur domaine d’activité, une dose suffisante de capital symbolique ». Et plus loin, Aron répond à la question qu’il s’est posée, brutalement : « Non. L’intellectuel belge est un oxymore. »
J’ai tenté moi-même, il y a quelques années, de répondre à cette question de l’existence d’une intelligentsia en Belgique6. Je ne suis pas arrivé à une réponse aussi radicale que celle de Paul Aron, mais j’ai dû convenir que les intellectuels belges sont peu nombreux, et peu présents dans le paysage culturel et politique de la Belgique. Le fait est que les grands médias belges (télévision) n’ont pratiquement pas de moments à consacrer pour les débats de société, tenant peut-être compte du fait qu’après tout le public s’intéresse davantage aux exploits d’une joueuse de tennis qu’aux idées d’un philosophe. Je n’ai pas à revenir sur mon analyse des intellectuels en Belgique, déjà faite dans mon ouvrage cité, mais il faut quand même ne pas oublier une évidence : la France est un pays fort peuplé. Faut-il vraiment s’étonner qu’il y ait plus d’intellectuels dans un pays de plus de soixante millions d’habitants que dans un pays qui n’en a que dix ?
La définition d’Aron est intéressante, car elle contient deux idées qui méritent notre attention. D’abord, il parle des intellectuels comme venant de la science ou de la littérature, mais aussi « du monde de l’art ». Ceci est délicat. Dois-je prendre en considération, parce qu’ils sont souvent invités sur les chaînes de télévision françaises, et dois-je insérer dans ma liste le chanteur Jean-Philippe Smet (dit Johnny Hallyday), le comédien Gérard Depardieu, l’actrice-chanteuse Arielle Dombasle, ou l’artiste de music-hall Jean-Marie Bigard ? Ou Patrick Sébastien, qui semble avoir des idées sur la manière dont il faudrait gouverner la France ? J’ai longuement hésité, et finalement j’ai écarté le « monde de l’art ». N’est-ce pas le monde de l’émotion et du sentiment, avant d’être celui des débats basés sur la réflexion documentée et sur la recherche du vrai ?
Ensuite, Paul Aron parle d’un « capital symbolique ». C’est une remarque décisive. Il faut avoir atteint un certain niveau de notoriété pour être désigné comme un intellectuel. J’ai tenu compte de ce critère dans ma liste. Cela explique que l’on ne trouvera pas dans celle-ci d’éminentes personnalités, très productives et parfois très inventives dans leur spécialité, mais qui furent ou qui sont relativement peu présentes dans les médias. En somme, on peut dire synthétiquement qu’un intellectuel est un spécialiste dans n’importe quel domaine appelé par les médias pour s’exprimer sur les questions sociales et politiques « qui intéressent les Français ». En retenant A dans ma liste et en omettant B, je ne fais que constater une présence médiatique plus fréquente pour A que pour B. Cela n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité et l’importance des œuvres de A et de B. Pour le dire brutalement, Bernard-Henri Lévy, dit BHL, n’est peut-être pas le plus grand philosophe français du XXIe siècle, et Christophe Barbier n’est peut-être pas le plus grand politologue de notre temps. Mais il est indéniable que l’on voit souvent, sur les chaînes de télévision en France, la chemise blanche du premier et l’écharpe rouge du second.
Au-delà de l’étude biographique d’environ 300 penseurs ayant atteint la notoriété dans les questions sociales et politiques en France, ce qui peut paraître quelque peu anecdotique, nous avons voulu initier une réflexion sur l’histoire de la pensée dans ses rapports avec les structures sociales, en prenant l’exemple de la France.
Commençons par la fin du Moyen Âge, par le XIVe siècle. A cette époque, en France (et partout ailleurs dans la chrétienté, c’est-à-dire presque partout en Europe), penser est un monopole détenu par les clercs, les dirigeants et cadres de l’Église. Les nobles guerroient et pensent peu, les autres travaillent, presque tous dans l’agriculture, et ne pensent pas du tout. Mais ce siècle commence par une invention qui va bouleverser les structures sociales et, corrélativement, la pensée dans son ensemble. C’est l’invention de la poudre noire, rapidement suivie par l’invention du canon, puis des autres armes à feu7. La première utilisation de canons, encore rudimentaires, eut lieu à la bataille de Crécy, en 1346. Ces armes sont décisives, et les princes s’efforceront d’en posséder, et les structures féodales vont se décomposer. Le suprême savoir était dans les Écritures saintes (l’Ancien et le Nouveau Testament), et le personnage dominant était le chevalier, à cheval et muni d’armes blanches. Avec le canon, un homme nouveau apparaît, l’ingénieur, qui va introduire chez ceux qui pensent l’idée d’utiliser des instruments d’observation et de mesure. La science apparaît, de plus en plus explicative, et dont les résultats impressionnants vont entraîner le doute sur la véracité des traditions religieuses. La séquence est évidente : l’ingénieur introduit l’instrumentation, qui disqualifie la tradition au profit de l’observation instrumentée et du raisonnement mathématique. Nicolas Copernic ne lit plus dans la Bible ce qui s’y trouve écrit sur les mouvements du Soleil, mais il mesure à l’aide d’instruments (des quarts de cercle gradués) la position des planètes à différents moments de l’année. C’est l’apparition de l’esprit critique, et dès 1517 un Martin Luther ose discuter férocement l’autorité intellectuelle dominante, c’est-à-dire celle de l’Église, et ce sera la Réforme. On pourrait d’ailleurs dire que Luther fut le premier intellectuel, le premier en tout cas dont les discours auront un effet durable, car il fut un des premiers à critiquer l’ordre établi, même s’il reste à l’intérieur de la pensée religieuse. Mais on ne se libère pas facilement de mille années de Moyen Âge chrétien.
On voit ce que notre analyse a d’épistémologique. Bien sûr, tout cela se passe chez des hommes de chair et d’os, avec des liens sociaux concrets, et les instruments libérateurs de la pensée sont construits dans des ateliers, avec du bois, du fer, du bronze et du laiton. Mais l’essentiel est la nouveauté du « procédé » d’acquisition de savoir. Pendant tout le Moyen Âge, la source de toute connaissance est la tradition (religieuse). Désormais, les sources des savoirs sont l’observation (de plus en plus précise) et le raisonnement (de mieux en mieux mathématisé). L’humanité pensante passe du savoir lu dans des livres sacrés à des savoirs lus directement dans « le grand livre de la Nature ». Ce changement a une conséquence formidable : désormais les savoirs sont vérifiables, donc critiquables et perfectibles. Sur la vérifiabilité qui fonde la scientificité des savoirs modernes, il faut se reporter aux travaux du Cercle de Vienne (notamment ceux de Rudolf Carnap) et à ceux de Karl Popper. Mais ces travaux, qui ont fondé le « positivisme logique », ne vont pas assez loin, ne vont pas au fond des choses. Les Viennois ont certes bien vu que la démarcation entre science et non-science réside dans la vérification. Plus précisément dans la falsification d’après Popper. Mais les vérifications ou falsifications ne peuvent se faire qu’à l’aide d’instruments ! Bref, c’est la technique qui fonde la science8. Le marxisme ou la psychanalyse (si appréciés par tant d’intellectuels français) ne possèdent pas d’instruments comparables aux microscopes de la biologie ou aux télescopes et radiotélescopes des astronomes et des astrophysiciens. Ces doctrines ne sont pas des sciences.
La découverte du rôle révolutionnaire de l’ingénieur ou, ce qui revient au même, de la priorité de la technique sur la science9, m’a conduit à comprendre qu’il y a un fondement commun à trois productions humaines, la science (production de savoir), la technique (production de savoir-faire) et l’industrie (production de biens et de services). Ce fondement étant l’instrumentation et la mathématisation subséquente. L’arithmétique est commune aux savants, aux ingénieurs et aux dirigeants d’entreprises (notamment sous la forme de comptabilité). J’ai donc proposé de distinguer, au sein de la Civilisation, la STI (science-technique-industrie) de la non-STI, qui rassemble toutes les autres productions humaines, où les mathématiques sont exclues : rites, mythes, religions, idéologies, littératures, œuvres d’art, celles-ci dans la mesure où elles ne sont pas des artefacts du monde industriel. J’appelle « culture » la non-STI, et je pense qu’une des clés de la crise postmoderne réside dans cette séparation entre STI et culture. L’intellectuel britannique (il y a aussi des intellectuels en Grande-Bretagne !) Charles P. Snow (1905-1980) avait déjà étudié cette question dans un livre paru en 1959, et traduit en français10 en 1968. Mais Snow n’opposait la culture « littéraire » qu’à la science, ne voyant pas les liens de celle-ci avec la technique et avec le monde économique. En somme, comme tant d’intellectuels, il rejetait la technique (les mains sales) et l’industrie (l’argent, plus « sale » encore) hors du champ de ses préoccupations, se délectant de romans ou de théories abstraites, mais ne voyant pas d’où venaient ces théories, et même ces romans. De nombreux intellectuels, comme Snow, veulent bien s’intéresser aux mystères de la Relativité ou des Quanta, qui leur rappellent les mystères de l’âme humaine ou de la vie sociale, mais ils ne veulent pas réfléchir au fait que ces théories sublimes résultent d’une part de l’arithmétique (l’art du banquier qui compte ses sous) et d’autre part d’observations sensorielles, surtout visuelles, à l’aide d’instruments fabriqués par les hommes qui ont fondu du métal, découpé des morceaux d’acier, limé des pièces métalliques, ajusté les composants d’un microscope ou d’un spectromètre… Par leurs méthodes de travail et leurs schémas de pensée, le physicien et le biologiste sont plus proches du vendeur ou du menuisier que des romanciers et des poètes, glorieux faiseurs de phrases et marchands de rêves. Snow a certes révélé une importante coupure entre le savant et l’écrivain, mais l’un et l’autre restent dans le monde des jolis textes et des paroles élégantes. Il croyait encore que le verbe était au commencement. L’épistémologie de la STI montre une fracture plus radicale, plus tragique, plus obscène, même, celle entre ceux qui rêvent (de réformes politiques ou d’étoiles extragalactiques), avec éloquence, et ceux qui calculent et qui observent, sans souci de plaire.
Car les intellectuels sont caractérisés aussi par l’éloquence, rebaptisée sens de la communication, et il n’est pas faux de les considérer comme de lointains descendants des rhéteurs et des sophistes d’Athènes, où l’on a inventé à la fois la démocratie et le bavardage en public. Arrière-arrière-petits-fils de Socrate, les intellectuels des XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe et XXIe siècles ont comme lui le talent de fasciner les foules par leurs discours, et c’est vrai que BHL et les autres parlent bien, « communiquent » à merveille sur le plateau d’un talk-show. Mais, contrairement à Socrate, ils ne savent pas qu’ils ne savent rien !
Communication. C’est évidemment un des mots-clés dont il faut se servir pour comprendre le phénomène de l’intellectuel, en tout cas de l’intellectuel français. Dans les collèges et les lycées (du moins si l’on y étudie encore l’histoire de la littérature française, ce dont je ne suis pas sûr), on vante le style de Montaigne, les longues phrases harmonieuses de Chateaubriand, les belles périodes de Bossuet, et la finesse faite d’un mélange de sobre clarté et de cruelle ironie de Voltaire. Pour autant que je me souvienne de mes études secondaires, hélas bien anciennes, les maîtres parlaient de ces grands hommes d’abord pour la beauté de leurs phrases, et je me souviens que je fus en effet émerveillé par certaines oraisons funèbres de Bossuet ou par certains paragraphes de Candide. Le style étant l’homme, nos maîtres ne parlaient même parfois que du style, et laissaient de côté la pensée même, les idées d’intellectuels qui étaient réduits au rôle de littérateurs.
C’est une des idées centrales de l’éditologie : tout savoir est un texte édité, c’est-à-dire proposé au public par l’édition. Et les modalités de celle-ci permettent de distinguer un savoir scientifique, un dogme religieux, une idéologie… C’est aussi un acquis essentiel de la linguistique : parmi les fonctions du langage, les principales sont l’expression (nommer les choses) et la communication (relier deux locuteurs, pour faire passer un message de l’un à l’autre). Quand on observe, à la télévision, les intellectuels d’aujourd’hui, on voit souvent que la fonction de communication l’emporte sur la fonction expressive. Ce n’est d’ailleurs pas de la faute des intellectuels, puisque la communication se fait à deux : un émetteur et un récepteur. Et peut-on reprocher à BHL sa chemise blanche et ses cheveux longs, si les Français retiennent mieux la couleur de sa chemise que la coloration de ses idées ?
De ces diverses considérations, il résulte que l’étude des intellectuels français pendant un demi-millénaire revient à observer comment, dans un pays ou plutôt chez un peuple donné (la France, c’est d’abord l’ensemble de ceux qui parlent le français, même si les aléas de l’histoire ont instauré quelques barrières politiques qui découpent la francophonie en divers territoires), la pensée s’est formée par l’expression chez les penseurs et s’est répandue dans la population par la communication des intellectuels. Nous resterons en France « hexagonale », pour diverses raisons. Mais il est évident que la pensée française n’est pas uniquement celle des hexagonaux, ou que celle des hexagonaux se répand au-delà des frontières, d’abord dans une première ceinture faite des parties francophones du Canada, de la Belgique et de la Suisse, ensuite dans une zone plus vaste, mais plus diffuse où le français est parlé en concurrence avec d’autres langues, et l’on peut même dire que cette pensée française atteint encore une troisième zone, qui correspond aux pays où l’on lit Victor Hugo, Jean-Paul Sartre et sans doute quelques autres en traduction dans les grandes langues de l’humanité.
Écrire l’histoire des intellectuels français, ou rédiger celle de la pensée en France, c’est bien sûr d’abord élaborer une suite de biographies, mais c’est aussi, si l’on veut comprendre, étudier les lieux de formation des intellectuels, étudier leurs groupes et associations, bien sûr leur production (les œuvres et les idées), étudier les médias où ils s’expriment, étudier leurs rapports avec les spécialistes d’un côté, et avec les hommes politiques de l’autre. Vaste programme ! Je n’ai, on s’en doute, fait qu’esquisser de telles enquêtes. Pour approfondir, il faudrait connaître, par exemple, les circonstances de la création de l’École Polytechnique (1794) et de l’École Normale Supérieure (la même année), en notant d’ailleurs que la première correspond à la « STI » et la seconde à la « culture ». Mais il faudrait aussi étudier les origines et les développements des autres grandes écoles et des universités. Il faudrait étudier l’histoire du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et des autres lieux de la recherche organisée en France. Il faudrait, peut-être surtout, étudier les créations de journaux, de revues, de magazines, car c’est là que l’on trouve les idées de l’intelligentsia, et il n’y a pas que le journal L’Aurore. C’est même une caractéristique des intellectuels, de tenter de créer leur propre périodique, et je citerai brièvement, parmi beaucoup d’autres, Le Conservateur littéraire (Victor Hugo, 1819), la Revue philosophique de la France et de l’étranger (Théodule Ribot, 1876), les Cahiers de la Quinzaine (Charles Péguy, 1900), La Nouvelle Revue Française (André Gide, 1908), Esprit (Emmanuel Mounier, 1932), Acéphale (Georges Bataille, 1936), Les Temps modernes (Jean-Paul Sartre, 1945), Diogène (Roger Caillois, 1952), Tel Quel (Jean-Edern Hallier et Philippe Sollers, 1960).
Il faudrait même étudier les éditeurs, car les maisons d’édition ne sont pas toujours idéologiquement neutres, et leurs dirigeants jouent peut-être, dans l’histoire de la pensée française, un rôle important que l’on oublie un peu vite, les projecteurs étant plus orientés vers les auteurs – qui bénéficient du prestige, encore assez grand en France, de l’ « écrivain » – que vers les éditeurs, considérés comme de simples commerçants, voire comme des membres du patronat, peu aimé par tant d’intellectuels de France. Et il faudrait alors, pour la période contemporaine, étudier les opérateurs de radio et de télévision, et peut-être même les cinéastes, car il y a peut-être des films qui portent un message social ou politique.
Il faudrait… Eh oui, il faudrait faire plein de choses. Mais il fallait d’abord réunir les noms des principaux intellectuels français, et les situer dans le temps (du XVIe siècle au XXIe) et dans l’espace (presque toujours Paris). C’est ce que j’ai tenté de faire…
Nous dirons donc que les intellectuels sont ceux qui s’occupent de politique, mais qui n’en font pas. C’est dire qu’il n’y aura pas de politiciens dans ma liste, ce qui ne signifie pas que je dénie toute intellectualité à ces hommes d’action. Bien au contraire, il y a beaucoup d’intelligence dans certains discours ou dans certains mémoires de Colbert, de Danton et de Robespierre, de Napoléon, de Jean Jaurès, d’Aristide Briand, de Charles de Gaulle, de Dominique Strauss-Kahn, de Nicolas Sarkozy, de Ségolène Royal et des autres, et l’on trouve même dans quelques-uns de ces textes des qualités littéraires tout à fait remarquables. Du reste, un homme politique est souvent un intellectuel devenu politicien. Mais l’intellectuel tel que je l’entends ici est celui qui reste en retrait de la lutte pour le pouvoir. Au fait, c’est peut-être très bien comme ça !
1. La mienne n’étant pas assez bien pourvue, j’ai travaillé à la Bibliothèque Royale, à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, parce que c’est près de chez moi.
2. J.P. Sartre : Plaidoyer pour les intellectuels. Gallimard, 117 p., 1972.
3. Th. Leterre : Alain, le premier intellectuel. Stock, Paris, 589 p., 2006.
4. Voir L. Bodin : Les intellectuels. PUF, Paris, 124 p., 1962.
5. M. Brunet & P. Lanthier : L’inscription sociale de l’intellectuel. L’Harmattan, Paris, 382 p., 2000.
6. J.C. Baudet : A quoi pensent les Belges. Jourdan, Bruxelles, 361 p., 2010.
7. Sur l’invention de l’artillerie pyrotechnique, voir J.C. Baudet : De l’outil à la machine. Vuibert, Paris, IV+346 p., 2003.
8. J’ai tenté de développer cette idée, qui prolonge les résultats du Cercle de Vienne, dans ma revue Technologia (1978-1989).
9. J.C. Baudet : Le signe de l’humain. Une philosophie de la technique. L’Harmattan, Paris, 172 p., 2005.
10. Ch.P. Snow : Les deux cultures. Pauvert, 153 p., 1968.
MÉTHODE
Pour étudier les intellectuels, il faut disposer de sources fiables, et j’ai déjà dit l’indispensable fréquentation des bibliothèques, car bien entendu les souvenirs scolaires ne suffisent pas. On peut commencer par consulter les notices du gros dictionnaire de Jacques Julliard et Michel Winock1, et puis il faut, patiemment, lire des livres, compulser des périodiques, écouter la radio et regarder la télévision, prendre des notes, comparer des informations parfois contradictoires, retenir un nom (pourquoi celui-ci ?), en écarter un autre (pourquoi celui-là ?). C’est ainsi que j’ai réuni quelque 300 noms.
Je les présente dans l’ordre chronologique des dates de naissance, ce qui donne « automatiquement » un aperçu de l’histoire de la pensée française. Car bien sûr, Voltaire, né en 1694, peut avoir influencé Gaston Bachelard, né en 1884, mais il est parfaitement impossible de trouver une quelconque imprégnation de Montaigne, né en 1533, par les idées de Voltaire !
Chaque notice commence par la date de naissance du personnage, écrite selon la norme ISO2 : année, mois, jour. On trouvera ensuite, en tête de notice, le lieu de naissance, puis la date et le lieu du décès.
Chaque biographie est plus ou moins étendue pour diverses raisons. Nous n’avons pas voulu stéréotyper les articles, car nous voulions rédiger un récit continu plutôt qu’un simple dictionnaire. On trouvera quelques données bibliographiques, mais nous avons renoncé à accompagner nos informations de toutes les références qui sont de mise dans les travaux d’érudition universitaire, car cela aurait alourdi le texte considérablement, et probablement sans profit pour la majorité des lecteurs. Faut-il vraiment préciser que si nous n’avons pas présenté tous les intellectuels français, nous n’avons pas non plus tout dit sur ceux que nous avons présentés ? Faut-il rappeler que, sur des personnalités comme Montaigne, Voltaire ou Bachelard, il existe des dizaines d’études parues en librairie, et des centaines, voire des milliers d’articles dans des revues spécialisées ?
1. J. Julliard & M. Winock : Dictionnaire des intellectuels français. Les personnes, les lieux, les moments. Seuil, Paris, 1258 p., 1996.
2. L’ISO est l’International Organization for Standardization, qui édite des normes en vue de faciliter les échanges intellectuels ou commerciaux dans le monde entier.
L’IMPRIMERIE
1467 01 26 / BUDÉ, GUILLAUMENé à Paris, mort à Paris le 22 août 1540.
Quand Guillaume Budé approche de l’âge adulte, vers 1487, la France est sous le règne de Charles VIII, dit Charles l’Affable, qui en 1483 avait succédé à Louis XI. Le pays est sorti de la Guerre de Cent Ans en 1475 (traité de Picquigny), et depuis une trentaine d’années une invention allemande, tout à fait admirable, due à Johannes Gutenberg (1451), a complètement révolutionné la vie intellectuelle : l’imprimerie. En 1489, par exemple, l’imprimeur parisien Pierre Levet publie Le grant testament et le petit, un recueil de poèmes parfois drolatiques, souvent émouvants, d’un certain François Villon, un personnage assez obscur, né en 1432 et mort on ne sait quand. N’empêche, le personnage est mal connu, mais ses lecteurs découvrent un chef-d’œuvre, et qui n’est pas écrit en latin ! Car, en cette fin de XVe siècle, les œuvres de l’esprit qui méritent d’être diffusées auprès du public, dans le royaume de France comme partout ailleurs dans la chrétienté, sont rédigées en latin. Certes, le peuple de France parle différents jargons issus du latin, et notamment le françois que l’on parle dans la région de Paris et à la cour du roi. Mais les lettrés, les théologiens, les médecins et les juristes, les historiens et les poètes s’expriment en latin, la prestigieuse langue de l’Empire romain, la langue aussi de l’Église et donc de l’enseignement, car les écoles dépendent toutes de l’Église catholique et romaine, qui règne sur les esprits, si les rois et les princes règnent sur les corps.
C’est donc une situation intéressante que celle de la France – et d’ailleurs aussi des autres régions chrétiennes, à commencer par l’Italie – au moment où Guillaume Budé a vingt ans. D’une part le développement de l’imprimerie, d’autre part un progrès considérable de la langue vulgaire, « romane », qui n’était guère utilisée que par les auteurs de « romans », dont le plus célèbre fut Chrétien de Troyes (mort vers 1183). C’est aussi une période où les peintres font des merveilles, dans les Pays-Bas, avec par exemple Hugo van der Goes qui, au Rouge-Cloître, à Bruxelles, peint de manière surprenante La Mort de la Vierge, et plus encore en Italie, avec les œuvres d’une grâce infinie de Sandro Botticelli. Et ce n’est pas tout ! L’époque est vraiment intéressante. Alors que l’imprimerie facilite les échanges intellectuels, alors que les langues vulgaires se dotent d’une littérature, alors que les arts plastiques se renouvellent (la peinture, mais aussi les palais à Florence, à Venise, à Rome…), voilà qu’en 1492 Christophe Colomb découvre l’Amérique, et que toute une cohorte d’intellectuels se délectent de lire les auteurs du passé grec et romain. On admire Cicéron et Sophocle. On relit ou on découvre Homère et Virgile. On se passionne pour la langue grecque. Et alors que le latin était en train de perdre du terrain dans les masses populaires au profit des langues « nationales » – et c’est de là que vint le poison politique du nationalisme –, des érudits se mettent à étudier passionnément la langue de Tite-Live, de Tacite, et de Jules César.
Ces intellectuels, ces érudits, sont les « humanistes ». Guillaume Budé sera l’un d’eux.
Guillaume Budé était le fils d’un homme fort instruit, et il acquiert lui-même de vastes connaissances. Celles-ci lui vaudront de devenir un des proches collaborateurs du roi François Ier, qui régna de 1515 à 1547. Budé sera l’auteur de nombreux travaux en latin, mais j’ai pris l’option de traiter des intellectuels français sensu stricto, c’est-à-dire de ceux qui s’exprimèrent, au moins partiellement, en langue française. Je ne détaillerai donc pas la bibliographie de notre homme, formée principalement de livres en latin. En 1522, il publie cependant un ouvrage en français, Summaire ou Épitome du livre de Asse, qui est une étude approfondie des monnaies et des mesures depuis l’Antiquité. Il s’agit d’ailleurs de l’adaptation en français d’un livre paru en latin quelques années auparavant. C’est aussi en 1522 que François Ier nomme Budé « maître de la librairie royale », c’est-à-dire responsable de la bibliothèque de Fontainebleau, à l’origine de l’actuelle Bibliothèque Nationale de France.
En 1529, le bibliothécaire et conseiller du roi éprouva très certainement une grande satisfaction. Il était parvenu à convaincre François Ier de consacrer l’argent nécessaire à la création du Collège des lecteurs royaux, institution de haut enseignement où l’on donnera des cours de grec et d’hébreu, langues qui n’étaient pas enseignées à l’Université de Paris. La prestigieuse institution existe encore, mais s’appelle Collège de France1 depuis 1870.
Il est possible que Guillaume Budé ait également joué un rôle dans une importante prise de décision du roi, qui va avoir de grandes conséquences pour l’évolution de la langue française. En 1539, l’édit de Villers-Cotterêts est promulgué par François Ier. Il stipule que, dans le royaume de France, tous les actes et documents de justice seront établis en « langage maternel françois ». Cela va évidemment accélérer l’adoption du français par les intellectuels (même si le mot n’existe pas encore), qui délaisseront de plus en plus le latin.
1494 ? / RABELAIS, FRANÇOISNé à Chinon, mort à Paris le 9 avril 1553.
La date de sa naissance n’est pas connue exactement, mais François Rabelais a vingt ans vers 1515, à l’avènement de François Ier. C’est le temps des guerres d’Italie et, malgré les batailles, les échanges culturels s’intensifient entre la France et les cités italiennes. C’est le temps de la Renaissance.
En novembre 1530, François Rabelais est nommé bachelier à la Faculté de médecine de Montpellier. Deux ans plus tard, il est à Lyon, où il est nommé médecin de l’Hôtel-Dieu de Notre-Dame de la Pitié du Pont-du-Rhône.
Mais le médecin Rabelais ne s’intéresse pas qu’à la médecine. Il aime la plaisanterie, les jeux de mots, l’étourdissant plaisir de faire des phrases alambiquées comme les jongleurs font des pitreries, il aime la littérature, il aime aussi la réflexion, la recherche de la quintessence des choses et de la substantifique moelle des propos des plus doctes. Il a sans doute, à l’Hôtel-Dieu, beaucoup de loisir, car il parvient à publier, déjà en 1532, un gros volume qui est comme une parodie des romans de ce que l’on appelle alors le Moyen Âge, ces siècles obscurs qui séparent la glorieuse époque de l’Empire romain de la période contemporaine, celle de la renaissance des lettres et des arts. C’est en 1469 que l’humaniste italien Giovanni Andrea Bussi (1417-1475) avait lancé cette expression de « Media Tempestas » pour désigner la longue période qui sépare l’Antiquité gréco-romaine du XVe siècle.
Le livre de Rabelais est intitulé Les horribles et espoventables faictz et prouesses du très renommé Pantagruel, Roy des Dipsodes, filz du grand géant Gargantua, et est édité par Claude Nourry, à Lyon. Les facéties de Gargantua et de son fils rencontreront grand succès et feront s’esbaudir beaux seigneurs et gentes dames, et Rabelais poursuivra son œuvre, qui célèbre un nouvel idéal de vie, basé sur la connaissance (le gai savoir) et les plaisirs variés, dont ceux de la dive bouteille. La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel paraît en 1534.
En 1537, Rabelais est proclamé docteur en médecine à Montpellier. Ce qui n’empêchera pas le désormais docteur de poursuivre ses plaisanteries littéraires avec une verve tout à fait réjouissante, et le Tiers livre des faictz et dictz héroïques du noble Pantagruel paraît en 1546. Il y aura encore, en 1548, Le Quart livre des faits et dits héroïques du noble Pantagruel. Et en 1551, notre romancier, certes docte, mais aussi chantre de l’ivrognerie, de la paillardise et de quelques autres activités humaines peu appréciées par le discours officiel des gens d’église, est nommé curé de Meudon. Le roman français « moderne » est né, bien éloigné des valeurs du roman courtois des temps moyenâgeux.
Un Frédéric Dard (1921-2000), au XXe siècle, se souviendra des longues énumérations burlesques de Rabelais, de sa richesse lexicale n’hésitant pas à utiliser des néologismes ou des mots d’argot, de ses recours parfois appuyés au registre pornographique ou scatologique, en créant ses personnages du commissaire San Antonio et de son adjoint Bérurier. Rabelaisien est devenu un adjectif qui convient très bien à toute une tradition de la littérature de France, mais qui n’est peut-être pas la plus appréciée par les « intellectuels ».
1503 / ESTIENNE, ROBERTNé à Paris, mort à Genève le 7 septembre 1559.
En 1539, Robert Estienne, humaniste déjà en vue, édite un Dictionnaire françois-latin à Paris. Sa production est surtout rédigée en latin, mais il fait paraître La dissection des parties du corps humain en 1546. C’est que l’anatomie, grâce aux médecins italiens et au Bruxellois André Vésale, venait de faire des progrès considérables par la pratique désormais courante de la dissection, jusque-là interdite par l’Église.
1503 12 14 / NOSTRADAMUS, MICHELNé à Saint-Rémy-de-Provence, mort le 2 juillet 1566.
Michel de Nostredame, dit Nostradamus, publie en 1552 un ouvrage Le vray & parfaict embellissement de la Face, & la maniere de faire des confitures, chez Jean Pullon de Trin, à Lyon. Ouvrage qui aura un vif succès. Mais si Nostradamus s’intéresse aux confitures et aux cosmétiques, parce qu’il est apothicaire, il est surtout intéressé par l’astrologie, et il se met à rédiger des prédictions qu’il rassemble, en 1555, dans ses Centuries astrologiques, qui rencontreront plus de succès encore que son traité sur les confitures.
1509 07 10 / CALVIN, JEANNé à Noyon, mort à Genève le 27 mai 1564.
En 1536, les sermons et discours de Martin Luther (sa « réforme » de la religion chrétienne commence en 1517) ont trouvé audience dans presque toute l’Allemagne, et même au-delà des frontières du pays. Inspiré par la prédication luthérienne, Jean Calvin publie, à Bâle : Institutio christianae religionis, qu’il édite en version française en 1541 : Institution de la religion chrétienne. Désormais le christianisme est divisé en catholicisme et en protestantisme, et le protestantisme lui-même est partagé entre les luthériens et les calvinistes. Les protestants deviennent rapidement nombreux en France, et les Français (qui restent majoritairement catholiques) les appellent « huguenots ». Un nouveau problème est soumis à la sagacité des littérateurs français : les rapports entre catholicisme et protestantisme, dont la coexistence est loin d’être pacifique. Aux guerres d’Italie succèdent les guerres de religion.
1509 08 03 / DOLET, ÉTIENNENé à Orléans, mort à Paris le 3 août 1546.
Ses origines sont mal connues, et certains historiens ont même cru – mais cela semble légendaire – que Dolet était un fils illégitime du roi François Ier. Il étudie à l’Université de Toulouse et devient humaniste et poète. En 1535, il devient imprimeur à Lyon, où il publie notamment, en 1540, un petit manuel La manière de traduire d’une langue en aultre. Il s’aventure à publier certains ouvrages critiquant la religion chrétienne, au point qu’il finit par acquérir une réputation d’athée. À vrai dire, il est difficile de déceler dans ses textes s’il était athée ou protestant, mais en tout cas il est arrêté et emprisonné en 1542, sous l’accusation d’athéisme. Il est relâché puis emprisonné à nouveau et, en 1546 il est étranglé et brûlé, avec tous ses livres, sur la place Maubert, à Paris.
1525 / DU BELLAY, JOACHIMNé à Liré, mort à Paris le 1 janvier 1560.
Joachim du Bellay rencontre Pierre de Ronsard (1524-1585), en 1547, alors que celui-ci voyageait pour se rendre à Poitiers. Les deux jeunes gens, qui ont vingt-deux et vingt-trois ans, se découvrent une même passion pour la poésie et le même souci d’augmenter l’influence, dans la culture, de la langue française, s’opposant ainsi à ceux des humanistes qui voulaient que le latin conserve son quasi-monopole de la haute pensée. Avec d’autres, Ronsard et du Bellay formeront une espèce d’association vouée au français et à la pratique poétique, qui s’appellera la Pléiade. Dans ce groupe, Ronsard est poétiquement le plus doué, publiant notamment plusieurs recueils d’Amours, des sonnets fort bien tournés dont plusieurs deviendront célèbres. Quant à du Bellay, je dirais, malgré l’anachronisme, qu’il était l’intellectuel de la bande. En 1549, il publie un vigoureux plaidoyer pour l’usage du français : La deffence et illustration de la langue françoise. Mais c’est tout de même sa production poétique qui est la plus abondante, et il publie notamment Les Regrets en 1558. C’est un recueil de 191 sonnets en alexandrins, où l’on trouve ces vers éternels :
Heureux qui, comme Ulysse, a faict un beau voyage
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
1528 / ESTIENNE, HENRINé à Paris, mort à Lyon en 1598.
Henri est le fils aîné de Robert Estienne. Il est humaniste, imprimeur, et a publié plusieurs ouvrages importants en latin. En français, il fait paraître Conformité du langage français avec le grec, en 1565, Dialogues du nouveau langage français italianisé, en 1578, Précellence du langage français, en 1579. Comme du Bellay avant lui, il était un ardent défenseur de la langue française.
1529 / BODIN, JEANNé à Angers, mort à Laon en juin 1596.
Jean Bodin est un juriste qui, en 1566, se fait remarquer par un petit ouvrage Methodus ad facilem historiam cognitionem (« Méthode pour faciliter la connaissance de l’histoire »). C’est encore une préoccupation d’humaniste. Dix ans plus tard, en 1576, il fait paraître une œuvre plus importante, en français : Les six livres de la République, à Paris. Le mot « république » ne doit pas nous égarer. Il s’agit de la res publica des Romains, la « chose publique », et Bodin construit en fait une théorie juridique de l’autorité royale, le roi devant notamment assurer la paix civile et garantir la tolérance religieuse. C’est que nous sommes encore en pleine guerre de religion. Les six livres forment un des premiers traités de « bonne gouvernance » publiés en France.
Nous devons à Jean Bodin un aphorisme devenu célèbre :
Il n’est de richesses que d’hommes.
1533 02 28 / MONTAIGNE, MICHEL DENé à Saint-Michel-de-Montaigne, mort le 13 septembre 1592.
Michel Eyquem, seigneur de Montaigne (en Dordogne), noble de province, aime la tranquillité, la lecture, la méditation. Il aime aussi l’écriture, et il entreprend, dans une solitude cependant attentive au reste du monde, d’écrire ce qu’il pense. Il est l’inventeur français de l’introspection, et il influencera profondément toute une lignée de penseurs qui, en France, comprendront que l’on ne peut pas penser sérieusement autrement qu’en commençant par penser à soi-même. C’est en somme la mise en application du principe philosophique de Socrate : « connais-toi toi-même ». Montaigne l’a d’ailleurs écrit clairement : « Je n’ai d’autre objet que de me peindre moi-même ». Aussi peut-on dire – même s’il est resté distant de l’érudition des humanistes – que Montaigne fut le premier philosophe2 en langue française.
Notre auteur introspectif avait, dans une tour ronde de son château, aménagé une salle de travail décorée de livres, dans laquelle il pensait et écrivait, solitaire, mais en compagnie des meilleurs auteurs : « Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour ». En 1580, Montaigne a rassemblé ses notes et fait paraître ses Essais