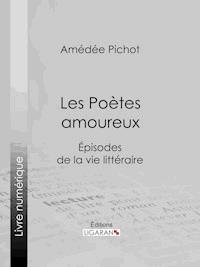
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Dans les premiers jours de juin 1833, après avoir revu Oxford, je voulus revoir Cambridge, que j'avais visité une première fois dix années auparavant : je ne faisais pas un pèlerinage scientifique aux deux anciennes universités anglaises; Je n'avais d'autre but que de retremper en quelque sorte mes souvenirs dans une course rapide à travers les provinces les plus voisines de Londres."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le titre de ce volume appartient à mon éditeur. Je l’ai adopté faute d’un meilleur, en doutant qu’un volume fût suffisant pour remplir le cadre qu’il indique. Sans même sortir d’Angleterre, il y a eu d’autres poètes amoureux que Milton, Pope, Cowper et Chatterton, les amours de ce dernier étant même un problème résolu négativement. Notre titre sera cependant parfait s’il fait désirer aux lecteurs une suite. Le fait est que ces biographies romanesques, fondées sur un épisode de la vie de chaque poète qui y figure, ont été composées à diverses dates et ont fait partie d’un ouvrage que je renonce à réimprimer sous son titre primitif, quoiqu’il soit épuisé depuis longtemps. Si je donnais cette suite, qu’il me serait fort doux de savoir désirée, ce serait sous une autre forme, en réunissant quelques notices littéraires sans mélange de roman, telles qu’elles ont paru dans les Revues auxquelles j’ai coopéré à diverses époques. Les Poètes amoureux sont à la biographie ce qu’est le roman historique à l’histoire. Je ne me suis pas cru tenu à la vérité littérale ; mais j’ai cherché à rester fidèle au caractère des personnages. Je sais des notices et des biographies beaucoup moins vraies que mes petits romans.
AMÉDÉE PICHOT.
Sèvres, villa Boson, juillet 1858.
À MON FRÈRE ALEXIS LE GO
Dans les premiers jours de juin 1833, après avoir revu Oxford, je voulus revoir Cambridge, que j’avais visité une première fois dix années auparavant : je ne faisais pas un pèlerinage scientifique aux deux anciennes universités anglaises. Je n’avais d’autre but que de retremper en quelque sorte mes souvenirs dans une course rapide à travers les provinces les plus voisines de Londres. J’étais, d’ailleurs, le cicerone de Z… e, et plus jaloux de recueillir ses naïves impressions que de faire provision de nouvelles notes historiques ou littéraires. Je lui avais promis un contraste plein d’intérêt entre l’aspect italien ou grec d’Oxford et l’aspect gothique de Cambridge ; l’effet de cette transition me frappa moi-même qui y étais préparé. À Oxford, tout est vie, tout est mouvement, tout est pompe bruyante autour des palais qu’habite l’étude ; la science a un air mondain, un air de représentation jusque dans ses plus vieux temples, qui sont tous richement restaurés. Cambridge, dès la première vue, inspire plus de recueillement ; dans ses édifices, dans ceux même qui égalent par la magnificence de l’architecture les collèges de l’université rivale, on éprouve une admiration plus religieuse ; il leur est resté quelque chose du génie claustral qui présida à la fondation primitive du plus grand nombre. Enfin, les promenades de Cambridge sont plus solitaires, plus favorables à la méditation, et par suite aux idées poétiques.
On a peine à croire que tous les professeurs, tous les étudiants égarés sous ces ombrages qu’arrose le Cam, soient encore plus occupés de chercher la solution de quelque problème d’Euclide qu’à rêver tout bas avec la Muse. Cambridge cite, parmi ses illustrations académiques, des poètes tels que Ben. -Jonson, Waller, Milton, Dryden, Otway, Gray, Byron ; mais il est un nom que ses professeurs mettent bien au-dessus de tous ces noms, celui de Newton ; il est une étude qui passe avant toutes les autres : celle des mathématiques.
Nous venions de parcourir avec le plus complaisant et le plus aimable de tous les Fellows de Cambridge, à qui nous avait adressés sir Henry Bulwer, les rues presque désertes de la ville, et ses principaux édifices ; nous venions de visiter cette succession pittoresque de collèges dont les façades occidentales bornent les fraîches prairies où le Cam déroule son eau paresseuse, comme un grave professeur de théologie, fatigué du bruit de la classe, étendrait son manteau de soie sur l’herbe pour dormir et rêver de la mitre épiscopale, dernière récompense de son zèle ; un peu fatigués nous-mêmes d’admiration et de promenade, nous étonnâmes le baron R… lorsque, au lieu de le remercier de nous avoir montré tout ce qu’il y a de curieux à Cambridge de manière à pouvoir repartir sans regret, le lendemain matin, saisis tout à coup d’un tardif souvenir, comme d’un remords de conscience, nous nous écriâmes que notre voyage était manqué ; le baron R… avait justement oublié de nous conduire à Christ-College, au Collège où étudia Milton.
Depuis trois ans et plus, que le baron R… habitait Cambridge, et jouissait de son canonicat universitaire, de sa fellowship de Trinity-College, il n’avait jamais pensé à aller saluer le mûrier planté par le poète du Paradis perdu : remarquez qu’à part sa spécialité, le baron aime les arts et la poésie, qu’il fait, je crois, des vers lui-même, qu’il parle avec goût de notre littérature et de celle de l’Italie comme de la sienne ; mais encore une fois il nous avait tenus au moins une demi-heure de trop autour de la statue du grand sir Isaac, vrai chef-d’œuvre d’un ciseau français, pendant que le bedeau semblait nous défier de démentir l’inscription fameuse :
Or pendant cette demi-heure la nuit était tombée : le portier de Christ-College refusa de nous ouvrir, malgré une admirable lune qui éclairait le jardin, malgré mes invocations à cet astre cher au poète, que je pris à témoin de cette inexorable barbarie, en répétant les vers du Paradis perdu :
Que faire ? Nous nous décidâmes à retarder notre départ de quelques heures le lendemain matin.
En attendant, le baron R… crut devoir une réparation à un Français qui citait Milton en anglais aux portiers de Cambridge, et il nous invita à un élégant symposium qu’il avait fait improviser pour nous dans son appartement de la TRINITÉ, sans nous en prévenir. Un de ses collègues était du souper. Nous fûmes éblouis non pas précisément du luxe, mais de l’élégant comfort introduit dans les cellules monastiques de ces saintes fondations. J’étais, pour ma part, si reconnaissant d’une hospitalité si aimable, que je m’imposai un des actes les plus difficiles que puisse faire un estomac délicat : il n’y avait que deux heures que j’avais copieusement dîné en voyageur prosaïque : je fis honneur au souper et au vin de Champagne, comme si mon dîner eût daté de la veille : ceux qui connaissent ma sobriété attribueront, j’espère, ce phénomène encore plus à la courtoisie qu’à l’air appétissant qu’on respire sur les bords du Cam et de la Grenta. En retour, nos hôtes s’abstinrent de parler géométrie, algèbre et mathématiques transcendantes. Ils furent tout aussi discrets sur la théologie, cette autre muse de Cambridge, et quelques questions qui auraient pu y toucher furent écartées avec une charmante adresse. Au dessert par exemple,
ou plutôt, pour citer au moins une fois la traduction parfumée de l’abbé Dellile :
Au dessert, dis-je, ayant senti naître en moi le désir curieux de connaître comment vivaient dans les divers collèges de Cambridge les Fellows, ces nobles piliers de l’Anglicanisme, le système de la vie universitaire nous fut expliqué avec une délicate précision, sans que nos hôtes imitassent Raphaël, qui répond à la question d’Adam par une grande dissertation théologique :
La politique terrestre fut aussi exclue de ce délicieux banquet ; jamais, en un mot, philosophes ne sacrifièrent aux grâces avec plus d’esprit et de goût. Aussi le lendemain matin, rien n’étant changé, depuis la veille, au monde moral ni au monde physique, nous nous réveillâmes avec la suite naturelle de nos idées, inhabiles peut-être à démontrer la 47e proposition d’Euclide, sur le carré de l’hypoténuse, mais émus d’une joie naïve en voyant une matinée pure, et courant tout droit avec un poétique empressement au collège du Christ. J’avais préparé une invocation nouvelle pour toucher le concierge, si nous arrivions trop tôt ce matin, comme la veille nous étions arrivés trop tard :
DELILLE.
Mais la porte était ouverte ; nous ne fûmes même pas arrêtés par la question officielle du classique janitor : ce ne fut qu’à la seconde cour qu’une grille claustrale nous força de nous suspendre à la chaîne d’une cloche qui troubla le silence de cette retraite. À ce son bien connu, un jardinier, un souriant jardinier, digne d’arroser les parterres d’Éden, vint à nous et nous introduisit dans son domaine. Nous voulions aller d’abord au mûrier de Milton ; mais le jardinier était méthodique dans sa gracieuseté. Il avait, d’ailleurs, un petit amour-propre à contenter, son amour-propre de jardinier universitaire : il était botaniste… et jaloux de donner à chaque arbuste, à chaque plante son nom savant. Comme il y a un peu loin du sixième jour de la création à aujourd’hui, alors que notre premier père nommait par une sorte d’instinct chaque specimen des trois règnes,
on ne pouvait douter que le jardinier était le disciple de la science et non de la nature, admirable enseigne vivante pour faire deviner la science supérieure du professeur. Heureusement la matinée était belle, les sentiers du jardin proprement sablés, les gazons verts et diaprés de fleurs. Nous nous prêtâmes à tous les caprices de notre guide, jusqu’à ce qu’enfin nous vîmes le mûrier sacré. « Le voilà, nous dit-il, l’arbre vénérable, morus nigra !… » Mais je lui pardonnai son latin en voyant que c’était en effet un monument vénérable pour lui, et auquel il prodiguait religieusement tous les soins, tous les appuis dus aux infirmités de l’âge. Le pauvre mûrier a des tuteurs pour soutenir ses rameaux que leurs lourdes nodosités font plier vers la terre ; dans son tronc incliné un sillon caverneux menaçait de détruire tous les canaux nourriciers de la sève ; mais des lames de plomb protègent cette dangereuse blessure. Aussi son feuillage est touffu, des baies nombreuses couronnent sa féconde vieillesse. Les oiseaux qui viennent les becqueter librement lui prêtent une voix harmonieuse.
Parmi ceux que notre approche parut un peu déranger, nous remarquâmes un joli petit rouge-gorge, un joyeux Robin, comme les Anglais l’appellent, qui nous regardait avec une visible inquiétude, et qui semblait être le génie familier de l’arbre. Nous sûmes bientôt pourquoi le joli Robin sautillait ainsi de branche en branche : le mûrier de Milton était plus pour lui qu’un arbre chargé de fruits : c’était sa maison, il contenait sa jeune famille. Dans la caverne même du vieux tronc, à l’abri de la toiture artificielle dont je parlais, le Robin avait son nid. Le jardinier y plongea la main et la retira avec un des petits de l’oiseau qu’il nous fit caresser avant de le remettre doucement auprès de ses frères. C’est depuis des années que Robin rouge-gorge a pris possession de l’arbre du poète, et qu’il y a établi son ménage, plus heureux que le mieux logé des professeurs ou des Fellows titulaires, et respecté dans sa demeure comme eux dans leur chambre.
Enfin le jardinier, voyant qu’il avait affaire à des pèlerins dévots de Milton, nous coupa lui-même avec sa serpette de poche l’une des branches mortes du mûrier, relique précieuse que nous rapportâmes à Paris avec un fragment des lierres de Kenihworth, et quelques feuilles de saule dérobées par Z…e à la villa de Pope.
Nous repartîmes le même jour de Cambridge, mais avec l’espoir secret de revenir saluer le vieux mûrier planté par Milton au collège du Christ, les chênes et les ormeaux des bords du Cam, sous lesquels il aimait à promener ses chastes rêveries, et tous ces édifices solennels du catholicisme détrôné, dont la poésie prévalut toujours dans ses inspirations sur l’esprit étroit du puritanisme.
Ma dimmi : Al tiempo de’dolci sospiri
A che, e come concedette amore,
Che conoscete i dubbiosi desiri ?
DANTE.
Milton nous a raconté lui-même les premières années de sa vie avec une admirable simplicité : « Je naquis à Londres, d’une famille honorable, d’un père honnête homme, d’une mère vertueuse, qui s’était fait connaître surtout par ses aumônes. Mon père me destina dès mon âge le plus tendre à l’étude des belles-lettres ; je m’y livrai si avidement que dès ma douzième année je ne pouvais m’arracher à mes lectures et à mon travail avant minuit ; ce fut la première atteinte portée à ma vue ; mais comme ni la faiblesse naturelle de mes yeux, ni de fréquentes douleurs de tête ne pouvaient suspendre mon ardeur, mon père n’épargna rien pour la bien diriger. Il me donna des maîtres sous le toit domestique ; puis, lorsqu’il me vit possédant plusieurs langues et les premiers éléments de la philosophie, il m’envoya à l’université de Cambridge. Là, pendant sept ans encore, soumis à la discipline universitaire, me nourrissant de nouvelles études, demeurant pur de tout vice, estimé par tout ce qu’il y avait d’estimable, je reçus, non sans quelque succès, le grade de maître ès arts. »
Dans la liste des nombreux ouvrages de Milton, ceux qui portent la date de son séjour au collège du Christ nous montrent le jeune maître ès arts occupé en même temps de philosophie, de mathématiques, de grec, de latin et de poésie. Quoi qu’en ait dit Johnson, Milton était à Cambridge l’étudiant modèle, chéri de ses professeurs comme de ses condisciples ; savant, mais modeste ; sage, mais d’une douceur inaltérable : sa beauté, la sérénité de son front et son air de candeur attiraient à lui tous les cœurs par une sorte de majesté naturelle : on l’a comparé, tel qu’il était alors, parmi les paisibles retraites des bords du Cam, à son Adam sous les bocages d’Éden ; et plus tard, tous ceux qui le connaissaient applaudirent au distique latin que lui adressa le marquis de Villa, faisant allusion par un double sens à sa croyance religieuse, et à cette beauté céleste dont il était doué :
Fatigué d’une longue promenade ou de quelque savante lecture à la lampe, Milton s’était endormi sous un arbre, et y rêvait peut-être de idea platonica quemad-modumAristote les intellexit, lorsqu’il fut réveillé tout à coup par le contact d’une main qui avait ouvert une des siennes ; il se leva en sursaut, entendit le frôlement d’une robe, et vit s’éloigner une femme dont il ne put distinguer la figure, mais dont la démarche et la taille, révélant presque une divinité, lui rappelèrent l’incessu patuit dea de Virgile. Le sage élève des muses classiques trouva plié entre ses doigts un morceau de papier avec ces quatre vers écrits au crayon :
Sans être alors aussi versé dans l’italien que dans le grec, Milton comprit le sens de ces vers, et rougit du compliment qui lui était adressé : « Beaux yeux, astres mortels, auteurs de mes maux, si fermés vous me faites mourir, que ferez-vous ouverts ? »
Milton rentra rêveur au collège du Christ, et sa rêverie ne fit qu’augmenter lorsqu’un de ses condisciples lui eut demandé s’il avait vu la dame italienne qui, venue pour visiter les collèges de Cambridge, avait enthousiasmé tous les étudiants par ses grâces et sa beauté. Il apprit, sans oser faire aucune question lui-même, qu’elle était déjà repartie, et il se surprit à regretter d’être le seul peut-être qui n’eût pu voir et admirer la belle étrangère, lorsque seul il avait été distingué par elle. Milton chercha à se distraire de ce regret involontaire par ses études savantes, mais il s’aperçut bientôt que le grec, le latin, la théologie et la philosophie d’Aristote n’avaient plus pour lui les mêmes attraits. C’était vers la langue de l’Italie moderne, c’était vers la poésie de Pétrarque et du Tasse qu’il se sentait invinciblement entraîné. Peu à peu, à l’amour de l’italien se joignit le désir de connaître l’Italie elle-même ; il ne put se dissimuler enfin que l’apparition de la belle étrangère occupait exclusivement toutes les facultés de son âme. L’ennui de Cambridge le ramena d’abord à Horton, où était alors la maison paternelle, et là, poursuivi par la même curiosité, il sollicita et obtint de son père la permission d’entreprendre le voyage de Rome.
Le père de Milton était un habile musicien, qui méritait l’éloge que son fils a fait de son talent dans ces vers où, parlant de ses compositions musicales, il le proclame un digne héritier d’Arion :
Le motif qu’il lui donna de son voyage fut son désir d’aller former une collection d’airs italiens. Auprès de son protecteur, sir Henry Wotton, qui le recommanda à ses illustres amis, il prétexta l’envie d’aller perfectionner comme lui ses connaissances par la fréquentation des savants : on le laissa partir. Il se rendit d’abord à Paris, où il fut présenté à Grotius, alors ambassadeur de Suède ; de Paris il passa à Livourne, puis à Pise, et enfin à Florence, où il se fixa pendant deux mois ; il y vit plusieurs fois Galilée, pour qui Grotius lui avait donné une lettre, et qu’il n’a pas oublié parmi les grands noms cités dans son poème. Il fréquenta les autres hommes remarquables dont Florence était le rendez-vous, les étonnant par l’universalité de son savoir, sans rien perdre de sa candeur, malgré les éloges qu’il obtenait partout. Inspiré à la fois par le commerce de ces hautes intelligences, et par le pressentiment secret que la muse qui l’appelait en Italie allait enfin se faire connaître à lui, Milton nous raconte qu’il osa enfin croire à son génie et à sa future immortalité. Estimant comme de faibles essais tout ce qu’il avait écrit jusque-là, il s’exaltait par l’idée encore confuse de ce qu’il entreprendrait un jour. Tout ce qu’il voyait, tout ce qu’il entendait désormais n’était plus que les matériaux de ce sujet sans titre encore, mais qu’il était sûr de trouver. De Florence, Milton partit pour Rome avec une lettre pour l’érudit Lucas Holstenius, qui devait être plus tard le bibliothécaire du Vatican, et que le cardinal Antonio Barberini avait chargé du soin de sa riche bibliothèque particulière. Urbain VII occupait la chaire pontificale. Ce pape n’était pas seulement un grand politique ; tout en étendant en Italie la puissance temporelle des clefs par ses négociations et ses guerres, il s’entourait d’un éclat plus doux par le culte des sciences et des lettres : s’il canonisa François de Borgia et Ignace de Loyola, il accueillait aussi avec distinction les poètes et les artistes de tous les pays et de toutes les croyances. Son népotisme fut encore favorable aux arts libéraux, qui trouvèrent dans ses neveux, les Barberini, des patrons magnifiques.
Le cardinal Antoine consulta plusieurs fois Milton sur ses vers latins ; en retour, le jeune Anglais pria Son Éminence de l’aider dans ce choix d’airs italiens qu’il avait promis de faire pour son père. Le cardinal rassemblait à ses concerts les musiciens les plus célèbres ; il invita Milton à y assister. « Je suis charmé, lui dit-il, de vous voir associer le goût de la musique à celui des lettres ; nous n’avons pas à Rome que des érudits comme Holstenius et son ami l’abbé Bouchard ; je veux aussi vous faire connaître nos musiciens et nos poètes : ce soir, la belle Léonora Baroni daigne se faire entendre ; venez admirer avec nous la voix et la beauté de cette cantatrice. Vous avez peut-être à Cambridge des savants comparables à mon bibliothécaire, mais pas de sirène comme Léonora ; c’est elle, d’ailleurs, que je veux prier de vous aider dans vos recherches musicales. »
Le pieux et sévère Milton aurait pu sans doute quelques mois auparavant trouver le cardinal un peu profane dans son admiration pour une chanteuse ; mais en se rappelant le vrai motif de son voyage en Italie, le jeune poète protestant accepta, sans se faire prier, l’offre de ce prince ecclésiastique de la « prostituée des sept collines, » ainsi que les Anglicans appellent encore Rome catholique. Quelque chose lui disait que dans le cercle des beautés romaines, il rencontrerait peut-être sa mystérieuse inconnue. Ce soir-là, Holstenius l’attendit en vain pour collationner quelques manuscrits de l’Ancien Testament. À peine si Milton songea à lui envoyer ses excuses. Entré un des premiers dans la grande salle du palais Barberini, il y prit place à côté d’un groupe où Léonora était justement le sujet de la conversation, et où le comte Fulvio Testi récitait le sonnet qu’il avait fait pour elle :
Un Français, M. Mau gars, après avoir renchéri en prose sur ces éloges poétiques, les résuma en disant que la modestie de Léonora égalait son talent, son esprit, le charme de sa voix, et qu’à peine le téorbe résonnait sous sa main « on croyait être déjà parmi les anges jouissant du contentement des bienheureux. »
En ce moment Léonora entra, conduite par le cardinal Barberini, qui, apercevant Milton, et exact à tenir sa promesse, se dirigea de son côté ; il le présenta à la belle chanteuse, comme l’étranger dont il venait de lui parler, pour le recommander à son obligeance. Il fallut échanger quelques mots de compliments. Léonora sourit en écoutant les premières paroles de Milton, et celui-ci crut avoir surpris d’abord l’expression d’une curiosité particulière ou d’un léger embarras dans le regard qui avait précédé ce sourire. Il eut donné beaucoup pour savoir en quels termes le cardinal l’avait recommandé à cette sirène. Quand elle s’éloigna de lui, il la vit se retourner de son côté, comme pour relever un des plis de sa robe ; et cependant ses yeux se portèrent rapidement plus loin ; elle s’assit, et déjà Milton se vit de nouveau regardé par elle, tandis que, s’il eût pu analyser sa propre émotion, il eût senti naître le désir que son inconnue ressemblât à cette Léonora, dont la présence faisait éclater tout à coup dans la salle un murmure général de plaisir et d’applaudissements. Elle prit son téorbe ; les premières notes qu’elle en tira négligemment commandèrent le silence ; et, dans un chant improvisé, elle justifia par la beauté de sa voix et la pureté de sa méthode tous les éloges du comte Testi, ainsi que ceux du musicien Maugars. Milton était sous le charme. Elle n’avait pas encore fini, qu’il avait oublié son inconnue ; il lui sembla qu’il n’était venu en Italie que pour Léonora. Elle se fit entendre encore deux fois dans la soirée, parut avoir remarqué l’émotion du jeune Anglais, et avant de sortir trouva l’occasion de lui dire qu’elle l’attendait le lendemain chez elle s’il désirait s’y présenter.
Le lendemain, c’était un ouvrage inédit d’Olympiodore, envoyé d’Aix, par Peyresc, que Holstenius eût voulu montrer à Milton ; mais eût-ce été un ouvrage inédit de Platon ou d’Homère, Holstenius aurait encore attendu en vain son hôte. Léonora le vit accourir à l’heure indiquée. Combien il se félicita, après l’embarras des premières questions, de pouvoir parler à la belle Italienne des principes de son art, plus heureux auprès d’elle d’être le fils d’un musicien que le fils d’un roi, quand il vit qu’il devait à ce titre d’en être accueilli presque tout d’abord comme un frère ! Mais si Léonora, en véritable artiste, l’admit à une sorte de familiarité, il semblait que cette confiance même imposait une réserve plus délicate au sentiment que Milton éprouvait pour elle, et il craignit longtemps de faire la moindre allusion à ce qui se passait dans le fond de son cœur. Il avait abandonné peu à peu toutes les sciences pour la musique et la poésie ; mais, par un reste de ses goûts d’université, ce fut en vers latins qu’il célébra, pour la première fois, la beauté qui le rendait infidèle à ses études classiques. Dans une de ces pièces, il la comparait à la fameuse Léonora qui causa les malheurs du Tasse. « Mais combien, dit-il, Torquato serait moins à plaindre avec la seconde Léonora, dont la voix suffirait pour lui rendre la raison que sa beauté lui eût fait perdre ! » Cette allusion au Tasse regardait Milton lui-même, agité plus que jamais de l’ambition de marcher sur les traces d’un tel émule en composant un poème digne de la Gerusalemme liberata. Il croyait enfin avoir trouvé son sujet dans les âges de la chevalerie. Lui aussi, à l’imitation du Tasse, il voulait chanter l’amour et les dames. Comme dernier hommage à sa terre natale, qu’il oubliait insensiblement sous le beau soleil d’Italie, c’était le roi Arthur de la Grande-Bretagne et les paladins de la Table-Ronde qu’il choisissait pour ses héros.
Léonora Baroni était au-dessus d’une simple cantatrice. Comme sa mère, la belle Adriana de Mantoue, elle composait souvent les paroles et les airs qu’elle chantait. Poète et digne de comprendre le génie de Milton, elle ne tarda pas à partager l’amour qu’elle lui inspirait, et sa dernière excuse pour ne pas y répondre, quand elle en reçut l’aveu, fut l’impossibilité qu’il y aurait pour elle de vivre loin de l’Italie. C’était déclarer à son amant qu’il devait lui sacrifier à jamais sa terre natale. Ce sacrifice, il ne se sentait que trop disposé à le faire, et ce ne fut que par un faible remords de conscience qu’il essaya de représenter à Léonora qu’elle avait peut-être tort d’être prévenue contre la Grande-Bretagne sans la connaître.
« Vous vous trompez, reprit-elle en souriant, j’ai vu les rives brumeuses de votre Tamise, j’ai vu Londres et ses maisons de briques, j’ai vu Oxford et ses palais consacrés aux sciences ; j’ai vu Cambrigde…
– Cambridge ? dit Milton, qui se ressouvint alors de l’inconnue.
– Oui, » reprit Léonora.
Et tandis que Milton passait la main sur ses yeux, comme un homme qui croit faire un rêve, elle ajouta :
« Ô ciel ! c’était vous ? » s’écria Milton ; et cette découverte le rendit encore plus amoureux qu’auparavant. Non seulement il crut qu’il lui serait facile de renoncer à l’Angleterre, mais encore à la gloire qui l’y attendait comme poète. Il voulut devenir tout à fait Italien pour mériter celle qu’il aimait : par un effort de travail, que son amour et son génie couronnèrent d’un rare succès, il parvint à écrire en italien comme un Italien même ; et le premier poème qu’il apporta à Léonora fut un de ces sonnets dans la langue du Tasse, que le Tasse lui-même n’eût pas désavoué. Il est peu connu. Nous allons le transcrire, d’autant mieux que Milton s’y peint avec une noble franchise.
À LÉONORA BARONI.
« Jeune homme simple et amant timide, incertain si je dois me fuir moi-même, je veux, madame, vous offrir, à vous, l’humble don de mon cœur. Je puis du moins vous le donner pour un cœur fidèle, constant, ferme, intègre, et se nourrissant de pensées élevées. Quand le monde est ébranlé par la tempête, quand la foule mugit, il se replie sur lui-même comme dans une cuirasse de diamant. À l’abri des traits de l’envie et des outrages du monde, libre de ces espérances et de ces craintes qui agitent le vulgaire, enthousiaste pour le génie et le mérite, pour les chants de la lyre et ceux des muses, vous ne le trouverez faible que là où l’amour a su l’atteindre d’une blessure incurable. »
Peu de temps après Milton envoya à son ami Charles Diodati cet autre sonnet écrit encore avec toute l’élégance du pur toscan, et dans lequel il ne craint plus d’avouer quel est le tendre lien qui l’enchaînait à Rome : c’est aussi le portrait de son enchanteresse :
À CHARLES DIODATI.
« Diodati ! je te dirai, tout étonné moi-même, que moi qui avais coutume de dédaigner l’Amour et me moquais souvent de ses piégés, j’y suis tombé comme tant d’autres. Ce ne sont pas des boucles d’or, ni un teint de rose qui m’ont séduit, mais une beauté étrangère, qui ravit le cœur par la noblesse et la grâce décente de son maintien, par le doux éclat de son front, par ses paroles empruntées tantôt à une langue, tantôt à une autre, par son chant magique, qui ferait descendre du ciel la lune errante, et par ses yeux d’où jaillit un tel feu qu’il ne me servirait guère de fermer mes oreilles avec de la cire. »
Ces deux sonnets, comme les autres, où Milton chante celle qu’il aime, nous prouvent que dans cette passion de sa jeunesse il conserva toujours la chaste retenue de son caractère. Son amour ne fut pas sans doute exclusivement platonique, mais conforme cependant à sa dignité habituelle ; et il put, sans être démenti, invoquer plus tard la pureté de ses mœurs, lorsqu’il se vit en Angleterre tombé dans « de mauvais jours, et parmi des langues mauvaises, » c’est-à-dire accusé de tous les vices par ses ennemis politiques.
Quelque tendre qu’on puisse supposer le chantre des premières amours d’Adam et d’Ève, l’imagination se prêterait difficilement à déchirer le voile de chasteté dont il les a lui-même couvertes chaque fois qu’il en a parlé. Si quelques commentateurs ont pu dire que la fameuse Béatrix du Dante était une personnification de la théologie, il est heureux pour la Léonora de Milton qu’il soit bien prouvé par les témoignages de ses contemporains qu’elle était une maîtresse réelle ; car avec un amant dont la secte fut depuis si grave et si austère, elle eût risqué d’être prise par la postérité pour une des abstractions de la vie puritaine. Il est certain du moins que sa beauté seule, quoique aidée de la magie de sa voix, n’eût pas séduit aussi complètement un adorateur tel que Milton. Mais, femme supérieure par tous les dons de l’esprit, elle parlait vivement à son intelligence. Elle fut littéralement la muse qui l’initia à tous les trésors de la poésie italienne, dont on remarque de fréquentes réminiscences dans son grand poème. Il y a même dans le Paradis perdu des expressions, et surtout des concetti, qui ont fait dire à quelques critiques que l’Homère anglais est quelquefois plus Italien que le Tasse.
Mais quand Milton eut fait à Léonora l’abandon volontaire de ses goûts et de son pays natal, il arriva ce qui a lieu entre deux amants dont l’un a tout donné à l’autre ; c’est le tour de celui-ci de faire des sacrifices, sous peine de laisser s’apaiser ou s’éteindre leur feu mutuel. Léonora comprit donc qu’elle devait devenir un peu plus Anglaise à mesure que Milton devenait tout à fait Italien. Ce fut elle qui, dans leurs entretiens littéraires, se plut à lui rappeler sa patrie absente, et qui l’excitait à lui tracer le tableau de ses études à Cambridge, ou de ses vacances à Horton, sous le toit paternel. Après avoir admiré avec lui Dante, Pétrarque ou Torquato, elle était la première à mettre à côté de ces noms le nom de Shakespeare. Elle s’étonnait que l’Eschyle anglais n’eût pas un mausolée digne de sa gloire dans l’île qui le vit naître : cette plainte inspira peut-être à Milton son sonnet sur Shakespeare, si souvent cité. Léonora avouait volontiers que la Melpomène italienne était bien pâle comparée à celle des Anglais, malgré l’estime qu’on faisait encore alors, dans les académies de Florence et de Rome, de la Sophonisbe du Trissin, qui n’est plus aujourd’hui considérée que comme un curieux monument de la renaissance de l’art dramatique. Les successeurs du Trissin s’étaient, d’ailleurs, affranchis des règles qu’il avait voulu renouveler de la poétique ancienne. Ils préféraient la composition plus populaire des mystères et des moralités, appelés rappresentazione.
Je veux, dit un jour Léonora à Milton, vous prouver combien votre sauvage Shakespeare est grand, comparé à nos Thespis italiens : j’ai refusé d’aller chanter ce soir au concert du cardinal, pour assister avec vous à une représentation qu’Andreini donne de son Adamo.
Andreini, comme votre Shakespeare, est à la fois auteur et acteur ; mais, hélas ! là s’arrête la ressemblance.
Milton se laissa conduire.
Batista Andreini était devenu, depuis la mort de son père, le directeur de la fameuse troupe ambulante de I Gelosi, les Jaloux. Il prenait le titre de Comique fidèle et membre de l’académie des insouciants, Comico fidele ed academico spensierato. Il était secondé par sa femme Virginia Ramponi, plus connue sous le nom de la Florinde. C’était lui qui remplissait le rôle d’Adam, Florinde celui d’Ève. L’histoire n’a pas conservé les noms des autres acteurs ; mais voici les personnages et la rapide analyse de la rappresentazione sacra qui fut jouée devant Milton et Léonora Baroni :
DIEU LE PÈRE ;
L’ARCHANGE MICHEL ;
ADAM ;
ÈVE ;
L’ANGE GARDIEN D’ADAM ;
CHŒUR D’ANGES, DE SÉRAPHINS ET DE CHÉRUBINS ;
LUCIFER ;
SATAN ;
BELZÉBUB ;
LES SEPT PÉCHÉS MORTELS ;
LE MONDE ;
LA CHAIR ;
LA FAMINE ;
LE TRAVAIL ;
LE DÉSESPOIR
LA MORT ;
LA VAINE GLOIRE ;
LE SERPENT ;
VOLANO, messager de l’Enfer ;
CHŒUR de Fantômes ;
CHŒUR d’Esprits infernaux ;
CHŒUR d’Esprits de feu, d’Esprits aériens, d’Esprits aquatiques.
La pièce commençait par un chœur d’anges chantant la gloire de Dieu. Après cette espèce de prologue. Dieu le père, entouré des anges, appelle Lucifer, il le force d’admirer l’œuvre des six jours, et crée Adam et Ève, pour augmenter encore sa confusion. Lucifer exprime sa haine contre Dieu, les bons anges et l’homme, et jure de se montrer à jamais leur ennemi :
Lucifer convoque alors Satan, Belzébub et les autres démons, pour les associer à son complot contre l’homme. Il distribue à sept d’entre eux les rôles des sept péchés capitaux. Melecano est chargé de l’orgueil, Lurcone de l’envie, Ruspicano de la colère, Alfarat de l’avarice, Maltea de la paresse, Dulciato de la luxure, Guliar de la gourmandise.
Un chœur d’anges ouvre le second acte par un nouvel hymne à la gloire de Dieu.
Adam et Ève paraissent, suivis de Lurcone et de Guliar, invisibles ; mais ces deux démons sont mis en fuite par la prière des deux époux.
Lucifer, sous la forme du serpent, annonce à Satan et aux autres démons son dessein de séduire la femme.
Volano arrive et déclare que les puissances infernales ont décidé d’envoyer une déité de l’enfer, appelée Vaine Gloire, pour vaincre l’homme.
Vaine Gloire entre appuyée sur un géant ; elle est saluée par le serpent, qui se cache avec elle dans l’arbre pour épier et tenter Ève. Ève s’approche seule ; le serpent la séduit ; Vaine Gloire termine le second acte en célébrant son triomphe.
Dans la première scène du troisième acte, Adam s’approche d’Ève. – Milton regarda tendrement Léonora quand Andreini eut prononcé avec l’accent de la tendresse ces vers si doux :
« Ô ma compagne bien-aimée ! ô toi, cœur et âme de ma vie ! si tu as erré au loin, si tu as couru, empressée, solitaire, pour retrouver Adam, le voici ; que lui veux-tu ? »
Léonora, à son tour, sourit à Milton quand Ève répondit :
« Ô mon cher Adam ! ô mon défenseur, ô mon guide ! toi qui seul me réjouis et me consoles, c’est toi seul que je cherchais. »
Toute cette scène, chef-d’œuvre de tendresse, toucha vivement Milton. Ève avoue à son époux qu’elle a cueilli la pomme et veut la partager avec lui ; Adam comprend toute l’énormité de sa faute, mais il ne veut pas qu’Ève soit seule coupable et malheureuse : il se perd avec elle par excès d’amour. Soudain le remords et la terreur, touchent les deux époux ; ils fuient et se cachent.
Dans les scènes suivantes, les démons célèbrent leur victoire. Le serpent demande un chant de triomphe à Canoro, démon de la musique, mais la venue soudaine de Dieu change cette fête en cris d’horreur.
Dieu réprimande Adam et Ève, prononce leur sentence, leur donne des peaux d’animaux pour se couvrir, et l’Archange Michel les chasse du paradis. Ils se livrent au désespoir, mais un chœur d’anges les excite à la pénitence.
L’acte quatrième montre Volano et un chœur d’esprits qui rendent hommage à Lucifer. – Lucifer exprime son horreur pour la lumière ; s’entretient avec les démons sur le sens des paroles de Dieu, leur annonce l’incarnation du Fils de l’homme et prépare de nouvelles machinations contre la postérité des exilés d’Éden ; des cyclopes infernaux créent un nouveau monde par l’ordre de Lucifer, qui envoie trois démons à Adam pour jouer les rôles du Monde, de la Chair et de la Mort.
Adam seul se lamente, lorsqu’il voit accourir Ève, effrayée par les animaux féroces. Elle excite son époux au suicide.
La Famine, la Soif, la Lassitude et le Désespoir se montrent à Adam et Ève dans toute leur laideur ; et l’acte se termine par l’apparition de la Mort, qui vient ajouter aux terreurs du couple malheureux.
Dans le cinquième et dernier acte, la Chair vient trouver Adam sous la forme d’une femme. Adam résiste à la tentation.
Lucifer, sous la forme d’un homme, vient alors dire à Adam qu’il est son frère aîné.
Adam, tourmenté par le doute, va succomber, lorsque son ange gardien paraît pour le défendre.
La scène change, et les tentations assiègent Ève à son tour. C’est le Monde, sous la forme d’un homme richement paré, qui, faisant sortir un superbe palais de terre, cherche à séduire Ève par la magnificence.
Adam vient au secours d’Ève et l’exhorte à résister. Lucifer, le Monde, la Mort, les démons se préparent à saisir les deux époux. L’archange Michel, à la tête d’un chœur d’anges, combat et défait Lucifer.
Enfin, dans la dernière scène, Adam, Ève, avec les anges, se réjouissent de la victoire de Michel, qui leur promet la clémence de Dieu pour prix de leur repentir, et la pièce se termine par des hymnes à la louange du Rédempteur.
Léonora, qui faisait peu de cas du talent d’Andreini, quoiqu’elle ne fût pas insensible aux traits heureux dont son œuvre était semée, s’étonna de l’attention que Milton y avait prêtée constamment. Quand elle voulut hasarder quelques critiques, il ne l’écouta que d’un air distrait. Le lendemain, en se promenant avec elle dans Rome, il la dirigea du côté des deux statues colossales d’Adam et d’Ève par Bandinelli, les contempla longtemps en silence, et il ne les quitta que pour aller ensuite admirer le magnifique tableau où Michel-Ange a représenté la création.
Depuis ce jour ce ne furent plus Merlin et le roi Arthur qui occupèrent exclusivement l’imagination du poète : il lut moins les romans de chevalerie, et l’Adamo d’Andreini le ramena à la lecture de la Bible, qu’il avait un peu négligée depuis qu’il était à Rome. Ce retour aux livres saints devait nécessairement raviver en lui une foule d’autres impressions et de souvenirs qui allaient chaque jour s’effaçant auprès de Léonora. D’autant plus facilement alarmée qu’elle aimait davantage, Léonora s’aperçut que Rome et ses pompes mondaines n’avaient plus le même attrait pour Milton. Elle avait pu croire un moment qu’à l’exemple d’Holstenius, il renoncerait enfin à la foi protestante comme au pays de ses pères. Cet espoir lui échappa, et elle ne songea plus qu’à arracher Milton à l’ennui de Rome. Elle partit avec lui pour Naples, où le noble marquis de Villa, dernier protecteur du Tasse, reçut en ami généreux des lettres la nouvelle Eléonore et son amant. Milton, qui a payé par de beaux vers l’aimable hospitalité de cet auguste vieillard, avoue qu’il puisa dans son commerce de précieux encouragements pour le grand ouvrage qu’il méditait. Peut-être l’influence du climat voluptueux de Naples allait-elle lui faire oublier de nouveau l’Angleterre : tout entier à ses pensées de poésie et d’amour, il se disposait à s’embarquer pour la Sicile, et formait le projet de visiter ensuite la Grèce avec Léonora, lorsqu’une lettre inattendue vint, comme le bouclier d’Ubalde présenté aux yeux de Renaud, détruire le charme d’Armide. C’était une lettre de son père, qui ne lui adressait aucun reproche, mais qui lui annonçait avec tristesse et inquiétude les troubles dont était menacée l’Angleterre. L’amour de la patrie se réveilla soudain dans le cœur républicain de Milton, et lui donna le courage de rompre violemment les liens de tout autre amour. Il retrouva le stoïcisme de son adolescence ; il dit adieu à l’Italie, à la muse et à Léonora, pour aller se ranger parmi les ennemis de l’épiscopat et du roi Charles.
Por certo i bei vostri occhi, donna mia,
Esser non puo che non sian lo mio sole.
MILTON, Sonnets italiens.
– « Ancor non m’abbandona. »
DANTE.
Rien n’est moins rare dans l’histoire que de voir les nations renverser les idoles qu’elles ont adorées, exalter de nouveau les noms qu’elles ont couverts d’opprobre. Les Stuarts venaient de remonter sur leur trône ; les acclamations de l’allégresse publique éclataient de toutes parts ; ils pouvaient bien oublier dans ce retour triomphal vingt années de discordes civiles, de combats et d’usurpation, où l’on avait vu d’un côté le roi et sa noblesse avec tous les vieux souvenirs de la féodalité normande ; de l’autre, le peuple rebelle avec le fanatisme de la religion et l’audace de la démocratie : guerre parricide commencée sur le champ de bataille, terminée sur les planches d’un échafaud ; époque de grands crimes, mais aussi de grandes vertus ; drame incomplet après toutes ses diverses péripéties de terreur et de gloire, si la restauration de l’ancienne dynastie en fût restée le dénouement contradictoire.
Cependant cette conclusion inattendue semblait au moins condamner désormais au silence toutes les factions hostiles à la royauté héréditaire. Parmi le petit nombre d’esprits indomptés qui pleuraient en secret la ruine des libertés publiques, nul ne pouvait être assez clairvoyant pour deviner que l’un des deux fils de Charles Ier irait un jour reporter dans un éternel exil la couronne sanglante de son père. Pour les peuples et les rois de l’Europe, la révolution anglaise n’avait été qu’une tragédie sans moralité ! Peuples et rois ne pouvaient comprendre que leurs destinées fussent en cause dans cette lutte entre un roi et son peuple, lutte de principes qui devait se reproduire successivement dans toutes les monarchies, et finir par changer le droit public des deux mondes. En France comme en Espagne, en Hollande comme en Italie et en Allemagne, on n’avait guère vu dans ce qui venait de se passer chez les Anglais qu’une guerre civile faisant suite aux vaines révoltes de Jack Cade et de Wat Tyler, ou aux disputes sanglantes des deux roses, toujours sans influence sur le continent. Seulement, jusqu’ici, les rois et les reines d’Angleterre avaient seuls eu le droit de vie et de mort sur les rois et les reines ; le bourreau ne recevait point d’ordres des sujets contre leurs souverains. L’épisode inouï du supplice de Charles Stuart avait excité à la fois l’indignation et la pitié ; l’indignation, à cause du caractère sacré du roi ; la pitié, par les détails touchants de sa dernière heure. Ce souvenir seul expliquerait comment l’opinion générale de l’Europe s’associa aux réactions qui signalèrent le rétablissement des enfants de la victime royale. Les outrages faits aux cendres de Cromwell parurent des représailles naturelles, car le fait même d’une restauration annulait les titres glorieux de cet usurpateur, qu’il avait été plus facile d’arracher à son tombeau qu’à son trône. On ne songea même pas à réclamer en faveur des cendres de l’amiral Blake, qui n’avait cependant défendu le pavillon républicain que sur la mer et contre l’invasion étrangère. Le titre de régicide excusait toute espèce de réaction contre les vivants et contre les morts. C’était, d’ailleurs, comme d’usage, une exception qui consacrait l’amnistie : une liste de proscrits rassure l’égoïsme du plus grand nombre ; quand on sut quels étaient ceux que le nouveau roi sacrifiait aux mânes de son père, on exalta en chœur la clémence de Charles II.
Les partisans du roi avaient, d’ailleurs, pris leurs précautions pour que les proscrits et les persécutés de l’opinion vaincue n’inspirassent aucun intérêt : ce n’était pas seulement une guerre d’épée qui avait décidé de l’abolition momentanée de la monarchie, les armes de la polémique n’étaient pas restées oisives ; la parole des prédicateurs, la plume des écrivains n’avaient pas fait des blessures moins profondes que l’arquebuse ou l’épée du soldat et la hache du bourreau. L’épée, l’arquebuse, la hache ne mutilent que le corps, le glaive de la presse rend difformes le corps et l’âme. Les métaphores du discours ne sont plus de vaines images dans la langue des partis ; la haine voit son ennemi aussi hideux qu’on veut le lui faire. Pour les puritains fanatiques, Charles Stuart avait porté sur le front la marque fatale de l’Apocalypse ; pour les royalistes fidèles, Cromwell, Bradshaw, Lambert, Vane, etc., étaient des démons incarnés, auxquels il ne manquait ni le pied fourchu ni les cornes de Belzébub ou de Belial.
Il y avait un homme surtout que la calomnie s’était plu à peindre sous des traits repoussants : cet homme avait été le secrétaire latin du Long Parlement et du Protectorat, l’adversaire redoutable de la prélature, l’apologiste de la république régicide. C’était peut-être de bonne foi que, sur le continent, Saumaise, More, Dumoulin et les autres réfutateurs de Milton, écrivaient que jamais âme plus noire n’avait eu pour prison terrestre un corps plus affreux ; sa taille était alternativement grandie d’une coudée ou abaissée à celle d’un nain ; ses mains étaient armées de doigts crochus comme les griffes d’une hyène, et une horrible lèpre qui avait dévoré ses prunelles sillonnait en tout sens son visage : on lui appliquait sérieusement, en un mot, le vers classique du Cyclope aveuglé par Ulysse :
Certes, qui avait connu Milton en Italie, qui l’avait aimé jeune, beau et comparé à un ange par le marquis de Villa, pouvait bien penser qu’il y avait probablement deux hommes du même nom : le poète et le controversiste ; et lorsque le bruit de la mort du secrétaire latin de Cromwell suspendit heureusement la proscription dirigée contre celui-ci, les amis étrangers de Milton le poète pouvaient encore hésiter à porter le deuil.





























