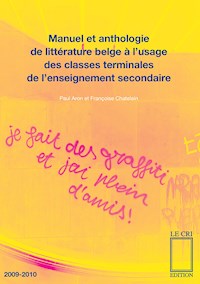Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions de l'Université de Bruxelles
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Du menuisier Adam Billaut au boucher Joseph Ponthus, du dentiste Marmont au docteur Camuset, du cordonnier Magu au géologue Cochon de Lapparent, nombreux sont les poètes qui ont évoqué leur profession dans leurs vers. Certains en ont fait des ouvrages didactiques, comme les enseignants de géographie, d'histoire ou de grammaire, d'autres de simples moments de plaisir partagé, comme le pharmacien Pascalon. Leurs œuvres sont tantôt ambitieuses, comme celle de l’avocat qui réécrit le Code civil en vers, tantôt émouvantes, comme les poèmes pacifistes d’un ancien officier. Tous ces écrivains, amateurs ou confirmés, ont cependant en commun d’être ceux que ce livre désigne, avec une ironie bienveillante, comme des « poètes de métier ». En quatre chapitres, Paul Aron esquisse de façon inédite une histoire de ces échanges entre profession réelle et art poétique. Mêlant érudition et humour, il dévoile ainsi un continent méconnu de l’histoire littéraire.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Paul Aron est docteur en philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles. Il est directeur de recherche honoraire au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et professeur de littérature à l’Université libre de Bruxelles. Il s’intéresse à l’histoire de la vie littéraire, principalement des XIXe et XXe siècles, aux relations entre les arts et entre les médias de presse, la vie politique et l’histoire culturelle et journalistique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les Éditions de l’Université de Bruxelles ont choisi d’accorder une plus grande place à la littérature dans leur catalogue, et pour ce faire, elles créent aujourd’hui une nouvelle collection : Littérature(s). Cette collection a pour vocation d’accueillir aussi bien des études monographiques que des ouvrages thématiques collectifs, des anthologies, ou des essais, relatifs aux littératures, prioritairement francophones, mais également étrangères, à la littérature comparée et à l’intermédialité. Les textes, publiés en français, sont assortis d’un appareil critique, d’un index et, le cas échéant, d’un supplément iconographique. Les manuscrits sont soumis à la double évaluation par les pairs. Direction de la collection :Valérie André
Éditions de l’Université de Bruxelles
Dans la même collection Lire, se mêler à la poésie contemporaine. A. Césaire, B. Noël, D. Fourcade, F. Pazzottu Béatrice Bloch, 2021Bruxelles sur scène.Luc Malpertuis et l’histoire de la revue théâtrale en Belgique (1880-1930)Fanny Urbanowiez, 2022
Illustration de couverture : Félicien Rops, Les Sonnets du Docteur, 1884 © Musée Félicien Rops, Province de Namur, inv. PER E0502.2.PISBN 978-2-8004-1866-7ISSN 2736-6170 D2024/0171/6 © 2024, Éditions de l’Université de Bruxelles Avenue Paul Héger 26 1000 Bruxelles (Belgique) [email protected]
À propos de l’auteur
Paul Aron est docteur en philosophie et lettres de l’Université libre de Bruxelles. II est directeur de recherche honoraire au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et professeur de littérature à l’Université libre de Bruxelles. Il s’interesse à l’histoire de la vie littéraire, principalement des XIXe et XXe siècles, aux relations entre les arts et entre les médias de presse, la vie politique et l’histoire culturelle et journalistique
À propos du livre
Du menuisier Adam Billaut au boucher Joseph Ponthus, du dentiste Marmont au docteur Camuset, du cordonnier Magu au géologue Cochon de Lapparent, nombreux sont les poètes qui ont évoqué leur profession clans leurs vers. Certains en ont fait des ouvrages didactiques, comme les enseignants de géographie, d’histoire ou de grammaire, d’autres de simples moments de plaisir partagé, comme le pharmacien Pascalon. Leurs œuvres sont tantôt ambitieuses, comme celle de l’avocat qui réécrit le Code civil en vers, tantôt émouvantes, comme les poèmes pacifistes d’un ancien officier. Tous ces écrivains, amateurs ou confirmés, ont cependant en commun d’être ceux que ce livre désigne, avec une ironie bienveillante, comme des « poètes de métier ». En quatre chapitres, Paul Aron esquisse de façon inédite une histoire de ces échanges entre profession réelle et art poétique. Mêlant érudition et humour, il dévoile ainsi un continent méconnu de l’histoire littéraire.
Pour référencer cet eBook
Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.
Table des matières
Remerciements
Introduction
Un continent oublié
Le temps des métromanes
Poésie et poétique
Chapitre I
L’art d’enseigner, en vers et pour tous
Prises de parole
La fabrique du poème national
Les grammairiens métronomes
Les grammaires pour dames, ou le vers galant
La classe en rimes
Conclusion
Chapitre II
Les mètres des maux
Le corps en listes
La poésie comme distinction
Les querelles médicales en vers
L’antimoine
Le mesmérisme
L’homéopathie
De la saignée à l’accouchement
Les thermes poétiques
L’esprit de la salle de garde
Le double métier
Dentistes
Publicités médicales
Les pharmaciens-poètes
L’exposé du savoir-faire
Rimer est un plaisir
Une réclame humaniste
Les usages du vers en contexte médical
Chapitre III
En vers et en droit
Rhétorique ou poésie ?
Les codes transcrits en chansons et en vers
Défenses et plaidoiries en vers
Les Lettres et le Droit
Chapitre IV
Les rimes de l’outil
Essai de périodisation d’un sous-genre illégitime
Les années 1850
Fin de siècle
Période contemporaine
Dire l’outil
Artiste en cheveux comme en vers
Des paroles ouvrières confisquées
Le chant des mines
Poètes paysans
L’esprit de corps
La poésie ouvrière
Conclusion
← 6 | 7 →
Remerciements
Ce livre a bénéficié d’une bourse du programme DEA de la FMSH à Paris (2018), d’un crédit de recherche du F.R.S.-FNRS (2019-2020) et d’une résidence d’écriture à la Fondation des Treilles (2021). Je remercie très vivement les personnes et les institutions qui m’ont permis de rassembler la documentation et de travailler dans les meilleures conditions possibles, en pleine crise sanitaire liée au Covid. Je remercie aussi les ami(e)s et collègues qui ont accepté de relire ce texte, et la Faculté de Lettres, Traduction et Communication de mon université qui en a facilité la publication. ← 7 | 8 →
← 8 | 9 →
Introduction
Ce livre aborde la poésie sous un angle inhabituel. Son point de départ est une pratique de la langue fondée sur le vers et le rythme que d’innombrables personnes ont entretenue dans les circonstances les plus diverses, et depuis bien longtemps. De nos jours, on tend à rabattre la versification sur la poésie et la chanson. L’histoire révèle des usages bien différents. On a connu une muse savante, inspirée par les modèles de l’Antiquité, qui s’est maintenue jusqu’au XVe siècle, et bien après chez certains auteurs. On a connu également une muse ordinaire qui a véhiculé et continue de véhiculer des émotions, des valeurs, des idées. Mais le développement de la prose a transformé le statut symbolique de la mise en vers. En perdant de son évidence, cette dernière est progressivement devenue une forme choisie en vue de certains effets. Dans le domaine littéraire, elle a successivement abandonné la fiction puis le théâtre. Une part de la poésie même s’énonce aussi en prose. Le mouvement a été encore plus tranchant dans les domaines scientifiques, jusqu’à marginaliser la langue française elle-même au profit d’un anglais international. Ces évolutions ont fait oublier des textes anciens, écrits en français (ou en latin) et en vers, qui ont été, en leur temps, perçus comme importants. Nulle institution n’a eu le souci d’entretenir leur souvenir. L’écriture en vers a été et est encore un fait social de grande ampleur largement occulté de nos jours1.
Cette méconnaissance est renforcée par deux autres raisons. Elle tient d’abord au fait que la poésie ordinaire a généralement circulé indépendamment de toute reconnaissance littéraire, c’est-à-dire sans qu’y opèrent les mécanismes de sélection et de consécration propres à ce domaine. Elle tient aussi à la diversité de ses supports, souvent éphémères, et aux liens étroits qu’elle entretient avec la musique et le chant.
Le fil rouge qui noue les textes que je soumets à la curiosité du lecteur contemporain concerne une infime partie de cette production de textes versifiés. Il relie ceux que j’ai nommés les « poètes de métier », à savoir les personnes qui écrivent de la poésie en relation avec la profession qu’elles exercent dans la vie sociale et qui ne sont pas, ou peu, reconnues dans le monde des Lettres. J’entends par là les textes qui thématisent ce métier ou sont en liaison explicite avec lui, ce qui écarte les innombrables « chansons de marins », et autres, qui peuvent être considérées comme de la poésie, mais qui traitent de toutes sortes de sujets non professionnels. Une seconde restriction porte sur le statut éditorial des textes. Je ne retiens que des œuvres imprimées, quel qu’en soit le support (livre, revue, journal), parce que la publication est en soi un geste tourné vers un public, une offre d’effectivité du texte. Même réduit de la sorte, le corpus est imposant et ancien. Essayons d’en esquisser les contours et une périodisation. ← 9 | 10 →
Un continent oublié
En 1644, maître Adam Billaut, menuisier à Nevers, publie son recueil, Les Chevilles. Celui-ci s’ouvre sur une dédicace où le poète offre ses vers à un protecteur, en précisant :
La même main qui te les offre Te peut encor offrir un coffre, Car quand je rabote ou j’écris, Ma raison met à même prix, Et même boutique enveloppe, Mon Apollon et ma varlope2.
Complètement oublié de nos jours, dans le premier tiers du XIXe siècle, Félix Becker, ouvrier menuisier dans l’Oise, est l’auteur de plusieurs chansons. On peut en extraire les vers suivants :
La Scie De poète et menuisier Ma foi, j’ai la manie ; Et loin de m’en effrayer, J’ai résolu d’égayer La scie3.
Bien plus près de nous, en 2019, Joseph Ponthus publie, lui, À la ligne. Feuillets d’usine, un récit en vers libres où il raconte sa vie d’ouvrier, au jour le jour, dans l’industrie alimentaire. Il précise :
J’écris comme je pense sur ma ligne de production divaguant dans mes pensées seul déterminé J’écris comme je travaille À la chaîne À la ligne4.
Billaut a probablement été un petit patron menuisier et non pas un ouvrier, et il travaillait pour la chambre des comptes de Nevers lors de la publication de son recueil ← 10 | 11 → de poèmes5. Becker a été un menuisier singulièrement instruit et engagé politiquement6. Ponthus a fait des études de lettres et collaboré à un premier ouvrage avant la publication de celui-ci. Il n’a pas écrit en vers, au sens classique du mot, mais dans une prose brisée qui lui a valu une immédiate et méritée reconnaissance publique. Mais ces précisions biographiques sont secondaires. L’important est que ces trois auteurs nomment d’emblée leur métier, et que celui-ci s’inscrit véritablement dans leurs textes poétiques comme thème et comme motivation. Tous insistent en effet sur le parallèle de leurs activités. L’ouvrier du bois fabrique des chevilles, il rabote ses vers, son successeur joue sur le triple sens de la scie, outil, instrument de musique ou rythme obsédant, et Ponthus relie la ligne de production au vers libre qu’il emploie.
Voici donc un dispositif inhabituel. D’un côté, celui qui écrit signale sa profession réelle, de l’autre, il thématise ce métier dans ses vers. Or nous avons l’habitude de séparer le statut social du poète de son moi lyrique. Imagine-t-on Mallarmé signer « professeur d’anglais » le recueil de ses poésies, et Louis Aragon « adjudant médecin auxiliaire » son Paysan de Paris ? À l’inverse, personne n’attend des médecins ou des menuisiers qui écrivent qu’ils évoquent tous des remèdes ou des meubles. Les écrivains ont l’habitude de se présenter comme libres, indépendants des contingences. Ceux qui m’intéressent ici se situent d’emblée dans une posture paradoxale : ils énoncent à la fois une catégorie littéraire (« le poète ») et une autre, possiblement antagoniste (« le paysan » ou « l’ouvrier »). Dans certains cas, assez rares, les deux identités sont liées par un trait d’union, en particulier lorsqu’une institution les relaie. On aura donc des poètes médecins ou des médecins-poètes, la distinction demeurant circonstancielle et de peu d’importance pour le propos, sauf lorsque les acteurs la revendiquent.
Ce point de départ invite à découvrir une sorte de continent méconnu de l’histoire littéraire, celui de la « poésie professionnelle ». Je m’intéresse aux vers produits en relation avec un métier et par ceux qui l’exercent : les rimes dues aux juristes, médecins, cheminots ou mineurs, qui évoquent le droit, l’art de guérir, les trains ou le charbonnage. Il ne s’agit donc pas de réunir les poèmes produits par tous ceux qui ont exercé un métier particulier – la plupart des avocats poètes n’ont pas thématisé leur métier dans leurs vers –, mais de réfléchir aux implications du signalement professionnel dans une pratique poétique.
Bien entendu, cette « poésie professionnelle » est souvent le fait de « non professionnels » de la poésie, j’entends par là des poètes occasionnels, des amateurs peu consacrés par les institutions littéraires, au contraire de Billaut ou Ponthus. Ces amateurs ont rarement bonne presse. Ils sont non seulement exclus du canon littéraire, ce que l’on peut comprendre s’agissant de faire connaître les auteurs importants, mais ils sont également oubliés par les historiens du littéraire, ce qui est plus gênant. Car les amateurs sont, d’une part, des lecteurs qui participent à la vie des Lettres et, d’autre part, des praticiens qui ont l’ambition de plaire, de divertir ou de se rendre utiles en faisant des vers. Leur production est immense, publiée en brochures, en petits formats, en revues, à compte d’auteur souvent, ou simplement récitée lors de manifestations ← 11 | 12 → publiques. Elle forme un volume si considérable qu’il décourage tout inventaire. Aucun orpailleur n’y cherchera jamais les pépites d’un texte immortel. Et pourtant la masse de ces vers peut être comparée aux innombrables photographies prises par tout un chacun, sur support papier et aujourd’hui digital. Après avoir été méprisés face aux œuvres des photographes reconnus, ou abandonnés sur les marchés aux puces, ces clichés se révèlent d’une grande valeur documentaire, voire esthétique. Certains atteignent d’ailleurs des prix comparables aux œuvres des artistes cotés. Les écrivains occasionnels seraient-ils plus méprisables que les photographes du dimanche ?
Je n’ai pas l’ambition d’escalader cette montagne de vers oubliés ni de servir de guide à de futurs excursionnistes. Mon objectif n’est pas de répertorier tous les écrivains du dimanche, mais de comprendre pourquoi et comment, le dimanche, certains font des vers sur leur métier quotidien et les publient. S’ouvre ainsi ce que l’on pourrait nommer le territoire d’une « littérature vernaculaire », sorte de toile de fond sur laquelle se détachent, selon des processus analysables, les œuvres reconnues et qualifiées7.
Je ferai trois hypothèses de travail. La première est que les professions influencent la fabrique des vers et que cette influence transcende l’intention propre à chaque auteur. Si tel est bien le cas, nous nous trouvons clairement devant un « fait sociologique » au sens où Durkheim entendait le mot : une réalité collective objectivable déterminant les comportements individuels. Cela implique de ne pas privilégier un seul métier ou un seul groupe social, mais d’envisager un échantillon de professions diverses8.
Ensuite, je suppose que les poètes qui évoquent leur « vrai » métier dans leurs vers sont presque nécessairement conduits à interroger cette pratique ; ils se réfèrent au « comment » et au « pourquoi » de leur écriture. Ce mouvement introspectif est comparable à l’autoréflexivité de « l’art poétique » des écrivains plus engagés dans la vie littéraire. Il est le moment où l’art de dire tend à se représenter pour lui-même. Même s’ils ne prétendent pas toujours participer à la littérature instituée, nombre de versificateurs de mon corpus ont tenu à préciser les raisons de leur activité. Ils révèlent ainsi une grande diversité de motivations, qui outrepassent les limites attendues d’un amateurisme occupationnel.
Ma troisième hypothèse est que les différentes professions se disent en vers pour des raisons particulières, et pas seulement parce qu’elles comptent des poètes amateurs dans leurs rangs. Dans le contexte social qui rythme les usages du vers, il existe différentes temporalités propres à chaque métier et aux enjeux spécifiques qu’ils donnent à la rime. Ce livre voudrait esquisser une histoire du choix de versifier chez les professionnels retenus. ← 12 | 13 →
Le temps des métromanes
Il n’existe pas d’histoire sociale du vers français, même si les histoires et les anthologies de poésie abondent9. Or le vers est partout, et depuis toujours. Il est dans la chanson, dans l’espace public, sur les murs et les scènes de spectacle ; il décore les objets ou les tissus ; il accompagne la naissance, la mort, les amours, les compliments. Comme la chanson, le poème ne demande pas de connaissances littéraires et souvent n’ambitionne aucune légitimité. Il se borne à user d’une langue rimée ou rythmée, avec une dimension musicale non négligeable, et parfois aussi graphique (comme dans les acrostiches). Pour autant, si l’on prend en considération les poèmes publiés en langue française, une périodisation peut être esquissée.
En 1737, le dramaturge Alexis Piron fait jouer une pièce dont le titre restera célèbre : La Métromanie. Le personnage principal est Damis, le Poète, un être défini par la manie (donc la folie) de faire des vers. Cette passion transcende les réalités sociales étanches de l’Ancien Régime :
D’état, il n’en a point, il n’en aura jamais. ; C’est un homme isolé qui vit en volontaire ; Qui n’est ni Bourgeois, Abbé, Robin ni Militaire Qui va, vient, veille, sue, & se tourmentant bien, Travaille nuit & jour, & ne fait jamais rien10.
Le Poète n’est pas seul à rimer, Francaleu, le père de famille, est également « démangé » par la rime, Lucile, sa fille, est séduite par les vers qu’elle entend, et même le barbon de service se voit embarqué dans la comédie.
Pour une part, la pièce réagit contre la multiplication des pièces poétiques dans les revues littéraires (rien n’est plus faux que l’idée reçue selon laquelle le XVIIIe serait le siècle des philosophes et non des poètes). Le Mercure de France avait publié en 1729 des poésies signées Antoinette Malcrais de la Vigne, présentée comme une demoiselle bretonne. Il s’agissait d’une supercherie (l’auteur était Paul Desforges-Maillard), mais les admirateurs ne manquèrent pas, dont Voltaire lui-même. C’est pourquoi M. Francaleu, poète amateur, publie ses vers sous le nom d’emprunt de Mlle de Mériadec de Kersic. La satire porte donc sur l’amateurisme, mais aussi sur Damis, le « vrai » poète, qui défend l’idée audacieuse de dérober l’inspiration à ceux qui viendront après lui. À travers ses personnages, dont aucun n’est caricatural, Piron ← 13 | 14 → fait un tableau nuancé du goût public pour la poésie et des différentes attitudes sociales qu’il génère11.
De fait, sa pièce témoigne d’une vague de fond, déjà bien amorcée au siècle précédent, et qui ira s’amplifiant jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le monde du spectacle est un des lieux où s’observe cette montée en puissance de la versification. Sur les scènes, vers et prose sont pratiqués indifféremment dans les différents genres. La période révolutionnaire et les premières années du XIXe siècle voient se développer cette « métromanie » dans tous les secteurs de la vie sociale. On pétitionne en vers, on propose des concours académiques en vers, on manifeste des opinions, on fait de la réclame, on traite de l’actualité, on polémique en vers. La Convention nationale est envahie de pièces poétiques, certaines de pur opportunisme, chantant les exploits de la révolution au point qu’elle finit par décréter que la tribune sera réservée à la prose12. Ce mouvement se poursuit puisque les historiens notent que « les recueils de vers publiés annuellement sous la Restauration l’emportent en nombre sur les romans13 ». Au grand dam des disciples de Boileau, la versification cesse d’être une exigence stylistique mise « cent fois sur le métier » ; elle devient au contraire le vecteur rapide et efficace des idées. Le vieux Nisard, qui ne l’aimait pas, voyait dans la poésie du XVIIIe siècle « une sorte de presse anticipée14 ». La formule est heureuse, car elle lie le vers à l’actualité. Elle est plus juste que celle de Lanson pour qui « la poésie a disparu », sous l’afflux des vers et des versificateurs15.
Poésie et poétique
Comment définir cette poésie ? Certainement pas comme l’expression d’un registre lettré, même si les recoupements sont nombreux. La sensibilité poétique, on le sait bien, excède largement le fait littéraire. On peut qualifier de poétique un paysage, un film, une œuvre d’art, une manière d’être, sans référence aucune à la forme nommée poésie. À l’inverse, tous les textes en vers ne se donnent pas pour poétiques. Certains sont didactiques, religieux, savants ou philosophiques. La distinction est bien connue et c’est à elle que fait référence la première phrase du Petit Traité de poésie de Théodore de Banville : « Presque tous les traités de poésie ont été écrits aux dix-septième et dix-huitième siècles, c’est-à-dire aux époques où l’on a le plus mal connu ← 14 | 15 → et le plus mal su la poésie16. » Mais ce sont effectivement ces traités qui décrivent de la manière la plus précise l’usage de la langue qui nous intéresse ici. Il s’agit de lui imposer un rythme particulier, scandé par la rime, et comprenant un nombre régulier de syllabes. Le vers doit respecter des règles (comme celles du hiatus), et peut se ranger sous diverses formes, fixes (comme le sonnet) ou narratives. Ce cadre se défait dans le courant du XXe siècle, au profit d’une poésie libérée de la rime et du syllabisme, même si paraissent encore de nos jours de nombreux recueils de poésie classique.
La métromanie n’est donc pas morte. Sur le plan sociologique, elle est intéressante à plus d’un titre. Elle est d’abord révélatrice d’un savoir-faire et d’un goût largement partagés. Elle prend appui sur un apprentissage souvent acquis à l’école, qui mêle la mémorisation de quantité de vers avec des exercices d’application et de diction. Majoritairement nourri par les auteurs latins, mais aussi par les auteurs du XVIIe siècle, cet apprentissage forme l’oreille au rythme du vers et conduit à transposer assez aisément le modèle ancien vers les règles françaises17. Le passage d’un enseignement privé, par les précepteurs attachés aux grandes familles, à un enseignement en collèges (religieux puis républicains ou impériaux), destinés à la bourgeoisie et à une part de l’aristocratie, élargit considérablement le nombre d’élèves ainsi formés, souvent dans le vase clos des internats. Le goût des vers se propage aussi grâce aux jeux, aux éléments de conversation, de récitations et d’allusions littéraires qui font le charme de la mondanité des salons, des académies et des cénacles cultivés. Il est omniprésent au théâtre, jusqu’au tournant du XXe siècle. L’équivalent, dans les milieux populaires, ce sera la chanson, la sociabilité des ateliers et de l’usine, le compagnonnage. Par l’imprimé, grâce au développement de l’instruction élémentaire, grâce au brassage géographique et à la concentration urbaine, des ouvriers et des personnes peu instruites accèdent également à la publication de leurs vers, que favorisent par ailleurs certaines circonstances politiques.
Un petit poème publié dans le journal satirique Le Tintamarre acte à sa manière l’élargissement social du cercle des impétrants versificateurs :
Le langage des Dieux Maintenant chacun fait des vers Chacun veut pincer de la lyre ; C’est une rage, un vrai élire, Le monde a la tête à l’envers. Le tonnelier sur sa futaille, Le cuisinier à ses fourneaux, Chacun pense, chacun rimaille, Les vers rongent tous les cerveaux. ← 15 | 16 → La poésie a fait ses malles, Pour aller dans les plus bas lieux ; Bientôt le langage des Dieux Sera le langage des halles18.
Le regret antidémocratique suggère que ce poème est écrit par un individu qui préférait le temps où les dieux étaient recrutés dans les classes supérieures. Mais son constat est pertinent. C’est bien alors que surgissent d’innombrables poètes, dans les casernes comme au prétoire, en médecine ou dans les salons de coiffure. Leurs textes ont été conçus isolément, le plus souvent à l’écart d’une tradition littéraire ou discursive. Mais au-delà de la performance individuelle, résultant d’un goût particulier d’un auteur pour l’expression versifiée, une fois constitués en séries, leurs écrits prennent un sens nouveau. Ils deviennent la manifestation durable d’un désir d’expression collective, inscrite dans une forme (le vers) et une modalité d’échange (la publication). Tel est le mouvement dont il faut constater l’ampleur et la permanence. Ce livre tente de considérer la métromanie des métiers comme un fait culturel méconnu, qui mérite d’être constitué en objet et balisé historiquement et poétiquement.
1Pour le domaine scientifique, voir entre autres A. Armstrong et S. Kay, Une Muse savante ? Poésie et savoir, du Roman de la Rose jusqu’aux grands rhétoriqueurs, Paris, Garnier, 2014.
2Poésies de maître Adam Billaut, menuisier de Nevers, Nevers, J. Pinet, 1842, p. 7. Orthographe modernisée.
3Chansons de Félix Becker, Paris, Lemoine ; Beauvais, Dupont-Dion, 1829.
4J. Ponthus, À la ligne, Paris, Gallimard-Folio, 2021, p. 17 (éd. or. 2019).
5D. Ribard, « Le premier poète ouvrier », Pratiques et formes littéraires, no 16, 2019, p. 243-254.
6Voir La Liberté individuelle sous le régime de la charte-vérité, lettre adressée par Félix Becker, de la maison d’arrêt de Château-Thierry, à ses amis de l’« Union » et publiée par eux à son profit (30 novembre), Paris, 1832.
7On pourrait aussi parler d’écritures ordinaires, comme le suggère Daniel Fabre dans le recueil qu’il a dirigé (Écritures ordinaires, Paris, P.O.L.,1993), bien que son enquête anthropologique concerne principalement des textes non destinés à la publication. La contribution de Marie-Laure Le Bail (« Écrire à Riverac », p. 351-372) montre bien la diversité des pratiques d’écriture des amateurs et des amatrices.
8Nombre d’études sont consacrées aux poètes ouvriers qui sont, un peu paradoxalement, le groupe d’amateurs le mieux étudié. Il est important, je pense, d’élargir le corpus.
9À l’exception notable des réflexions éparses de F. Brunot, Histoire de la langue française des origines à 1900, Paris, A. Colin, 1905-1953, de l’ouvrage d’O. Belin, La Poésie faite par tous. Une utopie en questions, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2022 et de celui de D. Ribard, Le Menuisier de Nevers. Poésie ouvrière, fait littéraire et classes sociales (XVIIIe-XIXe siècle), Paris, CNRS éditions, 2023.
10La Métromanie, comédie. Représentée pour la premiere fois par les comédiens françois, le 10 janvier 1738, À Paris, chez la Veuve Duchesne, 1769, p. 5. En 1671, dans La Comtesse d’Escarbagnas, Molière mettait déjà en scène un vicomte et un bourgeois, M. Tibaudier, qui rivalisaient de rimes amoureuses.
11St. Loubère, « Piron, ou l’apothéose du poète qui ne fut rien », Lumen. Travaux choisis de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle, no 35, 2016, p. 1-17.
12Décrets et lois 1789-1795. Collection Baudouin, disponible sur The ARTFL Project (https://artfl-project.uchicago.edu/).
13J.-L. Chappey, C. Legoy et St. Zékian, « Poètes et poésies à l’âge des révolutions (1789-1820) », La Révolution française, no 7, 2014, § 3, mis en ligne le 31 décembre 2014. [En ligne] https://doi.org/10.4000/lrf.1179
14Précis de l’histoire de la littérature française depuis ses premiers monuments jusqu’à nos jours, Paris, Firmin-Didot, 1878, p. 255.
15G. Lanson, Histoire de la littérature française, Paris, Hachette, 1922, p. 641. En 1922, Lanson reviendra sur ses jugements négatifs, dont il reconnaît que « l’idée romantique de lyrisme les a trop inspirés » (ibid., note 1, p. 644).
16Th. de Banville, Petit Traité de poésie française, Paris, A. Le Clère, 1872, p. 1.
17La distinction des langues joue peu de rôle en raison de l’importance du latin dans l’enseignement. Sous la rubrique « Vers » de ses Éléments de littérature (1787), somme de l’esthétique littéraire du siècle, Marmontel traite ainsi indifféremment des vers latins et français.
18Ch. R., Le Tintamarre, 24 août 1845.
← 16 | 17 →
Chapitre I
L’art d’enseigner, en vers et pour tous
Si l’enseignement, depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, est principalement oral, c’est que les supports de l’écrit sont rares et chers. La tablette de cire ou d’argile, le papyrus ou le parchemin, le papier de chiffon sont peu accessibles aux écoliers et sont réservés à d’autres fins que l’apprentissage. Même lorsqu’il dispose de notes ou de livres, le maître s’exprime à voix haute, et les élèves sont censés retenir ses leçons. Le vers, qui découpe le discours en unités rythmiques, apparaît dès lors comme un exceptionnel outil de mémorisation. La transmission versifiée du savoir reste en usage jusqu’à l’apparition d’un papier bon marché. La démocratisation (relative) du public scolaire, autour de 1800, tend à augmenter la part de l’écrit. De plus, la généralisation de l’enseignement primaire à la fin du siècle bénéficiera d’outils pédagogiques autres que la récitation des formules mémorisées.
Une vaste tradition a diffusé, dans l’Empire romain, des vers couvrant à peu près tous les domaines de la vie sociale, de l’astronomie (Marcus Manilius, Astronomica, ca an 10) à la chasse (Gratius Faliscus, Cynegeticon, entre 63 av. J.-C. et 14 de notre ère). Le modèle est grec, et le plus ancien texte didactique connu est celui d’Hésiode, Les Travaux et les Jours (fin du VIIIe siècle av. J.-C.). Le mètre, et donc le rythme poétique, est commun à tous ces textes. Une part du genre est constituée par les vers rédigés par les plus grands poètes à destination d’un élève ou d’un récipiendaire prestigieux, comme Virgile qui adresse les Géorgiques à Mécène, en dehors de toute relation d’apprentissage. Les auteurs consacrés ont donné une légitimité littéraire au modèle pédagogique, lequel est aussi transposé dans le domaine de la vulgarisation ou de la connaissance scientifique comme l’indiquent les essais, dans ce domaine, de poètes aussi reconnus que Pierre de Ronsard, Maurice Scève ou Agrippa d’Aubigné au XVIe siècle1. Le vers est encore un vecteur de choix pour qui veut transmettre une opinion dans un monde régi par l’oralité, comme le sont les salons et la cour sous l’Ancien Régime. L’Art poétique de Boileau (1674) est ainsi pour une part un poème didactique, adressé non pas à ceux qui veulent apprendre à faire des vers mais à l’opinion publique mondaine, en vue de défendre, grâce à l’exemple prestigieux d’Horace, la poétique de Malherbe2.
La poésie scientifique – au double sens de poètes diffusant la science et de scientifiques s’exprimant en vers – s’est prolongée de manière ininterrompue jusqu’à la ← 17 | 18 → Révolution et connaît même encore aujourd’hui des descendants reconnus. Elle fondait sa légitimité sur trois arguments : rendre la science séduisante, faciliter sa mémorisation et lui conférer la valeur d’une expression versifiée3. Nulle rupture entre ces objectifs. Jusqu’au début du XIXe siècle, il eût semblé inconcevable d’opposer qualités littéraires et qualités scientifiques. Jacques Delille était ainsi autant un poète qui attirait les foules par ses lectures et un savant reconnu, titulaire d’une chaire de poésie latine au Collège de France. L’Homme des champs (1800) célébrait les sciences naturelles ; Les Trois Règnes de la nature (1808) était un traité de physique en huit chants, présentant successivement la lumière et le feu, l’air, l’eau, la terre, les règnes végétal et animal (en deux parties). Il était annoté par Cuvier et d’autres savants. Pour ses contemporains, Delille était le plus grand poète français. Dans une large mesure, l’idée même de faire de la poésie didactique un genre singulier, en la coupant de la poésie en général, est un geste anachronique4.
Les institutions publiques jouent également un rôle dans la permanence d’une demande sociale de réflexions en vers. Ainsi, en 1817, l’Académie française avait proposé pour sujet de son prix de poésie : « Le bonheur que procure l’étude dans toutes les situations de la vie ». Des enseignants ou des avocats envoyèrent leurs réponses, et même un jeune auteur âgé de quinze ans, qui montrait ainsi ses premières ambitions académiques. Il s’agissait de Victor Hugo5. L’inauguration d’une ligne de chemin de fer, une réception diplomatique, toutes les commémorations appelaient leur lot de cantates et de discours en vers6.
Par ailleurs, depuis le milieu du XVIIIe siècle, les sciences exigent de plus en plus de compétences spécifiques et écartent de fait ceux qui prétendent au savoir universel. La poésie des enseignants et celle des savants deviennent intéressantes précisément à l’époque et selon les modalités où elles cessent d’être une pratique effective partagée par tous, pour devenir un exercice singulier, réfléchi, ou une performance répondant à d’autres préoccupations7. Des pédagogues s’expriment dès lors en vers pour défendre leur métier ou le valoriser aux yeux des autorités, voire pour diffuser l’image de soi qu’ils souhaitent offrir à la postérité. ← 18 | 19 →
Prises de parole
Au milieu du XVIIIe siècle, François-Nicolas Guérin, professeur de rhétorique au collège Mazarin, dédie au Dauphin un discours sur la nécessité de l’instruction d’un futur grand roi. Les Muses, c’est-à-dire les pédagogues, entourent son berceau et murmurent, tentatrices :
Venez entre nos bras éprouver nos douceurs ; Nous ouvrirons vos yeux, nous formerons vos mœurs8.
Prolongeant la tradition du discours en vers adressé par un pédagogue à ses élèves royaux, nombre d’enseignants ont publié leurs performances versifiées. Formés sous l’Ancien Régime, pour les premiers d’entre eux, et travaillant dans un monde voué à la répétition plutôt qu’à l’innovation, ils saisissent tous les prétextes de la vie scolaire pour déclamer. Leurs discours en vers sont prononcés lors des rentrées académiques, des distributions de prix, des commémorations de la Saint-Charlemagne. Il serait fastidieux de citer tous ces discours, en raison de leur manque d’originalité. Ils semblent appeler sur eux la malédiction lancée par Victor Hugo dans Les Contemplations :
Marchands de grec, marchands de latin, cuistres, dogues, Philistins, magisters, je vous hais, pédagogues ! Car dans votre aplomb grave, infaillible, hébété, Vous niez l’idéal, la grâce et la beauté !
Pourtant, certains témoignent d’une ambition qui les écarte du lot commun. C’est le cas de Michel Boyer, ancien professeur de rhétorique au collège du Mans. En publiant les deux volumes de son poème L’Éducation (plus de 800 pages), il prétend rendre compte de la vie d’un enseignant sous tous les aspects. Il réunit des récits pédagogiques, des cantiques, des chants destinés aux distributions des prix, des portraits (de l’élève vicieux ou du bon bibliothécaire), des comparaisons entre l’instituteur et le jardinier, et même des pièces en latin et en français composées par ses anciens élèves. Sur un plan plus personnel, il rime toutes les circonstances de sa vie, le décès de son épouse, une pièce présentée à la distribution des prix ; il chante le matin, dénonce la médiocrité des élèves et surtout il clame sa foi dans la mission sociale de l’éducateur9.
On peut avoir une pensée émue pour les générations d’élèves obligés de subir ces discours complaisants. Pensons à ceux à qui s’adressait Magloire Nayral, juge de paix et membre du conseil d’administration du collège de Castres, lors d’une rentrée scolaire : ← 19 | 20 →
De vous parler en vers si je prends la licence Vous voudrez m’excuser. Ce langage si doux Qui plaît tant à mon cœur a des attraits pour vous. « Maudit soit le premier dont la verve insensée Dans les bornes d’un vers enferma sa pensée » A dit un auteur ; mais pour vous et pour moi Un bon mot serait-il un article de foi ? Laissons donc pérorer ces écrivains sans âme, Que n’embrasa jamais la poétique flamme ; Tant que des habitants peupleront l’univers, Partout avec bonheur on entendra des vers10.
Dans cette perspective, le vers a pour fonction de renforcer le lien communautaire : enseignant et enseignés sont censés communier dans les mêmes valeurs dont le poème est à la fois le moteur et le prétexte. Les jeunes filles et leurs mères ont droit à une confession moins orgueilleuse de la part de l’enseignant d’une école privée, en raison de leur sexe :
Mon bagage est moins lourd ; je ne marche escorté D’aucun des Immortels, fils de l’Antiquité. Pour adoucir les sons de ma voix indiscrète, Je porte seulement la lyre du poète ; J’essaierai, sans orgueil, d’en tirer des accords : Puisse votre indulgence accueillir mes efforts11 !
Alfred de Wailly avait plus d’esprit. Au banquet annuel des anciens élèves du lycée Napoléon et du collège Henri IV, le 26 décembre 1857, il évoque le souvenir de tous ceux qui ont fréquenté l’établissement. Ses vers sont formés uniquement par les noms propres des élèves, organisés en micro-séries, parfois ironiques lorsque s’accumulent les noms d’animaux (Poisson, Dulac…) ou les allusions culinaires (Sallé, Poivre, Gingembre), parfois respectueuses dans l’évocation des maréchaux du Premier Empire. La performance mérite une longue citation.
Enfin, quoi qu’on ait fait, que l’on s’appelle ici Casabianca, Dumon, hélas ! Abbatucci, Haussmann ou Pastoret, Larabit, Liadières, Barrot, Tonnet, Chandru, Guérin, Lamartinière, ← 20 | 21 → Dessalles, Mahérault, Sallenave, Baltard, Cauchy, Marc-Girardin, Laya, Royer-Collard, Ampère, Arrighi, Jars, Cambacérès, Lagrande, De Lyonne, d’Oullembourg, Gudin, Renson, Lostange, Ambert, Montfort, Perrot, Servatius, Roguet, Parseval ou Dubloc, Dobignie ou Joguet, Villemeureux, Bary, Gibon, Gréban, Fourcade, Zheindre, Achille Dufaud, L’Heure, Ajax Camiade, Fournier, Delort, Guilhem, Lanjuinet, Chasseloup, Labensky, Wollowsky, Heurteloup, Horteloup, Rochemur, Montguyon, Reille, Pillet, Amette, Maison, Duclos, Duparc, Despretz, Deschamps, Lherbette, Domergue, Ducouëdic, Millen, d’Etchégoyen, Walkenaër, Hassenfratz, Worms, Paff, Van der Straten, Dejussieu, Petit-Jean, Robin, Sermet, Bréville, De Guise, Édan, Jubé, d’Anthouard, Gassonville, Mongenot, Ventenat, Vial, Andral, Jubinal, Gaujal, Peytal, Gleizal, d’Eitchtall ou Cucheval, De Pontois, Thouvenel, Mornay, Bresson, de Sparre, Gobert, Gaillard, Vatout, Patin, Drut, Delabarre, Barbier, Pontier, Rougier, Dangeny, Démery, Nivenheim, Merckheneim, Ploucauld, Bouton, Henry, Périn, Méchin, Chauvin, Sallé, Poivre, Gingembre, Roux, Brun, Blanc, Gros, Legras, Lecourt, Lelong, Lenoir, Lion, Lecerf, Levraud, Lechat, Loyseau, Leloir, Lapie ou Rossignol, Merlet, Leduc, Caboche, Poisson, Dulac, Dufour, Dutaillis, Delaroche, Desportes, Lecamus, Jouanne, de Chaveau, Couturier, Marcilly, Manceaux, Geoffroy-Château, Saint-Hilaire Geoffroy, car il n’importe guère Que Geoffroy soit devant ou Geoffroy soit derrière, Et ce couple de noms dans l’univers cité, Ira, l’un portant l’autre, à la postérité ; Pour distinguer le fils de son auguste père, Ajoutons Isidore, et les deux font la paire ; Dareste, Ducellier, Cuvier, Jallon, Gilbert, Lenormand, Chegaray, Saint-Elme, Ouvrard, Colbert, Villette, Devilliers, Marion, de Chazelles, ← 21 | 22 → De Lavenay, Valade, Étienne, Ardant, Corcelle, Aguado, Bibesko, Morio, Viale Rigo, Voizot, Soufflot, Frochot, Travot, Mocenigo, Defauconpret, Chamblain, Forcade la Roquette, Deroullède, Picard, Cazalès, de Valette Fénelon, Thanaron, Godoy, Santa-Crux, […] Rémusat, Fain, Jaÿr, Lesourd, Montalivet, Ekmühl, Montebello, Soult, Essling, Ney, Bellune, Qu’on ait toujours gaîment de la blonde à la brune, Du Champagne au Médoc passé comme Romieu, Été, comme Enfantin, un père, un pape, un dieu, Aussi républicain que Guinard et Bastide, Vieux Romains, parmi nous laissant leur place vide, Si quelqu’un a marché camarade en nos rangs, Troué son pantalon aux clous des mêmes bancs, S’il a mouillé sa lèvre à la commune coupe, Mort, vif, absent, présent, on boit à lui… fût-il Sur le trône à Madrid, à Londres dans l’exil ! Oui, vainqueurs et vaincus, trinquons… sans politique12 !
Certains professeurs ont été de véritables spécialistes de ce genre, réitérant complaisamment chaque l’année l’exploit d’un long discours versifié prononcé devant un public qui changeait peu. Ce fut le cas de Victor Edan, licencié ès lettres, principal du collège de Roye, qui distribua les prix des années 1839 à 1842, ou de Victor Bétolaud, prestigieux professeur de grec qui prononce les discours en vers aux banquets des anciens élèves de Louis-le-Grand entre 1849 et 1859.
Parmi les discoureurs, l’histoire a retenu le nom d’Édouard Chanal, professeur de rhétorique qui compta Arthur Rimbaud au nombre de ses élèves. Il oppose la moquerie à la gaieté gauloise, gage d’une France de bonne humeur, et résistant encore et toujours aux envahisseurs. Ce personnage sorti d’Astérix proférait des conseils en vers comme « Le respect du prochain sied bien aux jeunes gens », un précepte dont l’efficacité pédagogique semble discutable13. À Sens, le professeur de rhétorique s’adresse aux élèves qui vont quitter le lycée. Il leur conseille de relire les vers qu’ont aimés leurs aïeux car : ← 22 | 23 →
Une tradition dirige notre essor, Et nous chérissons tous sa prudence éclairée : Nous sommes les enfants de la France lettrée, Et nous voulons garder son suprême trésor14.
De fait, la tradition se maintient jusqu’au début du siècle suivant. Un certain Jean-Marie qui enseigne à Nîmes fait l’éloge de Dieu, de l’ordre et de l’amour, ces trois piliers d’une pédagogie bien pensée. Il prétend faire œuvre originale en chantant la pédagogie, puisque « La France a tout chanté : son sein fécond de mère / Nous germe, tous les ans, quelque nouveau trouvère15 ».
La vie scolaire suscite aussi la publication de toute une série de recueils poétiques tels que Rêves et Devoirs de Théodore Froment16. L’enseignant confie à ses élèves qu’il a le goût des vers :
Tel est le pouvoir de la muse, Par elle en vous tout me sourit ; Votre légèreté m’amuse, Votre paresse je l’excuse, Votre sagesse me ravit17.
L’exercice lui fait oublier les aléas du métier ; il lui redonne confiance : « Moi, dans la chaire étroite où sans bruit je professe / Je travaille pour l’avenir » (ibid., p. 30). Et pourtant, il regrette de ne plus enseigner la rhétorique traditionnelle et de « ne plus chercher dans Virgile que le spondée ou le dactyle » (ibid., p. 33).
Souvent complaisants, parfois mélancoliques, ces poèmes sont avant tout destinés à afficher une compétence professionnelle. Les auteurs font étalage du savoir-faire qu’ils sont censés transmettre aux élèves. La vocation poétique est rarement présente et, quand elle transparaît, comme chez Froment, c’est avec une grande pudeur. Certains auteurs se servent du vers pour défendre qui une manière d’enseigner, qui une orientation idéologique. Un certain B. Drouin promeut ainsi en vers la lecture à voix haute, selon lui déjà menacée :
N’est-ce pas démontrer à quel point l’art d’écrire Est resté redevable à celui de bien lire ? Quand l’un reçoit de l’autre un service aussi grand, Tous deux, dans l’art d’instruire, ont droit au même rang18. ← 23 | 24 →
Non dépourvu d’ambition, il souhaite que son livre soit offert comme cadeau d’étrennes et que « [c]hacun conçoive le désir de l’apprendre par cœur19 ! » À l’inverse, plus modeste et plus réaliste, G. Géant, maître adjoint à l’école normale de Troyes, se borne à célébrer la pédagogie elle-même, « cet art miraculeux », en des rimes censées traduire la compétence d’un enseignant catholique sous le cabinet de Jules Ferry. Son ouvrage « peut solliciter l’attention de plusieurs en faveur de cette science de l’éducation, plus prônée encore que bien connue ; il peut sembler, aux yeux des humbles qui s’en occupent, l’ennoblir et en résumer assez bien les principes généraux ; il peut, enfin, contribuer à rapprocher les deux partis qui se disputent, en France, l’éducation de la jeunesse, ou, à défaut de ce résultat si désirable, mais si difficile et si éloigné encore, prouver qu’on peut être à la fois universitaire et catholique, laïque et religieux, et que nos écoles normales ne forment pas des athées20 ». L’argument, ici, est évidemment politique. Mais il tend également à mettre en valeur le rôle de passeur des enseignants formés dans les collèges catholiques, dont la compétence en matière de versification a de prestigieux modèles.
Un seul texte me paraît transcender les limites du genre. Il s’agit du grand poème satirique Les Régents de collège de Louis-Dionys Ordinaire. Brillant élève, professeur de rhétorique à Amiens, puis rédacteur de La Petite République et homme politique républicain, l’homme publie en 1879 un recueil de ses textes rimés écrits entre 1851 et 1860, au moment où il enseignait21. Il s’agit d’un portrait au vitriol du professeur de lettres, dans lequel l’auteur a certainement mis une part de lui-même, mais surtout de ses chers collègues. On voit d’abord la naissance d’une vocation. Peu gâté par la nature, le futur enseignant est marqué du sceau de la vocation originelle :
Je sortis professeur du ventre de ma mère. À l’âge où l’enfant pleure en demandant du pain, Je demandais du grec. Chaque matin mon père Me donnait à manger une page d’Homère. Tous les voisins lisaient dans mes regards naïfs L’amour de l’analyse et des temps primitifs. J’étais déjà si laid que mon jeune visage Faisait sauver de peur les enfants de mon âge, La nature déjà sur mes traits enfantins Élevait des rochers et creusait des ravins. Mes sourcils, allongés en accent circonflexe, Ombrageaient le dessus de ma face convexe. ← 24 | 25 → Mon nez cicéronien, sec comme un os jauni, Surplombait mon menton comme un point sur un i. Le thème grec dormait dans mon œil terne et louche, Et d’affreux vers latins me sortaient de la bouche22.
Il met ensuite en doute la nature même de son enseignement et son efficacité :
Quand je vins, surchargé de mes lauriers de Thème, À Saint-Jean-Pied-de-Port régenter la sixième, De grec et de latin bourré comme un canon, J’éclatai, je remplis la ville de mon nom. Lhomond, par la terreur, régna dans mon école. Ô de l’enseignement saintes émotions ! J’ai dompté, j’ai pétri comme la cire molle Dans ma main de régent vingt générations. Vingt ans, des Béarnais j’ai tiré les oreilles. Enfin Dieu fit fleurir et prospérer mes veilles, Et j’eus des écoliers, immobiles, muets, Tristes, effarouchés, comme je les voulais. La plupart, je l’avoue, à l’ombre de ma chaire, Devenaient idiots, mais savaient leur grammaire. (Ibid., p. 62)
Découragé par des exigences contradictoires, dégoûté par l’Administration, il donne ensuite la parole à l’élève dont les mots sont sans pitié :
Mon maître, croyez-moi, votre industrie est morte. Le règne des régents touche à son dernier jour, Les dieux s’en vont. Le vent qui souffle des fabriques A desséché la fleur des études antiques. Notre siècle autre part a porté ses amours. Sur le marché français vos effets n’ont plus cours. (Ibid., p. 69)
La rupture entre les humanités anciennes défendues par la profession et les études modernes exigées par le progrès industriel sonne le glas de la compétence de versificateur de l’enseignant de rhétorique dans le temps même où elle met en doute sa discipline. ← 25 | 26 → Louis-Dionys Ordinaire a su proposer ce constat dans des vers bien construits, fruit de son savoir ancien, et marqués par l’ironie de celui qui a pu quitter le métier. Son texte s’éloigne de la déploration naïve ou du discours rhétorique parce qu’il adopte résolument le genre du poème satirique légitimé par la tradition latine (Juvénal, Horace).
La fabrique du poème national
Si le monde de l’enseignement se transforme rapidement tout au long du XIXe siècle, il demeure des matières dont la mémorisation reste, de l’avis général, une nécessité absolue. Ce sont celles sur lesquelles repose le récit collectif. Chaque petit Français est censé maîtriser l’espace de son pays (les fleuves, les villes, le paysage) et les principales séquences de son histoire, hommes célèbres et rois inclus. La géographie et l’histoire sont donc les grandes pourvoyeuses de manuels de mémorisation en vers. Le Catalogue de l’histoire de France que Jules Taschereau publie par ordre de l’Empereur de 1855 à 1885, en 9 volumes (et 9 autres de tables et suppléments), forme la base du classement thématique des collections de la Bibliothèque impériale puis nationale. La catégorie de l’« Histoire de France en vers » bénéficie ainsi d’une cote particulière (L40 notamment) ; il en va de même pour les géographies versifiées (L11). La fabrique du poème national est donc chose connue et reconnue.
Ici encore, l’ombre portée de modèles prestigieux donne une certaine noblesse à l’entreprise. Les chroniques médiévales des rois de France étaient parfois en vers (comme la Chronique métrique de Godefroy de Paris en 1313). Jean Froissart inaugure ses Chroniques en expliquant que, « issu de l’école », il avait dicté une première histoire des guerres royales en vers, avant de passer à la prose pour que son récit soit « ordonné si justement que telle chose le requiert23 ». À l’inverse, on doit au juriste normand Godard de Bérigny un Abrégé de l’histoire de France (1679) qui ambitionne d’écrire en vers l’épopée de la monarchie française : « Je vais sur les débris de l’Empire romain, / Élever hautement le trône de la France24. » Roi après roi, dynastie après dynastie, chacun a droit à quelques pages de cette épopée indigeste, qui en compte 422. Le didactisme n’y est pas absent, mais il est encore discret. Ce ne sera plus le cas avec la tentative d’Augustin Alletz, oratorien puis avocat et littérateur de Montpellier. Pour lui, il s’agit de renouveler l’approche pédagogique parce que la méthode usuelle « par dialogues » avec questions et réponses ne stimule pas la mémoire. Il se méfie également des vers « artificiels ou techniques » ; ceux-ci sont généralement hachés, coupés, le style y étant seulement ajusté à un contenu donné : « […] ces vers étant nécessairement d’une dureté extrême à la prononciation et à l’oreille, ont été d’une très grande difficulté à être appris par cœur ». Il s’efforce donc d’inventer un langage plus naturel : « On s’est servi ← 26 | 27 → d’un langage ordinaire, qui tient néanmoins quelque chose de la Poésie et de la Prose », dans la pratique, ce sont des vers relativement fluides dépourvus de termes techniques. La fin du règne de Louis XIV, sur laquelle s’achève le livre, en donne une idée :
Louis sut soutenir d’une âme peu commune Sur l’État et sur les siens les coups de la fortune. Il acheva son règne en adorant les Lois, Et la main du Très-Haut qui dispose des Rois25.