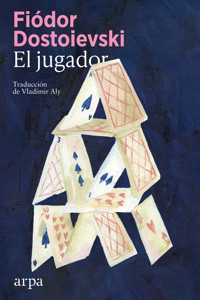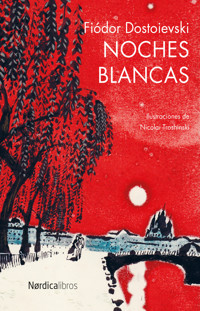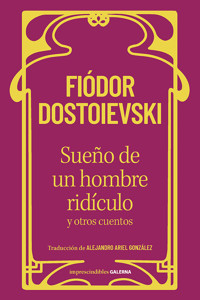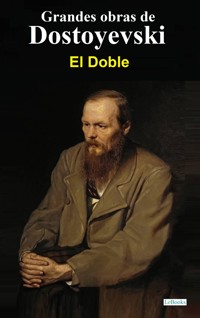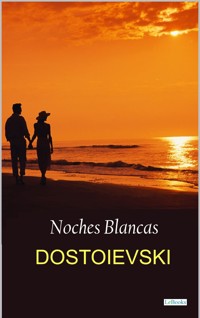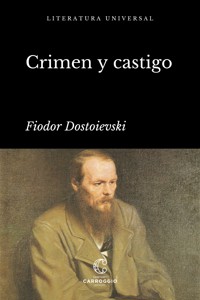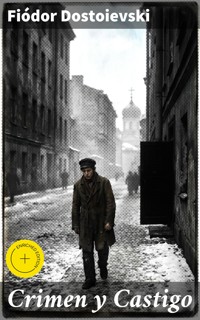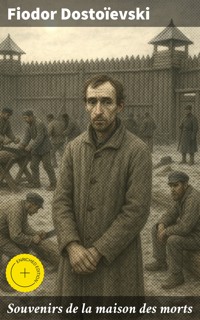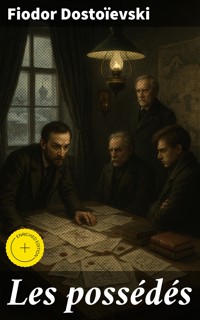
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Dans 'Les Possédés', également connu sous le titre 'Démons', Fiodor Dostoïevski explore les tourments psychologiques et les conflits moraux des personnages qui naviguent dans un paysage politique et social en pleine mutation. Ce roman, publié en 1872, est marqué par un style complexe et captivant qui mêle dialogues incisifs et réflexions profondes, tout en évoquant les tensions entre nihilisme et foi dans la Russie post-tsariste. L'œuvre aborde des thématiques telles que le pouvoir de l'idéologie, la manipulation des masses et la question de la responsabilité personnelle, révélant ainsi une compréhension aiguë des maux de la société moderne et des âmes humaines. Fiodor Dostoïevski, écrivain russe emblématique du XIXe siècle, a été influencé par ses propres luttes existentielles et son expérience de la répression politique. Marqué par son emprisonnement en Sibérie et son intérêt pour les philosophies divergentes, Dostoïevski a envisagé 'Les Possédés' comme un moyen d'analyser la montée des idées radicales à titre de mise en garde contre les dérives potentielles d'une société en proie à des idéologies destructrices. Recommandé pour ceux qui s'intéressent à la psychologie humaine et aux implications sociopolitiques, 'Les Possédés' est un incontournable de la littérature classique. Le lecteur découvrira un fascinant tableau de la condition humaine, enrichissant sa compréhension des défis universels liés à l'existence, à la liberté et à la moralité. Dans cette édition enrichie, nous avons soigneusement créé une valeur ajoutée pour votre expérience de lecture : - Une Introduction succincte situe l'attrait intemporel de l'œuvre et en expose les thèmes. - Le Synopsis présente l'intrigue centrale, en soulignant les développements clés sans révéler les rebondissements critiques. - Un Contexte historique détaillé vous plonge dans les événements et les influences de l'époque qui ont façonné l'écriture. - Une Biographie de l'auteur met en lumière les étapes marquantes de sa vie, éclairant les réflexions personnelles derrière le texte. - Une Analyse approfondie examine symboles, motifs et arcs des personnages afin de révéler les significations sous-jacentes. - Des questions de réflexion vous invitent à vous engager personnellement dans les messages de l'œuvre, en les reliant à la vie moderne. - Des Citations mémorables soigneusement sélectionnées soulignent des moments de pure virtuosité littéraire. - Des notes de bas de page interactives clarifient les références inhabituelles, les allusions historiques et les expressions archaïques pour une lecture plus aisée et mieux informée.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Les possédés
Table des matières
Introduction
Une étincelle invisible peut embraser une cité avant que quiconque ne remarque la fumée. Dans Les possédés, Dostoïevski observe la propagation d’idées extrêmes comme on suivrait un feu souterrain, gagnant les maisons, les consciences, les institutions. Ni chronique policière ni traité politique, ce roman scrute la vitesse avec laquelle le vide spirituel s’empare d’une communauté lorsqu’un langage de fer s’installe. Ce qui s’annonce n’est pas simplement désordre, mais une crise de sens où la logique de l’absolu défait la trame fragile des liens humains. Ici, l’imaginaire, la morale et la vie civique entrent en collision frontale.
Considéré comme un classique, l’ouvrage doit ce statut autant à son ambition formelle qu’à sa lucidité. Il conjugue le roman d’idées à la farce noire, la satire sociale au drame métaphysique, imposant une architecture où chaque scène fait vibrer des registres contraires. La profondeur psychologique, la polyphonie des voix et la tension éthique y atteignent une intensité rare. En dévoilant la grammaire intime de l’endoctrinement, il a nourri des générations de lecteurs et d’artistes. On y revient pour sa puissance d’alerte, pour son humour féroce, et pour la manière dont il transforme une crise locale en allégorie durable.
Fiodor Dostoïevski, romancier russe du XIXe siècle, compose Les possédés au tournant des années 1870, après des œuvres qui l’ont placé au premier rang de la littérature européenne. Le texte paraît d’abord en feuilleton en 1871-1872 dans Le Messager russe, avant d’être publié en volume. Cette genèse inscrit le roman dans un moment d’intenses débats intellectuels en Russie impériale, où se croisent aspirations réformatrices, inquiétudes morales et secousses politiques. Dostoïevski, qui avait déjà exploré la culpabilité et la grâce, y déplace le regard vers la contagion des idées collectives et la responsabilité du langage dans la fabrication des événements.
Un fait divers marquant sert de tremplin à la fiction: l’affaire Netchaïev de 1869, révélant un noyau révolutionnaire prêt à tout au nom d’une cause. Dostoïevski ne se contente pas d’en reprendre les contours; il élargit la perspective pour interroger la dynamique d’un groupe, la séduction d’un programme simplificateur et l’effondrement graduel des inhibitions. Cette transposition n’a rien d’un reportage. Elle vise à comprendre comment des individus ordinaires, dans une ville ordinaire, peuvent se trouver déportés vers l’extrême par une combinaison d’orgueil, de ressentiment et de vide, quand le débat se fige en slogans et en mots d’ordre.
Le cadre est une ville de province, avec ses salons, ses administrations et ses rivalités locales. Un aristocrate au charisme énigmatique revient y prendre place, tandis qu’un agitateur persuasif fédère des jeunes gens avides d’influence. Rumeurs, pamphlets et rendez-vous clandestins créent un climat d’électricité morale. L’idée d’un bouleversement imminent circule plus vite que les faits, et la peur s’allie à la fascination. Le roman s’ouvre ainsi sur une mise en place où se déploient curiosité mondaine, ambitions mesquines et impatience messianique, sans révéler ce que ces forces contraires produiront, mais en laissant sentir leur charge explosive.
Ce qui distingue l’ouvrage, c’est la diversité des procédés narratifs. Un témoin interne, impliqué sans être omniscient, relate les faits tout en dévoilant ses limites, ce qui introduit d’emblée le doute et l’ironie. Dostoïevski juxtapose scènes de comédie sociale et accès de gravité, multipliant les chœurs, les apartés et les monologues intérieurs. Le texte respire par sa polyphonie: plusieurs consciences se heurtent, se démentent, s’imitent, jusqu’à produire un bourdonnement d’époque. Cette orchestration confère au roman sa vigueur dramatique et sa précision analytique, en montrant comment une idée se propage par la voix, la rumeur et la performance publique.
Les thèmes majeurs se nouent autour du nihilisme, de la responsabilité morale et du vertige de la liberté. Le roman sonde la tentation de l’absolu lorsqu’une société perd ses repères et voit dans la destruction un remède. Il explore l’orgueil blessé, la soif d’importance, le désir de pureté et l’attrait des systèmes totalisants. Il réfléchit à la puissance et au mensonge du langage politique, à la fragilité de la foi personnelle, à l’exigence de vérité qui, mal dirigée, devient cruauté. La possession du titre désigne autant des êtres que des idées qui possèdent, et qui exigent leur dû.
Ce sont des personnages aux prises avec leurs vides intérieurs qui donnent chair à ces questions. Dostoïevski excelle à montrer comment l’incohérence intime peut chercher refuge dans une doctrine prête à l’emploi. La honte, la jalousie, la rancune et la fascination pour la force se combinent, offrant à l’idéologie une porte d’entrée. La comédie des salons et l’effervescence étudiante deviennent des laboratoires d’expériences morales. Derrière la grimace du grotesque, on perçoit un théâtre de consciences où la responsabilité se dérobe. L’ensemble compose une radiographie des vulnérabilités sur lesquelles prospèrent les entreprises de captation mentale et d’organisation de l’adhésion.
Son influence dépasse la Russie du XIXe siècle. Des écrivains majeurs du XXe siècle ont reconnu l’acuité de ce diagnostic et l’ampleur de sa forme. L’œuvre a nourri le roman politique et le roman d’idées, tout en inspirant de nombreuses mises en scène théâtrales. Albert Camus en a proposé une adaptation, signe de la vitalité scénique du matériau. L’insistance sur les mécanismes de groupe, sur l’attrait de la violence purificatrice et sur les impasses de la rationalisation idéologique a irrigué la réflexion européenne, rendant ce livre incontournable pour comprendre la modernité et ses tentations de simplification radicale.
Classique, Les possédés l’est aussi par la densité de sa construction romanesque. L’entrelacs des intrigues locales avec les lignes de force historiques confère au récit une puissance de fable sans le réduire à une thèse. Sa réception a été marquée par des lectures variées, parfois opposées, signe d’une œuvre ouverte, résistant aux usages partisans. Les débats qu’elle suscite depuis sa parution attestent sa capacité à interroger chaque époque, sans perdre son ancrage concret. C’est cette combinaison de précision sociologique, d’invention dramatique et de profondeur spirituelle qui explique pourquoi le livre demeure un repère dans le canon romanesque.
Lire ce roman, c’est accepter un mouvement en spirale: des scènes apparemment anecdotiques prennent sens au contact d’autres, des paroles mineures se révèlent décisives. L’humour, souvent cruel, soutient la gravité des enjeux et évite l’emphase; la caricature même devient outil cognitif. La prose, nerveuse, met en scène la performativité des discours, leur musique et leurs désastres. Rien n’est donné d’avance: l’auteur laisse le lecteur mesurer par lui-même les glissements, les dénégations, les fractures d’âme. Cette éthique de la complexité fait de l’œuvre un espace d’apprentissage du discernement, où l’intelligence narrative répond à l’urgence morale.
À l’heure où prolifèrent radicalisations rapides, bulles informationnelles et séductions simplificatrices, Les possédés conserve une saisissante pertinence. Il rappelle que les crises idéologiques sont aussi des crises de langage et d’imaginaire, et que la politique commence par des gestes de parole. En dévoilant les rouages de la contagion et les ressorts du vide, le livre aide à penser le présent sans slogan. Il en ressort une leçon sobre: comprendre avant de juger, décrire avant de condamner. C’est pourquoi ce roman, né d’un moment précis, parle encore à notre temps, et promet au lecteur une vigilance qui ne se démode pas.
Synopsis
Roman de Fiodor Dostoïevski publié en 1871-1872, Les Possédés se déroule dans une ville de province russe et examine la montée d’un radicalisme politique et moral. Composé dans le sillage des convulsions idéologiques des années 1860, l’ouvrage explore comment une communauté apparemment tranquille se dérègle sous l’effet d’idées importées et de passions locales. À travers un récit à la première personne, il associe chronique sociale, analyse psychologique et réflexion politique. Le cadre resserré permet d’observer la propagation d’une agitation qui touche notables, intellectuels, fonctionnaires et jeunes gens, et interroge la responsabilité des individus face aux doctrines qu’ils professent ou subissent.
Le narrateur, proche de l’intellectuel Stepan Trofimovitch Verkhovenski, introduit la société provinciale: salons, amitiés, rivalités et ambitieux petits projets. Stepan, vieil idéaliste dépendant de la protection de Varvara Petrovna, joue le rôle d’ornement libéral, adulé pour son brillant passé supposé. Le récit s’attarde sur le rythme figé de la ville, ses fêtes, ses rumeurs, ses hiérarchies, où chacun cherche une place et un auditoire. L’arrivée de nouvelles figures, annoncée par des lettres et des indiscrétions, promet de reconfigurer ces équilibres. Dans ce décor, l’idéalisme rhétorique de Stepan côtoie déjà une impatience plus sombre qui gagne la jeune génération.
Le retour de Nikolaï Stavroguine, jeune aristocrate au charme impérieux, agit comme un choc. Figure énigmatique, à la fois séduisante et inquiétante, il subjugue par son flegme, son audace et une réputation troublée venue de la capitale. Les notables et les jeunes hommes projettent sur lui leurs espoirs et leurs peurs; les femmes y lisent une promesse de destin. Sa politesse distante, ses gestes imprévisibles et un passé semé d’épisodes controversés nourrissent les conversations. Sa présence silencieuse, plus que ses discours, déplace les lignes: autour de lui, fidélités et inimitiés se redessinent, tandis que l’ancienne sociabilité provinciale se tend et s’opacifie.
Pyotr Verkhovenski, fils de Stepan, arrive à son tour et catalyse une énergie plus résolue. Organisateur retors, il rassemble une petite société clandestine où se mêlent rêve de justice, ressentiment et goût du complot. Sa méthode s’appuie sur des liens d’obéissance, de secret et de culpabilité partagée, afin de souder le groupe et neutraliser les hésitations. L’ébauche d’un programme extrême, attribué à l’un des membres, pousse la logique égalitaire jusqu’à la surveillance universelle. Pyotr, habile à flatter et menacer, ne cherche pas tant une réforme qu’un instrument de domination, transformant le débat en mécanique de discipline, de chantage et d’actions symboliques.
Au cœur du roman, les controverses idéologiques se doublent de tourments spirituels. Chato v lutte avec la question de la foi, de la nation et de la responsabilité personnelle, après s’être détourné d’un radicalisme qu’il avait pourtant côtoyé. Kirillov, ingénieur obsédé par l’idée d’une liberté absolue, pousse la spéculation philosophique vers une frontière vertigineuse. Stepan, épuisé par les slogans, voit vaciller ses certitudes généreuses, tandis que Stavroguine, muet et fuyant, devient l’écran sur lequel chacun projette sa doctrine. De ces tensions naît une interrogation centrale: qu’advient-il des personnes quand les théories, au lieu d’éclairer la vie, prétendent s’y substituer?
La cité, d’abord amusée par les excentricités des uns et des autres, est bientôt entraînée dans une comédie publique qui tourne au désordre. Une fête officielle, conçue pour redorer l’image des autorités, expose au grand jour l’inanité des poses culturelles et la fragilité des hiérarchies locales. Pamphlets anonymes, caricatures et insinuations circulent, excitant jalousies et ressentiments. Les malentendus s’additionnent, les rivalités s’exacerbent, et le ridicule ouvre la porte au scandale. La vanité des élites se heurte à l’impatience de ceux qui veulent tout renverser, tandis que l’administration, prise entre déni et maladresse, perd le contrôle du récit public.
Sous l’impulsion de Pyotr, la petite cellule passe du discours à l’épreuve des actes, cherchant à lier ses membres par des compromissions irréversibles. Des provocations éclatent, destinées à semer la panique, discréditer les autorités et annoncer une prétendue force souterraine. La rumeur d’un complot plus vaste grandit, multipliant les peurs. Des violences ponctuelles — un incendie, une agression — troublent la ville et brouillent les responsabilités. Le climat, désormais crispé, isole les individus, rompt les solidarités et radicalise les hésitants. La ligne entre conviction politique et emprise personnelle se dissout dans une succession de gestes calculés.
Parallèlement, les intrigues privées prennent un relief tragique. Varvara Petrovna, Daria, Liza et la famille Lébiadkine se trouvent pris dans un réseau de dépendances morales et matérielles où l’honneur, la charité et l’intérêt s’entremêlent. Des confidences tardives et des dettes anciennes pèsent sur les choix présents. Les relations de Stavroguine, son passé comme ses promesses tacites, alimentent des attentes contradictoires qui se heurtent aux ambitions des conspirateurs. Le roman observe comment la détresse intime et l’idéologie collective s’exaspèrent mutuellement, transformant les erreurs ordinaires en engrenages irréparables, sans trancher d’emblée sur la culpabilité ultime des protagonistes.
Les Possédés dessine une critique des doctrines totalisantes, qui exploitent les frustrations et réduisent la personne à un rouage. Dostoïevski montre comment la fascination pour la rupture, la quête d’un ordre absolu et la peur du vide moral peuvent engendrer un fanatisme mimétique. Le livre interroge l’Europe des idées importées et la Russie des croyances hésitantes, mais refuse le simple pamphlet: il donne voix au besoin de justice, à l’angoisse métaphysique et au désir d’appartenance. Par sa peinture du charisme, de la manipulation et de la responsabilité, l’œuvre conserve une portée durable, au-delà de son contexte historique, sans requérir une morale explicite.
Contexte historique
Les possédés s’inscrit dans la Russie des années 1860 à début 1870, sous le règne d’Alexandre II. Le décor implicite est une ville de province, microcosme d’un empire encore autocratique mais traversé par des réformes et des tensions. L’orthodoxie, la noblesse locale, la bureaucratie et la gendarmerie structurent la vie publique. Les institutions traditionnelles coexistent avec des nouveautés comme les zemstvos et des organes de presse plus influents. Cette articulation de l’ancien et du réformé nourrit le roman, où les salons provinciaux, les autorités locales et de petits cercles intellectuels deviennent la scène d’une confrontation idéologique reflétant de plus vastes transformations de l’État et de la société russes.
La monarchie impériale demeure le cadre politique central, avec une police politique héritée de la Troisième Section et un appareil administratif étendu. Cependant, l’époque est marquée par un effort de rationalisation juridique et de modernisation. Cette contradiction entre autoritarisme et réforme produit une atmosphère de transition souvent anxiogène, que Dostoïevski transpose dans les relations entre notables, fonctionnaires, police et jeunes radicaux. Les procédures, la surveillance et les rivalités de compétences accroissent la confusion. Le roman s’empare de ce déséquilibre systémique pour montrer comment, dans une province en apparence calme, la verticalité du pouvoir et ses failles ouvrent des interstices où s’épanouissent intrigues, manoeuvres et expérimentations idéologiques.
L’émancipation des serfs promulguée en 1861 bouleverse les hiérarchies sociales et économiques. Les propriétaires fonciers perdent main-d’œuvre et prestige, tandis que les communautés paysannes obtiennent des droits, au prix de paiements de rachat et de conflits locaux. Cette redistribution imparfaite engendre tensions, mobilité accrue et incertitudes. Dans le roman, la fragilisation de la noblesse provinciale, l’errance de certains personnages et la montée d’intermédiaires bavards ou ambitieux reflètent ces déplacements de pouvoir. La sensibilité de Dostoïevski aux fractures post-émancipation éclaire la fragilité d’un tissu social où l’ancien paternalisme vacille et où des jeunes idéologues prétendent combler le vide par des projets tranchés.
Les réformes locales de 1864 instaurent les zemstvos, assemblées de district et de province chargées d’infrastructures, d’instruction et de santé. Elles encouragent l’engagement de notables et de professionnels, tout en suscitant rivalités et débats idéologiques. La ville de province décrite par Dostoïevski, avec ses réunions, ses charités, ses ambitions de modernisation et ses luttes d’influence, réfracte cet univers naissant de gouvernance locale. Les zemstvos, l’urbanisme en expansion et la nouvelle sociabilité civique offrent aux polémistes et aux activistes un terrain pour se montrer, intriguer, publier et recruter. Le roman met en scène cette petite agora où se mêlent philanthropie sincère, vanité, ambition et calcul politique.
La grande réforme judiciaire de 1864 introduit la publicité des débats, la professionnalisation et le jury, transformant la culture du droit en Russie. Parallèlement, la réforme de la censure de 1865, partiellement libéralisatrice, élargit un espace public qui reste néanmoins étroit et instable. La justice plus visible et une presse plus vive favorisent la circulation des idées et la dramatisation des affaires politiques. Dostoïevski exploite ce climat: les rumeurs, les articles et les lettres ouvertes exacerbent les tensions d’une communauté promptement chauffée à blanc. L’oscillation entre modernisation institutionnelle et réflexes policiers alimente l’inquiétude de fond qui imprègne le récit.
La tentative d’assassinat contre Alexandre II en 1866 par Dmitri Karakozov provoque un tournant répressif. La surveillance se durcit, la censure se resserre, et l’opinion est travaillée par la peur des sociétés secrètes. Ce réflexe de défense de l’État, porté par la gendarmerie et la presse conservatrice, nourrit un imaginaire d’ennemis intérieurs. Dans le roman, la crispation sécuritaire, les enquêtes maladroites et les paniques collectives s’enracinent dans ce contexte. La coexistence de réformes réelles et de frayeurs politiques crée une atmosphère où les raisonnements extrêmes, les calomnies et les provocations peuvent se confondre avec des réponses d’ordre public désordonnées.
Les universités russes connaissent, au début des années 1860, des troubles notables, dont des grèves et manifestations étudiantes en 1861. L’ouverture relative de l’enseignement supérieur et l’arrivée d’étudiants d’origines sociales variées transforment la culture de la jeunesse. Des cercles de lecture discutent de philosophie, de science et de politique. Le mot nihilisme, popularisé en 1862 par le roman de Tourgueniev, entre dans le débat public. Dostoïevski transpose cette effervescence dans des figures de jeunes gens fascinés par la cohérence doctrinale et l’action clandestine. Les conversations exaltées, l’ironie mordante et la défiance envers l’autorité traditionnelle sont autant d’échos de cette génération.
Le courant dit nihiliste agrège, en Russie, des influences occidentales: matérialisme, positivisme, utilitarisme, critique religieuse. Des auteurs comme Tchernychevski, avec Que faire publié en 1863, et Pisarev, critique influent jusqu’à sa mort en 1868, fournissent des modèles d’ascétisme rationnel, de coopératives et de rénovation des moeurs. Dostoïevski, qui s’était déjà opposé à un rationalisme réducteur dans ses textes des années 1860, met à l’épreuve ces idées par la fiction. Il interroge la promesse d’émancipation par la volonté et la raison, montrant comment slogans et schémas séduisants peuvent, dans un milieu provincial, se traduire en apostolats intraitables et en ruptures humaines.
L’émigration politique russe alimente, depuis les années 1850, un circuit transnational d’idées. Herzen publie à Londres le journal Kolokol entre 1857 et 1867, influençant lecteurs en Russie. Bakounine diffuse un anarchisme insurrectionnel et débat avec d’autres socialistes. Dans ce milieu circulent brochures et catéchismes militants. Cette économie de l’imprimé et de la conspiration, reliant Genève, Londres et les villes russes, informe l’arrière-plan du roman: on y voit la fascination pour l’étranger, la circulation de mots d’ordre et l’usage stratégique de la presse. Le transfert d’idéologies, souvent par fragments, accentue les malentendus et la radicalisation locale.
L’affaire Netchaïev de 1869 devient un symbole majeur. Autour de Sergueï Netchaïev, un cercle clandestin à Moscou assassine l’étudiant Ivan Ivanov, afin d’imposer une discipline impitoyable au groupe. Le Catéchisme du révolutionnaire, généralement relié à Netchaïev et à son entourage, défend une éthique de la fin justifiant les moyens. L’événement, largement commenté, choque l’opinion et sert d’argument aux adversaires du nihilisme. Dostoïevski s’en inspire pour sonder la logique d’une cellule conspirative en province. Sans reproduire les faits à l’identique, le roman reprend la question centrale: comment un idéal abstrait se durcit en instrument de domination et d’aveuglement moral.
Les incendies de Saint-Pétersbourg en 1862, dont les causes demeurent discutées, alimentent alors rumeurs et hypothèses de complot. Les autorités soupçonnent des agitateurs; la presse relaie peurs et dénonciations. Cette mémoire d’une capitale en proie aux flammes, bientôt instrumentalisée politiquement, nourrit l’imaginaire d’un pays vulnérable à la déstabilisation. Dans le roman, l’évocation d’incendies et d’affolements collectifs fait écho à ces paniques urbaines. Les feux deviennent métaphores d’un désordre plus profond, où la propagande, l’imitation et la rivalité sociale suffisent à embraser une communauté, sans qu’aucun des acteurs ne maîtrise pleinement l’étendue des conséquences.
La modernisation matérielle des années 1860 transforme le quotidien. Les chemins de fer s’étendent rapidement, reliant provinces et métropoles; le télégraphe accélère l’information; l’imprimerie bon marché favorise la diffusion de brochures. Les villes de province commencent à ressentir les effets de ce réseau: arrivées de voyageurs, d’ouvriers, de livres et de rumeurs. Dostoïevski utilise ces vecteurs pour expliquer la vitesse de propagation d’idées radicales et de scandales. Entre grands domaines en déclin, ateliers, administrations et gares, l’espace social se fragmente. Cette connectivité naissante rend la société plus mobile, mais aussi plus exposée aux emballements et aux manipulations concertées.
La dimension religieuse et morale est décisive dans le contexte du roman. L’orthodoxie demeure une institution structurante, tandis que la critique religieuse progresse dans les milieux d’étudiants et de lecteurs de philosophie occidentale. Le débat entre slavophiles et occidentalistes irrigue les années 1850-1860, opposant un retour aux sources nationales à l’imitation de l’Europe. Ayant connu l’arrestation en 1849 et la Sibérie, Dostoïevski revient avec une méfiance envers les utopies rationalistes et une attention au drame de la conscience. Le roman met à l’épreuve la possibilité d’un lien social sans transcendance, interrogeant les conséquences d’un vide spirituel sur l’action politique.
Le champ littéraire constitue un théâtre de la controverse. Les grandes revues mensuelles, dites épais journaux, encadrent la vie intellectuelle. Les Possédés paraît en 1871-1872 dans Le Messager russe, revue dirigée par Mikhaïl Katkov, figure conservatrice. Le feuilleton impose des contraintes de censure et de rythme, qui modelèrent la composition et la réception. Un chapitre crucial, à contenu jugé scandaleux, fut écarté lors de la parution en revue pour des raisons éditoriales et de censure, ce qui influa sur l’équilibre initial du texte. Ce contexte de publication, polémique et surveillé, fait partie intégrante de l’histoire du roman et de ses effets.
La police politique et la justice traitent alors des affaires révolutionnaires par la surveillance, les infiltrations et des procès très commentés. Les autorités redoutent les agents de liaison, les imprimeries clandestines et les cellules disciplinées. Dostoïevski transpose ce climat en soulignant l’ambiguïté de certains informateurs, l’aveuglement bureaucratique et les malentendus entre niveaux de pouvoir. La mécanique policière, parfois brutale ou maladroite, coexiste avec des procédures nouvelles issues des réformes. Le livre scrute les limites pratiques d’un État qui veut à la fois moderniser et neutraliser la dissidence, tout en montrant comment les conspirateurs exploitent les failles de cet appareil.
Les transformations des moeurs touchent aussi la condition féminine. Dans la décennie, l’accès des femmes à l’éducation progresse, avec l’ouverture de cours supérieurs dans les grandes villes au début des années 1870, et l’idéal de la femme nouvelle, popularisé par la littérature radicale, circule. Certaines s’engagent dans des coopératives, la philanthropie ou des cercles d’étude. Le roman reflète ces évolutions en montrant des figures féminines participant à la vie intellectuelle locale, prises entre aspiration à l’utilité sociale, loyautés familiales et pressions idéologiques. Cette présence féminine souligne que le bouleversement des hiérarchies ne concerne pas que la politique, mais l’ensemble des relations sociales.
Sur le plan économique, la Russie reste majoritairement rurale, mais l’urbanisation progresse et les débuts d’une industrie plus intégrée se font sentir, notamment autour des noeuds ferroviaires. La circulation des marchandises et des informations intensifie la dépendance entre centre et périphérie. Dans cet entre-deux, la province cumule ambitions de modernisation et ressentiments contre la capitale. Dostoïevski en fait un ressort dramatique: les élites locales cherchent prestige et reconnaissance, les jeunes radicaux veulent efficacité et pureté, et la population oscille entre curiosité et fatigue. Cette configuration favorise l’essor de meneurs capables de traduire frustrations diffuses en programmes intransigeants et en actions visibles, parfois violentes, même à petite échelle, au sein d’une communauté provinciale sous pression croissante des idées, des rumeurs et des intérêts divergents.
Biographie de l’auteur
Introduction
Fiodor Dostoïevski (1821–1881) est l’un des romanciers majeurs de la littérature mondiale. Né à Moscou et actif surtout à Saint‑Pétersbourg, il a exploré avec une intensité sans précédent la conscience morale, la liberté, la culpabilité et la foi. Ses romans plongent le lecteur dans des débats intérieurs où s’affrontent valeurs spirituelles, passions et idées politiques du XIXe siècle russe. Figure centrale du réalisme psychologique, il a façonné une prose polyphonique, dramatique et philosophique. Par l’ampleur de ses visions et la profondeur de ses personnages, il demeure un point de référence incontournable pour les écrivains, philosophes et lecteurs contemporains.
Ses œuvres les plus connues incluent Crime et Châtiment, L’Idiot, Les Démons, L’Adolescent et Les Frères Karamazov, ainsi que les Notes d’un souterrain et les Souvenirs de la maison des morts. Publiés souvent en feuilleton, ces textes ont marqué la culture russe et universelle par leur ambition morale et la complexité de leurs enquêtes psychiques. Dostoïevski a articulé l’expérience urbaine moderne, l’angoisse individuelle et les secousses idéologiques de son époque. Sa réputation s’est consolidée dès la fin du XIXe siècle et n’a cessé de croître, nourrissant la pensée littéraire, éthique et esthétique du XXe siècle et au‑delà.
Éducation et influences littéraires
Dostoïevski fut formé à Saint‑Pétersbourg, notamment dans une école d’ingénieurs, tout en se consacrant avec ardeur à la lecture. Très tôt, il se tourna vers la littérature européenne et russe, traduisant par exemple Eugenie Grandet de Balzac au début des années 1840. Il lut avec passion Pouchkine, Gogol et des auteurs romantiques, qui nourrirent son goût pour la dramaturgie morale et l’analyse des passions. Cette culture composite l’a aidé à conjuguer héritage national et interrogations européennes. La ville, ses bouleversements sociaux et ses marges, devint un laboratoire narrative majeur, offrant le cadre d’expériences humaines extrêmes et d’affrontements d’idées.
Sa sociabilité intellectuelle l’amena à fréquenter, à la fin des années 1840, des cercles de discussion intéressés par les réformes et les idées européennes. L’arrestation qui s’ensuivit et l’exil ont profondément infléchi son horizon spirituel et intellectuel. Durant la détention, la lecture intense de l’Évangile, seul livre autorisé, et l’épreuve du travail forcé transformèrent sa vision de la liberté, de la souffrance et du pardon. Ces expériences, jointes à ses crises d’épilepsie et aux difficultés matérielles ultérieures, structurèrent une sensibilité prête à interroger la modernité, ses promesses et ses risques, sans renoncer aux ressources de la tradition religieuse russe.
Carrière littéraire
Dostoïevski débuta avec Pauvres gens (1846), salué pour sa compassion envers les humbles et son réalisme épistolaire. Cette entrée remarquée fut suivie de textes où affleure déjà le dédoublement intérieur, comme Le Double, et de récits marquant son intérêt pour les sensibilités marginales, tel Les Nuits blanches. L’accueil critique, d’abord enthousiaste, se nuança devant l’irrégularité d’une production en quête de forme. Néanmoins, l’acuité psychologique de ces œuvres annonçait une voix singulière, attentive à la misère morale autant qu’économique, et déjà disposée à transformer le récit réaliste en scène de confrontation d’idéaux, de passions et de systèmes de valeurs.
Son arrestation en 1849, suivie d’une simulacre d’exécution et d’années de bagne en Sibérie, interrompit brutalement sa trajectoire littéraire. Après le travail forcé, il fut assigné au service militaire en Asie centrale avant d’obtenir l’autorisation de revenir en Russie européenne. La reprise de l’écriture s’ancra dans l’expérience carcérale, transfigurée dans Souvenirs de la maison des morts, dont la lucidité témoigne d’un regard affûté sur la souffrance, la dignité et la violence institutionnelle. Cette œuvre, par son mélange de témoignage et de fiction, élargit le cadre du roman russe, préparant le terrain à des expérimentations philosophiques plus hardies.
Au début des années 1860, Dostoïevski cofonda avec son frère des revues (dont Vremia, puis Epokha) qui servirent de plates‑formes pour ses textes et ses prises de position. Les Notes d’un souterrain (1864) marquèrent un tournant: un narrateur en crise s’y oppose aux systèmes rationnels et aux utopies simplificatrices. Cette voix, à la fois polémique et introspective, devint emblématique de sa manière. Parallèlement, Souvenirs de la maison des morts consolidait son autorité littéraire, tandis que ses activités éditoriales l’inscrivaient dans le débat public russe, entre réformes, tensions idéologiques et interrogations sur la modernité urbaine.
Au milieu des années 1860, il publia Crime et Châtiment, vaste enquête sur la culpabilité et la rédemption dans une métropole oppressante, qui fixa sa réputation d’analyste des consciences. Sous pression financière, il dicta Le Joueur à une sténographe, Anna Grigorievna Snitkina, avec laquelle il collabora de près. Peu après, L’Idiot prit forme durant des séjours en Europe, cherchant à imaginer une pureté morale affrontée au monde. Ces œuvres, composées souvent dans l’urgence, combinent tension narrative, débats d’idées et portraits psychologiques d’une rare intensité, faisant de l’écriture un laboratoire existentiel.
Dans les années 1870, Dostoïevski aborda la crise politique et morale de la Russie avec Les Démons, drame romanesque sur les effets corrosifs du radicalisme et du vide spirituel. L’Adolescent poursuivit l’exploration des héritages familiaux et des identités vacillantes dans une société en mutation. Parallèlement, son Journal d’un écrivain, publié de façon régulière, mêla chroniques, récits et interventions sur l’actualité, élargissant son audience. Enfin, Les Frères Karamazov, conçu à la fin de la décennie, porta à son sommet la polyphonie des voix, la méditation sur la responsabilité et l’énigme du mal, scellant son statut de classique.
La critique contemporaine salua l’audace psychologique mais débattit de ses positions idéologiques et de la démesure de ses intrigues. Dostoïevski renouvela la forme romanesque par l’affrontement de consciences autonomes, la polyphonie dialogique, les monologues intérieurs et l’art du paradoxe. La ville devint personnage, la culpabilité une dramaturgie, et la foi un problème vécu. Mikhail Bakhtine souligna plus tard la pluralité des voix comme principe structurant. Traduit rapidement, l’auteur exerça une influence durable sur les lettres européennes et extra‑européennes, inspirant romanciers, dramaturges et penseurs soucieux d’articuler l’éthique, la psychologie et la forme narrative.
Convictions et engagement
La pensée religieuse de Dostoïevski, affermie après la Sibérie, irrigue ses fictions sans se réduire à un catéchisme. Il interroge la liberté humaine, la responsabilité et la possibilité du pardon au cœur d’un monde sécularisé. Ses personnages, souvent au bord de l’abîme moral, mettent à l’épreuve la compassion et l’espérance chrétiennes. Cette orientation n’exclut ni le doute ni la révolte: elle transforme le roman en épreuve spirituelle. Loin d’édicter des doctrines, il dramatise les conflits d’âme, rendant la foi, la charité et la conversion des réalités vécues, problématiques et disputées, plutôt que des certitudes imposées.
Dans ses interventions publiques, notamment dans le Journal d’un écrivain, Dostoïevski commenta l’actualité russe et européenne, critiquant les utopies rationalistes et le nihilisme, et plaidant pour un renouvellement moral fondé sur une solidarité spirituelle. Il manifesta une sensibilité nationale marquée, attentive au destin de la Russie et aux causes slaves, tout en dénonçant la cruauté, y compris la peine capitale, dont il connaissait l’horreur. Ses prises de position restent inséparables de sa poétique: elles nourrissent des intrigues où s’examinent les effets des idées sur les vies, et où l’éthique collective se mesure à la fragilité individuelle.
Dernières années et héritage
Au cours de ses dernières années, Dostoïevski acheva Les Frères Karamazov (1879–1880), synthèse de ses thèmes majeurs, et prononça en 1880 un discours sur Pouchkine qui scella sa reconnaissance publique. Il mourut à Saint‑Pétersbourg en 1881, à la suite d’une hémorragie pulmonaire, et fut inhumé au cimetière Tikhvine. Sa popularité fut manifeste lors de funérailles très suivies. Son héritage dépasse la littérature russe: il a marqué l’existentialisme, la critique littéraire, la pensée morale et la psychologie moderne, et ses œuvres, abondamment traduites et adaptées, continuent de susciter débats, recherches et relectures, témoignant d’une puissance imaginative et éthique toujours actuelle.
Les possédés
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE PREMIER
EN GUISE D'INTRODUCTION: QUELQUES DÉTAILS BIOGRAPHIQUES CONCERNANT LE TRÈS HONORABLE STÉPAN TROPHIMOVITCH VERKHOVENSKY.
I
Pour raconter les événements si étranges survenus dernièrement dans notre ville, je suis obligé de remonter un peu plus haut et de donner au préalable quelques renseignements biographiques sur une personnalité distinguée: le très-honorable Stépan Trophimovitch Verkhovensky. Ces détails serviront d'introduction à la chronique que je me propose d'écrire.
Je le dirai franchement: Stépan Trophimovitch a toujours tenu parmi nous, si l'on peut ainsi parler, l'emploi de citoyen; il aimait ce rôle à la passion, je crois même qu'il serait mort plutôt que d'y renoncer. Ce n'est pas que je l'assimile à un comédien de profession: Dieu m'en préserve, d'autant plus que, personnellement, je l'estime. Tout, dans son cas, pouvait être l'effet de l'habitude, ou mieux, d'une noble tendance qui, dès ses premières années, avait constamment poussé à rêver une belle situation civique. Par exemple, sa position de «persécuté» et d'»exilé» lui plaisait au plus haut point. Le prestige classique de ces deux petits mots l'avait séduit une fois pour toutes; en se les appliquant, il se grandissait à ses propres yeux, si bien qu'il finit à la longue par se hisser sur une sorte de piédestal fort agréable à la vanité.
Je crois bien que, vers la fin, tout le monde l'avait oublié, mais il y aurait injustice à dire qu'il fut toujours inconnu. Les hommes de la dernière génération entendirent parler de lui comme d'un des coryphées du libéralisme. Durant un moment, — une toute petite minute, — son nom eut, dans certains milieux, à peu près le même retentissement que ceux de Tchaadaïeff[1], de Biélinsky, de Granovsky et de Hertzen qui débutait alors à l'étranger. Malheureusement, à peine commencée, la carrière active de Stépan Trophimovitch s'interrompit, brisée qu'elle fût, disait-il par le «tourbillon des circonstances». À cet égard, il se trompait. Ces jours-ci seulement j'ai appris avec une extrême surprise, — mais force m'a été de me rendre à l'évidence, — que, loin d'être en exil dans notre province, comme chacun le pensait chez nous, Stépan Trophimovitch n'avait même jamais été sous la surveillance de la police. Ce que c'est pourtant que la puissance de l'imagination! Lui-même crut toute sa vie qu'on avait peur de lui en haut lieu, que tous ses pas étaient comptés, toutes ses démarches épiées, et que tout nouveau gouverneur envoyé dans notre province arrivait de Pétersbourg avec des instructions précises concernant sa personne. Si l'on avait démontré clair comme le jour au très-honorable Stépan Trophimovitch qu'il n'avait absolument rien à craindre, il en aurait été blessé à coup sûr. Et cependant c'était un homme fort intelligent…
Revenu de l'étranger, il occupa brillamment vers 1850 une chaire de l'enseignement supérieur, mais il ne fit que quelques leçons, - - sur les Arabes, si je ne me trompe. De plus, il soutint avec éclat une thèse sur l'importance civique et hanséatique[3] qu'aurait pu avoir la petite ville allemande de Hanau dans la période comprise entre les années 1413 et 1428, et sur les causes obscures qui l'avaient empêchée d'acquérir ladite importance. Cette dissertation était remplie de traits piquants à l'adresse des slavophiles d'alors; aussi devint-il du coup leur bête noire. Plus tard, — ce fut, du reste, après sa destitution et pour montrer quel homme l'Université avait perdu en lui, — il fit paraître, dans une revue mensuelle et progressiste, le commencement d'une étude très savante sur les causes de l'extraordinaire noblesse morale de certains chevaliers à certaine époque. On a dit, depuis, que la suite de cette publication avait été interdite par la censure. C'est bien possible, vu l'arbitraire effréné qui régnait en ce temps-là. Mais, dans l'espèce, le plus probable est que seule la paresse de l'auteur l'empêcha de finir son travail. Quant à ses leçons sur les Arabes, voici l'incident qui y mit un terme: une lettre compromettante, écrite par Stépan Trophimovitch à un de ses amis, tomba entre les mains d'un tiers, un rétrograde sans doute; celui-ci s'empressa de la communiquer à l'autorité, et l'imprudent professeur fut invité à fournir des explications. Sur ces entrefaites, justement, on saisit à Moscou, chez deux ou trois étudiants, quelques copies d'un poème que Stépan Trophimovitch avait écrit à Berlin six ans auparavant, c'est-à-dire au temps de sa première jeunesse. En ce moment même j'ai sur ma table l'oeuvre en question: pas plus tard que l'an dernier, Stépan Trophimovitch m'en a donné un exemplaire autographe, orné d'une dédicace, et magnifiquement relié en maroquin rouge. Ce poème n'est pas dépourvu de mérite littéraire, mais il me serait difficile d'en raconter le sujet, attendu que je n'y comprends rien. C'est une allégorie dont la forme lyrico-dramatique rappelle la seconde partie de Faust[2]. L'an passé, je proposai à Stépan Trophimovitch de publier cette production de sa jeunesse, en lui faisant observer qu'elle avait perdu tout caractère dangereux. Il refusa avec un mécontentement visible. L'idée que son poème était complètement inoffensif lui avait déplu, et c'est même à cela que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant deux mois. Eh bien, cet ouvrage qu'il n'avait pas voulu me laisser publier ici, on l'inséra peu après dans un recueil révolutionnaire édité à l'étranger, et, naturellement, sans en demander la permission à l'auteur. Cette nouvelle inquiéta d'abord Stépan Trophimovitch: il courut chez le gouverneur et écrivit à Pétersbourg une très noble lettre justificative qu'il me lut deux fois, mais qu'il n'envoya point, faute de savoir à qui l'adresser. Bref, durant tout un mois, il fut en proie à une vive agitation. J'ai néanmoins la conviction que, dans l'intime de son être, il était profondément flatté. Il avait réussi à se procurer un exemplaire du recueil, et ce volume ne le quittait pas, — du moins, la nuit; pendant le jour Stépan Trophimovitch le cachait sous un matelas, et il défendait même à sa servante de refaire son lit. Quoiqu'il s'attendît d'instant en instant à voir arriver un télégramme, l'amour-propre satisfait perçait dans toute sa manière d'être. Aucun télégramme ne vint. Alors il se réconcilia avec moi, ce qui atteste l'extraordinaire bonté de son coeur doux et sans rancune.
II
Je ne nie absolument pas son martyre. Seulement, je suis convaincu aujourd'hui qu'il aurait pu, en donnant les explications nécessaires, continuer tout à son aise ses leçons sur les Arabes. Mais l'ambition de jouer un rôle le tenta, et il mit un empressement particulier à se persuader une fois pour toutes que sa carrière était désormais brisée par le «tourbillon des circonstances». Au fond, la vraie raison pour laquelle il abandonna l'enseignement public fut une proposition que lui fit à deux reprises et en termes fort délicats Barbara Pétrovna, femme du lieutenant général Stavroguine: cette dame, puissamment riche, pria Stépan Trophimovitch de vouloir bien diriger en qualité de haut pédagogue et d'ami le développement intellectuel de son fils unique. Inutile de dire qu'à cette place étaient attachés de brillants honoraires. Quand il reçut pour la première fois ces ouvertures, Stépan Trophimovitch était encore à Berlin, et venait justement de perdre sa première femme. Celle-ci était une demoiselle de notre province, jolie, mais fort légère, qu'il avait épousée avec l'irréflexion de la jeunesse. L'insuffisance de ressources pour subvenir aux besoins du ménage, et d'autres causes d'une nature plus intime, rendirent cette union très malheureuse. Les deux conjoints se séparèrent, et, trois ans après, madame Verkhovensky mourut à Paris, laissant à son époux un fils de cinq ans, «fruit d'un premier amour joyeux et sans nuages encore», comme s'exprimait un jour devant moi Stépan Trophimovitch. On se hâta d'expédier le baby en Russie, où il fut élevé par des tantes dans un coin perdu du pays. Cette fois Verkhovensky déclina les offres de Barbara Pétrovna, et, moins d'un an après avoir enterré sa première femme, il épousa en secondes noces une taciturne Allemande de Berlin. D'ailleurs, un autre motif encore le décida à refuser l'emploi de précepteur: la renommée d'un professeur très célèbre alors l'empêchait de dormir, et il aspirait à entrer au plus tôt en possession d'une chaire d'où il pût, lui aussi, prendre son vol vers la gloire. Et voilà que maintenant ses ailes étaient coupées! À ce déboire s'ajouta la mort prématurée de sa seconde femme. Il n'avait plus alors aucune raison pour se dérober aux insistances de Barbara Pétrovna, d'autant plus que cette dame lui portait des sentiments vraiment affectueux. Disons le franchement, Barbara Pétrovna lui ouvrait les bras, il s'y précipita. Qu'on n'aille point toutefois donner à mes paroles un sens bien éloigné de ma pensée: pendant les vingt ans que dura la liaison de ces deux êtres si remarquables, ils ne furent unis que par le lien le plus fin et le plus délicat.
D'autres considérations encore agirent sur l'esprit de Stépan Trophimovitch pour lui faire accepter la place de précepteur. D'abord, le très-petit bien laissé par sa première femme était situé tout à côté du superbe domaine de Skvorechniki que les Stavroguine possédaient aux environs de notre ville. Et puis, dans le silence du cabinet, n'ayant pas à compter avec les mille assujettissements de l'existence universitaire, il pourrait toujours se consacrer à la science, enrichir de profondes recherches la littérature nationale. S'il ne réalisa pas cette partie de son programme, par contre il put, pendant tout le reste de sa vie, être, selon l'expression du poète, le «reproche incarné». Cette attitude, Stépan Trophimovitch la conservait même au club, en s'asseyant devant une table de jeu. Il était à peindre alors. Toute sa personne semblait dire: «Eh bien, oui, je joue aux cartes! À qui la faute? Qui est-ce qui m'a réduit à cela? Qui est- ce qui a brisé ma carrière? Allons, périsse la Russie!» Et noblement il coupait avec du coeur.
La vérité, c'est qu'il adorait le tapis vert. Dans les derniers temps surtout, cette passion lui attira fréquemment des scènes désagréables avec Barbara Pétrovna, d'autant plus qu'il perdait toujours. Du reste, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je remarquerai seulement ici que Stépan Trophimovitch avait de la conscience (du moins quelquefois), aussi était-il souvent triste. Trois ou quatre fois par an il lui prenait des accès de «chagrin civique», c'est-à-dire tout bonnement d'hypocondrie, cependant nous usions entre nous de la première dénomination qui plaisait davantage à la générale Stavroguine Plus tard, outre cela, il s'adonna aussi au champagne; toutefois Barbara Pétrovna sut toujours le préserver des inclinations vers tout penchant trivial. Assurément, il avait besoin d'une tutelle, car il était parfois très étrange. Au milieu de la plus noble tristesse, il se mettait tout à coup à rire de la façon la plus vulgaire. À de certains moments, il s'exprimait sur son propre compte en termes humoristiques, ce qui contrariait vivement Barbara Pétrovna, femme imbue des traditions classiques et constamment guidée dans son mécénatisme par des vues d'ordre supérieur. Cette grande dame eut durant vingt ans une influence capitale sur son pauvre ami. Il faudrait parler un peu d'elle, c'est ce que je vais faire.
III
Il y a des amitiés bizarres. Deux amis voudraient presque s'entre- dévorer, et ils passent toute leur vie ainsi sans pouvoir se séparer l'un de l'autre. Bien plus, celui des deux qui romprait la chaîne en deviendrait malade tout le premier et peut-être en mourrait. Plus d'une fois, et souvent à la suite d'un entretien intime avec Barbara Pétrovna, Stépan Trophimovitch, bondissant de dessus son divan, se mit à frapper le mur à coups de poing.
Je n'exagère rien: un jour même, dans un de ces transports furieux, il déplâtra la muraille. On me demandera peut-être comment un semblable détail est parvenu à ma connaissance. Je pourrais répondre que la chose s'est passée sous mes yeux, je pourrais dire que, nombre de fois, Stépan Trophimovitch a sangloté sur mon épaule, tandis qu'avec de vives couleurs il me peignait tous les dessous de son existence. Mais voici ce qui arrivait d'ordinaire après ces sanglots: le lendemain il se fût volontiers crucifié de ses propres mains pour expier son ingratitude; il se hâtait de me faire appeler ou accourait lui-même chez moi, à seule fin de m'apprendre que Barbara Pétrovna était «un ange d'honneur et de délicatesse, et lui tout opposé». Non content de verser ces confidences dans mon sein, il en faisait part à l'intéressée elle- même, et ce dans des épîtres fort éloquentes signées de son nom en toutes lettres. «Pas plus tard qu'hier, confessait-il, j'ai raconté à un étranger que vous me gardiez par vanité, que vous étiez jalouse de mon savoir et de mes talents, que vous me haïssiez, mais que vous n'osiez manifester ouvertement cette haine de peur d'être quittée par moi, ce qui nuirait à votre réputation littéraire. En conséquence, je me méprise, et j'ai résolu de me donner la mort; j'attends de vous un dernier mot qui décidera de tout», etc., etc. On peut se figurer, d'après cela, où en arrivait parfois dans ses accès de nervosisme ce quinquagénaire d'une innocence enfantine. Je lus moi-même un jour une de ces lettres. Il l'avait écrite à la suite d'une querelle fort vive, quoique née d'une cause futile. Je fus épouvanté et je le conjurai de ne pas envoyer ce pli.
— Il le faut… c'est plus honnête… c'est un devoir… je mourrai, si je ne lui avoue pas tout, tout! répondit-il avec exaltation, et il resta sourd à toutes mes instances.
La différence entre Barbara Pétrovna et lui, c'est que la générale n'aurait jamais envoyé une pareille lettre. Il est vrai que Stépan Trophimovitch aimait passionnément à noircir du papier. Alors qu'elle et lui habitaient la même maison, il lui écrivait jusqu'à deux fois par jour dans ses crises nerveuses. Je sais de bonne source qu'elle lisait toujours ces lettres avec la plus grande attention, même quand elle en recevait deux en vingt-quatre heures. Ensuite, elle les serrait dans une cassette spéciale; de plus, elle en prenait note dans sa mémoire. Puis, après avoir laissé son ami sans réponse pendant tout un jour, lorsque Barbara Pétrovna le revoyait, elle lui montrait le visage le plus tranquille, comme s'il ne s'était rien passé de particulier entre eux. Peu à peu elle le dressa si bien, que lui-même n'osait plus parler de l'incident de la veille, il se bornait à la regarder furtivement dans les yeux. Mais elle n'oubliait rien, tandis que Stépan Trophimovitch, rassuré par le calme de la générale, oubliait parfois trop vite. Souvent, le même jour, s'il arrivait des amis et qu'on bût du champagne, il riait, folâtrait comme un écolier. Quel regard venimeux elle dardait probablement sur lui dans ces moments-là! Et il ne s'en apercevait pas! Au bout de huit jours, d'un mois, de six mois, elle lui rappelait à brûle- pourpoint telle expression de telle lettre, puis la lettre tout entière, avec toutes les circonstances. Aussitôt il rougissait de honte, et son trouble se traduisait ordinairement par une légère attaque de cholérine.
En effet, Barbara Pétrovna se prenait très souvent à le haïr. Mais, chose qu'il ne remarqua jamais, elle avait fini par le regarder comme son enfant, sa création, on pourrait même dire son acquisition; il était devenu la chair de sa chair, et si elle le gardait, l'entretenait, ce n'était pas seulement parce qu'elle était «jalouse de ses talents». Oh! combien devaient la blesser de telles suppositions! Un amour intense se mêlait en elle à la haine, à la jalousie et au mépris qu'elle éprouvait sans cesse à l'égard de Stépan Trophimovitch. Pendant vingt-deux ans elle l'entoura de soins, veilla sur lui avec la sollicitude la plus infatigable. Dès que se trouvait en jeu la réputation littéraire, scientifique ou civique de son ami, Barbara Pétrovna perdait le sommeil. Elle l'avait inventé, et elle croyait elle-même la première à son invention. Il était pour elle quelque chose comme un rêve. Mais, en revanche, elle exigeait beaucoup de lui, parfois même elle le traitait en esclave. Elle était rancunière à un degré incroyable…
IV
Au mois de mai 1855, on apprit à Skvorechniki le décès du lieutenant général Stavroguine. Sans doute Barbara Pétrovna ne pouvait pas regretter beaucoup le défunt, car, depuis quatre ans, les deux époux vivaient séparés l'un de l'autre pour cause d'incompatibilité d'humeur, et la femme servait une pension au mari. (En dehors de son traitement, le lieutenant général ne possédait que cent cinquante âmes; toute la fortune, y compris le domaine de Skvorechniki, appartenait à Barbara Pétrovna, fille unique d'un riche fermier des boissons.) Néanmoins, elle reçut une forte secousse de cet événement imprévu et se retira tout à fait du monde. Naturellement, Stépan Trophimovitch fut en permanence auprès d'elle.
Le printemps déployait toutes ses magnificences; les putiets fleuris remplissaient l'air de leur parfum; les dernières heures du jour prêtaient à la nature un charme particulièrement poétique. Chaque soir les deux amis se retrouvaient au jardin, et, jusqu'à la tombée de la nuit, assis sous une charmille, ils se confiaient leurs sentiments et leurs idées. Sous l'impression du changement intervenu dans sa destinée, Barbara Pétrovna parlait plus que de coutume; son coeur semblait chercher celui de son ami. Ainsi se passèrent plusieurs soirées. Une supposition étrange se présenta tout à coup à l'esprit de Stépan Trophimovitch: «Cette veuve inconsolable n'a-t-elle pas des vues sur moi? N'attend-elle pas de moi une demande en mariage à l'expiration de son deuil?» Pensée cynique, mais plus on est cultivé, plus on est enclin aux pensées de ce genre, par cela seul que le développement de l'intelligence permet d'embrasser une plus grande variété de points de vue. En examinant cette conjecture, il la trouva assez vraisemblable et devint songeur: «Certes, la fortune est immense, mais…» Le fait est que Barbara Pétrovna n'avait rien d'une beauté: c'était une femme grande, jaune, osseuse, dont le visage démesurément allongé offrait quelque analogie avec une tête de cheval. Stépan Trophimovitch hésitait de plus en plus et souffrait cruellement de ne pouvoir prendre un parti. Deux fois même son irrésolution lui arracha des larmes (il pleurait assez facilement). Le soir, sous la charmille, son visage exprimait, comme malgré lui, un mélange de tendresse, de moquerie, de fatuité et d'arrogance. Ces jeux de physionomie sont indépendants de la volonté, et ils se remarquent d'autant mieux que l'homme est plus noble. Dieu sait ce qu'il en était au fond, mais il est probable que Stépan Trophimovitch se faisait quelque illusion sur la nature du sentiment né dans l'âme de Barbara Pétrovna. Elle n'aurait pas échangé son nom de Stavroguine contre celui de Verkhovensky, quelque glorieux que fût ce dernier. Peut-être n'était-ce de sa part qu'un amusement féminin, peut-être obéissait-elle tout bonnement à ce besoin de flirter, si naturel aux dames dans certains cas.
Il est à supposer que la veuve ne tarda pas à lire dans le coeur de son ami. Elle ne manquait pas de pénétration, et il était quelquefois fort ingénu. Quoi qu'il en soit, les soirées se passaient comme de coutume, les causeries étaient toujours aussi poétiques et aussi intéressantes. Un jour, à l'approche de la nuit, après un entretien plein d'animation et de charme, la générale et le précepteur, échangeant une chaleureuse poignée de main se séparèrent à l'entrée du pavillon où logeait Stépan Trophimovitch. Chaque été, il transportait ses pénates dans ce petit bâtiment qui faisait presque partie du jardin. Rentré chez lui, il se mit à la fenêtre pour fumer un cigare, mais à peine s'était-il approché de la croisée qu'un léger bruit le fit soudain tressaillir. Il retourna la tête et aperçut devant lui Barbara Pétrovna. Il n'y avait pas cinq minutes qu'ils s'étaient quittés. Le visage jaune de la générale avait pris une teinte bleuâtre, un frémissement presque imperceptible agitait ses lèvres serrées. Pendant dix seconde elle garda le silence, fixant sur Stépan Trophimovitch un regard d'une dureté implacable, puis de sa bouche sortirent ces quelques mots murmurés rapidement:
— Jamais je ne vous pardonnerai cela[1q]!
Dix ans plus tard, quand il me raconta cette histoire à voix basse et après avoir d'abord fermé les portes, il me dit qu'il était resté pétrifié de stupeur; il avait tellement perdu l'usage de ses sens qu'il ne vit ni n'entendit Barbara Pétrovna quitter la chambre. Comme jamais dans la suite elle ne fit la moindre allusion à cet incident, il fut toujours porté à croire qu'il avait été le jouet d'une hallucination due à un état morbide. Supposition d'autant plus admissible que, cette nuit même, il tomba malade et fut souffrant pendant quinze jours, ce qui mit fort à propos un terme aux entrevues dans le jardin.
V
Le costume que Stépan Trophimovitch porta toute sa vie, était une invention de Barbara Pétrovna. Cette tenue élégante et caractéristique mérite d'être mentionnée: redingote noire à longs pans, boutonnée presque jusqu'en haut; chapeau mou à larges bords (en été c'était un chapeau de paille); cravate de batiste blanche à grand noeud et à bouts flottants; canne à pomme d'argent. Stépan Trophimovitch se rasait la barbe et les moustaches, il laissait tomber sur ses épaules ses cheveux châtains qui ne commencèrent à blanchir un peu que dans les derniers temps. Jeune, il était, dit- on, extrêmement beau. Dans sa vieillesse il avait encore, à mon avis, un air assez imposant avec sa haute taille, sa maigreur et sa chevelure mérovingienne. À la vérité, un homme de cinquante- trois ans ne peut pas s'appeler un vieillard. Mais, par une sorte de coquetterie civique, loin de chercher à se rajeunir, il aurait plus volontiers posé pour le patriarche.
Dans les premières années, ou, pour mieux dire, durant la première moitié de son existence chez Barbara Pétrovna, Stépan Trophimovitch pensait toujours à composer un ouvrage. Plus tard nous l'entendîmes souvent répéter: «Mon travail est prêt, mes matériaux sont réunis, et je ne fais rien! Je ne puis me mettre à l'oeuvre!» En prononçant ces mots, il inclinait douloureusement sa tête sur sa poitrine. Un tel aveu de son impuissance devait ajouter encore à notre respect pour ce martyr chez qui la persécution avait tout tué!
Vers 1860, Barbara Pétrovna, voulant produire son ami sur un théâtre digne de lui, l'emmena à Pétersbourg. Elle-même d'ailleurs désirait se rappeler à l'attention du grand monde où elle avait vécu autrefois. Ils passèrent un hiver presque entier dans la capitale, mais sans atteindre aucun des résultats espérés. Les anciennes connaissances avec qui Barbara Pétrovna essaya de renouer des relations accueillirent très froidement ses avances, ou même ne les accueillirent pas du tout. De dépit, la générale se jeta dans les «idées nouvelles», elle songea à fonder une revue et donna des soirées auxquelles elle invita les gens de lettres. En même temps elle organisa des séances littéraires destinées à mettre en évidence le talent de Stépan Trophimovitch. Mais, hélas! le libéral de 1840 n'était plus dans le mouvement. En vain, pour complaire à la jeune génération, reconnut-il que la religion était un mal et l'idée de patrie une absurdité ridicule, ces concessions ne le préservèrent pas d'un fiasco lamentable. Le malheureux conférencier ayant eu l'audace de déclarer qu'il préférait de beaucoup Pouchkine à une paire de bottes, il n'en fallut pas plus pour déchaîner contre lui une véritable tempête de sifflets et de clameurs injurieuses. Bref, on le conspua comme le plus vil des rétrogrades. Sa douleur fut telle en se voyant traiter de la sorte, qu'il fondit en larmes avant même d'être descendu de l'estrade.
Décidément il n'y avait rien à faire à Pétersbourg. La générale et son ami revinrent à Skvorechniki.
VI
Peu après Barbara Pétrovna envoya Stépan Trophimovitch «se reposer» à l'étranger. Il partit avec joie. «Là je vais ressusciter!» s'écriait-il, «là je me reprendrai enfin à la science!» Mais dès ses premières lettres reparut la note désolée. «Mon coeur est brisé», écrivait-il à Barbara Pétrovna, «je ne puis rien oublier! Ici, à Berlin, tout me rappelle mon passé, mes premières ivresses et mes premiers tourments. Où est-elle? Où sont-elles maintenant toutes deux? Qu'êtes-vous devenus, anges dont je ne fus jamais digne? Où est mon fils, mon fils bien-aimé? Enfin, moi-même, où suis-je? Que suis-je devenu, moi jadis fort comme l'acier, inébranlable comme un roc, pour qu'un Andréieff puisse briser mon existence en deux?» etc., etc. Depuis la naissance de son fils bien-aimé, Stépan Trophimovitch ne l'avait vu qu'une seule fois, c'était pendant son dernier séjour à Pétersbourg où l'enfant, devenu un jeune homme, se préparait à entrer à l'Université. Pierre Stépanovitch, comme je l'ai dit, avait été élevé chez ses tantes dans le gouvernement de O…, à sept cents verstes[5] de Skvorechniki (Barbara Pétrovna faisait les frais de son entretien). Quant à Andréieff, c'était un marchand de notre ville; il devait encore quatre cents roubles à Stépan Trophimovitch, qui lui avait vendu le droit de faire des coupes de bois dans son bien sur une étendue de quelques dessiatines. Quoique Barbara Pétrovna n'eût pas plaint les subsides à son ami en l'envoyant à Berlin, celui-ci comptait bien toucher ces quatre cents roubles avant son départ: il en avait sans doute besoin pour quelques dépenses secrètes, et peu s'en fallut qu'il ne pleurât, lorsque Andréieff le pria d'attendre un mois. D'ailleurs le marchand était parfaitement fondé à demander un répit, car, sur le désir de Stépan Trophimovitch qui n'osait avouer certain découvert à la générale, il avait fait le premier versement six mois avant l'échéance obligatoire.
Dans la seconde lettre reçue de Berlin le thème s'était modifié: «Je travaille douze heures par jour (s'il travaillait seulement onze heures! grommela en lisant ces mots Barbara Pétrovna), je fouille les bibliothèques, je compulse, je prends des notes, je fais des courses: je suis allé voir des professeurs. J'ai renouvelé connaissance avec l'excellente famille Doundasoff. Que Nadejda Nikolaïevna est charmante encore à présent! Elle vous salue. Son jeune mari et ses trois neveux sont à Berlin. Je passe les soirées avec la jeunesse, nous causons jusqu'au lever du jour. Ce sont presque des soirées athéniennes, mais seulement au point de vue de la délicatesse et de l'élégance. Tout y est noble: on fait de la musique, on rêve la rénovation de l'humanité, on s'entretient de la beauté éternelle…» etc., etc.
— Ce ne sont que des contes à dormir debout! décida Barbara Pétrovna en serrant cette lettre dans sa cassette, — si les soirées athéniennes se prolongent jusqu'au lever du jour, il ne donne pas douze heures au travail. Était-il ivre quand il a écrit cela? Et cette Doundasoff, comment ose-t-elle m'envoyer des saluts? Du reste, qu'il se promène!
Mais il ne se promena pas longtemps; au bout de quatre mois il n'y tint plus et raccourut en toute hâte à Skvorechniki. Certains hommes sont aussi attachés à leur niche que les chiens d'appartement.
VII
Dès lors commença une période d'accalmie qui dura près de neuf années consécutives. Les explosions nerveuses et les sanglots sur mon épaule se reproduisaient à intervalles réguliers sans altérer notre bonheur. Je m'étonne que Stépan Trophimovitch n'ait pas pris du ventre à cette époque. Son nez seulement rougit un peu, ce qui ajouta à la débonnaireté de sa physionomie. Peu à peu se forma autour de lui un cercle d'amis qui, du reste, ne fut jamais bien nombreux. Quoique Barbara Pétrovna ne s'occupât guère de nous, néanmoins nous la reconnaissions tous pour notre patronne. Après la leçon reçue à Pétersbourg, elle s'était fixée définitivement en province; l'hiver elle habitait sa maison de ville, l'été son domaine suburbain. Jamais elle ne jouit d'une influence aussi grande que durant ces sept dernières années, c'est-à-dire jusqu'à l'avènement du gouverneur actuel. Le prédécesseur de celui-ci, notre inoubliable Ivan Osipovitch, était le proche parent de la générale Stavroguine, qui lui avait autrefois rendu de grands services. La gouvernante sa femme tremblait à la seule pensée de perdre les bonnes grâces de Barbara Pétrovna. À l'instar de l'auguste couple, toute la société provinciale témoignait la plus haute considération à la châtelaine de Skvorechniki. Naturellement, Stépan Trophimovitch bénéficiait, par ricochet, de cette brillante situation. Au club où il était beau joueur et perdait galamment, il avait su s'attirer l'estime de tous, quoique beaucoup ne le regardassent que comme un «savant». Plus tard, lorsque Barbara Pétrovna lui eut permis de quitter sa maison, nous fûmes encore plus libres. Nous nous réunissions chez lui deux fois la semaine, cela ne manquait pas d'agrément, surtout quand il offrait du champagne. Le vin était fourni par Andréieff dont j'ai parlé plus haut. Barbara Pétrovna réglait la note tous les six mois, et d'ordinaire les jours de payement étaient des jours de cholérine.
Le plus ancien membre de notre petit cercle était un employé provincial nommé Lipoutine, grand libéral, qui passait en ville pour athée. Cet homme n'était plus jeune; il avait épousé en secondes noces une jolie personne passablement dotée; de plus, il avait trois filles déjà grandelettes. Toute sa famille était maintenue par lui dans la crainte de Dieu, et gouvernée despotiquement. D'une avarice extrême, il avait pu, sur ses économies d'employé, s'acheter une petite maison et mettre encore de l'argent de côté. Son caractère inquiet et l'insignifiance de sa situation bureaucratique étaient cause qu'on avait peu de considération pour lui; la haute société ne le recevait pas. En outre, Lipoutine était très cancanier, ce qui, plus d'une fois, lui avait valu de sévères corrections. Mais, dans notre groupe, on appréciait son esprit aiguisé, son amour de la science et sa gaieté maligne. Quoique Barbara Pétrovna ne l'aimât point, il trouvait pourtant moyen de capter sa bienveillance.