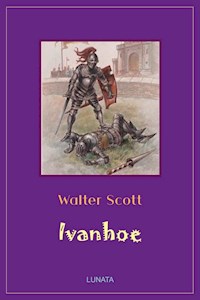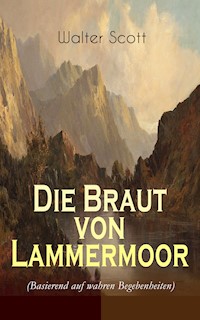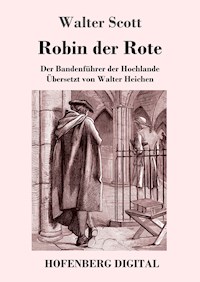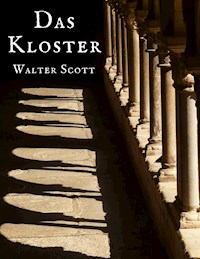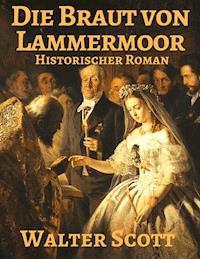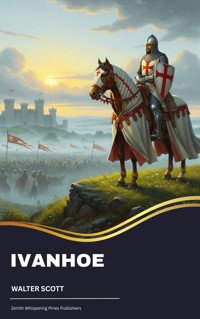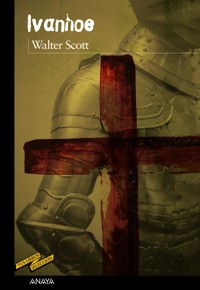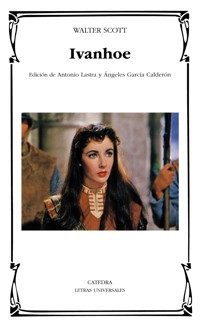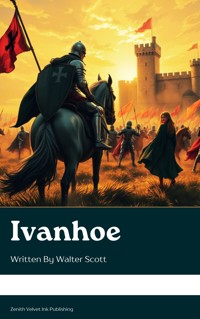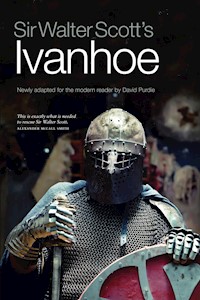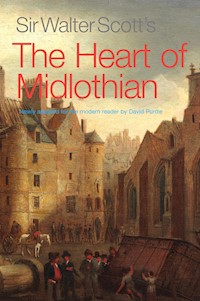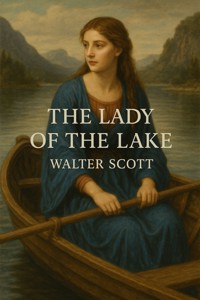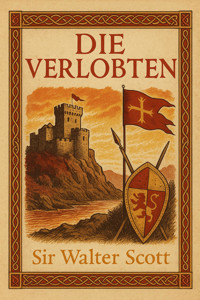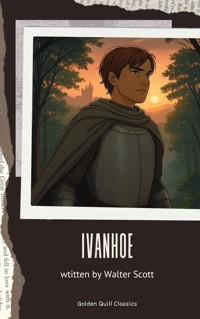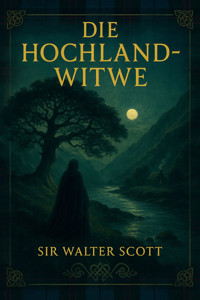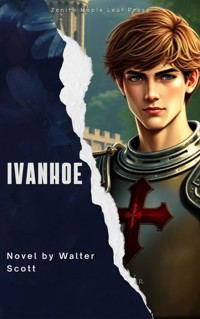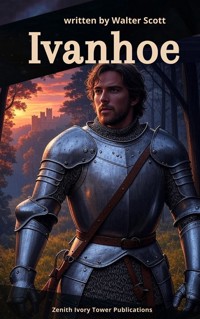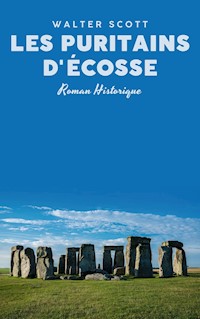
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
En 1677 et dans les années qui suivirent, la lutte était âpre entre les catholiques et les protestants en Grande Bretagne. L'Écosse fut le théâtre de nombreuses batailles. Henry Morton est fait prisonnier par une petite poignée de soldats du Roi, parce qu'il a aidé un puritain (religion protestante) à se soustraire à la justice du Roi (de religion catholique), en mémoire de son père qui avait servi dans les troupes puritaines. Ils font halte pour la nuit au château de Tillietudlem. Une garnison complète sur pied de guerre s'arrête au même château, garnison commandée par le colonel Glaverhouse. Celui-ci ne veut pas relâcher Morton et emmène avec lui le prisonnier, pour aller livrer bataille contre les protestants. Celle-ci est néfaste aux catholiques et beaucoup de soldats y perdent la vie. Morton, qui réussit à s'échapper, commande, presque contre son gré une garnison de puritains. Les protestants gagnent la bataille et se dirigent vers le château de Tillietudlem. Henry Morton essaie par tous les moyens de sauver les habitants du château, entre autres la jolie Edith Bellenden dont il est amoureux, bien qu'elle soit promise à un autre. Après de nombreuses péripéties, Morton s'échappe en Hollande où il se fait oublier pendant quelques années...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 754
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Scott
LES PURITAINS D’ÉCOSSE
CONTES DE MON HÔTE
Paris, Furne, 1830-1832.
Traduction Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret
Première publication en 1816
Table des matières
INTRODUCTION AUX CONTES DE MON HÔTE.
CHAPITRE PREMIER. Préliminaires.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
CHAPITRE XIII.
CHAPITRE XIV.
CHAPITRE XV.
CHAPITRE XVI.
CHAPITRE XVII.
CHAPITRE XVIII.
CHAPITRE XIX.
CHAPITRE XX.
CHAPITRE XXI.
CHAPITRE XXII.
CHAPITRE XXIII.
CHAPITRE XXIV.
CHAPITRE XXV.
CHAPITRE XXVI.
CHAPITRE XXVII
CHAPITRE XXVIII.
CHAPITRE XXIX.
CHAPITRE XXX.
CHAPITRE XXXI.
CHAPITRE XXXII.
CHAPITRE XXXIII.
CHAPITRE XXXIV.
CHAPITRE XXXV.
CHAPITRE XXXVI.
CHAPITRE XXXVII.
CHAPITRE XXXVIII.
CHAPITRE XXXIX.
CHAPITRE XL.
CHAPITRE XLI.
CHAPITRE XLII.
CHAPITRE XLIII.
CHAPITRE XLIV.
CONCLUSION.
PÉRORAISON.
Mentions légales
INTRODUCTION1 AUX CONTES DE MON HÔTE.2
Comme je puis, sans vanité, présumer que le nom et les qualités officielles qui sont en tête de cet ouvrage lui attireront, de la part des gens sages etréfléchis auxquels je l’adresse, le degré d’attention qui est dû à l’instructeur zélé de la jeunesse et au sacristain exact à remplir ses devoirs du dimanche, je ne chercherai point à allumer une chandelle en plein jour, et je m’abstiendrai de faire l’éloge d’un ouvrage dont le titre seul est une recommandation suffisante.
Cependant, comme je ne me dissimule pas que l’envie aboie toujours contre le mérite, et qu’il se trouvera des gens qui diront tout bas que, quoiqu’on ne puisse me refuser la science et les bons principes (Dieu merci), le poste que j’occupe à Gandercleugh3 n’a pas dû me donner une grande connaissance des voies et des œuvres de la génération présente, je divise en trois points ma réponse à cette objection, si elle a lieu.
Je dirai donc, 1° que Gandercleugh est le point central de notre Écosse, son ombilic (si fas sic dicere) ; de sorte que tous ceux qui vont pour leurs affaires du côté de notre métropole de législation, comme j’appelle Édimbourg, ou de notre métropole de commerce, comme je désigne Glascow, sont obligés d’y passer, et s’y arrêtent souvent pour la nuit. Or le sceptique le plus décidé avouera que moi, qui depuis quarante ans passe toutes mes soirées, excepté celle du dimanche, dans un grand fauteuil de cuir, au coin du feu de l’auberge de Wallace, j’ai vu autant de monde que si je m’étais fatigué à voyager dans toute l’Angleterre. De même le percepteur du droit de péage de la grande route de Well-brae-Head, assis tranquillement dans sa loge, y reçoit plus d’argent que si, s’avançant sur le chemin, il allait demander une contribution àchaque personne qu’il rencontrerait ; ce qui l’exposerait, suivant l’adage vulgaire, à revenir avec plus de coups de pied au derrière que d’half-pence4 dans sa poche.
2° Si le roi d’Ithaque, le plus sage des Grecs, acquit sa réputation en visitant les villes et les hommes, comme l’assure le poète romain, je réponds au Zoïle qui m’opposera cet exemple que, par le fait, j’ai vu aussi des villes et des hommes ; car j’ai visité les fameuses cités d’Édimbourg et de Glascow, deux fois la première et trois fois la seconde, dans le cours de mon pèlerinage en ce monde. De plus j’ai eu l’honneur de m’asseoir à l’Assemblée Générale5 (c’est-à-dire comme auditeur dans les galeries), et j’y ai entendu parler si éloquemment sur la loi du patronage, que les idées nouvelles que j’en ai rapportées me font considérer comme un oracle sur cette doctrine depuis mon heureux retour à Gandercleugh.
3° Enfin si, malgré ma grande connaissance du monde, acquise au prix de tant de peines par mes questions au coin du feu et par mes voyages, on prétend que je suis incapable de recueillir les agréables récits de mon hôte, je ferai savoir à ces critiques, à leur honte éternelle, aussi bien qu’à la confusion de tous ceux qui voudraient témérairement s’élever contre moi ; je leur ferai savoir, dis-je, que je ne suis ni l’auteur, ni le rédacteur, ni le compilateur des CONTES DE MON HÔTE, et que par conséquent je ne saurais être responsable de leur contenu pour un iota. Or, maintenant, race de censeurs qui vous montrez tels que les serpens d’airain de la Bible pour siffler avec vos langues et blesser avec vos aiguillons, prosternez-vous dans votre poussière native ; reconnaissez vos pensées pour celles de l’ignorance, et vos paroles pour celles de la folie. Vous voilà pris dans vos propres filets, vous voilà tombés dans votre propre trappe ; laissez donc là une tâche trop pénible pour vous ; ne détruisez pas vos dents en rongeant une lime ; n’épuisez pas vos forces contre des murs de pierre ; ne perdez pas haleine en luttant de vitesse avec un agile coursier, et laissez peser les CONTES DE MON HÔTE à ceux qui porteront avec eux les balances de la candeur, purifiées de la rouille des préventions par les mains du savoir modeste. Pour ceux-là seuls ils furent recueillis, comme le démontrera un court récit que mon zèle pour la vérité m’a engagé à faire servir de supplément à ce préambule.
Personne n’ignore que MON HÔTE était un homme aimable, facétieux, et aimé de tout Gandercleugh, excepté du laird, du collecteur de l’accise, et de ceux à qui il refusait de faire crédit. Je vais réfuter tour à tour leurs motifs particuliers de haine.
Le laird l’accusait d’avoir encouragé, en divers temps et lieux, la destruction des lièvres, des lapins, des oiseaux noirs et gris, tels que perdreaux, coqs de bruyère et autres volatiles ou quadrupèdes, en contravention aux lois du royaume ; car elles les réservent pour les puissans du siècle, qui paraissent prendre un grand plaisir à la destruction des animaux (plaisir que je ne puis concevoir). Mais, avec tout le respect que je dois à l’honorable laird, je prendrai la liberté de faire observer que mon défunt ami n’était pas coupable de cette offense, attendu que ce qu’il vendait pour des levrauts étaient des lapins de son clapier, et ses coqs de bruyère des pigeons bisets, servis et mangés comme tels. Ce n’était donc qu’une véritable deceptio visûs.
Le collecteur de l’accise prétendait que feu MON HÔTE distillait lui-même sa liqueur, sans avoir cette permission spéciale des grands de ce monde, appelée en termes techniques une licence. Me voici prêt à réfuter cette fausseté : en dépit du collecteur, de sa jauge, de sa plume et de son écritoire, je soutiens que je n’ai jamais vu ni goûté un verre d’eau-de-vie illégale dans la maison de MON HÔTE. Nous n’avions certainement nul besoin de nous cacher au sujet d’une liqueur agréable et attrayante débitée à l’auberge de Wallace sous le nom de rosée des montagnes. S’il est une loi contre la fabrication d’une semblable liqueur, que le collecteur me la montre, et je lui dirai si je dois la reconnaître ou non.
Quant à ceux qui se présentaient altérés chez MON HÔTE, et qui ne pouvaient apaiser leur soif, faute d’argent comptant ou de crédit, c’est un cas qui m’a ému les entrailles, comme s’il m’eûtconcerné personnellement. Mais je dois dire que MON HÔTE n’était pas insensible aux peines que souffre une bonne âme ayant soif, et qu’il lui fournissait à boire jusqu’à concurrence de la valeur de sa montre, ou de ses vêtemens, excepté ceuxde la partie inférieure du corps, qu’il n’a jamais voulu accepter en nantissement, pour l’honneur de sa maison. Et afin de rendre complètement justice à la libéralité de MON HÔTE, je dois dire que jamais il ne m’a refusé la dose de rafraîchissement dont j’avais l’habitude de réconforter la nature après les fatigues de mon école. Il est vrai que j’enseignais l’anglais et le latin, la tenue des livres, avec une teinture de mathématiques, à ses cinq garçons, et le plain chant à sa fille ; ce qui établissait une sorte de compensation, dont je m’accommodais plutôt que d’un honoraire ; car il est dur de faire attendre un gosier à sec.
Je crois cependant, s’il faut dire toute ma pensée, que ce qui engageait encore davantage MON HÔTE à déroger en ma faveur à son habitude assez naturelle de demander le paiement de l’école, c’était le plaisir qu’il prenait à ma conversation, qui, quoique solide et édifiante, était comme un palais construit avec soin et dans lequel on n’a pas oublié les ornemens extérieurs. MON HÔTE était si content de ses répliques dans nos colloques, et nous discutions si bien sur tous les cantons et tous les usages de l’Écosse, que ceux qui nous écoutaient avaient coutume de dire que le plaisir de nous entendre valait une bouteille de bière ; plus d’un voyageur étranger, ou des cantons les plus éloignés de l’Écosse, aimait à prendre part à la conversation, et à dire les nouvelles recueillies par lui dans les climats lointains, ou sauvées de l’oubli dans notre propre patrie.
Or j’avais pris, pour diriger mes basses classes, un jeune homme appelé Pierre ou Patrick Pattieson, qui avait été destiné à notre sainte église, et pouvait déjà, par une licence, prêcher en chaire. Ce jeune homme se plaisait à recueillir de vieux contes et d’anciennes légendes, et à les orner des fleurs de la poésie, pour laquelle il avait un goût vain et frivole : car il ne suivait pas l’exemple de ces bons poètes que je lui proposais pour modèles ; mais il s’était adonné à cette versification moderne, qui exige moins de peine et de pensées. Aussi l’ai-je plusieurs fois grondé d’être un des auteurs de cette fatale révolution, prophétisée par Robert Carey dans ses vers sur la mort du célèbre docteur John Donne6 :
Tu n’es plus, et tes lois irritent la licence
Des auteurs libertins du moderne Hélicon ;
Nos vers dont tu règles la pensée et le son
Dégénèrent bientôt en ballade ou romance7.
Je lui cherchais aussi querelle sur le style facile et redondant plutôt que concis et grave de sa prose ; mais, malgré ces symptômes de mauvais goût, et son humeur toujours prête à contredire ceux qui en savaient plus long que lui sur les passages d’une construction difficile dans les auteurs latins, je fus sincèrement affligé de la mort de Pierre Pattieson, et le regrettai comme mon propre fils. Ses papiers furent laissés à mes soins ; et, pour fournir aux frais de sa maladie et de ses funérailles, je me crus autorisé à disposer d’une partie, intitulée les CONTES DE MON HÔTE, que je cédai à un homme habile dans le commerce de la librairie. C’était un petit homme, gai, malin, facétieux, et contrefaisant à merveille la voix des autres. Je n’ai eu qu’à me louer de sa conduite envers moi.
On peut voir maintenant l’injustice qu’il y aurait à m’accuser d’incapacité pour écrire les CONTES DE MON HÔTE, puisque, après avoir prouvé que j’aurais pu les composer si j’avais voulu, comme je ne l’ai pas fait, la critique doit retomber, s’il y a lieu, sur M. Pierre Pattieson ; et, dans le cas contraire, la louange m’appartient, puisque, suivant l’argument plaisant et logique du doyen de Saint-Patrick8.
That without Which a thing is not,
Is causa sine quâ non9.
Celui sans qui chose n’est pas
Est le sine quâ non causa.
L’ouvrage donc est pour moi ce qu’un enfant est pour un père ; si l’enfant se fait bien valoir, le père en a l’honneur, sinon la honte reste justement à l’enfant.
Je dois ajouter qu’en disposant ces contes pour la presse, M. Pierre Pattieson a plus consulté son caprice que l’exactitude des récits : il en a même quelquefois mêlé deux ou trois ensemble pour l’agrément de ses plans. Je désapprouve cette infidélité ; cependant je n’ai pas voulu prendre sur moi de la corriger, parce que la volonté du défunt était que son manuscrit fût mis sous presse tel quel ; fantaisie bizarre de mon pauvre ami, qui, s’il eût pensé sagement, aurait plutôt dû meconjurer, par tous les tendres liens de notre amitié et de nos études communes, de revoir avec soin, d’abréger ou d’augmenter ses écrits, d’après mon goût et mon jugement. Mais la volonté des morts doit être suivie scrupuleusement, même quand nous déplorons leur entêtement et les erreurs de leur amour-propre. Ainsi donc, aimable lecteur, je vous salue, en vous offrant les fruits de nos montagnes ; je vous préviens encore que chaque histoire est précédée d’une courte introduction, où l’on cite les personnes qui en ont fourni les matériaux, et les circonstances qui ont mis l’auteur à même d’en profiter.
CHAPITRE PREMIER.Préliminaires.
« Pourquoi d’un pas infatigable
« Poursuit-il des tombeaux les sentiers ténébreux ?
« – Pour sauver de l’oubli le nom de ses aïeux. »
LANGMORNE.
Il n’est peut-être aucun de nos lecteurs (dit le manuscrit de M. Pattieson) qui, un beau soir d’été, n’ait pris plaisir à considérer la sortie joyeuse d’une école de village. L’esprit, bruyant de la jeunesse, contenu si difficilement pendant les heures ennuyeuses de la discipline, éclate, pour ainsi dire, en cris, en chansons et en gambades, lorsque les marmots se réunissent en groupes sur le théâtre ordinaire de leurs récréations, et y préparent leurs jeux pour la soirée : il est un individu qui a aussi sa part du plaisir qu’apporte cette heure si désirée, mais dont les sentimens ne sont pas aussi évidens aux yeux du spectateur, ou du moins celui-ci ne sympathise pas si volontiers avec lui. Je veux parler du magister lui-même, qui, assourdi par le bourdonnement continuel, et suffoqué par l’air épais de son école, a passé tout le jour (seul contre toute une armée) à contenir la pétulance, à aiguillonner la paresse, à éclairer la stupidité, et à multiplier ses efforts pour réduire l’obstination. La répétition d’une même leçon récitée cent fois, et que varient seulement les bévues des écoliers, a confondu sa propre intelligence ; les fleurs mêmes du génie classique, qui charmaient le plus sa pensée rêveuse, ont été flétries dans son imagination, à force d’être associées aux larmes et aux punitions ; de sorte que les églogues de Virgile et les odes d’Horace ne lui rappellent plus que la figure boudeuse et la déclamation monotone de quelque enfant à la voix criarde. Si à toutes ces peines morales viennent se joindre celles d’un tempérament délicat ; s’il a une âme ambitieuse de quelque fonction plus distinguée que celle d’être le tyran de l’enfance, le lecteur pourra concevoir quel soulagement procure une promenade solitaire, par une fraîche soirée d’automne, à celui dont la tête a souffert et dont les nerfs ont été tendus pendant tout un jour par l’occupation pénible de l’enseignement public.
Pour moi, ces promenades du soir ont été les heures les plus douces d’une vie malheureuse ; et si quelque lecteur indulgent veut bien par la suite trouver du plaisir à parcourir ces pages, fruit de mes veilles, je ne suis pas fâché qu’il sache que le plan en a été presque toujours tracé dans ces momens où, délivré de ma tâche et du bruit, le paysage paisible d’alentour avait disposé mon esprit au travail de la composition.
Mon rendez-vous favori, dans ces heures d’un agréable loisir, est le bord d’un petit ruisseau qui, serpentant à travers une vallée de vertes fougères, va passer devant l’école de Gandercleugh. Dans le premier quart de mille, je peux bien être distrait de mes méditations par la révérence ou le coup de chapeau de ceux d’entre mes élèves qui viennent jusque là pêcher la truite et les fretins dans le petit ruisseau, ou chercher des joncs et les fruits de l’arbousier sur ses rives ; mais au-delà de l’espace que j’ai mentionné, les jeunes pêcheurs n’étendent pas volontiers leurs excursions après le coucher du soleil. La cause en est qu’au bout de la petite vallée, et dans un lieu à l’écart, on trouve un cimetière abandonné, dont les petits tapageurs ont peur d’approcher à l’heure du crépuscule, tandis que pour moi cette enceinte a un charme inexprimable. Ce fut long-temps le but favori de mes promenades, et si mon généreux patron n’oublie pas sa promesse, ce sera probablement bientôt mon lieu de repos après mon pèlerinage dans ce monde10.
C’est un asile qui a toute la solennité des cimetières, sans exciter les autres sentimens moins agréables qu’ils nous font éprouver. Depuis plusieurs années il est tellement abandonné, que ses différens tertres épars ça et là sont couverts de la même verdure qui forme le tapis de toute la plaine. Les monumens, et il n’y en a que sept ou huit, sont à demi enfoncés dans la terre et cachés par la mousse. Aucune tombe récente n’y trouble le calme paisible de nos réflexions en nous retraçant l’image d’une calamité de la veille ; aucune touffe de gazon ne nous force de songer que son abondance est due aux dépouilles corrompues d’un de nos semblables qui fermentent sous la terre. La marguerite, qui émaille le sol, et la campanule, qui y est suspendue en guirlandes, reçoivent leur sève de la rosée pure du ciel, et leur aspect ne nous cause aucune idée repoussante ou pénible. La mort a bien été ici, et ses traces sont devant nous ; mais elles sont adoucies et n’ont plus rien de leur horreur, grâce à l’éloignement où nous sommes de l’époque où elles furent imprimées dans ce lieu pour la première fois. Ceux qui dorment sous nos pieds ne tiennent à nous que par la réflexion que nous faisons qu’ils furent jadis ce que nous sommes aujourd’hui, et que, de même que leurs restes sont identifiés avec la terre, notre mère commune, les nôtres seront soumis un jour à la même transformation.
Cependant, quoique la mousse couvre, depuis quatre générations, les plus modernes de ces humbles tombeaux, la mémoire de ceux qu’ils renfermèrent est encore l’objet d’un culte respectueux. Il est vrai que sur le plus considérable, et le plus intéressant pour un antiquaire, sur le monument qui porte l’effigie d’un valeureux chevalier revêtu de sa cotte de mailles avec son bouclier au bras gauche, les armoiries sont effacées par le temps, et quelques lettres nous laissent incertains s’il faut lire Dns-Johan… deHamel… ou Jehan… de Lamel… Il est vrai encore, quant à l’autre, où sont richement sculptées une mitre, une croix et une crosse, que la tradition peut tout au plus nous apprendre que c’est un évêque inconnu qui y fut enterré.
Mais sur deux autres pierres, à peu de distance, on lit, en prose grossière et en vers aussi peu élégans, l’histoire de ceux qui reposent dessous. L’épitaphe nous assure qu’ils appartinrent à la classe de ces presbytériens persécutés qui figurèrent si malheureusement sous le règne de Charles II et de son successeur11.
En revenant du combat des collines de Pentland, une troupe d’insurgés avait été attaquée dans ce vallon par un détachement des soldats du roi, et trois ou quatre d’entre eux furent tués dans l’escarmouche, ou fusillés comme rebelles pris les armes à la main. Le villageois continue à rendre aux tombeaux de ces victimes du presbytérianisme un honneur qu’il n’accorde guère à de plus riches mausolées : lorsqu’il les montre à ses fils et leur raconte les persécutions de ces temps d’épreuves, il conclut ordinairement par l’exhortation d’être prêts, si les circonstances l’exigeaient, àrésister à la mort, comme leurs braves ancêtres, pour la cause de la liberté civile et religieuse.
Quoique je sois éloigné de respecter les principes singuliers de ceux qui se disent les héritiers de ces hommes qui n’avaient pas moins d’intolérance et de bigoterie que de vraie piété, cependant je ne voudrais point outrager la mémoire de ces infortunés. Plusieurs réunissaient les sentimens indépendans d’un Hampden12 à la résignation d’un Hooper ou d’un Latimer13. D’une autre part, il serait injuste d’oublier que même plusieurs de ceux qui furent les plus actifs à étouffer ce qu’ils appelaient l’esprit séditieux de ces chrétiens errans, ceux-là, même quand vint leur tour de souffrir pour leurs opinions politiques et religieuses, montrèrent la même audace et le même dévouement, qui étaient accompagnés chez eux de la loyauté chevaleresque comme chez les autres de l’enthousiasme républicain.
On a souvent remarqué que la fermeté du caractère écossais se montre avec avantage dans l’adversité, semblable alors au sycomore de nos montagnes, qui dédaigne de plier ses jeunes rameaux sous le vent contraire, mais qui, les déployant dans toutes les directions avec la même vigueur, ne cède jamais à l’orage, et se laisse briser plutôt que de fléchir. Je veux parler de mes concitoyens tels que je les ai observés. On m’a dit que dans les pays étrangers ils sont plus dociles. Mais il est temps de finir ma digression.
Un soir d’été, dans une de mes promenades habituelles, je m’approchais de cet asile des morts, aujourd’hui abandonné, lorsque je fus un peu surpris d’entendre un bruit différent des sons qui en charment ordinairement la solitude, c’est-à-dire le murmure du ruisseau et les soupirs de la brise dans les branches de ces frênes gigantesques, limite du cimetière. Cette fois-ci, je distinguai le bruit d’un marteau, et je craignis de voir réaliser le projet de deux propriétaires qui, ayant leurs terres divisées par mon ruisseau favori, voulaient depuis long-temps faire creuser un fossé pour substituer une fade régularité aux gracieux détours de l’onde14.
En avançant je fus agréablement surpris : un vieillard était assis sur le monument des anciens presbytériens, et activement occupé à retracer avec un ciseau les caractères de l’inscription, qui annonçait en style de l’Écriture les bénédictions célestes réservées aux victimes, et prononçait anathème contre leurs assassins. Une toque bleue, d’une dimension peu commune, couvrait les cheveux gris de ce pieux ouvrier. Son costume était un habit antique du gros drap appelé hoddin-grey que portent les vieillards à la campagne, avec la veste et les culottes de même. L’ensemble de son costume, quoique décent encore, attestait un long service. De gros souliers ferrés et des gramoches ou guêtres en drap noir complétaient son équipement. À quelques pas de lui paissait, parmi les tombeaux, un poney, son compagnon de voyage, dont le poil, d’une blancheur sans mélange, les os saillans et les yeux creux, indiquaient la vieillesse. Il était enharnaché de la manière la plus simple, avec un licol de crin et un sank ou coussin de paille au lieu de bride et de selle. Une poche de canevas pendait au cou de l’animal, pour contenir sans doute les outils de son maître et tout ce qu’il voulait porter avec lui. Quoique je n’eusse jamais vu le vieillard, cependant son occupation singulière et son équipage me firent aisément reconnaître en lui un presbytérien errant dont j’avais souvent entendu parler, et connu dans diverses contrées de l’Écosse sous le nom de Old Mortality15. Où était né cet homme, quel était son véritable nom ? C’est ce que je n’ai pu savoir ; et je ne connais qu’imparfaitement les motifs qui lui avaient fait abandonner sa maison pour adopter cette vie errante.
Suivant la plupart, il était natif du comté de Dumfries ou de Galloway, et descendait en ligne directe de quelqu’un de ces défenseurs du Covenant dont les exploits et les malheurs étaient son entretien de prédilection. On dit qu’il avait précédemment tenu une petite ferme ; mais, soit après des pertes pécuniaires, soit après des malheurs domestiques, il renonça à cet état et à tout autre. Pour me servir du langage de l’Écriture, il quitta sa maison, sa famille, ses amis, et mena une vie errante jusqu’au jour de sa mort, c’est-à-dire pendant une trentaine d’années, dit-on16.
Pendant son long pèlerinage, cet enthousiaste pieux réglait ses courses de manière qu’il visitait annuellement les sépultures des malheureux presbytériens qui avaient souffert par le glaive ou par la main du bourreau sous le règne des deux derniers Stuarts. Ces sépultures sont en grand nombre dans la partie occidentale des districts d’Ayr, de Galloway et de Dumfries, mais on en trouve encore dans toutes les autres parties de l’Écosse où les fugitifs avaient combattu, succombé ou souffert en martyrs. Elle sont souvent écartées de toute habitation humaine : mais partout où elles existaient, Old Mortality ne manquait jamais de les visiter quand elles se trouvaient sur son passage dans sa tournée annuelle.
Au fond des retraites les plus solitaires des montagnes, le chasseur a souvent été surpris de le voir occupé à dépouiller les pierres funéraires de la mousse qui les couvrait, pour rétablir avec son ciseau les inscriptions à demi effacées, et les emblèmes de deuil dont sont ornés les plus simples monumens. Une piété sincère quoique bizarre était le seul motif qu’avait le vieillard pour consacrer tant d’années de sa vie à honorer ainsi la mémoire des défenseurs de l’Église. Il croyait remplir un devoir sacré en conservant pour la postérité les emblèmes du zèle et des souffrances de nos ancêtres, et en entretenant pour ainsi dire la flamme du phare qui devait exciter les générations futures à défendre leur religion au prix de leur sang.
Dans tous ses pèlerinages, le vieillard semblait n’avoir jamais besoin d’assistance pécuniaire, et n’en acceptait jamais. Il est vrai qu’il ne manquait de rien, car partout il trouvait une hospitalité préparée sous le toit de quelque caméronien de sa secte ou de quelque autre personne religieuse. Il reconnaissait toujours l’accueil qu’on lui faisait, en réparant les tombeaux, s’il en existait, de la famille ou des ancêtres de ses hôtes ; et comme il était rencontré le plus souvent occupé à cette tâche pieuse dans quelque cimetière de village, ou penché sur une tombe isolée dans les landes, troublant le pluvier et le merle par le bruit de son ciseau et de son marteau, pendant que son vieux poney paissait à son côté, cette habitude de vivre parmi les tombeaux lui avait fait donner le nom populaire de Vieillard de la mort.
Le caractère d’un homme comme celui-là ne pouvait guère avoir d’affinité même avec une gaieté innocente. Cependant il passe parmi ceux de sa secte pour avoir été d’une humeur riante. Les descendans des persécuteurs, ceux qu’il soupçonnait de partager leurs principes, et les railleurs de la religion, qui lui cherchaient quelquefois querelle, étaient traités par lui de race de vipères ; s’il s’entretenait avec les gens raisonnables, il était grave, sentencieux et même un peu sévère ; mais on dit qu’on ne le vit jamais se livrer à une colère violente, excepté un jour qu’un méchant écolier brisa avec une pierre le nez d’un chérubin que le vieillard retouchait. Je suis généralement très sobre de la verge, malgré la maxime de Salomon, qui ne doit pas mettre ce grand roi en bonne renommée dans les écoles ; mais cette fois-là je jugeai à propos de prouver que je ne haïssais pas l’enfant17.
Je reviens aux circonstances de ma première entrevue avec cet intéressant enthousiaste.
Pour l’aborder, je n’oubliai pas de rendre hommage à son âge et à ses principes, commençant par m’excuser avec respect d’oser interrompre ses travaux Le vieillard fit une pause, ôta ses lunettes, les essuya, et, les remettant sur son nez, répondit à ma politesse avec cordialité. Encouragé par son ton affable, je hasardai quelques questions sur ceux dont il réparait alors le monument. Parler des exploits des presbytériens était son plaisir, comme la conservation de leurs monumens son occupation. Il était prodigue de paroles quand il s’agissait de communiquer tous les détails qu’il avait recueillis sur eux, sur leurs guerres et leurs persécutions. On aurait pu croire qu’il avait été leur contemporain, et qu’il avait vu lui-même tout ce qu’il racontait, tellement il identifiait ses sentimens et ses opinions avec les leurs. – Il y avait dans ses récits tous les détails circonstanciés d’un témoin oculaire.
– C’est nous, disait-il d’un ton inspiré, c’est nous qui sommes les seuls véritables whigs. Des hommes charnels ont usurpé ce titre glorieux en suivant celui dont le royaume est de ce monde. Quels sont ceux d’entre eux qui voudraient s’asseoir pendant six heures sur un coteau pour entendre un pieux sermon ? Au bout d’une heure ils seraient fatigués. Ils ne valent guère mieux que ceux qui n’ont pas honte de prendre le nom de torys, ces persécuteurs altérés de sang. Ce sont tous des hommes intéressés, affamés de pouvoir, de richesses, ivres d’ambition terrestre, et oubliant tout ce qu’ont fait les illustres chrétiens qui bravèrent les méchans au jour de la colère céleste. Faut-il s’étonner s’ils craignent l’accomplissement de ce que prédit le digne M. Peden18, ce pieux serviteur du Très-Haut, dont aucune parole n’est tombée par terre ; faut-il s’étonner s’ils craignent de voir les momies français19 se montrer dans les vallons d’Ayr et sur les coteaux de Galloway, en aussi grand nombre que nos montagnards en 167720. Et ils sont déjà armés de la lance et de l’arc, alors qu’ils devraient gémir sur un royaume de pécheurs et sur la violation du Covenant.
Je calmai le vieillard en ayant soin de ne pas contrarier ses opinions ; et, désireux de prolonger mon entretien avec un personnage si original, je lui persuadai d’accepter l’hospitalité que M. Cleishbotham est toujours bien aise d’offrir àtous ceux qui en ont besoin. En cheminant vers l’école, nous entrâmes à l’auberge de Wallace, où j’étais sûr de trouver mon patron, Après un échange de civilités, le vieillard se laissa entraîner, mais difficilement ; à prendre avec son hôte un verre de liqueur, et cela à condition qu’il porterait lui-même une santé, qu’il fit précéder d’une prière de cinq minutes ; et puis, citant son bonnet et levant les yeux au ciel, il but à la mémoire de ces héros de l’Église qui avaient les premiers arboré sa bannière sur les montagnes. Comme aucune instance ne put l’engager à prendre un second verre, mon patron l’accompagna chez lui, et le logea dans la chambre du prophète : c’est ainsi qu’il appelle ce cabinet qui contient un lit de réserve occupé souvent par le pauvre voyageur21.
Le jour suivant, je pris congé du vieillard de la mort, qui parut touché de l’attention inaccoutumée avec laquelle j’avais cultivé sa connaissance et écouté sa conversation. Quand il fut monté, non sans peine, sur le vieux poney blanc, il me prit la main et me dit : – La bénédiction de notre maître soit avec vous, jeune homme ! mes heures sont comme les épis mûrs, et vos jours sont encore dans leur printemps. Cependant vous pouvez être porté dans les greniers de la mort avant moi, car sa faux moissonne aussi souvent l’épi vert que l’épi mûr ; et il est sur vos joues une couleur qui, comme le vermillon de la rose, ne sert souvent qu’à cacher le ver de la tombe. Travaillez donc comme un ouvrier qui ignore quand son maître viendra : et si Dieu veut que je retourne dans ce village après que vous serez déjà dans le lieu de repos, ces mains ridées vous sculpteront une pierre qui empêchera votre nom de périr.
Je remerciai le vieillard de ses généreuses intentions à mon égard, et je poussai un soupir moins de regret que de résignation, en pensant à la possibilité d’avoir bientôt besoin de ses bons offices. Mais quoique, selon toutes les probabilités humaines, il ne se soit pas trompé en supposant que le fil de ma vie pût être tranché avant le temps, il avait espéré pour lui une trop longue continuation de son pèlerinage sur la terre. Il y a aujourd’hui quelques années qu’il est absent de tous les lieux qu’il fréquentait, tandis que la mousse et le lichen couvrent rapidement ces pierres qu’il avait passé sa vie à protéger contre la dégradation. Vers le commencement de ce siècle, il termina ses travaux mortels, et fut trouvé sur la route de Lockerberry, dans le comté de Dumfries, épuisé et expirant ; le vieux poney compagnon de ses courses se tenait immobile près de son maître, sur lequel on trouva une somme suffisante pour l’enterrer décemment, ce qui prouve que sa mort ne fut hâtée ni par la violence ni par le besoin. Le bas peuple conserve avec respect sa mémoire, et plusieurs croient que les pierres qu’il répara n’auront plus besoin du secours du ciseau. On va même jusqu’à assurer que depuis la mort du vieillard de la mort, les noms des martyrs sont restés lisibles sur les pierres où leur meurtre est constaté, tandis que ceux de leurs persécuteurs, gravés sur les mêmes monumens, sont entièrement effacés. Il n’est guère besoin de dire que ceci n’est qu’une fable, et que depuis la mort du pieux pèlerin les pierres qui étaient l’objet de ses soins tombent chaque année en ruine, comme tous les monumens terrestres.
Mes lecteurs comprendront bien qu’en voulant composer un tout des anecdotes que j’eus l’avantage de recueillir de la bouche du vieillard, je me suis bien gardé d’adopter son style, ses opinions, et même ses récits des faits, quand ils m’ont paru dénaturés par ses préjugés. J’ai tout employé pour les vérifier, en remontant àla source des traditions authentiques que m’ont fournies l’un et l’autre parti.
Du côté des presbytériens, j’ai consulté les fermiers de l’ouest, qui, par la munificence de leurs propriétaires ou autrement, ont pu, malgré le bouleversement de domaines, conserver la jouissance des pâturages dans lesquels leurs pères conduisaient leurs troupeaux. Je dois pourtant avouer que plus nous avançons, plus cette source d’informations m’a paru limitée. J’ai donc eu recours, pour y suppléer, à ces modestes voyageurs que la civilité scrupuleuse de nos ancêtres appelait marchands ambulans ; mais que depuis, copiant en tant d’autres choses les sentimens et les idées de nos voisins plus riches, nous avons nommés comme eux porte-balles ou colporteurs. Je dois reconnaître mes obligations envers ces tisserands de campagne qui voyagent pour débiter leur travail d’hiver, mais surtout envers les tailleurs, qui, grâce à leur profession sédentaire et à la nécessité où ils sont parmi nous de l’exercer en résidant pour un temps dans les maisons de leurs pratiques, peuvent être considérés comme possédant un registre complet de traditions rurales. Je leur suis redevable de plusieurs éclaircissemens sur les récits du vieillard de la mort.
J’ai éprouvé plus de peine à trouver des matériaux pour corriger la partialité de ces astres de la science des traditions, me proposant d’offrir un tableau fidèle des mœurs de cette époque malheureuse, et de rendre en même temps justice aux deux partis. Mais j’ai été à même de modifier les récits du vieillard et de ses amis caméroniens par les rapports de plus d’un descendant de ces anciennes et honorables familles, aujourd’hui déchues dans la vallée de la vie, et qui gardent encore un orgueilleux souvenir du temps où leurs ancêtres combattirent et succombèrent pour la race exilée des Stuarts. Je puis même me vanter de certaines autorités respectables de ce côté, car plus d’un évêque non-conformiste, dont les revenus et le pouvoir étaient réduits sur une échelle aussi apostolique que pourrait le désirer le plus grand ennemi de l’épiscopat, ont daigné, en passant par l’auberge de Wallace, me fournir leurs informations comme correctifs des faits que d’autres m’avaient transmis. Il y a aussi par-ci par-là un laird ou deux qui, tout en haussant les épaules, ne sont guère honteux d’avouer que leurs pères ont servi dans les escadrons persécuteurs d’Earlshall et de Claverhouse. J’ai consulté avec fruit les gardes-champêtres de ces gentilshommes : cette charge est une de celles qui deviennent le plus facilement héréditaires.
Après tout, en retraçant de nos jours les résultats que des principes opposés eurent sur les bons et sur les méchans de chaque parti, je ne dois pas craindre d’être soupçonné de vouloir me rendre coupable d’outrage et d’injustice envers l’un ou l’autre. Le souvenir d’anciennes injures, le mépris et la haine de leurs adversaires, firent naître, il est vrai, la rigueur et la tyrannie dans un parti ; mais on ne saurait nier que, si le zèle de la maison du Seigneur ne dévora pas les partisans du Covenant, il dévora du moins, suivant l’expression de Dryden, beaucoup de leur loyauté, de leur bon sens et de leur bonne éducation. Nous pouvons espérer que les âmes de tous ceux qui étaient de bonne foi et vraiment braves dans les deux partis ont depuis long-temps jeté d’en haut un regard de surprise et de pitié sur les motifs mal appréciés qui causèrent leur haine mutuelle et leur état d’hostilité dans cette vallée de ténèbres, de sang et de larmes. Paix à leur mémoire ! Pensons d’eux ce que l’héroïne de notre seule tragédie écossaise prie son époux de penser de son père défunt22.
Ah ! ne blasphémez point la cendre de mon père :
Soncrime fut alors l’implacable colère,
Crime expié depuis par de cruels malheurs23 !
CHAPITRE II.
« Qu’aux portes du château cent cavaliers choisis
« Soient rassemblés, demain, à nos ordres soumis. »
DOUGLAS.
Sous le règne des derniers Stuarts, le gouvernement employait tous les moyens en son pouvoir pour détruire l’esprit austère de puritanisme, qui avait été le caractère principal du gouvernement républicain. Il cherchait à faire revivre ces institutions féodales qui unissaient le vassal à son seigneur, et qui les attachaient tous deux à la couronne. L’autorité indiquait des revues fréquentes, des exercices militaires, même des jeux et des divertissemens. Cette conduite était impolitique, pour ne rien dire de plus ; car la jeunesse des deux sexes, pour qui la flûte et le tambourin en Angleterre, et la cornemuse en Écosse, auraient été une tentation irrésistible, trouvait un plaisir encore plus doux dans la résistance aux ordres qui lui prescrivaient de danser. Forcer les hommes de danser et de se réjouir par ordre est un moyen qui réussit rarement, même à bord des vaisseaux négriers, où il était jadis tenté quelquefois dans le but de faire prendre un exercice salutaire aux captifs, et de rétablir la circulation de leur sang pendant le peu de temps qu’on leur permettait de respirer l’air sur le tillac.
Le rigorisme des calvinistes augmentait en proportion du désir que le gouvernement montrait de le voir se relâcher. Ceux qui professaient une sainteté plus grande se distinguaient par l’observation judaïque du dimanche et la condamnation des plaisirs les plus innocens, comme de la danse mêlée, c’est-à-dire de la danse des hommes avec les femmes (car je crois qu’ils admettaient que la danse des hommes entre eux ou des femmes entre elles n’était plus un péché) ; ils ne négligeaient rien pour empêcher ceux sur qui ils avaient quelque influence de se montrer lorsque le ban du comté était convoqué pour les anciennes wappen-schaws, ou revues, et que chaque seigneur, sous peine d’encourir de grosses amendes, devait paraître à la tête des hommes d’armes qu’il fournissait, en raison de son fief. Les covenantaires détestaient d’autant plus ces assemblées, que les lords-lieutenans et les shériffs avaient ordre de les rendre agréables aux jeunes gens qu’auraient pu séduire en effet les exercices militaires du matin et les divertissemens qui terminaient la soirée.
Les prédicateurs et leurs fougueux prosélytes n’épargnaient ni avis ni remontrances pour diminuer le nombre de ceux qui s’y rendaient. Ils savaient que, par ce moyen, ils affaiblissaient la force apparente et la force réelle du gouvernement, en empêchant la propagation de cet esprit de corps qui ne manque jamais de régner parmi les jeunes gens habitués à se réunir pour des exercices militaires ou des jeux d’adresse. Ils consacraient donc tous leurs efforts à retenir tous ceux qui pouvaient fournir des excuses pour se dispenser de se montrer à ces assemblées ; leur sévérité censurait surtout ceux de leurs auditeurs que la simple curiosité ou l’attrait des jeux attiraient. Néanmoins, les membres de la noblesse qui partageaient leurs principes ne pouvaient pas toujours se laisser guider par eux. La loi était péremptoire ; et le conseil privé, chargé du pouvoir exécutif en Écosse, appliquait toute la rigueur des statuts contre les vassaux de la couronne qui n’obéissaient pas à l’appel périodique du wappen-schaw. Les propriétaires étaient donc dans la nécessité d’envoyer au rendez-vous leurs fils, leurs tenanciers et leurs vassaux, suivant le nombre de chevaux, d’hommes et de lances qu’ils étaient obligés de fournir. Il arrivait fréquemment que, malgré la stricte recommandation de revenir aussitôt après l’inspection obligée, les jeunes gens ne pouvaient ni résister au désir de prendre leur part des divertissemens qui terminaient la revue, ni se dispenser d’aller écouter les prières prononcées dans les églises à cette occasion. C’était là ce que les pères et mères appelaient, en gémissant, se livrer à la chose maudite qui est une abomination devant le Seigneur.
Le shériff du comté de Lanark avait convoqué le wappen-schaw d’un district pittoresque appelé le canton supérieur du Clydesdale, dans la matinée du 5 mai I679. L’assemblée se tenait dans une grande plaine, près d’un bourg royal24 dont le nom n’est pas bien essentiel à notre histoire. Après la revue, les jeunes gens devaient, selon l’usage, se livrer à divers exercices dont le principal était appelé le tir du Perroquet. C’était la figure d’un oiseau paré de plumes de toutes couleurs, suspendue à une grande perche, et qui servait de but aux compétiteurs pour décharger leurs fusils et leurs carabines, depuis que ces armes avaient remplacé les arcs et les flèches. Celui dont la balle atteignait l’oiseau à la distance de soixante à soixante-dix pas portait le titre glorieux de capitaine du Perroquet pendant le reste du jour, et il était conduit en triomphe au cabaret le plus achalandé du voisinage, où la soirée se terminait sous ses auspices dans les joies de la table.
On pense bien que les dames des environs s’étaient empressées d’assister à cette cérémonie, excepté celles qui, esclaves des lois rigoureuses du puritanisme, auraient cru charger leur conscience d’un crime en autorisant par leur présence les profanes amusemens des impies.
Les landaus, les barouches ou les tilburis n’étaient pas encore connus dans ces temps de simplicité. Le lord-lieutenant du comté (personnage du rang d’un duc) avait seul une voiture portée sur quatre roues, dont la lourde charpente ne ressemblait pas mal aux mauvaises gravures de l’arche de Noé. Huit gros chevaux flamands à tous crins traînaient ce char massif contenant huit places intérieures et six en dehors. Dans l’intérieur étaient Leurs Grâces le lord-lieutenant et sa noble moitié, deux enfans, deux dames d’honneur, et un chapelain rencogné dans une niche latérale formée par une projection de la portière, que sa configuration particulière faisait nommer la botte ; enfin, dans l’enfoncement du côté opposé était un écuyer de Sa Grâce. L’équipage était conduit par un cocher et trois postillons coiffés de grandes perruques à trois queues, ayant de petites épées au côté, des espingoles en sautoir derrière les épaules, et des pistolets aux arçons de leurs selles. Sur le marchepied, derrière cette maison roulante, on voyait debout, en triple rang, six laquais en livrée, armés jusqu’aux dents. Les autres personnages nobles du cortège, hommes et femmes, jeunes et vieux, étaient à cheval, chacun suivi par ses gens et ses vassaux ; mais la compagnie était choisie plutôt que nombreuse, et le lecteur en connaît déjà la cause.
Immédiatement après l’énorme carrosse dont nous venons d’essayer de donner la description, arrivait le palefroi tranquille de lady Marguerite Bellenden, qui réclamait son rang de préséance sur la noblesse non titrée du canton. Elle était en grand deuil, n’ayant jamais quitté ce costume depuis que son mari avait été condamné et exécuté comme partisan de Montrose.
Sa petite-fille, unique objet de toutes ses affections sur la terre, Édith, aux cheveux blonds, était universellement reconnue pour la jeune personne la plus jolie de tout le canton, et semblait, auprès de son aïeule, le printemps à côté de l’hiver. Sa haquenée noire d’Espagne, qu’elle guidait avec grâce, son charmant habit d’amazone et sa selle chamarrée, tout contribuait à la faire remarquer avec avantage. Les boucles nombreuses de ses cheveux, que son chapeau laissait flotter sur ses épaules, étaient retenues par un ruban vert. Ses traits avaient une douceur féminine, mais avec une expression de finesse et de gaieté qui la préservait de la fadeur si souvent reprochée aux blondes et aux yeux bleus. C’était ce qui attirait les regards, plus que l’élégance de ses vêtemens ou que son joli palefroi.
Ces deux dames n’étaient suivies que de deux domestiques à cheval, quoique leur rang ainsi que leur naissance semblassent demander un cortége plus nombreux ; mais la bonne vieille dame n’avait pu parvenir à compléter le contingent d’hommes d’armes que sa baronnie devait fournir : pour rien au monde elle n’aurait voulu rester au-dessous de ses obligations à cet égard, et elle avait métamorphosé tous ses domestiques en militaires. Son vieil intendant, qui, armé de pied en cap, conduisait sa troupe, avait sué sang et eau, comme il le disait, pour vaincre les scrupules et les prétextes des fermiers qui voulaient éluder de fournir les hommes, les chevaux et les harnais exigés par la loi. Enfin la dispute avait fini par une déclaration ouverte des hostilités, l’épiscopal en courroux ayant fait tomber sur les récalcitrans le tonnerre de son indignation, et ayant reçu d’eux en retour la menace de l’excommunication calviniste. Que faire en cette circonstance ? Il pouvait les dénoncer au conseil privé, qui aurait prononcé une amende contre les réfractaires, et envoyé chez eux garnison pour la faire payer : mais c’eût été introduire des chasseurs et des chiens dans un jardin pour y tuer un lièvre.
– Les rustres ne sont pas trop riches, dit Harrison en lui-même, et si les habits rouges viennent leur prendre le peu qu’ils possèdent, comment pourront-ils payer leurs rentes à la Chandeleur ? Il n’est déjà pas trop facile d’obtenir le paiement de ce qu’ils doivent.
En conséquence, Harrison se décida à armer l’oiseleur, le fauconnier, le valet de pied, le garçon de ferme et un vieux ivrogne de sommelier qui, ayant jadis servi dans les rangs des cavaliers avec feu sir Richard, sous Montrose, étourdissait chaque soir toute la maison du récit de ses exploits à Kilsythe et à Tippermoor. C’était d’ailleurs le seul homme de la bande qui eût le moindre zèle pour la cérémonie. De cette manière, et en recrutant deux ou trois braconniers, M. Harrison compléta le contingent que lady Bellenden avait à fournir comme propriétaire de la baronnie de Tillietudlem et autres lieux.
Dans la matinée, comme Harrison passait sa troupe dorée en revue devant la porte de la tour, Mause, mère du valet de ferme, arriva chargée des grosses bottes, de la jaquette en peau de buffle et du reste de l’accoutrement qui avait été envoyé à Cuddy pour le service du jour. Elle les déposa à terre, devant l’intendant, avec une gravité affectée, en l’assurant que, soit que ce fût la colique, soit que ce fût le saisissement subit d’un scrupule de conscience, chose qu’elle ne pouvait décider, Cuddy avait souffert des tranchées atroces toute la nuit, et n’était guère mieux ce matin : – Le doigt de Dieu, ajouta-t-elle, est là-dedans, et mon fils ne doit pas prendre part à de telles corvées. Vainement on menaça Mause de lui donner son congé et de la punir ; elle resta obstinée : une visite domiciliaire eut lieu sur-le-champ, et l’on trouva Cuddy hors d’état de répondre autrement que par de profonds gémissemens. Mause était une ancienne domestique de la famille, et une espèce de favorite de lady Margaret : elle avait donc des priviléges. Lady Margaret était déjà en route pour le wappen-schaw, on ne pouvait en appeler à son autorité. Dans cette extrémité, le génie du vieux sommelier trouva un expédient fort heureux.
– Pourquoi ne pas prendre Goose Gibby ? s’écria-t-il ; j’ai vu combattre sous Montrose bien des gens qui ne valaient pas Goose Gibby.
Gibby était un jeune garçon un peu niais, d’une très petite taille, etchargé du soin de la basse-cour sous l’inspection de celle qui en avait la surintendance ; car dans une famille écossaise de ce temps-là il y avait une grande subrogation detravaux. On envoya chercher le marmot ; on l’affubla de la jaquette de peau de buffle, dont il pouvait à peine supporter le poids ; ses petites jambes entrèrent dans d’énormes bottes ; un casque lui couvrit la tête presque jusqu’au menton, comme un éteignoir, et on attacha un grand sabre à son côté, ou, pour mieux dire, ce fut lui qu’on attacha à un grand sabre. Ainsi accoutré, Gibby fut hissé, à sa demande, sur le cheval le plus doux qu’on put trouver. Instruit et soutenu par le vieux sommelier Gudyil, qui se chargea d’être son chef de file, il passa la revue comme les autres, le shériff ne croyant pas devoir examiner très scrupuleusement les recrues d’une dame aussi bien disposée pour le roi que l’était lady Bellenden.
Telle est la cause qui força lady Bellenden à se montrer en public sans autre suite que deux laquais, ce dont elle aurait rougi en toute autre circonstance : mais il n’était pas de sacrifice personnel, même celui de son amour-propre, quelle ne fût prête à faire à la cause de la royauté. Elle avait perdu son mari et deux fils de grande espérance dans les guerres civiles qui avaient eu lieu à cette époque malheureuse ; mais elle en avait reçu une récompense flatteuse : lorsque Charles II traversait l’ouest de l’Écosse pour aller livrer bataille à Cromwell dans la plaine fatale de Worcester, il s’était arrêté au château de Tillietudlem, et y avait accepté un déjeuner. Cet événement faisait une époque importante dans la vie de lady Marguerite Bellenden, et il était bien rare qu’elle passât un seul jour sans trouver occasion de citer quelque circonstance de la visite dont le roi l’avait honorée, sans oublier que Sa Majesté avait daigné l’embrasser sur les deux joues, mais omettant d’ajouter qu’il avait accordé la même faveur à deux servantes fraîches et réjouies, métamorphosées pour ce jour-là en dames d’honneur.
Une telle marque de la faveur royale aurait bien suffi sans doute pour que lady Marguerite embrassât à jamais la cause des Stuarts ; mais sa naissance, son éducation, et sa haine pour le parti opposé, l’avaient déjà irrévocablement attachée à leur fortune. Ils semblaient triompher en ce moment ; mais lady Margaret avait été fidèle à leur cause dans les circonstances les plus critiques, et elle était prête à braver les mêmes revers, si le sort les trahissait encore. Ce jour-là elle jouissait pleinement de voir déployer une force prête à soutenir les intérêts de la couronne, et dévorait en secret la mortification qu’elle éprouvait en se trouvant abandonnée d’une partie de ses propres vassaux.
Respectée par toutes les anciennes familles du comté, elle vit tous les chefs de maison qui assistaient à la revue s’empresser de lui rendre leurs hommages, et il n’y eut pas un jeune homme de distinction qui, se tenant ferme sur ses étriers et se redressant sur son cheval, ne vînt caracoler devant miss Édith Bellenden, pour déployer l’adresse avec laquelle il guidait sa monture ; mais tous ces jeunes cavaliers, distingués par leur rang et leur loyauté héréditaire, n’obtenaient d’Édith rien au-delà de ce qu’exigeaient les lois de la courtoisie. Elle écoutait avec une égale indifférence les complimens qu’on lui adressait, et dont la plupart étaient pillés des longs romans de La Calprenède et de Scudéry, modèles dans lesquels la jeunesse de ce siècle aimait à étudier ses sentimens et ses discours, jusqu’à ce que la folie du temps s’ennuyant de ces éternelles rapsodies de Cyrus, de Cléopâtre, et d’autres, les réduisit en petits volumes aussi courts que ceux que j’entreprends de faire lire aujourd’hui25. Mais le destin avait décidé que miss Bellenden ne montrerait pas la même indifférence pendant tout le cours de la journée.
CHAPITRE III.
« Le poids de son armure écrasant le guerrier,
« Il tombe, et dans sa chute entraîne son coursier. »
CAMPBELL. Les Plaisirs de l’espérance.
Après les évolutions militaires, qui se firent aussi bien qu’on pouvait l’attendre d’hommes inexpérimentés et de chevaux non dressés, de grands cris annoncèrent que les compétiteurs pour le prix du perroquet allaient s’avancer.
Le mât ou grande perche avec une gaule en croix ; à laquelle le but était suspendu, fut élevé au milieu des acclamations de l’assemblée ; même ceux qui avaient vu les évolutions de la milice féodale avec une espèce de sourire ironique, par haine contre la famille royale qu’ils avaient l’air de soutenir, ne purent s’empêcher de prendre intérêt à ce nouvel exercice.
On accourut en foule ; on critiqua la tournure de chaque compétiteur qui, par son plus ou moins d’adresse, excitait la risée ou les applaudissemens des spectateurs. Bientôt on vit s’approcher un jeune homme avec son fusil à la main, vêtu avec simplicité, mais avec une certaine prétention d’élégance ; son manteau vert était jeté négligemment sur ses épaules, et sa fraise brodée et sa toque à plumes annonçaient qu’il était au-dessus de la classe commune ; un murmure confus s’éleva à l’instant, et il aurait été difficile de juger s’il lui était favorable.
– Est-il possible, disaient les vieux et zélés puritains que leur curiosité, plus forte que leur fanatisme, avait conduits parmi les spectateurs ; – est-il possible que le fils d’un tel père prenne part à ces folies indécentes ? Les autres, et c’était la majeure partie, souhaitaient le succès du fils d’un des anciens chefs des presbytériens, sans s’inquiéter s’il lui convenait de disputer le prix.
Leurs vœux furent exaucés : l’aventurier du manteau vert tira et atteignit le perroquet, et c’était le premier coup qui comptât de la journée, quoique plusieurs balles eussent passé très près du but. Une acclamation presque générale s’éleva ; mais son succès n’était pas encore décisif. Il était nécessaire que ceux qui venaient après lui eussent la même chance, et ceux qui, comme lui, toucheraient le but, devaient concourir entre eux jusqu’à ce qu’un des compétiteurs obtînt une supériorité complète sur les autres. Il n’y en eut que deux de ceux qui n’avaient pas encore tiré qui atteignirent le perroquet. L’un était un homme appartenant évidemment à la classe du peuple d’un air commun, et enveloppé d’un grand manteau vert lequel il se cachait soigneusement la figure ; l’autre était un jeune cavalier d’un extérieur agréable, et paré avec quelque recherche. Depuis la fin de la revue, il était resté constamment près de lady Marguerite et de miss Bellenden, et les avait quittées avec un air d’indifférence, lorsque la vieille dame témoigna son regret qu’il ne se présentât aucun compétiteur noble et du parti royaliste pour disputer le prix. Le jeune lord Evandale, en moins d’une minute, descendit de cheval, emprunta un fusil à son domestique, et, comme nous l’avons dit, toucha le but.
La lutte s’ouvrit de nouveau entre les trois concurrens heureux, et l’intérêt des spectateurs redoubla. Le lourd équipage du duc fut mis en mouvement, non sans difficulté, et s’approcha du lieu de la scène ; les dames et les gentilshommes tournèrent de ce côté la tête de leurs chevaux : tous les yeux étaient attentifs au résultat de cette lutte.
Selon les anciens usages, les compétiteurs tirèrent leur tour au sort. Le hasard décida que le jeune plébéien tirerait le premier. Il prit son poste, découvrit à demi son visage campagnard, et dit au jeune homme vêtu d’un manteau vert : – Écoutez, M. Henry, en toute autre occasion je chercherais à manquer le but pour vous en laisser l’honneur ; mais Jenny Dennison nous regarde, et je dois faire de mon mieux.
Il ne réussit pourtant pas, quoique sa balle sifflât si près du but que l’oiseau fut ébranlé évidemment. Aussitôt, baissant les yeux, il s’enveloppa de son manteau, et se retira bien vite, comme s’il avait eu peur d’être reconnu.
Le tireur vert s’avança, et sa balle frappa une seconde fois le perroquet. Les acclamations furent générales, et du centre de l’assemblée s’éleva ce cri : – La bonne cause pour toujours !
Les dignitaires du canton fronçaient le sourcil en entendant ces cris des malintentionnés ; mais lord Evandale obtint aussi à son tour le même succès.
Les félicitations bruyantes et les applaudissemens des royalistes et de la partie aristocratique de l’assemblée ne lui furent pas épargnés ; mais l’épreuve n’était pas finie.
Le tireur vert, comme s’il était résolu à terminer l’affaire d’une manière décisive, prit son cheval, qu’il avait confié à un des spectateurs, s’assura de la solidité des sangles de la selle, mit le pied à l’étrier, et, faisant signe de la main à la foule de s’écarter, joua des éperons, traversa au galop la place d’où il allait tirer, lâcha la bride, se retourna sur sa selle, déchargea sa carabine, et abattit le perroquet. La plupart de ceux qui entouraient lord Evandale lui dirent que c’était une innovation aux usages établis, et qu’il n’était pas obligé de l’imiter. Il voulut pourtant suivre cet exemple ; mais, ou son adresse n’était pas aussi parfaite, ou son cheval n’était pas si bien dressé : à l’instant même où il lâchait son coup, l’animal fit un saut, et la balle n’atteignit pas l’oiseau.
On fut alors aussi charmé de la courtoisie du jeune homme en manteau vert qu’on l’avait été de son adresse. Il s’avança vers lord Evandale, lui dit qu’il ne pouvait se prévaloir d’un accident, et lui proposa une nouvelle épreuve à pied.
– Je la ferais plus volontiers à cheval, dit le lord, si j’en avais un aussi bien dressé que le vôtre.
– Voulez-vous me faire l’honneur de le monter, et de me prêter le vôtre ? dit le jeune homme.
Lord Evandale était presque honteux d’accepter cette offre. Il sentait qu’elle diminuerait le prix de la victoire s’il la remportait ; il désirait cependant rétablir la réputation de son adresse. Il lui dit donc qu’il lui cédait l’honneur de la journée, qu’il n’y conservait aucune prétention : mais qu’il acceptait volontiers sa proposition, et que le nouvel essai qu’ils allaient faire serait en l’honneur de leurs amours.
En parlant ainsi, il jeta un regard passionné du côté de miss Bellenden, et la tradition rapporte que les yeux du jeune tireur vert prirent la même direction, mais plus clandestinement. Le résultat de cette dernière épreuve fut le même que celui de la précédente, et ce fut avec peine qu’il continua d’affecter cet air d’indifférence moqueuse qu’il avait pris jusqu’à ce moment ; mais, craignant le ridicule qui s’attache toujours à un adversaire vaincu, il rendit le cheval du vainqueur et reprit le sien. – Je vous remercie, lui dit-il, d’avoir rétabli mon cheval dans ma bonne opinion. J’étais disposé à lui attribuer ma défaite, et je vois à présent que je ne dois en accuser que moi-même. Ayant prononcé ces paroles avec un ton léger d’insouciance pour cacher sa mortification réelle, il remonta sur son coursier et s’éloigna.
Suivant l’usage ordinaire du monde, les applaudissemens de ceux mêmes qui favorisaient lord Evandale furent accordés à son heureux rival, et toute l’attention de l’assemblée fut dirigée vers lui.
– Qui est-il ? quel est son nom ? s’écriaient de toutes parts ceux qui ne le connaissaient pas. On ne tarda pas à l’apprendre, et dès qu’on sut qu’il appartenait à cette classe à qui l’on peut marquer des égards sans déroger, quatre amis du duc, avec l’empressement que le pauvre Malvolio26 attribue à son cortége imaginaire, vinrent l’inviter à se présenter devant lui. Comme ils le conduisaient à travers la foule, en l’accablant de complimens sur son triomphe, il passa vis-à-vis de lady Bellenden. Ses joues prirent un incarnat plus vif lorsqu’il salua miss Édith, dont le visage se couvrit d’une semblable rougeur en lui rendant, avec une courtoisie mêlée d’embarras, son salut respectueux.
– Vous connaissez donc ce jeune homme ? dit lady Marguerite.
– Je… oui… je l’ai vu chez mon oncle, et… ailleurs aussi… quelquefois… par hasard.
– J’entends dire que c’est le neveu du vieux Milnwood.
– Oui, dit un gentilhomme qui était à cheval près de lady Marguerite. C’est le fils de feu le colonel Morton de Milnor, qui commandait pour le roi un régiment de cavalerie à la bataille de Dunbar et à Inverkeithing.