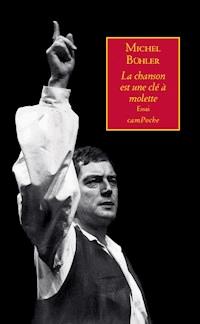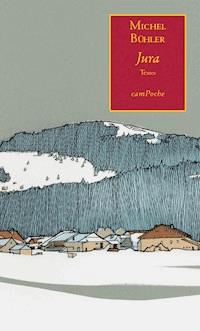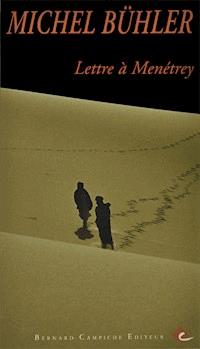
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Des pensées couchées sur papier comme un acte libérateur
Dans la
Lettre à Menétrey, Michel Bühler s’adresse à un ami, mort il y a deux ans. Bilan d’une vie et d’une amitié. Portrait aussi d’un « pays qui dort » (la Suisse) et, en pointillé tout au long du récit, un voyage dans les Territoires Occupés, en Palestine. Une fois de plus, Michel Bühler frappe par sa générosité, sa façon pudique, mais ferme, de dire les choses de la vie. Émergent aussi de ce livre le portrait attachant d’un homme hors du commun et l’histoire d’une grande amitié.
Un récit émouvant qui nous donne à voir l'existence sous un autre jour
EXTRAIT
Fin d’après-midi. Nous venions de rentrer d’un périple dans le désert, une petite semaine avec des chameaux, guidés par Mokhtar, yeux bleus, visage fin. Je m’étais assis sur une pierre, le dos appuyé au mur ocre de ta maison. Au-dessus de ma tête, un volet vert, devant moi le talus qui descendait jusqu’aux foggaras – j’y avais remarqué quelques petits têtards, le matin, en allant remplir notre cruche. Ciel immensément bleu. Le soleil descendait derrière les montagnes rouges. Dans l’oued, des gamins ramenaient leurs troupeaux de petites chèvres noires. Il devait même y avoir, pour faire bonne mesure, quelques chameaux dans le décor, et le braiment d’un âne du côté du village.
Et tout à coup, comme un souffle chaud, un sentiment de bonheur total m’avait envahi ! J’étais sur une planète qui était la mienne, libre, apaisé. Je grandissais jusqu’aux limites du paysage. Cela a duré jusqu’à ce que la nuit vienne.
J’ai gardé ces instants en moi. Maintenant, quand il m’arrive d’être mal dans ma tête, quand une insomnie me hante, je pense « désert », m’envole pour le Hoggar, et me retrouve dans cette vallée bénie.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Michel Bühler écrit en poste résistante. La Lettre à Menétrey est à la fois un livre d’amitié, de bourlingue, de nostalgie et de colère. Le meilleur de son auteur !" -
Jean-Louis Kuffer, 24 Heures
"L’amitié est au centre de ce livre pudique dédié à l’ami disparu un soir de juin à 68 ans. Pour l’auteur, poète et chanteur aussi, originaire du «pays qui dort» – la Suisse –, il fut le compagnon de tous les combats et des quatre cents coups. Michel Bühler déambule dans les sentiers de la mémoire, prenant l’ami à témoin." -
Ruth Valentini, Le Nouvel Observateur
A PROPOS DE L’AUTEUR
Michel Bühler est l’un des chanteurs suisses les plus connus. Auteur de plus de deux cents chansons, il a également publié trois romans,
La Parole volée (traduit en allemand chez Limmat Verlag),
Un notable et
La Plaine à l’Eau Belle, trois récits,
Cabarete, Lettre à Menétrey et
Un si beau printemps, et de nombreuses pièces de théâtre. Michel Bühler, qui demeure l’un des rares auteurs romands à rendre compte des problèmes politiques et sociaux de son pays, n’hésite pas à prendre part à des actions de solidarité et de défense des opprimés. Partageant son temps entre carrière littéraire et musicale, il vit actuellement à L’Auberson (Vaud) et à Paris.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michel Bühler
Lettre à Menétrey
Fin d’après-midi. Nous venions de rentrer d’un périple dans le désert, une petite semaine avec des chameaux, guidés par Mokhtar, yeux bleus, visage fin. Je m’étais assis sur une pierre, le dos appuyé au mur ocre de ta maison. Au-dessus de ma tête, un volet vert, devant moi le talus qui descendait jusqu’aux foggaras – j’y avais remarqué quelques petits têtards, le matin, en allant remplir notre cruche. Ciel immensément bleu. Le soleil descendait derrière les montagnes rouges. Dans l’oued, des gamins ramenaient leurs troupeaux de petites chèvres noires. Il devait même y avoir, pour faire bonne mesure, quelques chameaux dans le décor, et le braiment d’un âne du côté du village.
Et tout à coup, comme un souffle chaud, un sentiment de bonheur total m’avait envahi ! J’étais sur une planète qui était la mienne, libre, apaisé. Je grandissais jusqu’aux limites du paysage. Cela a duré jusqu’à ce que la nuit vienne.
J’ai gardé ces instants en moi. Maintenant, quand il m’arrive d’être mal dans ma tête, quand une insomnie me hante, je pense « désert », m’envole pour le Hoggar, et me retrouve dans cette vallée bénie.
Michel Bühler est l’un des chanteurs suisses les plus connus. Auteur de plus de deux cents chansons, il a également publié trois romans, La Parole volée (traduit en allemand chez Limmat Verlag), Un notable et La Plaine à l’Eau Belle, deux récits, Cabarete et Lettre à Menétrey, et de nombreuses pièces de théâtre. Michel Bühler, qui demeure l’un des rares auteurs romands à rendre compte des problèmes politiques et sociaux de son pays, n’hésite pas à prendre part à des actions de solidarité et de défense des opprimés. Partageant son temps entre carrière littéraire et musicale, il vit actuellement à L’Auberson (Vaud) et à Paris.
Dans la Lettre à Menétrey, Michel Bühler s’adresse à un ami, mort il y a deux ans. Bilan d’une vie et d’une amitié. Portrait aussi d’un « pays qui dort » (la Suisse) et, en pointillé tout au long du récit, un voyage dans les Territoires Occupés, en Palestine. Une fois de plus, Michel Bühler frappe par sa générosité, sa façon pudique, mais ferme, de dire les choses de la vie. Émergent aussi de ce livre le portrait attachant d’un homme hors du commun et l’histoire d’une grande amitié.
Couverture : photographie de Régis Colombo / diapo.ch
Michel Bühler
Lettre à Menétrey
« LETTRE À MENÉTREY »,CENTTRENTE ET UNIÈME OUVRAGEPUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR,A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION DE LINE MERMOUD,HUGUETTE PFANDER, MARIE-CLAUDE SCHOENDORFF,DANIELA SPRING ET JULIE WEIDMANNMISE EN PAGES : BERNARD CAMPICHECOUVERTURE : PHOTOGRAPHIE DE RÉGIS COLOMBO / DIAPO.CHPHOTOGRAPHIE DE L’AUTEUR : HORST TAPPE, MONTREUXPHOTOGRAVURE : IMAGES 3, LAUSANNEIMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE CLAUSEN &BOSSE, LECK(OUVRAGE IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE)
ISBN PAPIER 2-88241- 130-8ISBN NUMÉRIQUE 978-2-88241-352-9TOUSDROITS RÉSERVÉS© 2003BERNARD CAMPICHE ÉDITEURGRAND-RUE 26 – CH -1350ORBEWWW.CAMPICHE.CH
TONITRUANT.
C’est le premier mot qui me vient à l’esprit.
Tu étais tonitruant, bruyant, impétueux, démesuré. Hors normes, dans notre pays étriqué. Comment ton corps a-t-il supporté les hectolitres de vin, les quintaux de saucissons, les tonnes de pieds de cochon, de cervelle au beurre noir, de tripes et d’andouillettes qui, faisant tes délices, ont transité par ton système digestif, et se sont transformés en éclats de rire, en clameurs, durant les soixante-huit années de ton passage sur Terre ? Mystère.
Un colosse aux cheveux drus, au fin collier de barbe, aux narines larges, tel un mufle, faites pour aspirer goulûment, avec bonheur et d’un seul coup, l’air de tout un canton. Un géant aux lèvres gourmandes, à la voix chaude et puissante, propre à entonner, péremptoire, à hurler plutôt L’Internationale, ou Nobody Knows, ou Les Trois Orfèvres. Une force de la nature, le premier à lever son verre, le dernier à réclamer à grands cris l’ultime bouteille, puis bien sûr quelques autres encore, pour faire bonne mesure, voilà ce que tu étais.
Debout. Tu étais debout, ne vivant que d’exagération, de trop, d’excès. En amitié, aussi.
Et tout s’est achevé, pour toi, un soir de juin.
Tu étais au téléphone, dans le tout petit appartement valaisan où tu passais ta retraite, plafond bas, parois de bois sombre, racontant ta journée à Rita. Ton amoureuse devait t’écouter, joyeuse, marchant sur l’herbe de son jardin, dans son village des environs de Lausanne. Tu avais eu, comme cela t’arrivait fréquemment depuis quelques mois, du mal à respirer dès le matin. Tu as dit, soudain : « Ça tourne… » Rita a entendu un bruit de chute, puis plus rien. Affolée, elle a crié : « Jean-Claude, Jean-Claude ! »
Elle a cherché fébrilement dans ses papiers le numéro de téléphone de ta voisine.
Celle-ci t’a retrouvé étendu à terre, le visage dans ton tapis de laine blanche, le cœur arrêté depuis quelques minutes. La vie, ce souffle mystérieux, cette flamme qui animait ton corps, cette étrange veilleuse qui brûle lentement en chacun d’entre nous, t’avait quitté.
I
ParisRue Pernety
JE COMMENCE à écrire ceci le 11 septembre 2002, dans le petit rez-de-chaussée de mon amour à moi, Anne, dans le XIVe arrondissement de Paris.
Des jours déjà qu’on nous rebat les oreilles avec l’anniversaire des attentats de New York, qu’on nous projette en boucle les images des avions s’encastrant dans les parois de verre, des désespérés qui se jettent dans le vide, des tours jumelles qui s’effondrent dans un nuage de poussière.
Marre.
Tout à l’heure, je vais allumer la radio pour écouter les informations. On ne parlera naturellement que de terrorisme, de blessure, de vengeance légitime. Deux mille huit cent une victimes… C’est affreux, c’est trop. Les dizaines de milliers de personnes qui meurent, de faim, quotidiennement, les signalera-t-on aussi ? Non : c’est d’un banal…
Tu t’en es allé en l’an deux mille. Le lundi qui a suivi la Saint-Jean, la fête patronale de Médières, ton village d’adoption. Tu n’as donc rien su de cette attaque contre l’empire américain. Quoique. CNN est partout, il n’est pas impossible que l’on capte cette chaîne de télévision là où tu es maintenant. Pas impossible, même, que mes pensées te parviennent, du côté de Proxima du Centaure, où je te vois te prélasser dans un hamac, un verre de rhum punch à la main, un cigare cubain planté au coin de ta bouche. Veinard, va, plus de risque de cirrhose, ou de cancer, là-haut !
Je plaisante. Tu n’es plus nulle part. Tes cendres sont en terre, au bas du cimetière qui jouxte l’église du Châble, dans le val de Bagnes. Sur un petit bloc de granit, ta femme, Françoise, a fait graver : J.-C. Menétrey, 1932 – 2000. Rita m’a confié que tu aurais certainement préféré que l’on mette ton prénom tout entier. Les deux initiales, seules, te rappelaient trop un certain Jésus de Nazareth, que tu avais cessé de fréquenter depuis la fin de ton adolescence.
Tu n’es plus nulle part, sauf dans la mémoire de quelques-uns, et dans ma tête.
Les souvenirs que j’ai de toi… les déposer sur ces pages, avant qu’ils s’effacent. Une façon de te faire un signe par-delà la mort, de te maintenir, pour un temps, dans la lumière, au-dessus du puits de l’oubli.
Pour toi, donc, cette lettre. Instants sauvés, journal parfois, coups de gueule. Tout et n’importe quoi. Comme quand tu étais là.
*
Qui a dit que, en avançant en âge, on ne se fait plus de vieux amis ?
C’est ainsi. Certains s’en vont dans la terre, certains, on ne les voit plus, parce qu’ils sont ailleurs, dans une autre ville, occupés à un autre travail. Vieillir, c’est avancer vers la solitude ? L’oncle Gustave, qui vient de fêter son nonante-neuvième anniversaire, dit en haussant les épaules : « Je ne connais plus personne, au village, il n’y a plus que des jeunes. » Le village, c’est Sainte-Croix, où j’ai passé mon enfance.
*
La date, sur le calendrier, me ramène un souvenir… Allez, viens, suis-moi à l’autre bout de la planète !
Comment ? C’est un peu brusque, je te bouscule ? Monsieur n’était pas préparé à ce départ précipité ? Eh ! Ça fait plus de deux ans que je rumine, que je me dis à tout bout de champ : « J’aimerais raconter ce voyage à Jean-Claude, partager avec lui ce paysage, lui demander son avis… » Tu n’avais qu’à pas t’en aller ! Il faudra t’y faire, nous allons courir le monde !
Mille neuf cent nonante-huit, Santiago. Je ne t’avais pas rapporté chaque jour de ce voyage au Chili.
Hémisphère Sud, printemps brumeux. Le pays célébrait le vingt-cinquième anniversaire du coup d’État du général Pinochet, le vingt-cinquième anniversaire de l’assassinat de Salvador Allende, et de la démocratie chilienne, par les militaires, armés et encouragés par les États-Unis d’Amérique.
Un onze septembre…
Alors, tu comprends que, ayant de la mémoire, j’ai regardé le World Trade Center s’écrouler avec moins de surprise que d’autres gens. La tempête a éclaté… je savais que le vent avait été semé depuis longtemps. Ce jour-là, il n’y a pas eu pour moi tout le bien d’un côté et tout le mal de l’autre, les cow-boys innocents contre les affreux Indiens.
Il faisait frisquet devant la morgue, à l’entrée du cimetière général. La ville, silencieuse, était recouverte par un plafond de nuages, bas et jaunes. Une petite foule, quelques centaines de personnes, se pressait sur le trottoir, débordait sur la rue. Des rives du rio Mapocho, du quartier populaire qui entoure le grand marché, de tous les faubourgs, des hommes, des femmes de tous âges ne cessaient d’arriver, le visage grave. Ils saluaient brièvement, d’un mot ou deux, les amis, les connaissances. Les gens dansaient d’un pied sur l’autre, se frottaient les mains pour les réchauffer.
Un groupe de jeunes filles se sont mises à chanter doucement. Il ne s’est pas écoulé vingt secondes avant que tout le monde les accompagne, bouche fermée, ou murmurant les paroles. C’était une chanson de celui que nous étions venus saluer, Victor Jara. Composée au retour d’un voyage au Viêtnam, elle demandait : El derecho de vivir en paz… le droit de vivre en paix…
Qui a donné le signal ? Nous étions mille alors, peut-être le double. Nous nous sommes mis lentement à pénétrer dans le cimetière, suivant les grands drapeaux rouges qui s’étaient déployés en tête de cette procession laïque.
Chez certains, qui parlent haut et fort aujourd’hui, le drapeau rouge ne rallume, semble-t-il, le souvenir que du goulag, de l’oppression, des massacres staliniens. En moi, il réveille des images de l’enfance, lorsque les ouvriers de Sainte-Croix, solidaires, mais fragiles, mais déterminés malgré tout dans leur combat, défilaient le 1er Mai, derrière la bannière du syndicat. Il me dit la lutte des petits contre la misère, contre la guerre, et pour la dignité. Et merde !
Je marchais à côté d’Angel Parra, chanteur, sorti vivant, comme par miracle, du stade et des bagnes de la junte militaire. Comme nous passions devant le long monument qui porte les noms des victimes de la dictature, un adolescent, devant nous, a chuchoté pour son voisin :
— Il y a mon grand-père, dans cette liste…
Angel, sans me regarder, s’est mis à raconter :
— La radio diffusait des messages, invitant la population à signaler les gens suspects. C’est ma voisine qui m’a dénoncé, trois jours après le coup d’État. Une brave dame, qui me saluait en souriant tous les matins. Elle a appelé la police : « Vous avez oublié d’arrêter M. Parra, il est communiste, savez-vous ? » Dans le stade, les soldats nous faisaient mettre en rangs de temps en temps. Ils choisissaient une personne sur dix : « Toi, toi… » On entendait des coups de feu, on ne les revoyait jamais.
Le bruit de milliers de pas sur le gravier, le flot des têtes qui semblait ralentir entre les tombes, et laissait un espace vide vers le fond du cimetière.
— Le président de la Fédération internationale de football est venu inspecter le terrain, où allaient se dérouler des matches. On nous a fait descendre dans les sous-sols, on nous a entassés dans des vestiaires pendant sa visite. Il savait très bien que nous étions là, promis à la mort, détenus sans jugement. Il est passé, il n’a rien dit. Il s’appelait Joaõ Havelange…
Angel a hoché la tête, puis m’a regardé, pensif :
— Quand il fallait appeler quelqu’un, ou annoncer quelque chose, les militaires utilisaient les haut-parleurs du stade. Un jour, j’ai entendu une voix nasillarde qui prononçait mon nom : « Le détenu Angel Parra doit immédiatement se présenter au bureau du commandant ! » Il y a eu un silence, puis quelques applaudissements, timides, hésitants. Puis, tout à coup, sur la pelouse, dans les gradins, tous les prisonniers ont relevé la tête, et se sont mis à m’acclamer ! Jamais plus je n’ai reçu une telle ovation. Ce qu’on me disait, c’était que je me trouvais parmi des frères, tout autant en danger, tout aussi misérable qu’eux. Et ça, tu vois, ça vaut dix Prix Nobel !
La foule, maintenant, s’était arrêtée au pied d’une modeste tribune, devant un mur où étaient aménagés une centaine de casiers : les sépultures des pauvres.
— C’est là qu’on a mis son corps, a murmuré Angel, il y a vingt-cinq ans. Certains auraient voulu le déplacer, lui faire élever un monument. Sa famille s’y est opposée.
Une femme proche de la cinquantaine, grande, le visage mince, est montée sur l’estrade, quelques feuilles à la main. Elle s’est approchée du micro. Angel a soufflé :
— Sa veuve…
La rumeur dit qu’il a été reconnu par les soldats, dans le stade, aux premières heures du putsch :
— C’est toi, Victor Jara ? Le chanteur, le guitariste ?
Il a hoché la tête. Les militaires lui ont ordonné de poser ses bras sur un muret, et lui ont brisé les poignets à coups de crosse, avant de l’achever. D’autres disent qu’on lui a coupé les mains.
Dans un espagnol teinté d’accent anglais, la femme a rappelé qu’on avait découvert le pauvre corps de son mari dans un fossé. Elle avait été avertie par des employés de la morgue, qui avaient reconnu Jara au milieu d’une centaine d’autres cadavres. J’entends encore certaines phrases :
— Le souvenir du sourire de Victor, de son visage lumineux, de l’artiste plein de promesses… On nous demande aujourd’hui de pardonner. Mais pardonner à qui, puisqu’on nous dit que personne n’est coupable ?
Sa voix, mêlée de sanglots, s’envolait par-dessus les fronts penchés, par-dessus les tombeaux décorés de fleurs de plastique. Le discours achevé, il s’est fait un silence.
Soudain un homme a lancé ces mots, bientôt repris, bientôt scandés par la foule entière :
— El pueblo unido, jamás serà vencido !
Alors ont éclaté dans la sono quelques notes claires de guitare. Puis Victor Jara, enregistré au début des années septante, magnifique dans sa jeunesse, s’est mis à chanter :
— Levantate, y mira la montaña ! Lève-toi, et regarde la montagne, d’où viennent le vent et l’eau…
Après la fin de la chanson, nous sommes restés un peu, hésitant à nous séparer, nous regardant les uns les autres. Un pâle soleil commençait à percer la brume.
*
Combien de fois, Jean-Claude, nous faudra-t-il, dans le brouillard, crier ce slogan menteur, ces mots dérisoires parce qu’ils parlent d’un espoir superbe mais toujours trahi : « Le peuple uni ne sera jamais vaincu » ? Combien de fois encore porterons-nous le deuil, dis-moi, avant que les petits, ceux qui ne demandent rien d’autre que de vivre au jour le jour, cessent enfin d’en prendre plein la gueule, aux quatre coins du monde et douze mois par année ? Est-ce donc inévitable ?
Tu avais enseigné l’histoire et la littérature dans un collège lausannois, le latin et le grec aussi. Tu devais avoir lu les philosophes, tu devais savoir que l’humain se bâtit lentement, et souvent retombe vers la bête.
Début du vingt et unième siècle : les mercantis tiennent le haut du pavé, on s’incline devant les escrocs. À la télévision, on nous donne à voir les résidences des plus malins, les piscines des retors, les palais des sans-scrupules. Les braves gens suivent la vie des stars dans les magazines, et répètent ce qu’on leur a seriné depuis des années :
— Le monde est ainsi fait, on n’y changera rien…
Sont-ils envieux, désabusés ? Même pas. Ils achètent chaque semaine leur ticket de loto.
Il y a si longtemps qu’on le leur affirme : les transformations qui affectent la société, et les rabaissent, sont « inéluctables » ! L’enrichissement honteux de quelques-uns, et l’appauvrissement de la plupart ? Inéluctable ! Le bradage des services publics, leur remplacement par des organismes privés qui, sitôt en faillite, viendront sans vergogne réclamer l’aide de l’État ? Inéluctable ! La pollution qui dégrade la planète tout entière ? Inéluctable !
Tu parles ! Tiens, je te propose dorénavant de remplacer systématiquement ce vocable, quand nous le rencontrerons, par « voulu », ou « prémédité », ou, mieux encore, par « profitable à quelques salauds ». Tout passe par les mots, d’abord, il faudrait leur rendre leur sens profond, leur véritable place ! Pour celui-là, nous le savons, il n’y a, pour l’homme, que la mort qui soit « inéluctable ».
Tu vois, je suis de plus en plus porté à appeler un chat un chat, et une ordure par son nom. C’est peut-être l’un des avantages de l’âge : on peut se permettre de parler haut, parce qu’on n’a plus grand-chose à perdre.
Bien sûr, si tu pouvais intervenir dans ce monologue, tu me reprendrais, persifleur :
— Parce que tu n’as plus grand-chose à perdre ? Ce ne serait pas plutôt : parce que plus personne ne t’écoute ?
Ce que tu pouvais être désagréable, parfois…
*
L’oncle Charles était l’un des frères de ma mère. Petit, sec, l’œil clair, il s’était installé, à sa retraite, dans un pays de vignobles, à l’entrée de la plaine du Rhône. Avec leur lourd accent vaudois, les habitants du coin l’appelaient « le socialiste ». Y avait-il dans leur voix, lorsqu’ils prononçaient ce mot, du mépris, de la peur ? Non, pas de peur : un paysan, un vigneron de chez nous, campé sur sa terre, ne craignait rien ni personne dans ces années-là. On ne lui avait pas encore fait comprendre que sa disparition était prochaine, et inéluctable.
De passage près d’Ollon, j’étais monté jusqu’à sa petite maison, qui dominait les vignes. Il devait avoir alors dans les quatre-vingts ans. C’était le temps de la privatisation des chemins de fer britanniques, ou de la guerre des Malouines, ou de l’interminable grève des mineurs, je ne sais plus. J’avais frappé à la porte par principe mais, le sachant complètement sourd, n’avais pas attendu sa réponse pour entrer. Les fenêtres de la chambre étaient grandes ouvertes sur l’été, sur la colline de Saint-Triphon, sur le val d’Illiez et la splendeur des Dents-du-Midi. C’est à peine si le vieux, debout devant sa table, avait levé les yeux du journal étalé devant lui.
Il ne m’a pas laissé le temps de le saluer :
— Ah, c’est toi ! Tu as vu, cette salope de Thatcher, ce qu’elle a encore fait ?
Que je reste aussi vif que l’oncle Charles, aussi teigneux, et jusqu’au bout !
*
En colère, bien sûr. Mais j’ai aussi le bonheur en moi, cette force inattendue qui vous fait sourire un matin de printemps, qui vous fait sauter à cloche-pied et plonger votre nez ravi dans les arbres en fleurs. En moi le petit enfant qui rit, qui court, qui entre dans la vie, les bras tendus, plein de confiance !
*
Les bruits du monde…
Je vais sauter du coq à l’âne. Et alors ? Nous passions allégrement d’un sujet à l’autre, dans nos conversations. Ton absence, ou le fait que tu t’obstines à faire la sourde oreille, ne va pas m’empêcher de conserver cette belle liberté.
La Cour suprême de Jérusalem, aujourd’hui, a retiré sa nationalité à un Arabe israélien accusé de terrorisme. Qu’est-il maintenant, cet homme ? Un apatride, un Heimatlos ?
Pour désigner de pauvres gens, des infortunés contraints à l’errance, ma grand-mère Louise utilisait ce terme, à peine transformé. Dans sa bouche, celui qui avait perdu sa patrie devenait un « imatlose ». Il en passait parfois à Sainte-Croix, qui se proposaient pour aiguiser les couteaux, ou rétamer les casseroles.
Est-il encore un humain, cet imatlose, aux yeux de ses juges ?
À Guantánamo, sur l’île de Cuba, des détenus, enfermés dans les cachots étasuniens, n’ont plus aucun droit : ce ne sont pas des prisonniers de guerre, pas plus que des droit commun. Ils n’ont plus de noms. Morts ? Vivants ? Leur existence même est niée.
Là-bas, comme en Israël, reviendrait le temps des sous-hommes, des Untermenschen ?
Nous n’avons rien appris, c’est à pleurer…
*
Un message pour toi, de la part de ton cerisier !
Mais juste avant…
Mon frère Henri est un homme pragmatique, peu porté vers le mystique, pour autant que je le connaisse. C’est pourtant lui qui m’a rappelé…
Otto, notre père, avait planté un pin, tout en haut de son jardin. Le jour où il s’en est allé, son arbre s’est subitement fendu en deux, sur toute sa hauteur.
Bon… On était en hiver, il a pu y avoir de la neige fondue, de l’humidité, puis brusquement un gros gel… Il y a certainement une explication rationnelle. Mais il ne me déplaît pas d’imaginer des forces mystérieuses qui saluent, à leur façon, le départ d’un homme doux.
Revenons au tien, d’arbre.
C’est à Médières, ce village encore préservé, à deux pas de la clinquante station de Verbier. Juste en dessous de cette ville à la montagne, avec ses boutiques de luxe, ses hôtels cinq-étoiles dans lesquels je ne mettrai jamais les pieds, ni toi le bout d’une aile.
Il y a là quelques maisons anciennes serrées les unes contre les autres, quelques ruelles, une école, une minuscule chapelle. Tu y avais acquis, dans le quartier du haut, un petit appartement pour passer tes vieux jours. Dans le lot, en plus du deux-pièces, était comprise, en face, une vieille grange en bien piteux état. Un bout de terre te revenait également, dans une pente ensoleillée, au milieu des jardins potagers que cultivent les villageois. Un grand cerisier, planté là, au bord du chemin, ombrageait le haut de tes dix mètres carrés.
La grange, je te l’ai achetée et, avec l’ami Marcel, nous l’avons transformée, en l’espace de deux ans.
Toute la boue et la caillasse, extraite du sous-sol, a été déposée sur ton terrain, aplanie. L’herbe y a poussé, tu t’es ainsi retrouvé propriétaire d’une terrasse, aux dimensions certes modestes, mais coquette, dominant des alignements de salades et de poireaux. Une petite source chante à côté, bien pratique l’été pour mettre à rafraîchir les bouteilles de fendant. La vue porte sur les toits du village, de pierre ou d’éternit, puis sur le fond du val de Bagnes où flotte en suspension, quand le soleil descend, comme une poudre d’or. En face, ce sont les longues pentes qui dominent le village de Bruson, le sommet tout en roches du Rogneux, les neiges éternelles qui recouvrent le massif du Combin.
Très vite, cet endroit est devenu notre lieu de rencontre de fin de journée, et le cerisier a acquis, sans le savoir, le statut d’arbre à palabres.
Nous sortions de notre chantier, Marcel et moi, les vêtements pleins de sciure, nous avions terminé un plafond, monté un escalier. Tu nous attendais, assis dans un fauteuil d’osier. Des verres étaient déjà prêts sur la petite table, à côté d’une assiette de viande séchée. Nous regardions contre le ciel le vin doré, tu lançais, à la place de « santé », Dieu sait pourquoi mais c’était ton mot :
— Saté !
Et nous buvions avec délices la première gorgée.
De quoi parlions-nous ? De nos soucis du jour, de tel bout de bois que je n’avais pas, aux yeux du pointilleux Marcel, posé avec assez de soin, d’une commande de planches qu’il faudrait passer à notre vieux menuisier. À l’époque, tu étais encore enseignant. Nous passions donc invariablement un moment à t’écouter fustiger les méthodes nouvelles, et incohérentes, qu’imposait à ses professeurs le Département de l’instruction publique du canton de Vaud. Puis Marcel nous rappelait son enfance, famille pauvre dans une vallée pauvre. Il évoquait le garçon de dix ans qu’il avait été, les mois passés sur l’Alpe en été, au milieu des génissons, sans abri la plupart du temps, sans rien d’autre à manger que du pain noir.
Le soleil allait disparaître derrière la crête du Catogne, je me levais pour prendre, sous la source, une deuxième bouteille. Nos pensées s’envolaient vers des amis lointains. Vers Gaston le pianiste au cœur tendre, et Vigneault le solaire, ceux-là dans leur Québec. Vers l’autre Gilles, Bleiveis, retiré du show-business dans sa campagne de Touraine. Vers Jean, le Bordelais, qui viendrait bientôt, il l’avait promis, promener sa barbiche de mousquetaire et son accent fleuri dans nos montagnes. Nous disions :
— Il faut absolument leur téléphoner ! On va faire ça tout à l’heure !
Quelqu’un sonnait l’angélus dans la vieille chapelle. Nous étions, pour un instant, plongés dans le ravissement.
C’est toi qui rompais le silence, avec ce mot que tu avais ramené du désert, de Tazrouk ou de Tamanrasset :
— Elrher…
C’est ce que disent les Touareg dans de tels moments : « Tout va bien, le bonheur est là. »
De vilaines taches brunes sont apparues sur les feuilles de l’arbre. Il ne donne quasiment plus de fruits depuis deux ans, ou alors de toutes petites cerises, tristes et maigres, des « grafions », comme les appellent les vieilles dames du village. Il dépérit, il s’ennuie.
Tu lui manques.
II
Paris
Rue Pernety
ME PROMENER dans ces images, Jean-Claude, te parler, fait que tu es comme encore vivant. Il semble qu’il me suffira de composer ton numéro de téléphone pour entendre ta voix.
*
Hier, dans un article du Monde intitulé « Assurer le triomphe de la liberté », le président des États-Unis, George W. Bush, affirmait :
… Libre-échange et économie de marché ont démontré leur capacité à sortir des sociétés entières de la pauvreté, aussi les États-Unis œuvrent-ils avec l’ensemble de la communauté économique mondiale à construire un monde qui commerce librement et, par conséquent, croît en prospérité.
Je me demande parfois si l’antipathie que je nourris à l’encontre du petit maître de la planète n’est pas le résultat d’une erreur de jugement. Après tout, même s’ils ne représentent pas la majorité des votants, des millions de ses compatriotes l’ont adopté pour chef. Ils se sentent rassurés par sa détermination à combattre « l’empire du Mal ».
Je tente d’avoir un regard critique sur le présent. Mais, en contestant la pensée fast food américaine, est-ce que je ne me jette pas, tête baissée, yeux fermés, dans un camp adverse tout aussi obtus ? J’ai refusé les certitudes molles, le confort de l’acquiescement, bien. Mais ne suis-je pas bêtement en train de gober les idées opposées, sans les remettre en question ?
Et la distance avec laquelle je considère tout ce qui est, aux yeux de la majorité, « moderne », n’est-elle pas la marque classique d’un esprit vieillissant, tourné vers le passé ?
On a retrouvé, en Égypte, gravés dans la pierre depuis quelques milliers d’années, des hiéroglyphes rapportant les plaintes d’un prêtre : La jeunesse d’aujourd’hui ne respecte plus rien, c’était bien mieux de notre temps… Est-ce que je ne me coule pas peu à peu, à mon insu, dans le moule de l’aïeul grognon, de l’éternel mécontent ? Qu’en penses-tu ?
Pour donner un exemple de ma mauvaise volonté : les progrès de la technique, je les salue, mais ils ne me transportent pas d’enthousiasme. Je trouve intéressant que l’on puisse communiquer par e-mail, par courriel avec l’autre bout de la Terre – trouvant le mot plus joli que l’anglicisme ou le néologisme, je nomme depuis quelque temps ces messages électroniques des « émiles ». Mais je ne vais pas mettre sur un piédestal les concepteurs d’internet, les fabricants d’ordinateurs, ou le jeune homme aux cheveux gominés qui vend des téléphones portables dans mon quartier de Paris. Suis-je dans le faux ?
Les nouveaux outils rendent-ils l’homme plus intelligent, plus sage ?
La télévision, par exemple.
Depuis cinquante ans qu’elle existe, a-t-elle amélioré l’humanité ? Je n’en ai pas le sentiment. Simplement, parce qu’ils passent devant elle beaucoup de temps assis, elle a rendu les gens plus gros.
Je reviens à George W. Bush… Partisan forcené de la peine de mort, fanatique religieux, il rêve d’avoir la planète à sa botte.
Dans son article d’hier, il soutient que son modèle économique a démontré sa capacité à sortir des sociétés entières de la pauvreté. J’aimerais l’avoir en face de moi pour lui demander : où ? En Russie, en Argentine, en Uruguay, en Afrique ? Un monde qui commerce librement et, par conséquent, croît en prospérité