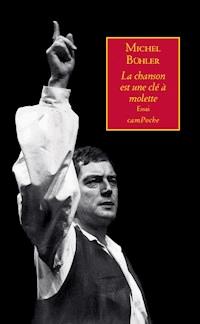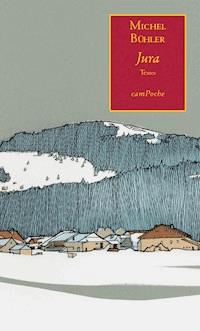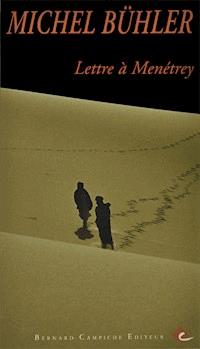Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bernard Campiche Editeur
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Michel Bühler, en écrivant à ses neveux, pose un regard à la fois critique et poétique sur le conflit générationnel entre les enfants d'hier et d'aujourd'hui
Que nous est-il arrivé ?
Je compare l’aujourd’hui avec ce que nous espérions – les gens de ma génération, ou une partie d’entre eux. Si l’on nous avait dit, quand nous avions votre âge: «Voilà ce que sera le monde, dans quarante ans», en décrivant ce début de millénaire tel qu’il est sous nos yeux, nous aurions éclaté de rire, nous aurions crié au fou! Avec les promesses que nous avions dans les mains, avec notre énergie, notre ardeur, nous allions évidemment bâtir une Terre fraternelle, débarrassée de la pauvreté et de la faim, une Terre d’hommes et de femmes égaux! Et nous ne courions pas après une lointaine utopie, non : le meilleur était en marche, il naissait sans heurts, sous nos pas. Il n’y avait qu’à continuer dans la direction indiquée par les mouvements sociaux d’avant et d’après-guerre, il n’y avait qu’à approfondir le sillon que d’autres avaient ébauché avant nous!
Au lieu de cela, le spectacle de maintenant.
Une révolution a eu lieu. Pas celle que nous espérions.
Nous avons échoué, nous nous sommes fait baiser, profond.
Par qui ? Comment ?
Un texte qui pousse à la réflexion et souligne l'importance de la révolte dans une société qui devient indifférente aux injustices
EXTRAIT
Quelques centimètres de petite neige mouillée ce matin, dans ma cour parisienne. Au café de la rue Raymond-Losserand, Angelo le garçon, qui vient depuis l’autre côté de la ville avec son scooter, a eu du mal à arriver jusqu’ici :
— Il y a une légère côte, avenue du Maine. À cinq heures, tu penses, j’étais le premier à y passer : pas une trace devant moi. Ma machine s’est mise à déraper, à patiner. J’ai fini par la pousser, à la main : plus de deux cents kilos. Saloperie…
Premier lundi de février, en cette année deux mille neuf. Dans le froid, Paris vit au ralenti.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
"Un spectacle pour parcourir quarante ans d’un répertoire d’une remarquable cohérence. On y retrouvera une trentaine de chansons incontournables, des toutes premières aux plus récentes, ponctuées de textes: souvenirs, réflexions sur l’actualité et regards vers l’avenir. Michel Bühler demeure fidèle à ses engagements, à ses colères contre l’insupportable injustice. Curieux du monde, l’idéaliste rebelle continue à «rêver d’hommes frères» martelant sa confiance et son espoir en l’homme." -
Sarah Turin, Théâtre de Vidy-Lausanne
"Émouvant récit du poète gesticulant devant la folie blindée des hommes." -
Jacques , La Liberté
A PROPOS DE L’AUTEUR
Michel Bühler est l’un des chanteurs suisses les plus connus. Auteur de plus de deux cents chansons, il a également publié trois romans,
La Parole volée (traduit en allemand chez Limmat Verlag),
Un notable et
La Plaine à l’Eau Belle, trois récits,
Cabarete, Lettre à Menétrey et
Un si beau printemps, et de nombreuses pièces de théâtre. Michel Bühler, qui demeure l’un des rares auteurs romands à rendre compte des problèmes politiques et sociaux de son pays, n’hésite pas à prendre part à des actions de solidarité et de défense des opprimés. Partageant son temps entre carrière littéraire et musicale, il vit actuellement à L’Auberson (Vaud) et à Paris.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MICHEL BÜHLER
Un si beau printemps
Que nous est-il arrivé ?
Je compare l’aujourd’hui avec ce que nous espérions – les gens de ma génération, ou une partie d’entre eux. Si l’on nous avait dit, quand nous avions votre âge: «Voilà ce que sera le monde, dans quarante ans», en décrivant ce début de millénaire tel qu’il est sous nos yeux, nous aurions éclaté de rire, nous aurions crié au fou! Avec les promesses que nous avions dans les mains, avec notre énergie, notre ardeur, nous allions évidemment bâtir une Terre fraternelle, débarrassée de la pauvreté et de la faim, une Terre d’hommes et de femmes égaux! Et nous ne courions pas après une lointaine utopie, non : le meilleur était en marche, il naissait sans heurts, sous nos pas. Il n’y avait qu’à continuer dans la direction indiquée par les mouvements sociaux d’avant et d’après-guerre, il n’y avait qu’à approfondir le sillon que d’autres avaient ébauché avant nous!
Au lieu de cela, le spectacle de mainte- nant.
Une révolution a eu lieu. Pas celle que nous espérions.
Nous avons échoué, nous nous sommes fait baiser, profond.
Par qui? Comment?
Michel Bühler est l’un des chanteurs suisses les plus connus. Auteur de plus de deux cents chansons, il a également publié trois romans, La Parole volée (traduit en allemand chez Limmat Verlag), Un notable et La Plaine à l’Eau Belle, deux récits, Cabarete et Lettre à Menétrey, et de nombreuses pièces de théâtre. Michel Bühler, qui demeure l’un des rares auteurs romands à rendre compte des problèmes politiques et sociaux de son pays, n’hésite pas à prendre part à des actions de solidarité et de défense des opprimés. Partageant son temps entre carrière littéraire et musicale, il vit actuellement à L’Auberson (Vaud) et à Paris.
Couverture: lithographie de Pierre Bichet,«L’Auberson», avril 1981,65 x 18 cm (dessin), détail
Michel Bühler
Un si beau printemps
CET OUVRAGE EST PUBLIÉ AVEC L’APPUIDE LA COMMISSION CANTONALE VAUDOISE DES AFFAIRES CULTURELLES
« UN SI BEAU PRINTEMPS »,DEUXCENT CINQUANTE-NEUVIÈME OUVRAGEPUBLIÉ PAR BERNARD CAMPICHE ÉDITEUR,A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC LA COLLABORATION D’HUGUETTE PFANDER,DE MARIE-CLAUDE SCHOENDORFF ET DE JULIE WEIDMANNMISE EN PAGES : BERNARD CAMPICHECOUVERTURE : LITHOGRAPHIE DE PIERRE BICHET,« L’AUBERSON », AVRIL 1981, 65 X 18 CM (DESSIN)PHOTOGRAPHIE DE L’AUTEUR : PHILIPPE PACHE, LAUSANNEPHOTOGRAVURE : BERTRAND LAUBER, COLOR+, PRILLY,& CÉDRIC LAUBER, L-X-IR IMAGES, PRILLYIMPRESSION ET RELIURE : IMPRIMERIE LA SOURCE D’OR,À CLERMONT-FERRAND(OUVRAGE IMPRIMÉ EN FRANCE)
ISBN PAPIER 978-2-88241- 260-7ISBN NUMÉRIQUE 978-2-88241-353-6TOUSDROITS RÉSERVÉS© 2009BERNARD CAMPICHE ÉDITEURGRAND-RUE 26 – CH-1350 ORBEWWW.CAMPICHE.CH
Je vous le répète, il est plus facile à un chameaude passer par le trou d’une aiguille qu’il ne l’està un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.
MATTHIEU 19.24
Quelle heure est-il, quel temps fait-il ?J’aurais tant aimé cependantGagner pour vous, pour moi, perdantAvoir été peut-être utile…
LOUIS ARAGON
Chapitre 1
QUELQUES centimètres de petite neige mouillée ce matin, dans ma cour parisienne. Au café de la rue Raymond-Losserand, Angelo le garçon, qui vient depuis l’autre côté de la ville avec son scooter, a eu du mal à arriver jusqu’ici :
— Il y a une légère côte, avenue du Maine. À cinq heures, tu penses, j’étais le premier à y passer : pas une trace devant moi. Ma machine s’est mise à déraper, à patiner. J’ai fini par la pousser, à la main : plus de deux cents kilos. Saloperie…
Premier lundi de février, en cette année deux mille neuf. Dans le froid, Paris vit au ralenti.
Devant la bouche du métro, en haut de l’escalier, un vieux monsieur, habillé proprement, bien rasé, tend sa casquette. Il ne dit rien, n’a aucune expression sur le visage. De temps en temps, un passant lui fait l’aumône de quelques centimes d’euros. Il restera là, silencieux, toute la matinée.
*
L’idée d’un livre, écrit pour vous, a germé il y a presque deux ans.
C’était un de ces aoûts bénis, sans un nuage, où, en bande, on court les sentiers des Alpes, remplissant ses poumons d’air vif, captant au passage quelques traces du parfum des pins, ou devinant, parce qu’elles sont loin, l’odeur doucereuse des noires vachettes.
Nous avions passé notre journée à remonter une vallée par un chemin caillouteux « bordé, annonçait une brochure touristique, de mélèzes absolument remarquables ». Rapide pique-nique au bord d’un lac aux eaux verdâtres, face au glacier qui faisait, plus haut, étinceler ses séracs. Un vent frisquet nous avait fait renoncer à une halte plus longue.
Le soir, nous nous étions retrouvés au chalet, grosse table familière, platée de spaghettis, bonne bouteille et bonne fatigue. Il y avait là Anne, dont je partage la vie depuis plus de seize ans, Liliane votre mère et sa colocataire Sylvia, et puis Caillou, que l’on appelle ainsi parce qu’il se prénomme Pierre. La soirée avançant, nous avions peu à peu laissé nos esprits vagabonder.
Comme nous recherchions des moyens d’arrondir nos fins de mois et d’assurer nos vieux jours, j’avais suggéré que nous pourrions créer une secte. J’en aurais bien sûr été le gourou, et ses revenus, assurés par l’exploitation des multiples gogos que nous n’aurions pas manqué de faire tomber dans nos filets, auraient été partagés de façon tout à fait inéquitable entre moi et les autres membres fondateurs. Feignant d’entrer dans mon jeu, Anne s’était écriée, véhémente :
— Alors là, sans moi !
Laissant parler la part de sang italien qui coule dans ses veines, Liliane avait fait mine de s’emporter. Elle m’avait traité de renégat, de traître à tous les idéaux qui nous avaient réunis jusqu’ici, et m’avait voué à disparaître à tout jamais dans les poubelles de l’Histoire. Silencieux, Caillou avait souri. Seule Sylvia s’était montrée intéressée par mon projet. Servile, obséquieuse, avec un enthousiasme appuyé, elle s’était immédiatement autoproclamée ma première et ma plus proche disciple, et m’avait affublé du nom trois fois saint de Grand Mirliflore.
À ce jour, elle est toujours mon unique fidèle…
Délaissant les rivages brumeux du mysticisme, nous en étions venus, plus concrètement, à parler politique. Le vin m’avait échauffé. J’avais affirmé, péremptoire, que je ne voyais pas d’avenir à notre planète, si l’on n’abandonnait pas sur-le-champ notre civilisation capitaliste. Il fallait de toute urgence revenir à une culture dont le but serait le bonheur de tous les humains, et non plus des profits maximaux pour quelques privilégiés. Anne m’avait fait remarquer, tout en m’approuvant, que « les gens » se foutaient complètement de tout ce qui ne touchait pas directement à leur petit confort. Je pouvais donc bien m’enflammer sous la lampe de mon chalet valaisan, il n’y avait aucune chance pour que je me fasse entendre, et moins encore pour qu’un quelconque changement se produise autour de nous.
J’avais rétorqué que je n’étais pas le seul sur terre à rêver de justice.
Avec la calme assurance que donne une foi profonde, Sylvia avait doctement murmuré que les paroles du Grand Mirliflore étaient bénies, et qu’Il pouvait à Lui seul déplacer n’importe laquelle des montagnes qui dormaient autour de la vallée.
Je ne me souviens pas de ce qu’avait dit Caillou. Peut-être, simplement, s’était-il contenté de hocher la tête, avec un petit air ironique.
Une nouvelle fois, Liliane avait laissé parler son caractère impétueux :
— Anne a raison ! Monsieur et Madame Tout-le-Monde n’en ont plus rien à fiche de la politique ! Chacun vit refermé sur soi ! Et plus particulièrement les jeunes, qui devraient pourtant être les premiers à faire bouger les choses !
Et c’est là que vous êtes entrés en scène, quand votre mère a poursuivi, sur le même ton passionné :
— Va demander à mes gamins ce qu’ils pensent, va regarder comment ils vivent !
Nous étions alors tombés d’accord pour déplorer amèrement le manque d’engagement de cette foutue jeunesse…
(Il faut dire que la moyenne d’âge de notre joyeuse équipe devait tourner autour des cinquante ans, grâce à la présence d’Anne, de très loin la plus jeune…)
… cette foutue jeunesse, à qui nous n’avions pourtant cessé de montrer l’exemple, manifestant ici, pétitionnant là, défilant par tous les temps.
— Ils ne sont pas informés, avait suggéré ma compagne.
— Mais non ! l’avait coupée Liliane. Ils savent très bien ce qui se passe autour d’eux. Simplement ils ont l’impression qu’il ne sert à rien d’agir, de réagir…
— Je vais leur expliquer !
Les regards s’étaient braqués sur moi. Et moi, fanfaron :
— Je vais écrire un livre, un essai, pour eux. Juré, craché ! Le titre ? « De la nécessité de la Révolution, expliquée à mes neveux » !
On s’attire parfois des applaudissements à très bon compte.
*
Il devrait exister une loi, un règlement, qui déclare non contraignants tous les engagements pris, même solennellement, entre copains, après dix heures du soir.
En attendant, je me retrouve dans un froid deux-pièces parisien, devant un ordinateur à l’écran quasiment vide.
France Inter annonce, pour le seul mois dernier, quarante-cinq mille chômeurs de plus dans le pays.
Sur le site de 24 Heures, le quotidien de Lausanne, je lis que l’Union de Banques Suisses va distribuer deux milliards de francs, à titre de primes, à certains de ses employés. Le Conseil fédéral, mon gouvernement, a récemment donné six milliards à cette banque. En s’interdisant de demander un droit de regard sur la façon dont cet argent, le mien, le vôtre, serait utilisé.
Ils étaient deux millions et demi à défiler dans toutes les villes françaises, jeudi dernier. Contre la baisse du pouvoir d’achat, contre la montée du chômage, contre le fait qu’une fois de plus ce sont les petits qui vont passer à la caisse. En réponse à ce mouvement populaire, le Premier ministre Fillon déclare qu’il restera fidèle à la ligne qu’il s’est tracée. Il va donc poursuivre les privatisations, le démantèlement des services publics, la marche vers toujours plus d’inégalités.
Le monde traverse, au dire de tout ce qui a un avis, « une crise sans précédent depuis celle de 1929 ». Elle ne semble pas faire réfléchir les décideurs.
Nous sommes dans un navire géant, à qui il faut des heures pour virer lorsqu’un iceberg se présente devant lui. Combien de mois passeront avant qu’on admette que nous avons fait fausse route ? Combien de victimes encore avant un changement de cap ?
*
Baptiste, Younouss, Alfaly, vous n’êtes pas vraiment mes neveux. Aucun lien du sang ne nous unit. Mais vous êtes les enfants de mes vieux amis, Liliane et Bouba, et, vous ayant connus à peine vous étiez nés, j’ai toujours considéré que nous étions de la même famille. D’ailleurs vous m’appelez « Tonton ». Donc c’est bien à vous que cet essai s’adresserait, si un jour naissait « De la nécessité de la Révolution… ».
*
Après cette soirée d’août, qui a vu mon engagement intempestif à vous écrire, et la naissance de la secte mirlifloresque – à mon grand regret quasiment morte dans l’œuf, comme je l’ai déjà indiqué –, j’ai, durant quelques semaines, mollement envisagé de tenir parole. Mais bien vite je me suis senti dépassé par l’ampleur de la tâche.
Élaborer un livre clair, irréfutable ? Il faudrait pour cela être historien, journaliste, philosophe… Trop technique, trop lourd pour moi.
J’ai donc rangé cette idée dans un coin de mon cerveau et mis par-dessus ce que je pensais être le mouchoir de l’oubli définitif.
C’était sans compter avec l’obstination des filles…
*
Le chalet, c’est, dans les Alpes valaisannes, une vieille grange que j’ai retapée avec l’aide de deux amis, il y a bientôt vingt ans.
Ils sont morts, Jean-Claude et Marcel, tous les deux, d’un arrêt cardiaque. Ce qu’ils avaient de plus tendre, leur cœur, les a trahis, à quelques mois de distance…
Nous nous y sommes retrouvés, autour de la grande table, les mêmes. Moins Caillou : tombé amoureux, il n’a plus donné de ses nouvelles depuis des mois. Donc Anne, Liliane, Sylvia, et moi, le lendemain de ce dernier Noël.
En fin de soirée…
(C’est à croire qu’on ne se dit rien d’important pendant la journée. Que les échanges qu’on a, avant que le soleil soit depuis longtemps couché, n’ont trait qu’aux achats à faire pour les repas, qu’aux projets de balades pour le lendemain…)
Je dois avoir dit, un peu tristement, que je me trouvais, au seuil de cette année 2009, sans véritable projet enthousiasmant : pas de grand voyage en vue, pas d’idée ou de désir d’écriture :
— D’ailleurs, aujourd’hui, tout le monde écrit, tout le monde chante. N’importe qui, n’importe quoi… Je n’ai plus envie de participer à ce brouhaha universel, à cette cacophonie. Plutôt me taire, ne plus bouger, dans mon coin.
— Et le bouquin qui devait s’adresser à mes gamins, s’est exclamée Liliane, on n’en a pas encore vu une ligne !
Anne s’est montrée réservée :
— Toi qui es tout le temps en train de pester contre le monde entier, en écoutant la radio, en lisant les journaux… Un livre sur la révolution… je vois d’ici les théories, les avis tranchés…
— Oui, mais le Grand Mirliflore l’avait annoncé, promis, a susurré Sylvia, la traîtresse, en me regardant par en dessous…
J’ai baissé la tête, fait la moue, et j’ai dû murmurer :
— Ouais…
*
Deux jours plus tard, mais il n’y a là vraisemblablement aucun lien de cause à effet, je me suis retrouvé cloué au lit avec une formidable fièvre, et une toux obstinée du genre qui vous fait ressembler à un baudet lançant vers le ciel, dans un effort pathétique, les hi-hans discordants que pourrait produire une porte mal huilée.
Dans l’une de ses chansons râpeuses, Tom Waits affirme, « You’re innocent when you dream » : « Tu es innocent quand tu rêves. » Si la plongée au pays du sommeil enlève à l’homme toute responsabilité quant à ce qui s’élabore dans son cerveau, à plus forte raison une poussée de température et le délire qui en découle doivent le mettre à l’abri de tout jugement de la part de ses semblables. C’est pourquoi j’ose avouer sans honte que ce qui n’a pas, alors, cessé de tourner dans ma tête était cette vieille scie qui ne peut se chanter qu’avec l’accent chtimi : « Tout ch’ti-là qui pisse il prend ch’biroute dans ch’main, et la plupart du temps il laisse eun’ goutte dans ch’main. Et pis qu’i’ la s’coue et d’ n’import’ quell’ façon, la dernière goutte ch’est pour l’ cal’chon… »
Délicat, n’est-ce pas ? Pour ma défense, j’avais trente-neuf de fièvre, et j’étais à l’article de la mort.
Tout cela pour vous dire que les idées les plus saugrenues et les images les plus invraisemblables peuvent se mettre à vous squatter l’esprit, lorsque votre thermomètre entreprend de dépasser les trente-sept degrés centigrades.
Comme ses tisanes bouillantes, son miel et ses aspirines ne venaient pas à bout de ce refroidissement, Anne m’a persuadé d’aller me présenter au petit centre de santé de notre village.
Pneumonie. Lit métallique, perfusion d’antibiotiques dans un bras, tuyau soufflant de l’oxygène dans mes narines. Et, se succédant à mon chevet durant cinq jours, ce qui m’est apparu comme une armada d’infirmières blondes, toutes plus prévenantes les unes que les autres, et s’inquiétant de ma tension, de ma température, du taux de gaz carbonique dans mon sang, du rythme de mes pulsations…
Le bonheur !
Il n’y avait pas de chambre disponible dans le modeste hôpital. On m’a donc mis dans une salle de bains, faisant accessoirement office de débarras, sans fenêtre, éclairée par un unique néon, encombrée de seaux de plastique, de brosses à récurer et de bidons de détergent. J’étais si mal en point qu’on aurait bien pu me reléguer dans le placard à balais qui occupait un coin de la pièce, je me serais encore confondu en remerciements.
En repensant à ce cagibi, maintenant que je suis tiré d’affaire, je me dis que j’attends de pied ferme le prochain décideur qui osera affirmer que l’on engloutit trop d’argent dans les services publics…
*
Que nous est-il arrivé ?
Je compare l’aujourd’hui avec ce que nous espérions – les gens de ma génération, ou une partie d’entre eux. Si l’on nous avait dit, quand nous avions votre âge : « Voilà ce que sera le monde, dans quarante ans », en décrivant ce début de millénaire tel qu’il est sous nos yeux, nous aurions éclaté de rire, nous aurions crié au fou ! Avec les promesses que nous avions dans les mains, avec notre énergie, notre ardeur, nous allions évidemment bâtir une Terre fraternelle, débarrassée de la pauvreté et de la faim, une Terre d’hommes et de femmes égaux ! Et nous ne courions pas après une lointaine utopie, non : le meilleur était en marche, il naissait sans heurts, sous nos pas. Il n’y avait qu’à continuer dans la direction indiquée par les mouvements sociaux d’avant et d’après-guerre, il n’y avait qu’à approfondir le sillon que d’autres avaient ébauché avant nous !
Au lieu de cela, le spectacle de maintenant.
Une révolution a eu lieu. Pas celle que nous espérions.
Nous avons échoué, nous nous sommes fait baiser, profond.
Par qui ? Comment ?
*
Revenons à ma salle de bains, à mon débarras plutôt, et à ma fièvre.
De ch’val…
La chanson chti cognait toujours contre l’intérieur de mon crâne et tourbillonnait dans mon pauvre cerveau. Mais la vie est faite de fatigues successives, et tout s’use avec le temps, tout s’éloigne dans le crépuscule de l’oubli, même les délires. Ainsi, par moments, « Tout ch’ti-là qui pisse », devenu lassant à force d’avoir été répété, laissait place à la vision floue de vos visages. Alors je me mettais à vous parler, et tout ce que j’aurais à vous dire coulait de source, tous les arguments, toutes les images étaient là. Le livre à venir était écrit, quelque part dans mes neurones, j’en étais persuadé, et lui faire voir le jour ne serait qu’une partie de plaisir !
Même le passage régulier des infirmières sous mon néon – tension, pouls, température – ne me distrayait pas. Je baignais avec bonheur dans les pages futures, et les phrases naissantes m’enveloppaient avec la tiédeur d’une mer tropicale. Ne restait quasiment plus qu’à écrire le mot « Fin ».
*
Tu parles… Si ce bouquin existe déjà dans quelques limbes, seul mon état fiévreux m’a permis de l’entrevoir. Et maintenant qu’il conviendrait de le graver dans un recoin de mon ordinateur, je n’en retrouve plus la trace. Il ne traîne, dans ma mémoire, pas un fil qui pourrait me conduire jusqu’à lui, pas l’ombre du souvenir d’une image.
Pourtant… Avec la crise qui nous frappe, la statue de l’ancien monde, déboulonnée, vacille. C’est aujourd’hui qu’il faut agir, s’unir, tirer sur les cordes de toutes ses forces, pour l’abattre une fois pour toutes. C’est aujourd’hui qu’il faut écrire, vite !
Depuis quelques jours, besogneux, je réfléchis. J’ai créé dans mon ordinateur un dossier « Neveux », et dans celui-ci un fichier « Idées ».
*
« Le crépuscule sur la ville traînait sa robe de lilas… » Ce vers du vieux Gilles trotte dans ma tête, tandis que l’obscurité monte dehors, dans la petite cour. Je m’emmitoufle, bonnet de laine et doudoune, pour affronter le froid mordant de la nuit parisienne, et ne pas risquer la rechute. L’ami Michel Devy vient manger ici ce soir, et il adore la viande rouge que me vend le boucher arabe du coin de la rue. Je sors dans le couloir, je contrôle que j’ai bien les clés dans ma poche avant de repousser la porte…
Téléphone.
Je rentre précipitamment, me prends les pieds dans le câble du radiateur électrique, me rattrape au portemanteau… sans doute Anne, restée en Suisse, son appel quotidien, sa tendresse…
Une voix engageante :
— Hello ! Je suis Jennifer de l’Institut Biotox, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Pourrais-je parler à votre épouse ?
Chapitre 2
DANS la lueur des réverbères voltigent quelques flocons de neige. Les Parisiens sortent de la bouche du métro et disparaissent dans les rues froides, pressés de rentrer chez eux.
Je grommelle intérieurement en progressant à petits pas, le trottoir est glissant.
Ces démarcheurs par téléphone m’horripilent. Poussant votre porte, se glissant dans votre intimité pour vous proposer avec une grossière insistance des produits imbéciles, ces importuns sont pour moi l’un des symboles de cette civilisation sans âme où tous les coups sont permis pour vendre, vendre, et vendre.
Oui, je sais, ces gens, dans leurs centres d’appels, sont soumis à des conditions de travail moyenâgeuses. Ils doivent remplir des quotas de commandes, ils ont sans cesse sur leur dos des petits chefs teigneux, et sont renvoyés au moindre signe de contestation. Et le salaire qu’on leur verse n’est pas suffisant pour leur permettre de subsister. Ils sont ce que l’on appelle des « working poors », des travailleurs pauvres. Complices, mais aussi victimes.
C’est pour cette dernière raison que je reste dans les limites de la politesse, le plus souvent, lorsqu’un lointain inconnu tente de me vendre une assurance-vie dont je n’ai rien à cirer, ou un abonnement dans un centre de fitness.
Une fois, une seule, j’ai tiré mon chapeau à l’un de ces fâcheux…
Midi et quelques broquilles. Seul dans ma cuisine de L’Auberson, je m’apprête à grignoter un morceau de pain, un bout de fromage. J’ai l’esprit complètement occupé par l’écriture laborieuse d’une nouvelle chanson. Ce n’est pas le moment de m’importuner. Tout à mes pensées, je bois machinalement un verre d’eau avant de me remettre au travail…
Téléphone !
Je quitte ma table, m’en vais vers l’autre bout de la pièce, jusqu’au petit bureau où la sonnerie continue de m’appeler. C’est peut-être important…
Un jeune homme dynamique, avec un léger accent africain :
— Bonjour ! Je représente la société d’investissements Fidutrust à Genève. Accordez-moi, Monsieur, une minute pour vous présenter…
Non, pas ça ! Sans un mot, je jette violemment le combiné sur son support, et reviens à ma table. À peine le temps de me rasseoir, nouvelle sonnerie. Retour vers le bureau. C’est le même individu, avec cette fois un ton offusqué :
— Pourquoi m’avez-vous raccroché au nez ?
Pas la tête du tout à me lancer dans des discours…
— Parce que vous m’emmerdez !
Et vlan, fin de la communication. Cuisine. J’entame avec mon couteau le morceau de gruyère. Sonnerie encore ! Ah, mais il va entendre parler de moi ! À grands pas je rejoins le téléphone, je vais lui dire son fait, je vais lui clouer le bec !
Sans me laisser le temps d’ouvrir la bouche, c’est lui qui m’abat en plein vol, d’un seul mot :
— Malpoli !
Et il raccroche !
*
Ceux qui subissent, qui s’écrasent et courbent l’échine, n’ont pas d’autre solution ? Parce qu’ils sont isolés, et faibles face aux puissants ?
Ben voilà. Il serait temps que les petits s’unissent. Ils deviendraient plus forts. On pourrait nommer ça un syndicat…
J’ai l’air de plaisanter… Pourtant, la première victoire de ceux qui nous ont imposé ce monde est d’avoir instillé dans la tête des gens l’idée qu’ils étaient seuls, et que se regrouper pour lutter était inutile, ridicule, voire néfaste.
Comme si, de tout temps, les hommes n’avaient pas eu besoin les uns des autres pour survivre et progresser. Formant des bandes pour chasser le mammouth, nos ancêtres s’associaient…
Ils ont réussi à tuer la fraternité.
*
Le spectacle de maintenant : les richesses qui s’accumulent pour quelques-uns, dans le haut de l’échelle, tandis qu’à la base la misère crasse ne cesse de s’étendre. La faim qui ricane toujours, et plus fort que jamais. Le chômage à la hausse, les salaires à la baisse, les petits qu’on méprise et qu’on jette comme des mouchoirs usagés.
Une révolution est nécessaire, j’en ai la conviction.
C’est un peu court ! Il s’agira de vous expliquer pourquoi, il s’agira de trouver les arguments qui pourront vous convaincre, maintenant que par faiblesse je me suis laissé entraîner dans cette histoire…
Dans mon fichier « Idées », j’ai commencé par noter :
« Pourquoi, comment le monde est-il devenu celui que nous vivons ? »
« Est-ce ma – ou notre – responsabilité personnelle ? Avons-nous “ fait faux ” ? Quand ? »
Puis plus bas :
« Que sais-tu encore de tes “ neveux ” ? »
J’avance sur la pointe des pieds. Mes réflexions ne se concrétiseront peut-être pas par la rédaction de « votre » livre, je ne suis pas dupe. Mais j’essaie, je tâtonne.
Sous ces premières questions, j’ai écrit :
« Lire. Étudier notamment ces dernières années. »
« Retrouver ce que je faisais – ce que nous faisions – il y a quarante ans. »
*
Qu’est-ce qui a changé dans nos sociétés, depuis le temps de ma jeunesse ?