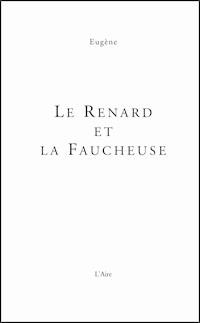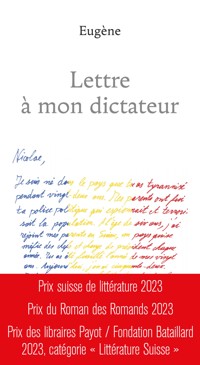
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Slatkine Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Un jour, ma mère m’a appris que j’avais une dette envers quelqu’un. Un type que ni elle ni moi n’aimions. Je ne savais pas quoi faire de cet aveu. Alors je l’ai enfoui dans ma « chambre des vérités embarrassantes ». À cinquante ans, j’ai décidé d’écrire une lettre à cet odieux personnage. Pour mieux comprendre et peut-être me libérer de cette dette. Je croyais en avoir pour quelques soirs, mais ça m’a pris des mois. Car ce n’est pas tous les jours qu’on écrit à… Nicolae Ceaușescu, tyran de la Roumanie pendant vingt-deux ans. Plus j’écrivais, plus je réalisais que Ceaușescu a toujours fait partie de ma vie. Même s’il a été fusillé l’année de mes vingt ans, il n’est pas sorti de mon existence pour autant. Au contraire.Dans Lettre à mon dictateur, Eugène raconte avec sincérité et humour son parcours de migrant, puis d’écrivain. Il découvre que chez un dictateur, la « chambre des vérités embarrassantes » est vide, puisque celui-ci ose tout et se donne tous les droits.Ce titre a reçu le prix suisse de la littérature.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Eugène est né à Bucarest. Arrivé en Suisse à 6 ans, il vit à Lausanne. Il est auteur de littérature (jeunesse et adulte), de pièces de théâtre, de nouvelles, de contes, etc. et enseigne à l’Institut littéraire suisse de Bienne. Ses textes, notamment La Vallée de la Jeunesse, ont reçu plusieurs prix et fait l’objet d’adaptation et de traduction.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi.
Mark Twain
Lettre à mon dictateur
Nicolae,
Je suis né dans le pays que tu as tyrannisé pendant vingt-deux ans. Mes parents ont fui ta police politique qui espionnait et terrorisait la population. À l’âge de six ans, j’ai rejoint mes parents en Suisse, un pays qui se méfie des chefs et change de président chaque année. Tu as été fusillé l’année de mes vingt ans. Aujourd’hui, j’en ai cinquante-deux. Trente-deux ans que tu habites dans ta tombe, Nicolae.
Je suis devenu quelqu’un que tu n’aurais sans doute pas apprécié. Mes histoires évoquent l’absurdité du monde. J’adore l’ironie et je considère l’autodérision comme salutaire.
Bref, je mets un point d’honneur à ne rien avoir en commun avec toi. Pourtant, je te dois quelque chose. J’ai une dette. Dérangeante et irritante.
Au début, notre histoire était belle. Ton visage apparaissait sur des affiches collées sur les murs, sur les palissades et sur de grandes toiles recouvrant les façades des immeubles. Pas une avenue de Bucarest sans ton portrait. Les piétons, les passagers des tramways, les automobilistes admiraient tes exploits.
Tu conduisais un tracteur à travers un champ de blé doré. Tu lâchais une colombe au-dessus d’une usine. Tu te penchais vers un groupe d’écoliers qui t’embrassaient en t’offrant des bouquets de roses. Tu me souriais à tous les coins de rue. À la maison, sur l’écran de la télévision en noir et blanc, ton visage surgissait chaque jour. Dans la cabine de pilotage d’un immense bateau, tu tenais le gouvernail que le capitaine t’avait cédé humblement. Tu donnais des ordres à des généraux à grosses casquettes qui t’écoutaient avec une attention inouïe. Tu montais dans des avions sous les flashs des photographes. Tu sortais d’une longue voiture noire d’un pas pressé. Juché au balcon d’un palais, tu saluais une foule qui pleurait de joie en écoutant tes discours. Sourire carnassier, tu posais à côté de l’ours des Carpates que tu venais de tirer.
Tout le monde t’aimait, et rien ne te faisait peur. J’avais l’impression que Dieu était membre de ma famille.
La propagande communiste ne fonctionnait pas que sur les enfants de cinq ans.
Au début de ton règne, en 1965, ta popularité n’était pas feinte. Ton peuple t’aimait pour de bon. Trois ans plus tard, lorsque Moscou a envoyé les tanks écraser le Printemps de Prague, la Roumanie a été le seul pays du Pacte de Varsovie à ne pas expédier de soldats. Mieux ! Tu as condamné publiquement la répression organisée par le Kremlin : « L’invasion de la Tchécoslovaquie constitue une énorme erreur et un grave danger pour la paix en Europe et l’avenir du socialisme dans le monde ! » as-tu crié depuis le balcon du siège central du Parti communiste roumain, à Bucarest. Une foule immensément fière t’a applaudi.
Pacte de Varsovie, bloc de l’Est, URSS, mur de Berlin… Je te préviens, Nicolae, ces mots puent le formol. Aujourd’hui, les jeunes Européens n’imaginent pas que le continent a été coupé en deux pendant des décennies.
Je suis né dans le bloc de l’Est, six jours avant que Neil Armstrong ne marche dans la mer de la Tranquillité. En ce fameux juillet 1969, la Roumanie était le seul pays du bloc de l’Est à autoriser la retransmission télévisée de l’alunissage américain.
J’imagine les gynécologues et les infirmières de la maternité l’œil rivé sur la petite télévision installée dans le bureau du directeur. J’imagine les nuits blanches du personnel soignant : La fusée Apollo a-t-elle décollé ? La capsule est-elle en orbite autour de la lune ? Le module lunaire s’est-il détaché ? A-t-il atterri ? Les astronautes sont-ils sortis ? A-t-on marché sur la Lune ? Grâce à toi, mes premières journées sur terre se sont déroulées dans une sorte d’allégresse cosmique. Je t’en sais gré.
Du point de vue de ma mère, les choses ne se sont pas déroulées si sereinement. Le bébé que j’étais se présentait mal : les pieds devant. Trop impatient de découvrir les joies du toboggan. Rien à faire pour me retourner. Le gynécologue a dû s’y résoudre : péridurale et césarienne. L’opération s’est bien déroulée. Ma mère n’a ni gémi ni hurlé comme à la naissance de mon frère aîné. Il n’empêche qu’elle éprouvait une sensation atroce. Comme si on lui remuait les tripes à pleines mains. Elle a fini par s’évanouir. Réveil quelques heures plus tard dans la fournaise de la salle commune. Les deux ventilateurs du plafond avaient décidé de faire la grève du vent.
Mes parents habitaient près de la gare du Nord, dans un ancien atelier d’artiste. Une seule pièce de vingt mètres carrés, avec kitchenette et salle de bains grande comme une tasse à café. Poêle en terre cuite dans un coin de la pièce qu’il fallait alimenter en bûches. La réserve de bois était dissimulée sous le plancher : une cave au sol en terre battue à laquelle on accédait par une trappe.
Rien à voir avec tes demeures cossues. Comme un affamé du luxe, tu passais de ton palais à ta villa et de ton château à ton pavillon de chasse. Non content de parcourir ta chère patrie, tu t’invitais chez les puissants de ce monde. Du shah d’Iran au Grand Timonier Mao, qui n’as-tu pas chaleureusement embrassé ? Comme tu n’étais pas « aligné » sur la politique du Kremlin, les présidents occidentaux t’adoraient. Tu te rends compte, Nicolae ? Tu as voyagé aux États-Unis plus souvent que la reine d’Angleterre !
Chapeau bas. Tu savais mener ta barque.
En mai 1968, Charles de Gaulle t’a rendu visite durant une semaine. La fumée des voitures incendiées étouffait Paris ; le quartier Latin disparaissait sous les barricades ; les étudiants balançaient des pavés sur les six mille CRS venus les arrêter ; la Sorbonne était occupée par les étudiants débattant avec fièvre ; le mécontentement universitaire menaçait de s’étendre au monde ouvrier. Pourtant, de Gaulle n’a rien trouvé de plus urgent que de s’envoler pour Bucarest. Le samedi 18 mai, tandis qu’un million d’ouvriers en grève paralysaient la France, Charles de Gaulle s’est rendu à l’Université de Bucarest. Il y a été acclamé par des étudiants ravis.
L’été suivant, le président Nixon est venu te faire une petite visite de deux jours. Des milliers d’étudiants à travers l’Amérique conspuaient ce président honni qui avait envoyé un demi-million de GI passer le Vietnam au napalm. Mais, à l’Université de Bucarest, Nixon a eu droit à sa standing ovation !
J’imagine les chancelleries occidentales se passant l’information : « Vous êtes critiqué dans votre pays ? Votre jeunesse vous déteste ? Vous n’osez plus quitter votre limousine dans votre propre capitale ? N’hésitez plus : offrez-vous un bain de foule dans la Roumanie de Ceaușescu. Applaudimètre en folie. Ambiance bon enfant garantie. »
Ne blâmons pas la jeunesse roumaine acclamant Nixon. Ces débordements de joie envers des présidents étrangers témoignaient avant tout d’une soif d’ouverture. La liberté de mouvement était morte en même temps que la proclamation de la République populaire roumaine, après la Seconde Guerre mondiale.
En 1961, la construction d’un mur à travers Berlin a fait office de symbole pour tout le continent. Appelé « mur de la liberté » par l’Allemagne de l’Est qui l’a érigé et « mur de la honte » par les Allemands de l’Ouest. Libres, parce qu’emmurés ? La propagande communiste osait tout.
Toutefois, dans la Roumanie que tu dirigeais, de brefs voyages à l’étranger étaient tolérés. Pour s’assurer le retour au bercail, ta Commission nationale des visas et des passeports s’appuyait sur une règle simple : la séparation des proches. S’il s’agissait d’un couple sans enfant, alors un des deux partenaires passait la frontière, tandis que l’autre restait au pays. S’il s’agissait d’une famille, alors les parents voyageaient sans leurs enfants. Retour assuré.
Sauf que non.
Mon père et ma mère ont obtenu un visa touristique de trente jours. Mon frère – âgé de sept ans – et moi – âgé de cinq – avions été confiés à notre tante, notre oncle et notre grand-mère. Mes parents ont quitté ta capitale par un matin ensoleillé de juillet 1974. À bord de leur Renault 4 fabriquée en Roumanie sous la marque Dacia, ils ont foncé en direction de la ville de Timişoara, à l’ouest du pays.
Ils ont prévu une petite mise en scène pour tes douaniers. Comme tu t’en souviens certainement, tes citoyens n’étaient autorisés à sortir du pays qu’une petite somme d’argent. Ponctuellement, les douaniers fouillaient les véhicules. Si le montant autorisé était dépassé, le surplus passait dans leurs poches. Mon père et ma mère ont étalé leur pauvreté en disposant deux plaids sur la banquette arrière :
– Nous n’avons pas de quoi passer ne serait-ce qu’une seule nuit à hôtel. On dormira dans la Dacia.
– D’accord, d’accord. Circulez.
Je vais te confier un secret, Nicolae. En réalité, mon père et ma mère ont planqué une grosse liasse de dollars dans leurs affaires. Tu veux savoir où ? Aujourd’hui, il y a prescription. Je peux te révéler que les dollars étaient bien au chaud dans le bocal de Nescafé ! Qu’est-ce que tu dis de ça ? Tes flics n’y ont vu que du feu.
Mes parents ont roulé en Hongrie comme on traverse un tunnel en feu. Pied au plancher, ils ont parcouru le dernier pays du bloc de l’Est sans même marquer de pause à Budapest. Ils ont fini les sandwichs au fromage et vidé le thermos de café en roulant. Ils te fuyaient. Ils te fuyaient à cent kilomètres à l’heure. Mais dans leur tête, dans leur cœur, ils se traînaient. On ne te fuit jamais assez vite…
En fin d’après-midi, les deux touristes ont franchi le rideau de fer. Immense émotion pour ma mère qui n’avait encore jamais quitté le bloc de l’Est, tandis que mon père restait concentré sur la circulation. De toute façon, quelques années plus tôt, il avait eu droit à un voyage à Paris avec ses collègues de l’Institut de physique atomique : il avait respiré « l’air de la liberté », comme il disait.
Prochaine étape : Vienne. Dans cette ville inconnue, ancienne capitale d’un empire disparu, ils se sont mal repérés. Finalement, la Grande Roue du Prater a fait office de phare dans la nuit. Peu avant minuit, ils ont immobilisé la Dacia sous un platane, ont tiré les plaids sur eux et, main dans la main, se sont endormis. Ils se sont promis de revenir ici un jour si leur plan se déroulait comme prévu, pour monter dans la Grande Roue.
Le lendemain, la Dacia a traversé l’Autriche d’est en ouest. Ils ont fini par s’égarer dans les Alpes. Ma mère ne connaissait que la chaîne des Carpates, dont les plus hauts sommets ne dépassaient pas mille cinq cents mètres. Elle a eu la frayeur de sa vie sur les lacets alpins, non loin d’Innsbruck. Ils ont passé la frontière suisse près du lac de Constance. Épuisés, ils ont décidé de parquer la voiture au bord du lac. Ils se sont endormis comme des bienheureux, en admirant la lune se refléter dans l’eau. Les traîtres à la patrie ont une âme romantique…
Aube saluée avec du Nescafé froid. Quelques biscuits de qualité roumaine (donc farineux) en guise de petit-déjeuner. Et en voiture ! Ah ! les autoroutes helvétiques ! Aucune aspérité, pas la moindre bosse à éviter : de vraies tables de billard. Des merveilles construites depuis dix ans par des ouvriers espagnols, portugais et italiens à qui les autorités suisses interdisaient le regroupement familial. Mais, ça, mes parents l’ignoraient.
Destination finale : Lausanne. Ne sachant où s’arrêter, mon père a parqué la Dacia dans le quartier Sous-Gare, boulevard de Grancy très exactement.
Pas un papier d’emballage sur le trottoir, des bacs de bégonias sur lesquels aucun chien errant n’a pissé, une boulangerie vendant du pain aux cinq céréales, des tartes aux cerises et de la brioche. Un kiosque où on trouvait Le Monde, The New York Times, Der Spiegel. Et surtout aucun portrait de toi nulle part ! « Nous sommes arrivés au paradis », a murmuré ma mère.
Maintenant le coup de fil.
Une ancienne collègue de mon père avait obtenu le statut de réfugié politique deux ans plus tôt. Elle se prénommait Angela, et son mari, Mircea. C’était leur contact. Mon père avait planqué leur numéro de téléphone dans sa chaussette. Ma mère s’est rendue au kiosque pour faire de la monnaie (mon père était trop timide pour oser parler français). Le poing rempli de pièces de vingt centimes, il est entré dans la cabine téléphonique du boulevard de Grancy pour composer le numéro de son ex-collègue. De cet appel dépendait son avenir, celui de ses deux enfants et de toute la famille Meiltz.
Ça n’a pas répondu. Après avoir parcouru trois fois le mode d’emploi d’une cabine téléphonique suisse (rigoureusement identique à celui de n’importe quelle cabine téléphonique dans le monde), mon père a répété l’opération. Aucun résultat. Puis ils ont réfléchi. Il n’était que treize heures trente. Angela devait être au travail. Ils la rappelleraient en fin d’après-midi.
Mes parents ont arpenté les six cents mètres du boulevard de Grancy dans un sens, puis dans l’autre. Ils ignoraient qu’il s’agissait du seul et unique boulevard de Lausanne. Un siècle plutôt, les bourgeois de la ville avaient décidé de tracer une belle artère au milieu des vignes. Une ville sans boulevard faisait trop plouc. On y a construit de beaux appartements avec vue sur le Léman.
Mircea est venu les chercher à dix-neuf heures. Il a invité les nouveaux venus à dormir à la maison. Ils habitaient en dehors de Lausanne, dans un immeuble au bord des champs. Les Roumains en exil se sont embrassés, congratulés et tapés dans le dos. Pourtant une ombre ternissait cette joie. Le même nuage noir planait au-dessus de Mircea et Angela. Leurs deux enfants étaient restés en Roumanie ; ils tentaient de les arracher de tes griffes.
Après avoir mangé des sarmale cuisinées avec des feuilles de vignes achetées dans un magasin grec, les deux couples se sont installés au salon pour fumer et discuter.
Mes parents voulaient savoir comment obtenir le statut de réfugié politique. Est-ce que les autorités helvétiques acceptaient facilement le regroupement familial ? Mircea a raconté que l’année précédente, suite à la chute du président Allende au Chili et l’arrivée au pouvoir du général Pinochet, la Suisse avait déclaré ne pas avoir la capacité d’accueillir de réfugiés. Par contre, les réfugiés des pays de l’Est étaient toujours les bienvenus. Mon père ne comprenait pas cette injustice.
– La Suisse est un pays de droite, a résumé Mircea en rigolant.
Joie profonde sur le visage de mes parents. Chaque réfugié fuyant le bloc de l’Est était la preuve vivante que le système communiste ne fonctionnait pas. Cela discréditait le Parti socialiste suisse. En revanche, les malheureux Chiliens fuyant le régime de Pinochet étaient socialistes. Donc la Suisse leur a fermé la porte…
Deux jours plus tard, mon père et ma mère se sont rendus dans un bureau au centre de Lausanne pour déposer leur demande officielle en vue de l’obtention d’un statut de réfugié politique. Le fonctionnaire de la police des étrangers a prié les deux requérants de le suivre dans son bureau. Derrière sa machine à écrire, le fonctionnaire les a mitraillés de questions. Pouvaient-ils motiver leur demande ? Concrètement, qui les menaçait en Roumanie ? Préciser la nature du danger.
Mon père a hésité un instant. Devait-il parler de ton dernier délire ? Il y a quelques mois, tu avais exigé que la Grande Assemblée nationale de Roumanie t’élise président de la République. Jusqu’à présent, tu n’étais « que » secrétaire général du Parti communiste roumain. Comme la Constitution roumaine ne prévoyait pas la fonction de président, il a fallu l’amender. Une simple formalité, puisque tu contrôlais tous les députés de l’Assemblée nationale. Pourtant il t’en fallait plus : à l’occasion de la cérémonie d’investiture, tu as exigé de recevoir… un sceptre en or. Un architecte s’est aussitôt proposé pour dessiner et réaliser cet emblème du pouvoir monarchique. La cérémonie a été retransmise en direct à la télévision. Mon père se souvenait parfaitement du discours tenu par un des vétérans du Parti : « Au nom de la Grande Assemblée nationale, veuillez accepter ces symboles de dignité, de prestige, de souveraineté et d’autorité du peuple roumain qui témoignent de sa volonté de suivre son propre modèle de socialisme et de communisme. »
Le 28 mars 1974, tu t’es transformé en président communiste de… sang royal. Mais ton délire mégalomane motivait-il une demande d’asile ?
Ma mère a hésité à son tour.
Et si elle mentionnait le télégramme que t’a envoyé Salvator Dali ? Le lendemain de la cérémonie d’investiture, le roi des surréalistes a rédigé un télégramme de félicitations. À l’époque, la célébrité de l’artiste catalan était telle que L’Étincelle, le journal officiel du Parti communiste roumain, a reproduit le message dans ses colonnes. Ni le rédacteur en chef ni le ministre des Affaires étrangères n’ont réalisé l’ironie du texte. Les lecteurs se sont esclaffés en découvrant la gaffe du journal. Ma mère, comme beaucoup de Roumains, le connaissait par cœur.
Son Excellence Nicolae Ceaucescu
Président de la République Socialiste de Roumanie
J’apprécie profondément votre acte historique d’instituer un sceptre présidentiel.
Respectueusement vôtre, Salvator Dali
Mais le fait qu’un président ait inventé des cérémonies suffisamment dingues pour recevoir les félicitations de Dali motivait-il une demande d’asile ?
Dans le bureau de la police des étrangers, le silence devenait aigre. Les deux classeurs fédéraux disposés sur une étagère obnubilaient les deux requérants. Leur demande d’asile sera-t-elle conservée dans le classeur « acceptée » ou « refusée » ? Le fonctionnaire de la police des étrangers grimaçait avec ostentation.
Mon père devait-il évoquer ton fameux voyage en Asie ? En juin 1971, tu t’es envolé pour la Chine. Tu as rencontré le président Mao. La ferveur du peuple envers son guide suprême, l’admiration sans borne des cadres du Parti communiste pour leur Grand Timonier t’ont émerveillé. Ta femme et toi nagiez en plein bonheur lorsque des milliers d’enfants qui n’avaient encore jamais entendu parler de vous vingt-quatre heures plus tôt ont lâché une nuée de ballons rouges sur la place Tian’anmen.
Au bout de six jours, après avoir visité des chantiers, embrassé des responsables politiques locaux et des jeunes pionniers enthousiastes, tu as quitté Pékin, en agitant le bras avec ferveur. Direction : la Corée du Nord.
L’allégresse vécue en Chine n’était rien en comparaison de la béatitude ressentie au Pays du Matin calme. L’accueil que t’a réservé Kim Il-sung a été mémorable. Dans le stade de Pyongyang, cinquante mille jeunes ont exécuté des parades, tandis que cent mille spectateurs ont pris place sur les gradins. Des forêts de bras ont dressé des panneaux colorés formant des soleils, des colombes, des tracteurs, des camions et des soldats. Jumelles à portée de mains, tu t’es enthousiasmé ; tu as applaudi ; tu t’es esclaffé aux blagues de Kim Il-sung traduites à ton oreille par un interprète jovial.
Et soudain la tribune qui te faisait face s’est remplie de ces paroles :
« Tovăraşul Nicolae Ceauşescu Conducător iubit şi stimat al populurui român ! »1
Du roumain à Pyongyang ! Durant un instant, tu t’es cru universel : autant aimé en Occident qu’adulé en Asie.
À la fin de la représentation, tu as serré la main du maître d’œuvre de ce spectacle grandiose. Kim Il-sung t’a présenté son ministre de la Propagande, un homme d’une trentaine d’années, souriant, sûr de lui. Ton regard incrédule est passé de Kim Il-sung au ministre de la Propagande et du ministre à Kim Il-sung. Comme un air de famille. Mais c’était impossible. Puis le dictateur coréen a éclaté de rire : « Cher Nicolae, je vous présente Kim Jong-il, mon fils chéri. »
Un guide suprême qui n’avait pas peur de nommer son fils au gouvernement. Et ministre de la Propagande qui plus est ! Cette fois, plus de doute. Tu avais trouvé ton mentor.
Trois semaines après ton retour d’Asie, tu as tenu un discours stupéfiant devant le comité exécutif du Parti communiste roumain. J’imagine que tu te souviens par cœur de tes dix-sept propositions. Amélioration de l’action politique du Parti. Intensification de l’éducation politico-idéologique dans les écoles, les universités et les organisations pour les enfants telles que les jeunesses communistes. Abolition de la différence entre ville et campagne : « Les villages doivent être rasés, camarades ! Les paysans seront relogés dans des HLM. Ce qui cassera leur attachement à la terre. Rien ne doit s’opposer à la collectivisation. Les jeunes assumeront leur part de travail patriotique en participant aux grands projets de construction nationaux. » Interdiction des chaînes radiophoniques étrangères. Suppression des journaux étrangers. Expansion de la propagande politique à la radio, la télévision, au monde de l’édition, au cinéma, au théâtre, à l’opéra et au ballet. « Oui, camarades, même la danse sera communiste ! »
Bref, tu as décrété la folie.
Tes dix-sept propositions surnommées « Les Thèses de juillet » ont semé le trouble. Bien que personne ne crût en la mise en œuvre d’un tel plan, les Roumains ont commencé sérieusement à s’inquiéter. Dans la foulée, tu as ordonné la traduction de plusieurs ouvrages idéologiques et philosophiques de Corée du Nord. Les vitrines des librairies se sont remplies de bouquins rouges ornés du portrait de Kim Il-sung…
Mais ta promesse de transformer la Roumanie en Corée du Nord était-elle suffisante pour motiver une demande d’asile ?
À Lausanne, par la fenêtre du bureau, le bleu azur invitait à la rêverie. Comment imaginer que sous ce même ciel des tyrans organisaient la surveillance généralisée de leur propre population et décrétaient la « transformation nationale totale » ?
Le silence de ces deux requérants irritait au plus haut point le fonctionnaire vaudois. L’heure de la pause-café était imminente. Pourtant, au lieu de clore la discussion, le fonctionnaire a fait preuve de bienveillance.
– Êtes-vous membre du Parti communiste roumain ?
– Non, a admis mon père.
Papa était un très bon joueur d’échecs. Il a repéré tout de suite l’ouverture.
– Vous m’avez dit que vous êtes physicien, monsieur Meiltz. Vos supérieurs hiérarchiques de l’Institut de physique atomique ne vous ont-ils jamais reproché votre refus d’adhérer au Parti communiste ?
– Si, bien sûr.
Cette fois, papa avançait ses pions. La partie était engagée.
– Plusieurs collègues ont manifesté leur étonnement dans des réunions. Ils… ils ne comprenaient pas pourquoi j’occupais un si bon poste alors que je n’avais pas la carte du Parti. On m’a menacé de me virer.
– Pourquoi ne voulez-vous pas prendre la carte du Parti communiste ?
Le bruit de la machine à écrire rythmait les déclarations de mon père. De sa vie, il n’avait jamais tenu une si longue conversation en français.
– En Union soviétique, le Parti communiste a dynamité des églises et fusillé des prêtres. En Roumanie, avec la nouvelle orientation politique de Ceaușescu suite à son voyage en Corée du Nord et en Chine, les choses sont en train de mal tourner. Je ne veux pas être membre d’un parti qui met en place des horreurs contre la population.
Du pain béni pour le fonctionnaire.
Mon père était stupéfait. D’abord, il ne savait pas qu’il connaissait autant de mots dans la langue de Charles de Gaulle. L’empathie d’un fonctionnaire constituait l’autre motif d’étonnement. Comme mon père ne fréquentait que les administrations communistes, il pensait que le travail principal d’un fonctionnaire était de rabrouer, d’humilier ou de démoraliser ses concitoyens.
La décision des autorités du canton de Vaud est tombée quelques semaines plus tard : le statut de réfugiés politiques était octroyé à mes parents. Ils étaient donc autorisés à demeurer sur le territoire helvétique. Autorisation assortie d’une condition un peu étrange. Pour montrer qu’ils faisaient un pas vers la Suisse, on exigeait d’eux qu’ils renoncent à leur nationalité roumaine. Toutefois, la Confédération helvétique ne leur délivrerait pas de passeport à croix blanche. Ils n’obtiendraient qu’un titre de séjour nommé permis B. La Suisse faisait d’eux des apatrides.