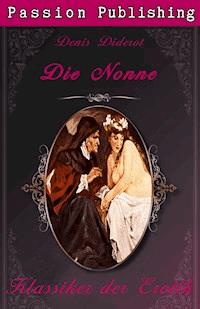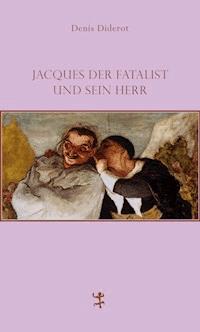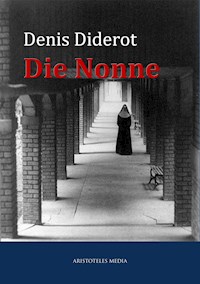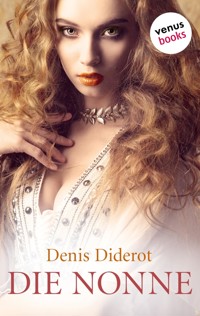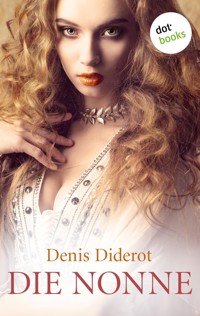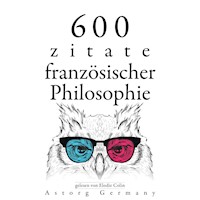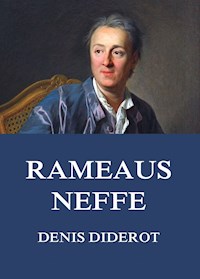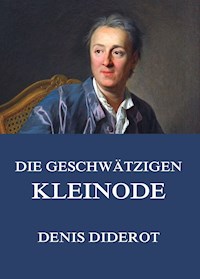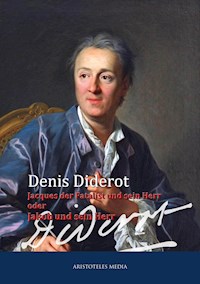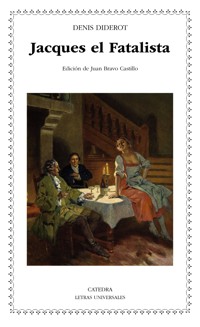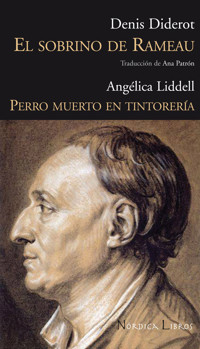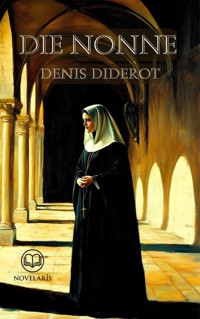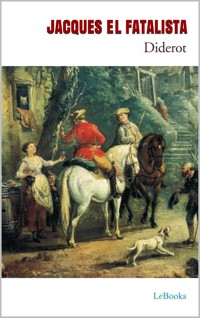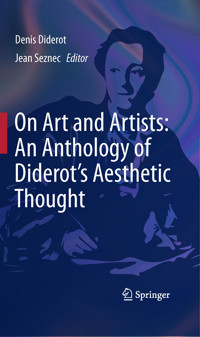Lettre sur les sourds et muets, à l'usage de ceux qui entendent et qui voient E-Book
Denis Diderot
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Qu'on vous demande ce que c'est qu'un corps, vous répondrez que c'est une substance étendue, impénétrable, figurée, colorée et mobile. Mais ôtez de cette définition tous les adjectifs, que restera-t-il pour cet être imaginaire que vous appelez substance ?"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335001259
©Ligaran 2015
De V…… ce 20 janvier 1751.
Je vous envoie, monsieur, la Lettre à l’auteur des Beaux-arts réduits à un même principe, revue, corrigée et augmentée sur les conseils de mes amis, mais toujours avec son même titre.
Je conviens que ce titre est applicable indistinctement au grand nombre de ceux qui parlent sans entendre, au petit nombre de ceux qui entendent sans parler, et au très petit nombre de ceux qui savent parler et entendre, quoique ma lettre ne soit guère qu’à l’usage de ces derniers.
Je conviens encore qu’il est fait à l’imitation d’un autre qui n’est pas trop bon ; mais je suis las d’en chercher un meilleur. Ainsi, de quelque importance que vous paraisse le choix d’un titre, celui de ma lettre restera tel qu’il est.
Je n’aime guère les citations, celles du grec moins que les autres. Elles donnent à un ouvrage l’air scientifique qui n’est plus chez nous à la mode. La plupart des lecteurs en sont effrayés ; et j’ôterais d’ici cet épouvantail, si je pensais en libraire. Mais il n’en est rien. Laissez donc le grec partout où j’en ai mis. Si vous vous souciez fort peu qu’un ouvrage soit bon, pourvu qu’il se lise ; ce dont je me soucie, moi, c’est de bien faire le mien, au hasard d’être un peu moins lu.
Quant à la multitude des objets sur lesquels je me plais à voltiger, sachez, et apprenez à ceux qui vous conseillent, que ce n’est point un défaut dans une lettre, où l’on est censé converser librement, et où le dernier mot d’une phrase est une transition suffisante.
Vous pouvez donc m’imprimer, si c’est là tout ce qui vous arrête ; mais que ce soit sans nom d’auteur, s’il vous plaît. J’aurai toujours le temps de me faire connaître. Je sais d’avance à qui l’on n’attribuera pas mon ouvrage ; et je sais bien encore à qui l’on ne manquerait pas de l’attribuer, s’il y avait de la singularité dans les idées, une certaine imagination, du style, je ne sais quelle hardiesse de penser que je serais bien fâché d’avoir, un étalage de mathématiques, de métaphysique, d’italien, d’anglais, et surtout moins de latin et de grec, et plus de musique.
Veillez, je vous prie, à ce qu’il ne se glisse point de fautes dans les exemples ; il n’en faudrait qu’une pour tout gâter. Vous trouverez dans la planche du dernier livre de Lucrèce, de la belle édition de Havercamp, la figure qui me convient. Il faut seulement en écarter un enfant qui la cache à moitié, lui supposer une blessure au-dessous du sein, et en faire prendre le trait. M. de S…, mon ami, s’est chargé de revoir les épreuves. Il demeure rue Neuve des…
Je suis,
Monsieur,
Votre, etc.
à l’usage de ceux qui entendent et qui parlent
Où l’on traite de l’origine des inversions, de l’harmonie du style, du sublime de situation, de quelques avantages de la langue française sur la plupart des langues anciennes et modernes, et, par occasion, de l’expression particulière aux beaux-arts.
Je n’ai point eu dessein, monsieur, de me faire honneur de vos recherches, et vous pouvez revendiquer dans cette lettre tout ce qui vous conviendra. S’il est arrivé à mes idées d’être voisines des vôtres, c’est comme au lierre à qui il arrive quelquefois de mêler sa feuille à celle du chêne. J’aurais pu m’adresser à M. l’abbé de Condillac, ou à M. du Marsais, car ils ont aussi traité la matière des inversions : mais vous vous êtes offert le premier à ma pensée ; et je me suis accommodé de vous, bien persuadé que cette fois-ci le public ne prendrait point une rencontre heureuse pour une préférence. La seule crainte que j’aie, c’est celle de vous distraire, et de vous ravir des instants que vous donnez sans doute à l’étude de la philosophie, et que vous lui devez.
Pour bien traiter la matière des inversions, je crois qu’il est à propos d’examiner comment les langues se sont formées. Les objets sensibles ont les premiers frappé les sens ; et ceux qui réunissaient plusieurs qualités sensibles à la fois ont été les premiers nommés : ce sont les différents individus qui composent cet univers. On a ensuite distingué les qualités sensibles les unes des autres ; on leur a donné des noms : ce sont la plupart des adjectifs. Enfin, abstraction faite de ces qualités sensibles, on a trouvé ou cru trouver quelque chose de commun dans tous ces individus, comme l’impénétrabilité, l’étendue, la couleur, la figure, etc. ; et l’on a formé les noms métaphysiques et généraux, et presque tous les substantifs. Peu à peu on s’est accoutumé à croire que ces noms représentaient des êtres réels ; on a regardé les qualités sensibles comme de simples accidents, et l’on s’est imaginé que l’adjectif était réellement subordonné au substantif, quoique le substantif ne soit proprement rien, et que l’adjectif soit tout. Qu’on vous demande ce que c’est qu’un corps, vous répondrez que c’est une substance étendue, impénétrable, figurée, colorée et mobile. Mais ôtez de cette définition tous les adjectifs, que restera-t-il pour cet être imaginaire que vous appelez substance ? Si on voulait ranger dans la même définition les termes, suivant l’ordre naturel, on dirait colorée, figurée, étendue, impénétrable, mobile, substance. C’est dans cet ordre que les différentes qualités des portions de la matière affecteraient, ce me semble, un homme qui verrait un corps pour la première fois. L’œil serait frappé d’abord de la figure, de la couleur et de l’étendue ; le toucher, s’approchant ensuite du corps, en découvrirait l’impénétrabilité ; et la vue et le toucher s’assureraient de la mobilité. Il n’y aurait donc point d’inversion dans cette définition ; et il y en a une dans celle que nous avons donnée d’abord. De là, il résulte que, si on veut soutenir qu’il n’y a point d’inversion en français, ou du moins qu’elle y est beaucoup plus rare que dans les langues savantes, on peut le soutenir tout au plus dans ce sens, que nos constructions sont pour la plupart uniformes ; que le substantif y est toujours ou presque toujours placé avant l’adjectif ; et le verbe, entre deux : car si on examine cette question en elle-même ; savoir si l’adjectif doit être placé devant ou après le substantif, on trouvera que nous renversons souvent l’ordre naturel des idées : l’exemple que je viens d’apporter en est une preuve.
Je dis l’ordre naturel des idées ; car il faut distinguer ici l’ordre naturel d’avec l’ordre d’institution, et, pour ainsi dire, l’ordre scientifique : celui des vues de l’esprit, lorsque la langue fut tout à fait formée.
Les adjectifs représentant, pour l’ordinaire, les qualités sensibles, sont les premiers dans l’ordre naturel des idées ; mais pour un philosophe, ou plutôt pour bien des philosophes qui se sont accoutumés à regarder les substantifs abstraits comme des êtres réels, ces substantifs marchent les premiers dans l’ordre scientifique, étant, selon leur façon de parler, le support ou le soutien des adjectifs. Ainsi, des deux définitions du corps que nous avons données, la première suit l’ordre scientifique, ou d’institution ; la seconde, l’ordre naturel.
De là on pourrait tirer une conséquence ; c’est que nous sommes peut-être redevables à la philosophie péripatéticienne, qui a réalisé tous les êtres généraux et métaphysiques, de n’avoir presque plus dans notre langue de ce que nous appelons des inversions dans les langues anciennes. En effet, nos auteurs gaulois en ont beaucoup plus que nous et cette philosophie a régné, tandis que notre langue se perfectionnait sous Louis XIII et sous Louis XIV. Les Anciens, qui généralisaient moins, et qui étudiaient plus la nature en détail et par individus, avaient dans leur langue une marche moins monotone ; et peut-être le mot d’inversion eût-il été fort étrange pour eux. Vous ne m’objecterez point ici, monsieur, que la philosophie péripatéticienne est celle d’Aristote, et par conséquent d’une partie des Anciens ; car vous apprendrez, sans doute, à vos disciples que notre péripatétisme était bien différent de celui d’Aristote.
Mais il n’est peut-être pas nécessaire de remonter à la naissance du monde et à l’origine du langage, pour expliquer comment les inversions se sont introduites et conservées dans les langues. Il suffirait, je crois, de se transporter en idée chez un peuple étranger dont on ignorerait la langue ; ou, ce qui revient presque au même, on pourrait employer un homme qui, s’interdisant l’usage des sons articulés, tâcherait de s’exprimer par gestes.
Cet homme, n’ayant aucune difficulté sur les questions qu’on lui proposerait, n’en serait que plus propre aux expériences ; et l’on n’en inférerait que plus sûrement de la succession de ses gestes, quel est l’ordre d’idées qui aurait paru le meilleur aux premiers hommes pour se communiquer leurs pensées par gestes, et quel est celui dans lequel ils auraient pu inventer les signes oratoires.
Au reste, j’observerais de donner à mon Muet de convention tout le temps de composer sa réponse ; et quant aux questions, je ne manquerais pas d’y insérer les idées dont je serais le plus curieux de connaître l’expression par geste et le sort dans une pareille langue. Ne serait-ce pas une chose, sinon utile, du moins amusante, que de multiplier les essais sur les mêmes idées, et que de proposer les mêmes questions à plusieurs personnes en même temps ? Pour moi, il me semble qu’un philosophe qui s’exercerait de cette manière avec quelques-uns de ses amis, bons esprits et bons logiciens, ne perdrait pas entièrement son temps. Quelque Aristophane en ferait, sans doute, une scène excellente ; mais qu’importe ? on se dirait à soi-même ce que Zénon disait à son prosélyte : εί φιλοσοφίας έπιθυμεĩς, παρασχευα ζού αύτοθέν, ώς καταγελαθησόμενος, ώς, etc. Si tu veux être philosophe, attends-toi à être tourné en ridicule. La belle maxime, Monsieur ! et qu’elle serait bien capable de mettre au-dessus des discours des hommes et de toutes considérations frivoles, des âmes moins courageuses encore que les nôtres !
Il ne faut pas que vous confondiez l’exercice que je vous propose ici avec la pantomime ordinaire. Rendre une action, ou rendre un discours par des gestes, ce sont deux versions fort différentes. Je ne doute guère qu’il n’y eût des inversions dans celles de nos muets, que chacun d’eux n’eût son style, et que les inversions n’y missent des différences aussi marquées que celles qu’on rencontre dans les anciens auteurs grecs et latins. Mais comme le style qu’on a est toujours celui qu’on juge le meilleur, la conversation qui suivrait les expériences ne pourrait qu’être très philosophique et très vive ; car tous nos muets de convention seraient obligés, quand on leur restituerait l’usage de la parole, de justifier, non seulement leur expression, mais encore la préférence qu’ils auraient donnée, dans l’ordre de leurs gestes, à telle ou telle idée.
Cette réflexion, Monsieur, me conduit à une autre : elle est un peu éloignée de la matière que je traite ; mais, dans une lettre, les écarts sont permis, surtout lorsqu’ils peuvent conduire à des vues utiles. Mon idée serait donc de décomposer, pour ainsi dire, un homme, et de considérer ce qu’il tient de chacun des sens qu’il possède. Je me souviens d’avoir été quelquefois occupé de cette espèce d’anatomie métaphysique ; et je trouvais que, de tous les sens, l’œil était le plus superficiel ; l’oreille, le plus orgueilleux ; l’odorat, le plus voluptueux ; le goût, le plus superstitieux et le plus inconstant ; le toucher, le plus profond et le plus philosophe. Ce serait, à mon avis, une société plaisante, que celle de cinq personnes dont chacune n’aurait qu’un sens ; il n’y a pas de doute que ces gens-là ne se traitassent tous d’insensés ; et je vous laisse à penser avec quel fondement. C’est là pourtant une image de ce qui arrive à tout moment dans le monde : on n’a qu’un sens, et l’on juge de tout. Au reste, il y a une observation singulière à faire sur cette société de cinq personnes dont chacune ne jouirait que d’un sens ; c’est que, par la faculté qu’elles auraient d’abstraire, elles pourraient toutes être géomètres, s’entendre à merveille, et ne s’entendre qu’en géométrie. Mais je reviens à nos muets de convention, et aux questions dont on leur demanderait la réponse.
Si ces questions étaient de nature à en permettre plus d’une, il arriverait presque nécessairement qu’un des muets en ferait une, un autre muet une autre ; et que la comparaison de leurs discours serait, sinon impossible, du moins difficile. Cet inconvénient m’a fait imaginer qu’au lieu de proposer une question, peut-être vaudrait-il mieux proposer un discours à traduire du français en gestes. Il ne faudrait pas manquer d’interdire l’ellipse aux traducteurs, la langue des gestes n’est déjà pas trop claire, sans augmenter encore son laconisme par l’usage de cette figure. On conçoit, aux efforts que font les sourds et muets de naissance pour se rendre intelligibles, qu’ils expriment tout ce qu’ils peuvent exprimer. Je recommanderais donc à nos muets de convention de les imiter, et de ne former, autant qu’ils le pourraient, aucune phrase où le sujet et l’attribut avec toutes leurs dépendances ne fussent énoncés. En un mot, ils ne seraient libres que sur l’ordre qu’ils jugeraient à propos de donner aux idées, ou plutôt aux gestes qu’ils emploieraient pour les représenter.
Mais il me vient un scrupule. C’est que, les pensées s’offrant à notre esprit, je ne sais par quel mécanisme, à peu près sous la forme qu’elles auront dans le discours, et, pour ainsi dire, tout habillées, il y aurait à craindre que ce phénomène particulier ne gênât le geste de nos muets de convention ; qu’ils ne succombassent à une tentation qui entraîne presque tous ceux qui écrivent dans une autre langue que la leur, la tentation de modeler l’arrangement de leurs signes sur l’arrangement des signes de la langue qui leur est habituelle ; et que, de même que nos meilleurs latinistes modernes, sans nous en excepter ni l’un ni l’autre, tombent dans des tours français, la construction de nos muets ne fût pas la vraie construction d’un homme qui n’aurait jamais eu aucune notion de langue. Qu’en pensez-vous, monsieur ? cet inconvénient serait peut-être moins fréquent que je ne l’imagine, si nos muets de convention étaient plus philosophes que rhéteurs ; mais, en tout cas, on pourrait s’adresser à un sourd et muet de naissance.
Il vous paraîtra singulier, sans doute, qu’on vous renvoie à celui que la nature a privé de la faculté d’entendre et de parler, pour en obtenir les véritables notions de la formation du langage. Mais considérez, je vous prie, que l’ignorance est moins éloignée de la vérité que le préjugé ; et qu’un sourd et muet de naissance est sans préjugé sur la manière de communiquer la pensée ; que les inversions n’ont point passé d’une autre langue dans la sienne ; que s’il en emploie, c’est la nature seule qui les lui suggère ; et qu’il est une image très approchée de ces hommes fictifs qui, n’ayant aucun signe d’institution, peu de perceptions, presque point de mémoire, pourraient passer aisément pour des animaux à deux pieds ou à quatre.
Je peux vous assurer, monsieur, qu’une pareille traduction ferait beaucoup d’honneur, quand elle ne serait guère meilleure que la plupart de celles qu’on nous a données depuis quelque temps. Il ne s’agirait pas seulement ici d’avoir bien saisi le sens et la pensée ; il faudrait encore que l’ordre des signes de la traduction correspondît fidèlement à l’ordre des gestes de l’original. Cet essai demanderait un philosophe qui sût interroger son auteur, entendre sa réponse, et la rendre avec exactitude ; mais la philosophie ne s’acquiert pas en un jour.
Il faut avouer cependant que l’une de ces choses faciliterait beaucoup les autres ; et que, la question étant donnée avec une exposition précise des gestes qui composeraient la réponse, on parviendrait à substituer aux gestes à peu près leur équivalent en mots ; je dis à peu près, parce qu’il y a des gestes sublimes que toute l’éloquence oratoire ne rendra jamais. Tel est celui de Macbeth dans la tragédie de Shakespeare. La somnambule Macbeth s’avance en silence (acte V, scène I), et les yeux fermés, sur la scène, imitant l’action d’une personne qui se lave les mains, comme si les siennes eussent encore été teintes du sang de son roi qu’elle avait égorgé il y avait plus de vingt ans. Je ne sais rien de si pathétique en discours que le silence et le mouvement des mains de cette femme. Quelle image du remords !
La manière dont une autre femme annonça la mort à son époux incertain de son sort, est encore une de ces représentations dont l’énergie du langage oral n’approche pas. Elle se transporta, avec son fils entre ses bras, dans un endroit de la campagne où son mari pouvait l’apercevoir de la tour où il était renfermé ; et après s’être fixé le visage pendant quelque temps du côté de la tour, elle prit une poignée de terre qu’elle répandit en croix sur le corps de son fils qu’elle avait étendu à ses pieds. Son mari comprit le signe, et se laissa mourir de faim. On oublie la pensée la plus sublime ; mais ces traits ne s’effacent point. Que de réflexions ne pourrais-je pas faire ici, monsieur, sur le sublime de situation, si elles ne me jetaient pas trop hors de mon sujet.