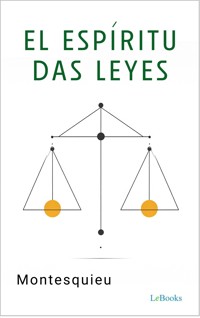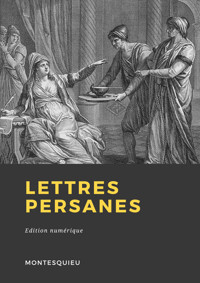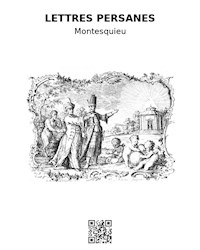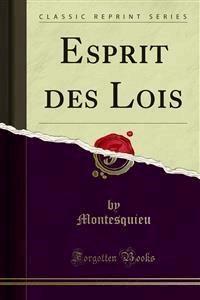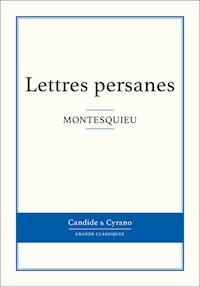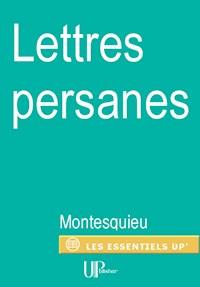Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Lettres persanes, écrit par Montesquieu, est un chef-d'œuvre de la littérature française du XVIIIe siècle. Publié en 1721, ce roman épistolaire nous plonge dans un voyage captivant à travers les yeux de deux Persans, Usbek et Rica, qui découvrent la société française de l'époque.
À travers une série de lettres échangées entre les personnages, Montesquieu nous offre une critique subtile et satirique de la société française, de ses institutions politiques, de sa religion et de ses mœurs. Usbek et Rica, en observateurs étrangers, portent un regard neuf et décalé sur les coutumes et les comportements des Français, ce qui permet à l'auteur de mettre en lumière les contradictions et les absurdités de cette société.
L'œuvre aborde également des thèmes universels tels que la liberté individuelle, la tolérance religieuse, l'amour et le pouvoir. Montesquieu utilise l'ironie et l'humour pour dénoncer les travers de son époque, tout en offrant une réflexion profonde sur la nature humaine et les relations sociales.
Lettres persanes est un livre qui a marqué son époque et qui continue d'influencer la littérature et la pensée philosophique. Montesquieu y déploie une plume brillante et incisive, mêlant habilement fiction et critique sociale. Ce roman épistolaire est un véritable bijou de la littérature française, à la fois divertissant et profondément intelligent.
En somme, Lettres persanes est un livre incontournable pour tous les amateurs de littérature classique, offrant une vision unique de la société française du XVIIIe siècle et une réflexion intemporelle sur les valeurs et les idéaux qui nous animent.
Extrait : ""Le soir, [...] ils chantaient les injustices des premiers Troglodytes et leurs malheurs, la vertu renaissante avec un nouveau peuple, et sa félicité : ils chantaient ensuite les grandeurs des dieux, leurs faveurs toujours présentes aux hommes qui les implorent, et leur colère inévitable à ceux qui ne les craignent pas; ils décrivaient ensuite les délices de la vie champêtre, et le bonheur d'une condition toujours parée de l'innocence."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335004205
©Ligaran 2014
À Ispahan
Nous n’avons séjourné qu’un jour à Com ; lorsque nous eûmes fait nos dévotions sur le tombeau de la vierge qui a mis au monde douze prophètes, nous nous remîmes en chemin ; et hier, vingt-cinquième jour de notre départ d’Ispahan, nous arrivâmes à Tauris.
Rica et moi sommes peut-être les premiers parmi les Persans que l’envie de savoir ait fait sortir de leur pays, et qui aient renoncé aux douceurs d’une vie tranquille pour aller chercher laborieusement la sagesse.
Nous sommes nés dans un royaume florissant ; mais nous n’avons pas cru que ses bornes fussent celles de nos connaissances, et que la lumière orientale dut seule nous éclairer.
Mande-moi ce que l’on dit de notre voyage ; ne me flatte point : je ne compte pas sur un grand nombre d’approbateurs. Adresse ta lettre à Erzeron, où je séjournerai quelque temps. Adieu, mon cher Rustan. Sois assuré qu’en quelque lieu du monde où je sois, tu as un ami fidèle.
De Tauris, le 15 de la lune de Saphar 1711.
À son sérail d’Ispahan
Tu es le gardien fidèle des plus belles femmes de Perse ; je t’ai confié ce que j’avais dans le monde de plus cher : tu tiens en tes mains les clefs de ces portes fatales qui ne s’ouvrent que pour moi. Tandis que tu veilles sur ce dépôt précieux de mon cœur, il se repose et jouit d’une sécurité entière. Tu fais la garde dans le silence de la nuit comme dans le tumulte du jour. Tes soins infatigables soutiennent la vertu lorsqu’elle chancelle. Si les femmes que tu gardes voulaient sortir de leur devoir, tu leur en ferais perdre l’espérance. Tu es le fléau du vice et la colonne de la fidélité.
Tu leur commandes et leur obéis. Tu exécutes aveuglément toutes leurs volontés, et leur fais exécuter de même les lois du sérail ; tu trouves de la gloire à leur rendre les services les plus vils ; tu te soumets avec respect et avec crainte à leurs ordres légitimes ; tu les sers comme l’esclave de leurs esclaves. Mais, par un retour d’empire, tu commandes en maître, comme moi-même, quand tu crains le relâchement des lois de la pudeur et de la modestie.
Souviens-toi toujours du néant d’où je t’ai fait sortir, lorsque tu étais le dernier de mes esclaves, pour te mettre en cette place et te confier les délices de mon cœur. Tiens-toi dans un profond abaissement auprès de celles qui partagent mon amour ; mais fais-leur en même temps sentir leur extrême dépendance. Procure-leur tous les plaisirs qui peuvent être innocents ; trompe leurs inquiétudes ; amuse-les par la musique, les danses, les boissons délicieuses ; persuade-leur de s’assembler souvent. Si elles veulent aller à la campagne, tu peux les y mener ; mais fais faire main-basse sur tous les hommes qui se présenteront devant elles. Exhorte-les à la propreté, qui est l’image de la netteté de l’âme : parle-leur quelquefois de moi. Je voudrais les revoir dans ce lieu charmant qu’elles embellissent. Adieu.
De Tauris, le 18 de la lune de Saphar 1711.
À Tauris
Nous avons ordonné au chef des eunuques de nous mener à la campagne ; il te dira qu’aucun accident ne nous est arrivé. Quand il fallut traverser la rivière et quitter nos litières, nous nous mîmes, selon la coutume, dans des boîtes ; deux esclaves nous portèrent sur leurs épaules, et nous échappâmes à tous les regards.
Comment aurais-je pu vivre, cher Usbek, dans ton sérail d’Ispahan, dans ces lieux qui, me rappelant sans cesse mes plaisirs passés, irritaient tous les jours mes désirs avec une nouvelle violence ? J’errais d’appartements en appartements, te cherchant toujours et ne te trouvant jamais, mais rencontrant partout un cruel souvenir de ma félicité passée. Tantôt je me voyais en ce lieu où, pour la première fois de ma vie, je te reçus dans mes bras ; tantôt dans ce lieu où tu décidas cette fameuse querelle entre tes femmes : chacune de nous se prétendait supérieure aux autres en beauté. Nous nous présentâmes devant toi après avoir épuisé tout ce que l’imagination peut fournir de parures et d’ornements : tu vis avec plaisir les miracles de notre art ; tu admiras jusqu’où nous avait emportées l’ardeur de te plaire. Mais tu fis bientôt céder ces charmes empruntés à des grâces plus naturelles ; tu détruisis tout notre ouvrage ; il fallut nous dépouiller de ces ornements qui t’étaient devenus incommodes ; il fallut paraître à ta vue dans la simplicité de la nature. Je comptai pour rien la pudeur ; je ne pensai qu’à ma gloire. Heureux Usbek ! que de charmes furent étalés à tes yeux ! Nous te vîmes longtemps errer d’enchantements en enchantements : ton âme incertaine demeura longtemps sans se fixer : chaque grâce nouvelle te demandait un tribut : nous fûmes en un moment toutes couvertes de tes baisers : tu portas tes curieux regards dans les lieux les plus secrets : tu nous fis passer en un instant dans mille situations différentes : toujours de nouveaux commandements, et une obéissance toujours nouvelle. Je te l’avoue, Usbek, une passion encore plus vive que l’ambition me lit souhaiter de te plaire. Je me vis insensiblement devenir la maîtresse de ton cœur : tu me pris, tu me quittas ; tu revins à moi, et je sus te retenir : le triomphe fut tout pour moi et le désespoir pour mes rivales. Il nous sembla que nous fussions seuls dans le monde ; tout ce qui nous entourait ne fut plus digne de nous occuper. Plût au ciel que mes rivales eussent eu le courage de rester témoins de toutes les marques d’amour que je reçus de toi ! Si elles avaient bien vu mes transports, elles auraient senti la différence qu’il y a de mon amour au leur ; elles auraient vu que, si elles pouvaient disputer avec moi de charmes, elles ne pouvaient pas disputer de sensibilité.... Mais où suis-je ! où m’emmène ce vain récit ! C’est un malheur de n’être point aimée ; mais c’est un affront de ne l’être plus. Tu nous quittes, Usbek, pour aller errer dans des climats barbares. Quoi ! tu comptes pour rien l’avantage d’être aimé ! Hélas ! tu ne sais pas même ce que tu perds ! Je pousse des soupirs qui ne sont point entendus ! mes larmes coulent, et tu n’en jouis pas ! il semble que l’amour respire dans le sérail, et ton insensibilité t’en éloigne sans cesse ! Ah ! mon cher Usbek, si tu savais être heureux !
Du sérail de Fatmé, le 21 de la lune de Maharram 1711.
À Erzeron
Enfin ce monstre noir a résolu de me désespérer. Il veut à toute force m’ôter mon esclave Zélide, Zélide qui me sert avec tant d’affection, et dont les adroites mains portent partout les ornements et les grâces. Il ne lui suffit pas que cette séparation soit douloureuse, il veut encore qu’elle soit déshonorante. Le traître veut regarder comme criminels les motifs de ma confiance ; et parce qu’il s’ennuie derrière la porte où le renvoie toujours, il ose supposer qu’il a entendu ou vu des choses que je ne sais pas même imaginer. Je suis bien malheureuse ! ma retraite ni ma vertu ne sauraient me mettre à l’abri de ses soupçons extravagants : un vil esclave vient m’attaquer jusque dans ton cœur, et il faut que je m’y défende ! Non, j’ai trop de respect pour moi-même pour descendre jusqu’à des justifications : je ne veux d’autre garant de ma conduite que toi-même, que ton amour, que le mien, et s’il faut te le dire, cher Usbek, que mes larmes.
Du sérail de Fatmé, le 27 de la lune de Maharram 1711.
À Erzeron
Tu es le sujet de toutes les conversations d’Ispahan ; on ne parle que de ton départ. Les uns l’attribuent à une légèreté d’esprit, les autres à quelque chagrin : tes amis seuls te défendent, et ils ne persuadent personne. On ne peut comprendre que tu puisses quitter tes femmes, tes parents, tes amis, ta patrie, pour aller dans des climats inconnus aux Persans. La mère de Rica est inconsolable ; elle te demande son fils que tu lui as, dit-elle, enlevé. Pour moi, mon cher Usbek, je me sens naturellement porté à approuver tout ce que tu fais : mais je ne saurais te pardonner ton absence, et, quelques raisons que tu m’en puisses donner, mon cœur ne les goûtera jamais. Adieu. Aime-moi toujours.
D’Ispahan, le 28 de la lune de Rebiab, 1,1711.
À Ispahan
A une journée d’Erivan, nous quittâmes la Perse pour entrer dans les terres de l’obéissance des Turcs. Douze jours après, nous arrivâmes à Erzeron, où nous séjournerons trois ou quatre mois.
Il faut que je te l’avoue, Nessir ; j’ai senti une douleur secrète quand j’ai perdu la Perse de vue, et que je me suis trouvé au milieu des perfides Osmanlins. À mesure que j’entrais dans les pays de ces profanes, il me semblait que je devenais profane moi-même.
Ma patrie, ma famille, mes amis, se sont présentés à mon esprit ; ma tendresse s’est réveillée ; une certaine inquiétude a achevé de me troubler, et m’a fait connaître que, pour mon repos, j’avais trop entrepris.
Mais ce qui afflige le plus mon cœur, ce sont mes femmes. Je ne puis penser à elles que je ne sois dévoré de chagrins.
Ce n’est pas, Nessir, que je les aime ; je me trouve à cet égard dans une insensibilité qui ne me laisse point de désirs. Dans le nombreux sérail où j’ai vécu, j’ai prévenu l’amour et l’ai détruit par lui-même ; mais de la froideur même il sort une jalousie secrète qui me dévore. Je vois une troupe de femmes laissées presque à elles-mêmes ; je n’ai que des âmes lâches qui m’en répondent. J’aurais peine à être en sûreté si mes esclaves étaient fidèles : que sera-ce s’ils ne le sont pas ! Quelles tristes nouvelles peuvent m’en venir dans les pays éloignés que je vais parcourir ! C’est un mal où mes amis ne peuvent porter de remède ; c’est un lieu dont ils doivent ignorer les tristes secrets : et qu’y pourraient-ils faire N’aimerais-je pas mille fois mieux une obscure impunité qu’une correction éclatante Je dépose en on cœur tous mes chagrins, mon cher Nessir ; c’est la seule consolation qui me reste dans l’état où je suis.
D’Erzeron, le 10 de la lune de Rebiab, 2,1711.
À Erzeron
Il y a deux mois que tu es parti, mon cher Usbek, et, dans l’abattement où je suis, je ne puis pas me le persuader encore. Je cours tout le sérail comme si tu y étais ; je ne suis point désabusée. Que veux-tu que devienne une femme qui t’aime, qui était accoutumée à te tenir dans ses bras, qui n’était occupée que du soin de te donner des preuves de sa tendresse, libre par l’avantage de sa naissance, esclave par la violence de son amour ?
Quand je t’épousai, mes yeux n’avaient pas encore vu le visage d’un homme : tu es le seul encore dont la vue m’ait été permise ; car je ne mets pas au rang des hommes ces eunuques affreux dont la moindre imperfection est de n’être point hommes. Quand je compare la beauté de ton visage avec la difformité du leur, je ne puis m’empêcher de m’estimer heureuse. Mon imagination ne me fournit point d’idée plus ravissante que les charmes enchanteurs de la personne. Je te le jure, Usbek ; quand il me serait permis de sortir de ce lieu où je suis enfermée par la nécessité de ma condition ; quand je pourrais me dérober à la garde qui m’environne ; quand il me serait permis de choisir parmi tous les hommes qui vivent dans cette capitale des nations, Usbek, je te le jure, je ne choisirais que toi. Il ne peut y avoir que toi dans le monde qui mérites d’être aimé.
Ne pense pas que ton absence m’ait fait négliger une beauté qui t’est chère. Quoique je ne doive être vue de personne, et que les ornements dont je me pare soient inutiles à ton bonheur, je cherche cependant à m’entretenir dans l’habitude de plaire : je ne me couche point que je ne me sois parfumée des essences les plus délicieuses. Je me rappelle ce temps heureux où tu venais dans mes bras ; un songe flatteur qui me séduit me montre ce cher objet de mon amour ; mon imagination se perd dans ses désirs comme elle se flatte dans ses espérances. Je pense quelquefois que, dégoûté d’un pénible voyage, tu vas revenir à nous : la nuit se passe dans des songes qui n’appartiennent ni à la veille ni au sommeil : je te cherche à mes côtés, et il me semble que tu me fuis : enfin le feu qui me dévore dissipe lui-même ces enchantements et rappelle mes esprits. Je me trouve pour lors si animée Tu ne le croirais pas, Usbek ; il est impossible de vivre dans cet état ; le feu coule dans mes veines. Que ne puis-je t’exprimer ce que je sens si bien ! et comment sens-je si bien ce que je ne puis t’exprimer ? Dans ces moments, Usbek, je donnerais l’empire du monde pour un seul de tes baisers. Qu’une femme est malheureuse d’avoir des désirs si violents lorsqu’elle est privée de celui qui peut seul les satisfaire ; que, livrée à elle-même, n’ayant rien qui puisse la distraire, il faut qu’elle vive dans l’habitude des soupirs et dans la fureur d’une passion irritée ; que, bien loin d’être heureuse, elle n’a pas même l’avantage de servir à la félicité d’un autre ! ornement inutile d’un sérail ! gardée pour l’honneur et non pas pour le bonheur de son époux !
Vous êtes bien cruels, vous autres hommes ! Vous êtes charmés que nous ayons des passions que nous ne puissions pas satisfaire : vous nous traitez comme si nous étions insensibles, et vous seriez bien fâchés que nous le fussions : vous croyez que nos désirs, si long temps mortifiés, seront irrités à votre vue. Il y a de la peine à se faire aimer ; il est plus court d’obtenir du désespoir de nos sens ce que vous n’osez attendre de votre mérite.
Adieu, mon cher Usbek, adieu. Compte que je ne vis que pour t’adorer : mon âme est toute pleine de toi ; et ton absence, bien loin de te faire oublier, animerait mon amour s’il pouvait devenir plus violent.
Du sérail d’Ispahan, le 12 de la lune de Rebiab, 1,1711.
À Ispahan
Ta lettre m’a été rendue à Erzeron, où je suis. Je m’étais bien dont que mon départ ferait du bruit ; je ne m’en suis pas mis en peine. Que veux-tu que je suive ? la prudence de mes ennemis, ou la mienne ?
Je parus à la cour dès ma plus tendre jeunesse : je le puis dire, mon cœur ne s’y corrompit point ; je formai même un grand dessein, j’osai y être vertueux. Dès que je connus le vice, je m’en éloignai, mais je m’en approchai ensuite pour le démasquer. Je portai la vérité jusques aux pieds du trône ; j’y parlai un langage jusqu’alors inconnu ; je déconcertai la flatterie, et j’étonnai en même temps les adorateurs et l’idole.
Mais quand je vis que ma sincérité m’avait fait des ennemis ; que je m’étais attiré la jalousie des ministres sans avoir la faveur du prince ; que, dans une cour corrompue, je ne me soutenais plus que par une faible vertu, je résolus de la quitter. Je feignis un grand attachement pour les sciences ; et à force de le feindre, il me vint réellement. Je ne me mêlai plus d’aucunes affaires, et je me retirai dans une maison de campagne. Mais ce parti même avait ses inconvénients. Je restais exposé à la malice de mes ennemis, et je m’étais presque ôté les moyens de m’en garantir. Quelques avis secrets me firent penser à moi sérieusement : je résolus de m’exiler de ma patrie ; et ma retraite même de la cour m’en fournit un prétexte plausible. J’allai au roi ; je lui marquai l’envie que j’avais de m’instruire dans les sciences de l’Occident ; je lui insinuai qu’il pourrait tirer de l’utilité de mes voyages. Je trouvai grâce devant ses yeux : je partis, et je dérobai une victime à mes ennemis.
Voilà, Rustan, le véritable motif de mon voyage. Laisse parler Ispahan ; ne me défends que devant ceux qui m’aiment. Laisse à mes ennemis leurs interprétations malignes ; je suis trop heureux que ce soit le seul mal qu’ils me puissent faire.
On parle de moi à présent : peut-être ne serai-je que trop oublié, et que mes amis... Non, Rustan, je ne veux point me livrer à cette triste pensée : je leur serai toujours cher ; je compte sur leur fidélité comme sur la tienne.
D’Erzeron, le 20 de la lune de Gemmadi, 2,1711.
À Erzeron
Tu suis ton ancien maître dans ses voyages ; tu parcours les provinces et les royaumes ; les chagrins ne sauraient faire d’impression sur toi ; chaque instant te montre des choses nouvelles ; tout ce que tu vois te récrée et te fait passer le temps sans le sentir.
Il n’en est pas de même de moi, qui, enfermé dans une affreuse prison, suis toujours environné des mêmes objets et dévoré des mêmes chagrins. Je gémis accablé sous le poids des soins et des inquiétudes de cinquante années ; et, dans le cours d’une longue vie, je ne puis pas dire avoir eu un jour serein et un moment tranquille.
Lorsque mon premier maître eut formé le cruel projet de me confier ses femmes, et m’eut obligé, par des séductions soutenues de mille menaces, de me séparer pour jamais de moi-même, las de servir dans les emplois les plus pénibles, je comptai sacrifier mes passions à mon repos et à ma fortune. Malheureux que j’étais ! mon esprit préoccupé me faisait voir le dédommagement, et non pas la perte ; j’espérais que je serais délivré des atteintes de l’amour par l’impuissance de le satisfaire. Hélas ! on éteignit en moi l’effet des passions, sans en éteindre la cause ; et, bien loin d’en être soulagé, je me trouvai environné d’objets qui les irritaient sans cesse. J’entrai dans le sérail, où tout m’inspirait le regret de ce que j’avais perdu ; je me sentais animé à chaque instant ; mille grâces naturelles semblaient ne se découvrir à ma vue que pour me désoler : pour comble de malheur, j’avais toujours devant les yeux un homme heureux. Dans ce temps de trouble, je n’ai jamais conduit une femme dans le lit de mon maître, je ne l’ai jamais déshabillée, que je ne sois rentré chez moi la rage dans le cœur, et un affreux désespoir dans l’âme.
Voilà comme j’ai passé ma misérable jeunesse. Je n’avais de confident que moi-même : chargé d’ennuis et de chagrins, il me les fallait dévorer. Et ces mêmes femmes que j’étais tenté de regarder avec des yeux si tendres, je ne les envisageais qu’avec des regards sévères : j’étais perdu si elles m’avaient pénétré : quel avantage n’en auraient-elles pas pris !
Je me souviens qu’un jour que je mettais une femme dans le bain, je me sentis si transporte que je perdis entièrement la raison, et que j’osai porter ma main dans un lieu redoutable. Je crus, à la première réflexion, que ce jour était le dernier de mes jours ; je fus pourtant assez heureux pour échapper à mille morts : mais la beauté que j’avais faite confidente de ma faiblesse me vendit bien cher son silence : je perdis entièrement mon autorité sur elle ; et elle m’a obligé depuis à des condescendances qui m’ont exposé mille fois à perdre la vie.
Enfin les feux de la jeunesse ont passé ; je suis vieux, et je me trouve à cet égard dans un état tranquille. Je regarde les femmes avec indifférence, et je leur rends bien tous leurs mépris et tous les tourments qu’elles m’ont fait souffrir. Je me souviens toujours que j’étais né pour les commander ; et il me semble que je redeviens homme dans les occasions où je leur commande encore. Je les hais depuis que je les envisage de sang froid, et que ma raison me laisse voir toutes leurs faiblesses. Quoique je les garde pour un autre, le plaisir de me faire obéir me donne une joie secrète : quand je les prive de tout, il me semble que c’est pour moi, et il m’en revient toujours une satisfaction indirecte : je me trouve dans le sérail comme dans un petit empire ; et mon ambition, la seule passion qui me reste, se satisfait un peu. Je vois avec plaisir que tout roule sur moi, et qu’à tous les instants je suis nécessaire : je me charge volontiers de la haine de toutes ces femmes, qui m’affermit dans le poste où je suis. Aussi n’ont-elles pas affaire à un ingrat ; elles me trouvent au devant de tous leurs plaisirs les plus innocents : je me présente toujours à elles comme une barrière inébranlable : elles forment des projets, et je les arrête soudain : je m’arme de refus ; je me hérisse de scrupules ; je n’ai jamais dans la bouche que les mots de devoir, de vertu. de pudeur, de modestie. Je les désespère en leur parlant sans cesse de la faiblesse de leur sexe et de l’autorité du maître : je me plains ensuite d’être obligé à tant de sévérité, et je semble vouloir leur faire entendre que je n’ai d’autre motif que leur propre intérêt, et un grand attachement pour elles.
Ce n’est pas qu’à mon tour je n’aie un nombre infini de désagréments, et que tous les jours ces femmes vindicatives ne cherchent à renchérir sur ceux que je leur donne. Elles ont des revers terribles. Il y a entre nous comme un flux et un reflux d’empire et de soumission : elles font toujours tomber sur moi les emplois les plus humiliants : elles affectent un mépris qui n’a point d’exemple ; et, sans égard pou r ma vieillesse, elles me font lever la nuit dix fois pour la moindre bagatelle : je suis accablé sans cesse d’ordres, de commandements, d’emplois, de caprices : il semble qu’elles se relaient pour m’exercer, et que leurs fantaisies se succèdent. Souvent elles se plaisent à me faire redoubler de soins ; elles me font faire de fausses confidences : tantôt on vient me dire qu’il a paru un jeune homme autour de ces murs ; une autre fois, qu’on a entendu du bruit, ou bien qu’on doit rendre une lettre. Tout ceci me trouble ; et elles rient de ce trouble, elles sont charmées de me voir ainsi me tourmenter moi-même. Une autre fois elles m’attachent derrière leur porte, et m’y enchaînent nuit et jour. Elles savent bien feindre des maladies, des défaillances, des frayeurs : elles ne manquent pas de prétextes pour me mener au point où elles veulent. Il faut dans ces occasions une obéissance aveugle et une complaisance sans bornes : un refus dans la bouche d’un homme comme moi serait une chose inouïe ; et si je balançais à leur obéir, elles seraient endroit de me châtier. J’aimerais autant perdre la vie, mon cher Ibbi, que de descendre à cette humiliation.
Ce n’est pas tout : je ne suis jamais sûr d’être un instant dans la faveur de mon maître : j’ai autant d’ennemis dans son cœur qui ne songent qu’à me perdre : elles ont des quarts d’heure où je ne suis point écouté, des quarts d’heure où l’on ne refuse rien, des quarts d’heure où j’ai toujours tort. Je mène dans le lit de mon maître des femmes irritées : crois-tu que l’on y travaille pour moi, et que mon parti soit le plus fort ? J’ai tout à craindre de leurs larmes, de leurs soupirs, de leurs embrassements et de leurs plaisirs même : elles sont dans le lieu de leurs triomphes : leurs charmes me deviennent terribles ; les services présents effacent dans un moment tous mes services passés ; rien ne peut me répondre d’un maître qui n’est plus à lui-même.
Combien de fois m’est-il arrivé de me coucher dans la faveur et de me lever dans la disgrâce ! Le jour que je fus fouetté si indignement autour du sérail, qu’avais-je fait ? Je laissai une femme dans les bras de mon maître ; dès qu’elle le vit enflammé, elle versa un torrent de larmes ; elle se plaignit, et ménagea si bien ses plaintes qu’elles augmentaient à mesure de l’amour qu’elle faisait naître. Comment aurais-je pu me soutenir dans un moment si critique ? Je fus perdu lorsque je m’y attendais le moins ; je fus la victime d’une négociation amoureuse, et d’un traité que les soupirs avaient fait. Voilà, cher Ibbi, l’état cruel dans lequel j’ai toujours vécu.
Que tu es heureux ! tes soins se bornent uniquement à la personne d’Usbek ; il t’est facile de lui plaire et de te maintenir dans sa faveur jusqu’au dernier de tes jours.
Du sérail d’Ispahan, le dernier de la lune de Saphar 1711.
À Erzeron
Tu étais le seul qui pût me dédommager de l’absence de Rica, et il n’y avait que Rica qui pût me consoler de la tienne. Tu nous manques, Usbek ; tu étais l’âme de notre société. Qu’il faut de violence pour rompre les engagements que le cœur et l’esprit ont formés !
Nous disputons ici beaucoup : nos disputes roulent ordinairement sur la morale. Hier on mit en question si les hommes étaient heureux par les plaisirs et les satisfactions des sens, ou par la pratique de la vertu. Je t’ai souvent ouï dire que les hommes étaient nés pour être vertueux, et que la justice est une qualité qui leur est aussi propre que l’existence. Explique-moi, je te prie, ce que tu veux dire.
J’ai parlé à des mollaks, qui me désespèrent avec leurs passages de l’Alcoran ; car je ne leur parle pas comme vrai croyant, mais comme homme, comme citoyen, comme père de famille. Adieu.
D’Ispahan, le dernier de la lune de Saphar, 1711.
À Ispahan
Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne : tu descends jusqu’à me consulter ; tu me crois capable de t’instruire. Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatte encore plus que la bonne opinion que tu as conçue de moi ; c’est ton amitié qui me la procure.
Pour remplir ce que tu me prescris, je n’ai pas cru devoir employer des raisonnements fort abstraits. Il y a de certaines vérités qu’il ne suffit pas de persuader, mais qu’il faut encore faire sentir : telles sont les vérités de morale. Peut-être que ce morceau d’histoire te touchera plus qu’une philosophie subtile.
Il y avait en Arabie un petit peuple appelé Troglodyte, qui descendait de ces anciens Troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu’à des hommes. Ceux-ci n’étaient point si contrefaits, ils n’étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, ils avaient deux yeux ; mais ils étaient si méchants et si féroces qu’il n’y avait parmi eux aucun principe équité ni de justice.
Ils avaient un roi d’une origine étrangère, qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement : mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent, et exterminèrent toute la famille royale.
Le coup étant fait, ils s’assemblèrent pour choisir un gouvernement ; et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus qu’ils leur devinrent insupportables, et ils les massacrèrent encore.
Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu’ils n’obéiraient plus à personne, que chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans consulter ceux des autres.
Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient : Qu’ai-je affaire d’aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point ? Je penserai uniquement à moi ; je vivrai heureux : que m’importe que les autres le soient Je me procurerai tous mes besoins ; et, pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les autres Troglodytes soient misérables.
On était dans le mois où l’on ensemence les terres ; chacun dit : Je ne labourerai mon champ que pour qu’il me fournisse le blé qu’il me faut pour me nourrir ; une plus grande quantité me serait inutile : je ne prendrai point de la peine pour rien.
Les terres de ce petit royaume n’étaient pas de même nature : il y en avait d’arides et de montagneuses ; et d’autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année, la sécheresse fut très grande ; de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles : ainsi les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte.
L’année d’ensuite fut très pluvieuse ; les lieux élevés se trouvèrent d’une fertilité extraordinaire. et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine ; mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu’ils l’avaient été eux-mêmes.
Un des principaux habitants avait une femme fort belle ; son voisin en devint amoureux et l’enleva : il s’émut une grande querelle ; et après bien des injures et des coups, ils convinrent de s’en remettre à la décision d’un Troglodyte qui pendant que la république subsistait avait eu quelque crédit. Ils allèrent à lui et voulurent lui dire leurs raisons. Que m’importe, dit cet homme, que cette femme soit à vous, ou à vous ? j’ai mon champ à labourer ; je n’irai peut-être pas employer mon temps à terminer vos différents, et à travailler à vos affaires, tandis que je négligerai les miennes. Je vous prie de me laisser en repos et de ne m’importuner plus de vos querelles. La dessus il les quitta, et s’en alla travailler sa terre. Le ravisseur, qui était le plus fort, jura qu’il mourrait plutôt que de rendre cette femme ; et l’autre, pénétré de l’injustice de son voisin et de la dureté du juge, s’en retournait désespéré, lorsqu’il trouva dans son chemin une femme jeune et belle qui revenait de la fontaine. Il n’avait plus de femme ; celle-là lui plut : elle lui plut bien davantage lorsqu’il apprit que c’était la femme de celui qu’il avait voulu prendre pour juge et qui avait été si peu sensible à son malheur. Il l’enleva, et l’emmena dans sa maison.
Il y avait un homme qui possédait un champ assez fertile qu’il cultivait avec grand soin : deux de ses voisins s’unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ : ils firent entre eux une union pour se défendre contre tous ceux qui voudraient l’usurper ; et effectivement ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois. Mais un des deux, ennuyé de partager ce qu’il pouvait avoir tout seul, tua l’autre, et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long : deux autres Troglodytes vinrent l’attaquer ; il se trouva trop faible pour se défendre, et il fut massacré.
Un Troglodyte presque tout nu vit de la laine qui était à vendre ; il en demanda le prix. Le marchand dit en lui-même : Naturellement je ne devrons espérer de ma laine qu’autant d’argent qu’il en faut pour acheter deux mesures de blé, mais je la vais vendre quatre fois davantage, afin d’d’avoir huit mesures. Il fallut en passer par là et payer le prix demandé. Je suis bien aise, dit le marchand ; j’aurai du blé à présent. Que dites-vous ? l’acheteur : vous avez besoin de blé ? j’en ai à vendre : il n’y a que le prix qui vous étonnera peut-être, car vous saurez que le blé est extrêmement cher et que la famine règne presque partout ; mais rendez-moi mon argent, et je vous donnerai une mesure de blé, car je ne veux pas m’en défaire autrement, dussiez-vous crever de faim.
Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du pays voisin, et donna ses remèdes si à propos qu’il guérit tous ceux qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qu’il avait traités demander son salaire ; mais il ne trouva que des refus : il retourna dans son pays, et il y arriva accablé des fatigues d’un si long voyage. Mais bientôt après il apprit que la même maladie faisait sentir de nouveau, et affligeait plus jamais cet te terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois, et n’attendirent pas qu’il vînt chez eux. Allez, leur dit-il, hommes injustes, vous avez dans l’âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir ; vous ne méritez pas d’occuper une place sur la terre, parce que vous n’avez point d’humanité, et que les règles de l’équité vous sont inconnues : je croirais offenser les dieux qui vous punissent. si je m’opposais à la justice de leur colère.
D’Erzeron, le 3 de la lune de Gemmadi, 1711.
À Ispahan
Tu as vu, mon cher Mirza, comment les Troglodytes périrent par leur méchanceté même, et furent les victimes de leurs propres injustices. De tant de familles il n’en resta que deux qui échappèrent aux malheurs de la nation. Il y avait dans ce pays deux hommes bien singuliers : ils avaient de humanité, ils connaissaient la justice, ils aimaient la vertu ; autant liés par la droiture de leur cœur que par la corruption de celui des autres, ils voyaient la désolation générale, et ne la ressentaient que par la pitié : c’était le motif d’une union nouvelle. Ils travaillaient avec une sollicitude commune pour l’intérêt commun ; ils n’avaient de différents que ceux qu’une douce et tendre amitié faisait naître ; et, dans l’endroit du pays le plus écarté, séparés de leurs compatriotes indignes de leur présence, ils menaient une vie heureuse et tranquille : la terre semblait produire d’elle-même, cultivée par ces vertueuses mains.
Ils aimaient leurs femmes et ils en étaient tendrement chéris. Toute leur attention était d’élever leurs enfants à la vertu. Ils leur représentaient sans cesse les malheurs de leurs compatriotes, et leur mettaient devant les yeux cet exemple si triste : ils leur faisaient surtout sentir que l’intérêt des particuliers se trouve toujours dans l’intérêt commun ; que vouloir s’en séparer c’est vouloir se perdre ; que la vertu n’est point une chose qui doive nous coûter, qu’il ne faut point la regarder comme un exercice pénible ; et que la justice pour autrui est une charité pour nous.
Ils eurent bientôt la consolation des pères vertueux, qui est d’avoir des enfants qui leur ressemblent. Le jeune peuple qui s’éleva sous leurs yeux s’accrut par d’heureux mariages : le nombre augmenta, l’union fut toujours la même ; et la vertu, bien loin de s’affaiblir dans la multitude, fut fortifiée au contraire par un plus grand nombre d’exemples.
Qui pourrait représenter ici le bonheur de ces Troglodytes ? Un peuple si juste devait être chéri des dieux. Dès qu’il ouvrit les yeux pour les connaître, il apprit à les craindre ; et la religion vint adoucir dans les mœurs ce que la nature y avait laissé de trop rude.
Ils instituèrent des fêtes en l’honneur des dieux. Les jeunes filles, ornées de fleurs, et les jeunes garçons, les célébraient par leurs danses et parles accords d’une musique champêtre ; on faisait ensuite des festins où la joie ne régnait pas moins que la frugalité. C’était dans ces assemblées que parlait la nature naïve ; c’est là qu’on apprenait à donner le cœur et à le recevoir ; c’est là que la pudeur virginale faisait en rougissant un aveu surpris, mais bientôt confirmé par le consentement des pères ; et c’est là que les tendres mères se plaisaient à prévoir de loin une union douce et fidèle.
On allait au temple pour demander les faveurs des dieux. Ce n’était pas les richesses et une onéreuse abondance ; de pareils souhaits étaient indignes des heureux Troglodytes ; ils ne savaient les désirer que pour leurs compatriotes : ils n’étaient aux pieds des autels que pour demander la santé de leurs pères, l’union de leurs frères, la tendresse de leurs femmes, l’amour et l’obéissance de leurs enfants. Les filles y venaient apporter le tendre sacrifice de leur cœur, et ne leur demandaient d’autre grâce que celle de pouvoir rendre un Troglodyte heureux.
Le soir, lorsque les troupeaux quittaient les prairies et que les bœufs fatigués avaient ramené la charrue, ils s’assemblaient ; et, dans un repas frugal, ils chantaient les injustices des premiers Troglodytes et leurs malheurs ; la vertu renaissant avec un nouveau peuple, et sa félicité : ils célébraient les grandeurs des dieux, leurs faveurs toujours présentes aux hommes qui les implorent, et leur colère inévitable à ceux qui ne les craignent pas : ils décrivaient ensuite les délices de la vie champêtre et le bonheur d’une condit ion toujours parée de l’innocence. Bientôt ils s’abandonnaient à un sommeil que les soins et les chagrins n’interrompaient jamais.
La nature ne fournissait pas moins à leurs désirs qu’à leurs besoins. Dans ce pays heureux la cupidité était étrangère : ils se faisaient des présents, où celui qui donnait croyait toujours avoir l’avantage. Le peuple troglodyte se regardait comme une seule famille : les troupeaux étaient presque toujours confondus ; la seule peine qu’on s’épargnait ordinairement c’était de les partager.
D’Erzeron, le 6 de la lune de Gemmadi, 2,1711.
Je ne saurais assez te parler de la vertu des Troglodytes. Un d’eux disait un jour : Mon père doit demain labourer son champ : je me lèverai deux heures avant lui ; et quand il ira à son champ, il le trouvera tout labouré.
Un autre disait en lui-même : Il me semble que ma sœur a du goût pour un jeune Troglodyte de nos parents ; il faut que je parle à mon père, et que je le détermine à faire ce mariage.
On vint dire à un autre que des voleurs avaient enlevé son troupeau : J’en suis bien fâché, dit-il, car il y avait une génisse toute blanche que je voulais offrir aux dieux.
On entendait dire à un autre : Il faut que aille au temple remercier les dieux, car mon frère que mon père aime tant et que je chéris si fort a recouvré la santé ;
Ou bien : Il y a un champ qui touche celui de mon père, et ceux qui le cultivent sont tous les jours exposés aux ardeurs du soleil ; il faut que j’aille y planter deux arbres, afin que ces pauvres gens puissent aller quelquefois se repose r sous leur ombre.
Un jour que plusieurs Troglodytes étaient assemblés, un vieillard par la d’un jeune homme qu’il soupçonnait avoir commis une mauvaise action, et lui en fit des reproches. Nous ne croyons pas qu’il ait commis ce crime, dirent les jeunes Troglodytes, mais, s’il l’a fait, puisse-t-il mourir le dernier de sa famille !
On vint dire à un Troglodyte que des étrangers avaient pillé sa maison et avaient tout emporté. S’ils n’étaient pas injustes, répondit-il, je souhaiterais que les dieux leur en donnassent un plus long usage qu’à moi.
Tant de prospérités ne furent pas regardées sans envie : les peuples voisins s’assemblèrent, et, sous un vain prétexte, ils résolurent d’enlever leurs troupeaux. Dès que cette résolution fut connue, les Troglodytes envoyèrent au devant d’eux des ambassadeurs qui leur parlèrent ainsi :
Que vous ont fait les Troglodytes ? Ont-ils enlevé vos femmes, dérobé vos bestiaux, ravage vos campagnes ? non ; nous sommes justes, et nous craignons les dieux. Que demandez-vous donc de nous ? Voulez-vous de la laine pour vous faire des habits ? Voulez-vous du lait de nos troupeaux, ou des fruits de nos terres ? Mettez bas les armes, venez au milieu de nous, et nous vous donnerons de tout cela. Mais nous jurons par ce qu’il y a de plus sacré que, si vous entrez dans nos terres comme ennemis, nous vous regarderons comme un peuple injuste, et que nous vous traiterons comme des bêtes farouches.
Ces paroles furent renvoyées avec mépris. Ces peuples sauvages entrèrent armés dans la terre des Troglodytes, qu’ils ne croyaient défendus que par leur innocence. Mais ils étaient bien disposés à la défense ; ils avaient mis leurs femmes et leurs enfants au milieu d’eux. Ils furent étonnés de l’injustice de leurs ennemis, et non pas de leur nombre. Une ardeur nouvelle s’était emparée de leur cœur : l’un voulait mourir pour son père, un autre pour sa femme et ses enfants, celui-ci pour ses frères, celui-là pour ses amis, tous pour le peuple troglodyte : la place de celui qui expirait était d’abord prise par un autre, qui, outre la cause commune, avait encore une mort particulière à venger.
Tel fut le combat de l’injustice et de la vertu. Ces peuples lâches qui ne cherchaient que le butin n’eurent pas honte de fuir, et ils cédèrent à la vertu des Troglodytes, même sans en être touchés.
D’Erzeron, le 9 de la lune de Gemmadi, 2,1711.
Comme le peuple grossissait tous les jours, les Troglodytes crurent qu’il était à propos de se choisir un roi : ils convinrent qu’il fallait déférer la couronne à celui qui était le plus juste ; et ils jetèrent tous les yeux sur un vieillard vénérable par son âge et par une longue vertu. Il n’avait pas voulu se trouver à cette assemblée ; il s’était retiré dans sa maison, le cœur serré de tristesse.
Lorsqu’on lui envoya des députés pour lui apprendre le choix qu’on avait fait de lui : À Dieu ne plaise, dit-il, que je fasse ce tort aux Troglodytes, que l’on puisse croire qu’il n’y a personne parmi eux de plus juste que moi ! Vous me déférez la couronne, et, si vous le voulez absolument, il faudra bien que je la prenne ; mais comptez que je mourrai de douleur d’avoir vu en naissant les Troglodytes libres, et de les voir aujourd’hui assujettis. À ces mots il se mit à répandre un torrent de larmes. Malheureux jour ! disait-il ; et pourquoi ai-je tant vécu ? Puis il s’écria d’une voix sévère : Je vois bien ce que c’est, Ô Troglodytes ! votre vertu commence à vous peser. Dans l’état où vous êtes, n’ayant point de chef, il faut que vous soyez vertueux malgré vous ; sans cela vous ne sauriez subsister, et vous tomberiez dans le malheur de vos premiers pères. Mais ce joug vous parait trop dur ; vous aimez mieux être soumis à un prince et obéir à ses lois moins rigides que vos mœurs. Vous savez que pour lors vous pourrez contenter votre ambition, acquérir des richesses, et languir dans une lâche volupté, et que, pourvu que vous évitiez de tomber dans les grands crimes, vous n’aurez pas besoin de la vertu. Il s’arrêta un moment, et ses larmes coulèrent plus que jamais. Et que prétendez-vous que je fasse ? Comment se peut-il que je commande quelque chose à un Troglodyte ? Voulez-vous qu’il fasse une action vertueuse parce que je la lui commande, lui qui la ferait tout de même sans moi et par le seul penchant de la nature ? Troglodytes ! je suis à la fin de mes jours, mon sang est glacé dans mes veines, je vais bientôt revoir vos sacrés aïeux ; pourquoi voulez-vous que je les afflige, et que je sois obligé de leur dire que je vous ai laissés sous un autre joug que celui de la vertu ?
D’Erzeron, le 10 de la lune de Gemmadi, 2,1711.
À Erzeron
Je prie le ciel qu’il te ramène dans ces lieux, et te dérobe à tous les dangers. Quoique je n’aie guère jamais connu cet engagement qu’on appelle amitié, et que je me sois enveloppé tout entier dans moi-même, tu m’as cependant fait sentir que j’avais encore un cœur ; et, pendant que j’étais de bronze pour tous ces esclaves qui vivaient sous mes lois, je voyais croître ton enfance avec plaisir.
Le temps vint où mon maître jeta sur toi les y eux. Il s’en fallait bien que la nature eût encore parlé lorsque le fer te sépara de la nature. Je ne te dirai point si je te plaignis, ou si je sentis du plaisir à te voir élevé jusqu’à moi. J’apaisai tes pleurs et tes cris. Je crus te voir prendre une seconde naissance, et sortir d’une servitude où tu devrais toujours obéir, pour entrer dans une servitude où tu devais commander. Je pris soin de ton éducation. La sévérité, toujours inséparable des instructions, te fit longtemps ignorer que tu m’étais cher. Tu me l’étais pourtant ; et je te dirai que je t’aimais comme un père aime son fils, si ces noms de père et de fils pouvaient convenir à notre destinée.
Tu vas courir les pays habités par les chrétiens, qui n’ont jamais cru. Il est impossible que tu n’y contractes bien des souillures. Comment le prophète pourrait-il te regarder au milieu de tant de millions de ses ennemis ? Je voudrais que mon maître fît à son retour le pèlerinage de la Mecque : vous vous purifieriez tous dans la terre des anges.
Du sérail d’Ispahan, le 10 de la lune Gemmadi, 1711.
À Com
Pourquoi vis-tu dans les tombeaux, divin mollak ? tu es bien plus fait pour le séjour des étoiles. Tu te caches sans doute de peur d’obscurcir le soleil : tu n’as point de taches comme cet astre, mais, comme lui tu te couvres de nuages.
Ta science est un abîme plus profond que l’Océan : ton esprit est plus perçant que Zufagar, cette épée d’Hali qui avait deux pointes : tu sais ce qui se passe dans les neuf chœurs des puissances célestes : tu lis l’Alcoran sur la poitrine de notre divin prophète, et, lorsque tu trouves quelque passage obscur, un ange, par son ordre, déploie ses ailes rapides et descend du trône pour t’en révéler le secret.
Je pourrais, par ton moyen, avoir avec les séraphins une intime correspondance ; car enfin, treizième iman, n’es-tu pas le centre où le ciel et la terre aboutissent, et le point de communication entre l’abîme et l’empyrée ?
Je suis au milieu d’un peuple profane : permets que je me purifie avec toi : souffre que je tourne mon visage vers les lieux sacrés que tu habites : distingue-moi des méchants, comme on distingue au lever de l’aurore le filet blanc d’avec le filet noir : aide-moi de tes conseils : prends soin de mon âme ; enivre-la de l’esprit des prophètes ; nourris-la de la science du paradis, et permets que je mette ses plaies à tes pieds. Adresse tes lettres sacrées à Erzeron, où je resterai quelques mois.
D’Erzeron, le 11 de la lune de Gemmadi, 2,1711.
Je ne puis, divin mollak, calmer mon impatience ; je ne saurais attendre ta sublime réponse. J’ai des doutes, il faut les fixer : je sens que ma raison s’égare ; ramène-la dans le droit chemin ; viens m’éclairer, source de lumière ; foudroie avec ta plume divine les difficultés que je vais te proposer ; fais-moi pitié de moi-même, et rougir de la question que je vais te faire.
D’où vient que notre législateur nous prive de la chair de pourceau et de toutes les viandes qu’il appelle immondes ? D’où vient qu’il nous défend de toucher un corps mort, et que, pour purifier notre âme, il nous ordonne de nous laver sans cesse le corps. Il me semble que les choses ne sont en elles-mêmes ni pures ni impures ; je ne puis concevoir aucune qualité inhérente au sujet qui puisse les rendre telles. La boue ne nous paraît sale que parce qu’elle blesse notre vue ou quelque autre de nos sens, mais en elle-même elle ne l’est pas plus que l’or et les diamants. L’idée de souillure contractée par l’attouchement d’un cadavre ne nous est venue que d’une certaine répugnance naturelle que nous en avons. Si les corps de ceux qui ne se lavent point ne blessaient ni l’odorat, ni la vue, comment aurait-on pu s’imaginer qu’ils lussent impurs ?
Les sens, divin mollak, doivent donc être les seuls juges de la pureté ou de l’impureté des choses. Mais comme les objets n’affectent point les hommes de la même manière, que ce qui donne une sensation agréable aux uns en produit une dégoûtante chez les autres, il suit que le témoignage des sens ne peut servir ici de règle, à moins qu’on ne dise que chacun peut à sa fantaisie décider de ce point, et distinguer pour ce qui le concerne les choses pures d’avec celles qui ne le sont pas.
Mais cela même, sacré mollak, ne renverserait-il pas les distinctions établies par notre divin prophète et les points fondamentaux de la loi qui a été écrite de la main des anges ?
D’Erzeron, de la lune de Gemmadi, 2,1711.
À Erzeron
Vous me faites toujours des questions qu’on a faites mille fois à notre saint prophète. Que ne lisez-vous les traditions des docteurs ? Que n’allez-vous à cette source pure de toute intelligence ? vous trouveriez tous vos doutes résolus.