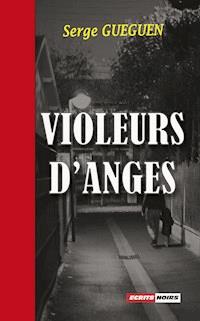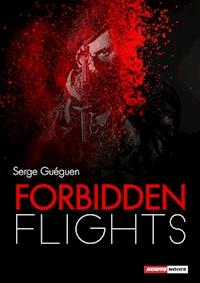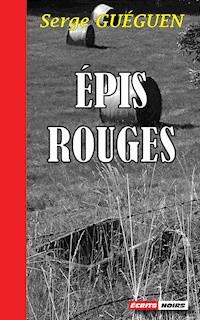Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Écrits Noirs
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Complots politiques au sein d'une famille
Après le décès de sa grand-mère Lucas Aubin découvre que son père militant basque a été assassiné par un groupuscule d'extrême droite - MR 13/18 - dont un des fondateurs est son grand-père disparu quelques années auparavant.
Pour comprendre l'histoire de ses parents et assouvir son désir de vengeance il recherche les complices éventuels de ce meurtre. Il découvrira au fil de son enquête que des actes graves pour le pays sont en préparation. La mort est au bout du canon pour certains et du couteau pour d'autres.
Désir de vengeance, secrets mafieux, intrigues familiales : tout est réuni pour offrir un thriller réussi
A PROPOS DE L'AUTEUR : Serge Guéguen
Je suis un écrivain français. Ma date de naissance n'a que peu d'importance, mais sachez que les cheveux blancs sont bien présents. Quant à ma carrière professionnelle elle a été riche en rencontres et mes voyages m'ont beaucoup inspiré.
Depuis les années quatre-vingt j'écris des scénarios, des pièces de théâtre, des nouvelles et des romans policiers.
Dans tout ce que j'écris, il y a une part de moi-même qui transpire alors à vous de trouver. Je pense, par ailleurs, que vous pouvez passer un bon moment en compagnie de mes héros.
EXTRAIT
La nouvelle année venait à peine d’éclore et un soleil bas envahissait l’appartement de Lucas Albin, quand le téléphone sonna.
— Monsieur Albin ?
— Oui !
Au ton de la voix féminine, il comprit que le coup de fil qu’il redoutait depuis plusieurs semaines venait d’arriver.
— C’est l’hôpital Saint Jacques, votre grand-mère est décédée cette nuit à 4 heures 45, je vous prie d’accepter mes sincères condoléances monsieur.
— Merci, réussit à articuler Lucas avant de demander dans un sanglot, où est-elle en ce moment ?
— À la chambre mortuaire du CHU.
— Je passerai dans la journée pour récupérer ses affaires.
— Bien, Monsieur, au revoir.
— Au revoir, dit Lucas en raccrochant.
Une fois le combiné reposé, Lucas s’assit dans le fauteuil près du téléphone et pleura doucement dans ses mains. La mort de sa grand-mère sonnait le glas de son passé et de son enfance, elle était le seul lien qui le rattachait à ses parents disparus prématurément.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toute ressemblance avec des personnages ou des événements ayant réellement existé ne serait que pure coïncidence.
Chapitre 1
La nouvelle année venait à peine d’éclore et un soleil bas envahissait l’appartement de Lucas Albin, quand le téléphone sonna.
— Monsieur Albin ?
— Oui !
Au ton de la voix féminine, il comprit que le coup de fil qu’il redoutait depuis plusieurs semaines venait d’arriver.
— C’est l’hôpital Saint Jacques, votre grand-mère est décédée cette nuit à 4 heures 45, je vous prie d’accepter mes sincères condoléances monsieur.
— Merci, réussit à articuler Lucas avant de demander dans un sanglot, où est-elle en ce moment ?
— À la chambre mortuaire du CHU.
— Je passerai dans la journée pour récupérer ses affaires.
— Bien, Monsieur, au revoir.
— Au revoir, dit Lucas en raccrochant.
Une fois le combiné reposé, Lucas s’assit dans le fauteuil près du téléphone et pleura doucement dans ses mains. La mort de sa grand-mère sonnait le glas de son passé et de son enfance, elle était le seul lien qui le rattachait à ses parents disparus prématurément.
De son père, il ne savait rien ou pas grand-chose, seulement qu’il était parti un jour d’été 1977 sans jamais revenir, Lucas avait un an. Quant à sa mère, elle fut emportée quelques mois plus tard par une leucémie foudroyante.
Ses grands-parents maternels avaient naturellement pris le relais de son éducation, mais sans lever le voile sur les premières années de sa vie. Pourtant, il leur avait souvent demandé comment était son père. Est-ce que sa mère était heureuse ? Toutes ces questions qu’un adolescent pose à un moment de sa vie. Pour seule réponse, il obtenait invariablement un : « On verra pus tard. »
Au fil du temps, Lucas s’était habitué à la réponse de Jean, son grand-père, ancien de la guerre d’Algérie et commissaire à la retraite. Sa grand-mère était plus proche de lui, en fait, c’est elle qui l’avait élevé et lui avait donné l’éducation nécessaire à la construction de sa vie en l’absence de ses parents.
Sa jeunesse se déroula sans accroc dans cette ville de banlieue parisienne en pleine mutation. Le petit pavillon qui avait vu grandir sa mère n’avait pas changé en cinquante ans, sauf la peinture extérieure et quelques aménagements intérieurs. Pour le reste, le jardin et son potager cultivé religieusement par Jean, décédé cinq ans avant sa femme, produisaient les légumes de la soupe quotidienne. À l’époque des fraises, cueillies scrupuleusement dans le jardin, Lucas se régalait et de leur onctuosité, d’autant plus quand Mamé y ajoutait de la crème fraîche. Il gardait ces souvenirs et ces saveurs gravés à jamais dans sa mémoire. Le bonheur, pour lui c’était cette période où l’insouciance rimait avec enfance.
Après une scolarité normale, il décida, sous l’influence de sa grand-mère, de suivre un cursus universitaire en espagnol. Il n’avait jamais compris pourquoi elle avait tant insisté pour qu’il s’oriente vers cette voie. « L’espagnol, c’est la troisième langue au monde », avait-elle coutume de dire. Affirmation étonnante venant d’une femme n’ayant pas dépassé le certificat d’études et qui de facto ne parlait que le français.
Cette question métaphysique évacuée, il avait suivi ses conseils. Cette orientation intellectuelle lui avait permis de percevoir des auteurs dans leur langue d’origine, comme Federico García Lorca, ou bien de lire son poète préféré, Pablo Neruda, dans son sens littéral sans intermédiaire, mais également l’écrivain péruvien Manuel Scorza, que lui avait fait découvrir sa copine de l’époque. « Tiens, tu comprendras mieux le combat des paysans d’Amérique du Sud, lui avait-elle dit en lui tendant : Roulements de tambours pour Rancas. » Histoire extraordinaire relatant la lutte perdue d’avance de villageois des montagnes andines, dans les années 1950.
Il passa avec brio une maîtrise d’espagnol et commença à enseigner. Ce début dans la vie active enthousiasmait ses grands-parents, ils étaient fiers de sa réussite, mais Lucas ne partageait pas le même bonheur. Se retrouver devant des jeunes peu intéressés à d’autres cultures, et de surcroît turbulents, le mettait très mal à l’aise.
Pourtant, le contact avec les autres, il aimait et connaissait. Talonneur de l’équipe première de rugby des cheminots d’Achères, il mouillait le maillot depuis l’âge de dix ans. C’était son grand-père, ancien deuxième ligne et fan de Roger Couderc, commentateur de télé des années 60/70, qui l’avait inscrit au club des cheminots dont le président était un ami d’enfance de Jean. La culture du ballon ovale était quasiment génétique dans la famille maternelle. Depuis trois générations, il y a toujours un Albin pour courir derrière l’insaisissable cuir. L’atavisme pour ce sport faillit être rompu avec la naissance de sa mère.
En effet, son grand-père avait perdu son unique frère dans un accident de voiture, et ce dernier n’avait pas eu d’enfant. Viviane, sa mère, était la seule de cette génération, donc rupture “rugbalistique” dans la lignée familiale. Heureusement que Lucas, qui portait le nom de sa mère, avait pu sauver et perpétuer le nom et la tradition.
Après deux années passées à enseigner, Lucas décida, au grand dam de sa grand-mère, de quitter l’Éducation nationale pour incompatibilité d’humeur avec ses élèves. Connaissant son envie de changer d’air, son ami Daniel, deuxième ligne de l’équipe de rugby, lui proposa de passer le concours d’officier de police.
Après quelques semaines de réflexion et la pression familiale pour qu’il s’engage à faire « quelque chose » de sa vie, il décida de tenter l’expérience policière, pour le plus grand plaisir du grand-père et la désolation de Mamé. Pendant les mois qui suivirent sa décision, Daniel, ex-membre du Service de protection des hautes personnalités, devenu depuis capitaine à la « Crim’ », l’aida à préparer l’examen qu’il passa brillamment. Après dix-huit mois à l’École Nationale Supérieure des Officiers de Police, il demanda et obtint un poste à la brigade financière à Nanterre. Il y était depuis cinq ans et était devenu un spécialiste en cybercriminalité, doublé d’un expert en téléphonie.
Le premier chagrin passé, il fallait penser à l’organisation des obsèques. Il prit sa moto et se rendit à la chambre mortuaire du CHU, située à une dizaine de kilomètres de son domicile. Devant la dépouille de Mamé, il se pencha pour l’embrasser. Elle avait le teint livide. Cela faisait de long mois qu’il sentait qu’elle ne s’accrochait plus à la vie. Trois semaines avant son décès, il avait rencontré le médecin en charge du service gériatrique de l’hôpital.
— Vous savez, si elle fait de nouveau un AVC, nous ne la récupérons pas, lui avait dit le médecin.
— Je comprends, d’autant qu’elle a presque 80 ans, mais surtout, je ne veux pas qu’elle souffre.
— Je vous le promets, avait répondu le praticien.
Lucas avait rendu une dernière visite à sa grand-mère, quelques jours avant qu’elle ne rejoigne les siens. Dès l’instant où il pénétra dans la chambre, il sut que c’était fini. Son regard figé était dirigé vers la fenêtre. Il l’embrassa et elle ne réagit pas. Quand il lui prit la main comme chaque fois, elle n’eut aucune réaction. Après un long moment, il la serra dans ses bras. En quittant la pièce, il sut que c’était la dernière fois qu’il la voyait vivante.
Dans l’univers glacé de la morgue, il embrassa son visage froid et des larmes coulèrent sur ses joues.
« Au revoir, Mamé, tu vas me manquer », sanglota-t-il.
Lucas passa doucement le dos de sa main sur ce visage émacié et son doigt sur ses lèvres qui l’avaient tant de fois embrassé. De sa famille, il ne restait plus que son grand-oncle Alphonse, le frère de sa grand-mère. Il devait maintenant le prévenir, ce n’était pas une chose facile, car malgré son excellente condition physique, il évitait de se déplacer, d’autant qu’il vivait seul en Bretagne, depuis la mort de sa femme.
Lucas l’aimait beaucoup, c’était un ancien ouvrier, militant syndical et ardent communiste. Il avait fait la plus grosse partie de sa carrière chez Hispano Suiza à Colombes comme ajusteur. Il avait été de toutes les grandes manifestations, que ce soit celle du 28 mai 1952 à Paris, à l’occasion de l’arrivée en France du nouveau commandant en chef des forces de l’OTAN en Europe, où 718 personnes ont été arrêtées, dont Alphonse en compagnie du dirigeant du parti communiste Jacques Duclos. Ou aux manifestations plus calmes sur le maintien des retraites à 60 ans ou la protection de la sécurité sociale. En passant par le massacre de Charonne le 8 février 1962. À 82 ans, il avait encore bon pied, bon œil. Mais Lucas pensait que cette fois-ci, il allait avoir un choc, même s’il s’attendait au décès de sa sœur.
Après avoir quitté, sa grand-mère, Lucas sortit son téléphone.
— Allô, Alphonse, c’est Lucas, Mamé est décédée cette nuit.
À l’autre bout, il entendit le souffle de son grand-oncle s’accélérer.
— J’arrive, dit-il tout simplement.
— J’irai te chercher à Montparnasse.
— Entendu, à tout à l’heure.
Lucas ferma le capot de son téléphone, et repensa au moment où il avait annoncé à Alphonse son départ de l’enseignement en faveur de la « flicaille » comme il disait. Il ne fit aucune remarque, se contentant de hausser les épaules et de marmonner : « Tous pourris. » Il faut dire qu’entre Alphonse et son grand-père, ce n’était pas le grand amour, ils avaient toujours été, par conviction politique, de chaque côté de la barrière, au propre comme au figuré. Alphonse soupçonnait Jean d’avoir collaboré à des opérations pas très claires pendant la guerre d’Algérie. « Pacification » à laquelle Alphonse avait participé en tant qu’appelé dans une unité de l’aviation, c’est dire qu’il était loin des combats. Alors que Jean s’était engagé dans les paras en Indochine et avait ensuite enchaîné dans les mêmes unités en Algérie, celles de Bigeard, Massu et autres Aussaresse, tous les trois adeptes de la gégène.
La boutique des pompes funèbres était en face de l’hôpital. Lucas y pénétra et commanda le cercueil, pas en pin, ni en clinquant, un juste milieu, sobre, à l’image de celle qui allait rejoindre sa dernière demeure. Il indiqua le cimetière où était enterré son grand-père, ainsi que l’église où devait avoir lieu l’office religieux.
Lucas rappela Alphonse pour connaître son heure d’arrivée. Il avait juste le temps de rentrer chez lui et prendre sa voiture pour aller à la gare Montparnasse.
Le TGV arrivait sur le quai numéro un. Lucas avait un quart d’heure d’avance. Il s’était garé à Pasteur sur le parking réservé à la police. Le train était annoncé. Lucas guettait Alphonse qu’il aperçut droit comme un I. Sa stature avait toujours impressionné le petit garçon qu’il était resté face à ce grand-oncle que deux générations séparaient. Le vieil homme traînait une valise à roulettes rouges. « Normal », aurait dit Alphonse dans d’autres temps.
Ils s’étreignirent longuement, il ne restait plus qu’eux de leurs familles respectives.
— Tu as bien voyagé ? demanda Lucas.
— Le train était confortable et il n’y avait pas trop de monde.
— Donne-moi ta valise, je suis garé là-haut, dit Lucas en prenant la poignée que lui tendit Alphonse.
Ils prirent l’escalator et débouchèrent dans la gare Pasteur, annexe de Montparnasse, et se dirigèrent vers le parc de stationnement situé à l’arrière. Pendant le trajet, Lucas raconta les derniers instants qu’il avait vécus avec sa grand-mère. Après une demi-heure de route, Lucas gara sa voiture sur son parking et ils rejoignirent l’appartement qu’il avait acheté quelques mois auparavant.
— Je vois que cela paye bien dans la maison poulaga, ironisa Alphonse.
— On fait ce qu’on peut.
— C’est un bel appart dans une jolie résidence, commenta Alphonse.
— Je t’ai préparé la chambre du fond.
— C’est sympa, répondit Alphonse.
Cette première soirée entre les deux hommes fut chaleureuse et empreinte d’évocations de souvenirs communs. Alphonse était pour Lucas l’autre face de la pièce familiale, l’humaine, en opposition à son grand-père très carré et toujours droit dans ses bottes, certains disaient qu’il était réactionnaire et proche de l’extrême droite. Alors que l’oncle campait, certes, sur ses positions de gauche, mais avait la culture de la discussion et de l’échange chevillé au corps, comme de nombreux syndicalistes. Lucas avait toujours pensé que les deux beaux-frères se haïssaient, d’ailleurs Alphonse n’était pas venu à l’enterrement du grand-père. « Je ne veux pas me retrouver avec ce ramassis de “fachos” », avait-il répondu à Lucas quand celui-ci lui avait demandé les motifs de son absence, en vertu du principe que la mort effaçait le passé.
Le lendemain matin, ils se rendirent au CHU où les attendaient les employés des pompes funèbres. La chambre mortuaire était toujours aussi glaciale. Lucas se recueillit quelques instants devant la dépouille de sa grand-mère, puis il laissa Alphonse en tête à tête avec sa sœur. Au bout de quelques minutes, le vieil homme sortit de la pièce les yeux rougis. Les hommes en noir le remplacèrent. Alphonse marcha quelques instants, puis s’essuya les joues et revint vers Lucas.
— Il faut y retourner.
Lucas approuva de la tête. Dans l’univers froid de la mort, Mamé était dans son écrin de voile blanc. Les employés des pompes funèbres attendaient, droits et impassibles, que l’on ordonne la fermeture définitive du cercueil. Lucas s’approcha de sa grand-mère et lui déposa un baiser sur le front, son oncle fit de même. Ils reculèrent. Le visage de la défunte disparut et les visseuses enfermèrent définitivement l’image de Mamé.
Le policier de service apposa les scellés réglementaires sur les vis. Lucas et Alphonse sortirent en silence. Dans la voiture qui les conduisait à l’église, pas une parole ne fut échangée. Sur le parvis, quelques connaissances étaient venues, des voisins, des anciens collègues du grand-père. Les salutations furent brèves, comme la cérémonie religieuse. Au cimetière, ils n’étaient plus que deux à regarder le cercueil s’enfoncer dans les entrailles de la terre, pour son dernier voyage, l’être que Lucas avait tant aimé.
De retour à l’appartement, Alphonse se réfugia dans sa chambre pendant que Lucas préparait deux cafés. Ils avaient déjeuné dans un petit restaurant portugais où Lucas avait ses habitudes.
— Tiens, dit Alphonse en tendant une grande enveloppe marron en papier kraft à Lucas.
— C’est quoi ?
— C’est ce que m’a donné ta mère avant de mourir.
— Et c’est maintenant que tu me la donnes ! s’emporta Lucas.
— Attends que je t’explique, dit Alphonse calmement.
— C’est bon, je t’écoute, mais tu as intérêt à être convaincant.
— Quelques semaines avant le décès de ta mère, alors que je venais la voir, elle m’a dit : « Tu donneras cela à mon Lucas pour qu’il sache qui il est et d’où il vient, mais jure-moi que tu ne lui donneras pas avant la disparition de mes parents. » Voilà pourquoi je te la donne seulement aujourd’hui.
— Tu sais ce qu’elle contient ? interrogea Lucas.
— Non, c’est votre secret, pas le mien, répondit Alphonse en buvant son café.
Lucas tournait et retournait l’enveloppe de ce passé dont personne n’avait jamais voulu lui parler. Alphonse se leva et prit sa veste.
— Je te laisse à ta lecture, je vais faire un tour.
— Merci, dit Lucas en étreignant son oncle.
Alphonse sortit de l’appartement, tandis que Lucas décachetait fébrilement ce courrier vieux de trente ans et seul lien direct avec sa mère. Il versa le contenu sur la table de la cuisine. Elle contenait une chaîne en or et un cahier d’écolier. Il ouvrit le cahier, une écriture fine, faite de magnifiques pleins et déliés, ornait la page. En haut à droite il y avait une date, le 30 octobre 1978. Au milieu de la page un titre, « LUCAS », entouré de dessins de fleurs, à l’image des coloriages enfantins. En bas à droite, une citation : Le printemps est inexorable, de Pablo Neruda.
Lucas pleura à la lecture de cette première page que sa mère avait composée pour lui. Il tourna la page de garde. Un long texte démarrait en haut à gauche, avec un retrait, comme on apprenait à le faire à l’école des années soixante. Aucune rature n’entachait la beauté de la feuille.
Mon fils chéri,
Quand tu liras ces lignes, tu n’auras plus aucune attache avec ton passé dont malheureusement personne ne te parlera, car il a été vécu comme une infamie de la part de tes grands-parents. Et je pense que toutes les années que tu as vécues ou que tu vivras sans moi, ne te permettront pas de te connaître et encore moins de faire de toi un homme épanoui.
Tes grands-parents, à qui vont échoir la lourde tâche de t’élever, car je sais que la mort est pour moi dans un espace très proche, ne vont pas te parler de ton père. Et de moi, ils ne te diront que le minimum. C’est pourquoi j’ai demandé à mon oncle Alphonse, en qui j’ai une confiance absolue, de te donner ce cahier, après la disparition de mes parents. Et je t’en prie, ne tiens pas ombrage à Alphonse, il ne sait pas ce que j’écris, mais c’est moi qui lui ai demandé de te transmettre ce document. À un moment de ta vie où tu es seul face à ton passé.
Ce regard sur le passé est compliqué et je vais essayer de te faire comprendre simplement ce que nous avons fait, ton père et moi. Il a été l’Homme de ma vie, avant lui je n’avais eu que des amourettes, c’est lui qui m’a révélé à l’amour, et après lui, je n’ai connu personne d’autre. Maintenant que la mort est au pied de mon lit, ton père restera le seul être qui m’ait apporté autant de bonheur en si peu de temps. Tout ce que tu as entendu, ou entendras sur lui, sera à considérer avec prudence, tant la méchanceté et la méconnaissance des hommes est de mise dans notre monde.
Comme je pense que tu n’as jamais vu ton père, tourne la page et tu nous verras tous les deux sur la plage du casino à Biarritz.
Lucas tourna le feuillet et découvrit le portrait de son père. Il était allongé sur la plage avec sa mère. Instinctivement, les larmes coulèrent à nouveau. Sa main caressa la photo à la recherche d’une sensation inconnue. Peut-être celle d’une mère qui prend son enfant dans ses bras. En dessous, figure l’inscription : « Miguel et moi, août 1975, en vacances à Biarritz ». Lucas tourna la page.
Maintenant que tu as vu ton père, je vais te dire qui il était. Il s’appelait Miguel ONAIAXEA dit Kizkur (le frisé) et est né en 1951 à Basauri, au sein d’une famille nationaliste et bascophone. À 16 ans, il découvre Marx et se lie d’amitié avec la gauche nationaliste. Il devient un farouche adversaire du régime franquiste. Plus tard, il intégrera l’ETA dont tu as certainement entendu parler.
En 1970, il fait de la prison et passe la frontière pour le Pays basque français, il prend une part active à la future évolution de l’organisation. Durant ces années d’intenses dialectiques, ton père reprend à son compte ce que disait Argala un autre militant politique :
Yo discuto con todos, intelectualizo a los militares y militarizo a los intelectuales. « Je discute avec tous, intellectualise les militaires et militarise les intellectuels. »
Comme tu peux le constater, ton père n’était pas comme certains voudraient te le faire croire, un fou furieux, c’était un intellectuel doublé d’un érudit.
Donc, je continue, dans le Pays basque français, il prend part à la restructuration d’ETA. En novembre 1974, alors qu’il n’a que 23 ans, il prend part à la constitution d’ETA militaire. À partir de ce moment, il participera activement au harcèlement de la dictature franquiste, à la plus célèbre action d’ETA : l’opération Ogro, qui vit la mort de l’amiral Luis Carrero Blancoun, un proche de Franco.
Lucas était abasourdi par les révélations de sa mère, son père était un terroriste basque. Il comprenait un peu mieux le fait que dans la famille il y ait eu un black-out sur le personnage. Mais la question maintenant était de savoir ce que sa mère venait faire dans l’histoire. Il reprit avec assiduité la lecture de la lettre posthume.
Si je te raconte tout cela, c’est pour que tu saisisses que ton père était un homme extraordinaire et convaincu du bien-fondé de sa cause. Nous nous sommes rencontrés à Biarritz en 1975, alors que j’étais en vacances avec papa et maman dans un quartier pavillonnaire et très bourgeois, le Jardin anglais. Pourquoi ce détail ? parce que c’est à côté d’où nous logions, que je suis tombée amoureuse de ton père. Je le voyais tous les jours quand j’allais acheter le Figaro de ton grand-père. J’avais 18 ans, et ce beau brun frisé me souriait à chaque fois qu’il me tendait le journal. Puis, de fil en aiguille nous sommes allés à la plage, et je te laisse imaginer ce que peuvent faire deux jeunes gens sous le soleil, à la plage, les copains… Je pensais que cela ne serait qu’un flirt de vacances.
Mais quelques semaines après, Miguel est venu à Paris pour rencontrer des militants régionalistes, corses et bretons notamment. Nous nous sommes revus et aimés. Il faisait de fréquents voyages sur la capitale et j’ai décidé de le présenter à papa et maman.
Lucas suspendit sa lecture pour aller chercher un Perrier. Cette lecture lui avait donné soif, il avait la bouche pâteuse, ces révélations l’excitaient et le désemparaient à la fois. Il avait du mal à imaginer ses parents s’aimer. Il reprit le petit cahier et continua de lire.
L’accueil fut plutôt froid, comme tu peux l’imaginer. J’avais passé mon bac avec une année d’avance, obtenu une mention, et voilà que je m’amourachais d’un « métèque » sans avenir. Il fut reçu sobrement, mais pas invité à revenir. Nous nous sommes revus à son hôtel à chacun de ses déplacements. Cette relation perturbait mes études de médecine et j’optais brutalement, au début de l’année 76, pour la fac de langues où je commençais une licence d’espagnol.
« Non, ce n’est pas possible, Mamé a fait un transfert sur moi ! » s’étonna Lucas.
Donc, mes études partaient en déliquescence, j’étais de moins en moins présente à la maison et ce qui devait arriver se vérifia, je quittais la maison pour me réfugier chez un ami de ton père. Je sais que papa me chercha en vain. Nous vécûmes le grand amour jusqu’en juin 76, date à laquelle Miguel dut partir précipitamment en Espagne pour l’enterrement de ses parents morts dans un accident de voiture. Tu imagines que dans sa situation, avec des faux papiers, ce n’était pas facile à vivre. C’est à cette période que je fus contrainte de réintégrer le foyer familial, faute d’hébergement. L’ami de ton père dut également fuir.
Mon retour se passa mieux que je ne le pensais, ma disparition avait occasionné beaucoup de chagrin à maman, tandis que papa se faisait une raison, ils avaient eu très peur de me perdre. Si bien que, maman me dit un jour : « Si tu veux que Miguel vienne à la maison, amène-le. »
Ce revirement de situation me fit plaisir, et un mois plus tard, ton père débarquait dans le pavillon de Sartrouville. Il revint à plusieurs reprises et chaque fois sous des identités différentes, mais pour nous, il gardait son véritable nom. Parfois le soir, la discussion entre les deux hommes était âpre, l’un très à droite avec un passé colonial puissant, et l’autre très à gauche. Mais intelligemment ils finirent par éviter le sujet, même si je pense que ton grand-père n’aurait pas hésité, s’il avait su la vérité sur Miguel, à le dénoncer à la police française.
« Tiens ! Papé a un passé militaire et colonial, il faut que j’en parle à Alphonse. »
Quelques mois plus tard, je me retrouvais enceinte de toi, mon trésor. Ton père était aux anges, même si notre situation matérielle n’était pas extraordinaire. Enfin, nous nous aimions, maman allait être grand-mère, elle était ravie et aux petits soins pour moi. Début 77 fut l’année de ta naissance, pour le bonheur de tous, car tu étais la seule descendance des deux côtés de la famille.
En juin de la même année, Miguel, sur ordre d’ETA, partit pour l’Argentine afin de former des militants à l’insurrection. Il prit l’avion sous une fausse identité le 19 juin 1977, et nous ne le revîmes plus.
« La vache ! il s’est tiré comme un voleur. »
Je sais que tu dois penser qu’il nous a quittés, mais je peux te garantir que ce n’est pas vrai. Il était parti pour un mois et il devait revenir fêter tes six mois avec nous. J’ai attendu et je n’ai jamais eu de nouvelles. Il m’avait laissé quelques contacts, ils n’avaient pas de nouvelles non plus. Je pense qu’il a été arrêté en Argentine. Il faut savoir que c’est une dictature, je ne sais si elle sera encore d’actualité quand tu liras ces lignes, mais aujourd’hui, c’est le général Videla qui dirige le pays avec une main de fer. Je pense même qu’il a été dénoncé au départ de Paris. Mais cela, je ne le saurai jamais.
Voilà, mon fils chéri, ce que je voulais que tu saches sur ton père, je ne sais pas quand ce cahier te sera confié, mais sache que j’ai aimé ton père et qu’il me l’a bien rendu. Si un jour tu décides de partir à sa recherche, tu trouveras ci-dessous des noms et des adresses que ton père m’a confié avant de partir avec ces mots : « Si un jour je ne reviens pas, dis à mon fils que je l’aime. » Je t’aime aussi, mon bébé adoré.
Maman.
Lucas était en larmes, il feuilleta les pages du cahier, il y avait des poèmes en français et en espagnol, des photos collées sur le papier blanc. Un trèfle à quatre feuilles, enroulé dans deux mèches de cheveux de couleurs différentes, tomba sur la table. « Il ne leur a pas porté chance », murmura Lucas. Il consulta la liste que sa mère avait laissée, les numéros de téléphone à dix chiffres n’existaient pas à l’époque. L’Espagne de Franco était finie, l’Argentine était une démocratie et l’ETA prônait la fin des armes. Si ces informations avaient de la valeur à l’époque, aujourd’hui elles étaient obsolètes. Quant à retrouver la piste de son père, Lucas n’y croyait guère, et avait-il vraiment envie de le chercher ?
On sonna à la porte, Lucas ouvrit à Alphonse.
— Alors, cette balade ? demanda Lucas.
— Très vivifiante, et toi, ta lecture ?
— Très instructive !
— Tu racontes ? demanda Alphonse.
— Bien sûr, d’autant que j’ai des questions à te poser.
— Parfait, installons-nous, dit Alphonse en s’asseyant dans le canapé du salon.
Lucas s’installa dans le fauteuil en face de lui et commença à rapporter ce qu’il avait lu.
— Je me doutais de ce que tu me racontes, commença Alphonse, surtout que j’ai eu plusieurs occasions de discuter avec ton père.
— C’est-à-dire ?
— Le combat des peuples opprimés, nous, les communistes, on a toujours combattu pour la liberté, en Indochine, en Algérie ou ailleurs, donc, je comprenais son combat pour l’indépendance basque, sans pour autant l’approuver.
— Tu étais radicalement opposé à Papé ? interrogea Lucas.
— Tu peux le dire, et ton père devait être pour lui l’équivalent des fellaghas algériens, des types que l’on doit passer par les armes sans discussion.
— Ce n’est pas l’impression qu’il me donnait !
— Sur la fin de sa vie, il était plus calme, mais il avait gardé son âme de militaire.
— Maman pense que papa a été dénoncé en France et qu’on l’attendait à l’autre bout, tu en dis quoi ?
— Dans le contexte de ces années, je pense que c’est plausible, tu sais, à l’époque, il y avait des groupuscules comme le SAC…
— C’est-à-dire ?
— Le Service d’action civique, il a été de 1960 à 1981 au service du général De Gaulle puis de ses successeurs gaullistes et souvent qualifié de police parallèle.
— Je vois, répondis Lucas.
— Qui faisait régulièrement le coup de matraque, à l’instar de certains syndicats dits “libres”, comme la Confédération des syndicats libres, une confédération syndicale créée dans les années 1950 et dissoute en 2002, qui, chez Peugeot, avaient la même attitude et n’hésitaient pas à briser les grèves ainsi que la gueule des grévistes.
— Certes, mais mon père n’était que de passage en France ?
— Oui, mais en Espagne, à l’époque on torturait et on garrottait, enchaîna Alphonse.
— Garrottait ?
— Tu attaches un type à un poteau, tu passes une corde à son cou et derrière, tu serres à l’aide d’un bâton, jusqu’à ce que mort s’ensuive.
— C’est barbare ! s’offusqua Lucas.
— Comme tu dis, et c’est dans ce contexte que ton père évoluait, alors, qu’il ait été dénoncé ici par quelqu’un que la police a retourné, ou par un proche qui voulait se venger, c’est pas impossible, va savoir !
— Tu penses à Papé en disant cela ? interrogea Lucas.
— C’est une option, imagine : il a une descendance avec toi, un gendre qu’il n’aime pas et des amis dans la police, c’est une possibilité non ?
— Oui, mais…
— Je te propose que nous allions faire un tour et dîner, nous reprendrons cette discussion demain, tu ne crois pas ? demanda Alphonse.
— Tu as raison, répondit Lucas en tapant sur l’épaule de son oncle.
Ils enfilèrent chacun leur veste et sortirent.
Chapitre 2
Lucas gara sa voiture devant le pavillon de banlieue de ses grands-parents, il n’y était pas venu depuis un mois. Il s’y rendait régulièrement pour laisser un peu de chauffage en hiver et tondre la pelouse en été. Quand Mamé avait été hospitalisée, il s’était occupé de toute la partie administrative, sans pousser au-delà du nécessaire la recherche de documents relatifs à la succession qu’il devait maintenant assurer.
Au moment où il coupait le contact, madame Fero, la voisine, sortait de son jardinet fleuri et mitoyen de la rue des Épinettes. Lucas la connaissait depuis son enfance, il l’avait toujours connu âgée, elle devait approcher les quatre-vingt-quinze ans, et continuait à sortir tous les jours chercher son pain et son journal. Elle aperçut Lucas et Alphonse. Ils l’embrassèrent tous les deux.
— Vous devez être tristes, leur dit la vieille dame.
— Malheureusement, cela était inévitable, répondit Lucas.
— Je sais, nous y allons tous, dit-elle en regardant le ciel.
— Vous voulez que je vous accompagne ?
— Non, non, mon petit, cela me fait du bien de marcher, dit-elle en se retournant.
Elle s’éloigna tranquillement.
— Elle a bon pied bon œil, dit Alphonse.
— Comme tu dis.
Lucas pénétra dans le jardin et avança dans l’allée centrale bordée de fleurs. Sur la gauche, après le massif de rosiers, le garage atelier du grand-père dans lequel Lucas avait appris à utiliser la scie, le rabot, tous les outils que le grand-père utilisait pour bricoler. Au pied de la maison en meulière, un escalier rejoignait la cuisine et la salle à manger. À l’étage les chambres, et au-dessus, le grenier. Lucas avait décidé de faire un état des lieux en compagnie d’Alphonse. Car étant le seul héritier de la famille, il envisageait d’emménager rapidement dans la maison de son enfance et d’y faire quelques travaux d’aménagement et ainsi évacuer les fantômes du passé.
— On commence par où ? demanda Alphonse en pénétrant dans la cuisine.
— Je pense qu’il faut régler tout ce qui concerne les documents familiaux, après on s’occupera de faire l’inventaire.
— Tu as raison, les vieux gardent toujours des papiers qui ne servent à rien, dit Alphonse en souriant.
— Et tu t’y connais !
— C’est vrai, d’ailleurs à ma mort, tu vas avoir du boulot ! s’esclaffa Alphonse. Je te propose, comme il y en a partout, de les apporter dans la salle et on trie, qu’en penses-tu ?
— Cela me va.
Alphonse se dirigea vers la chambre, tandis que Lucas s’attaquait au buffet de la salle à manger. Ils trièrent et rangèrent toute la matinée, en faisant des tas pour la sécurité sociale, les caisses de retraite, les impôts, etc. Après le déjeuner, ils décidèrent de visiter la maison de la cave au grenier.
— On va peut-être trouver des lingots, ironisa Alphonse.
— Si c’est le cas, on fera la fête !
— D’autant qu’il était un peu pingre, le beau-frère !
— Tu as raison, il avait le porte-monnaie en peau de hérisson, mais paix à son âme.
— Surtout qu’il a eu une belle mort, partir comme ça, une nuit sans rien dire, c’est ce que j’aimerais qui m’arrive, sans souffrances !
— C’est vrai que c’est une belle mort, mais un peu jeune à mon goût !
— Mais toi tu l’as largement dépassé, répondit Lucas.
— Et j’espère bien continuer !
— Tu as combien, quatre-vingts et quelque chose ?
— Quatre-vingt-deux.
— Tu es un peu plus âgé que Mamé ?
— Oui, de deux ans, mais c’est la vie. Bon, on continue ? demanda Alphonse.
— On y va, répondit Lucas en montant l’escalier menant au grenier, il avait laissé la cave à son oncle, les marches étaient moins dures.
Lucas souleva la trappe menant sous les combles, il descendit l’échelle et commença son ascension. Il passa la tête par l’ouverture et chercha l’interrupteur sur la droite, clic, la lumière éclaira la charpente. Le grand-père avait fait poser sur le sol des lattes de bois, afin que l’on puisse se déplacer sans passer au travers du plafond. Lucas fit un redressement et se propulsa dans l’endroit poussiéreux qui n’avait pas vu âme qui vive depuis de nombreuses années.
Comme dans tous les greniers, il y avait des jouets, des couvertures, tout un bric-à-brac que Lucas devra emmener à la déchetterie, ou donner au Secours populaire. Au milieu de ce fatras, il y avait une malle fermée d’un cadenas. Lucas s’en approcha et secoua la fermeture pour tester sa résistance. L’attache métallique était de qualité et ne céda pas. Il fit glisser la malle jusqu’à l’ouverture, descendit les premières marches et la chargea sur son dos. Elle était lourde et l’échelle instable. Il réussit à descendre sans encombre jusqu’au dernier barreau sur lequel il dérapa. La malle, suivant l’inclinaison subite, tomba lourdement sur le sol. Lucas eut juste le temps de ranger ses pieds avant que la lourde caisse ne touche le sol. Du sous-sol, Alphonse hurla :
— Tu n’as rien, que s’est-il passé ?
— Ne t’inquiète pas, c’est une vieille malle qui a glissé.
— J’arrive !
Lucas redressa la malle, elle avait arraché le papier peint à fleurs qui ornait le couloir. « De toute façon, c’était une horreur », pensa Lucas. Alphonse arriva un peu essoufflé.
— Tu m’as fait peur !
— Ne t’affole pas, repose-toi un peu !
— C’est l’objet du délit ? demanda Alphonse en désignant la malle.
— Tu voulais des lingots, il y en a peut-être parce qu’elle est lourde !
— J’ai entendu !
— Je vais la descendre.
— Je vais t’aider, dit Alphonse.
Lucas le précéda dans l’escalier et les deux hommes descendirent péniblement l’encombrant souvenir qu’ils déposèrent dans la salle à manger.
— Je vais chercher une scie pour couper le cadenas, dit Lucas en se dirigeant vers l’atelier près du garage.
Cinq minutes plus tard, Lucas revint et s’affaira au sciage du cadenas. Il ne lui fallut que très peu de temps pour venir à bout du métal rouillé. Il le dégagea et ouvrit le coffre. Tous les deux se penchèrent pour regarder son contenu.
— Eh ben, il y en a des choses là-dedans ! s’étonna Alphonse.
Lucas ne fit pas de commentaire et sortit de la malle l’uniforme de parachutiste et le posa sur le buffet. Une fois déplié, on apercevait les décorations sur la partie gauche de la veste. Les fourragères du régiment avaient gardé leur éclat, notamment celle de la Légion d’honneur. De l’autre côté, au-dessus de l’insigne du régiment, il y avait l’insigne BPM (Brevet Parachutiste Militaire). Pour compléter l’ensemble, sur la manche droite, les galons de sergent-chef. Lucas fit un pas en arrière pour mieux le jauger.
— Il était bien bâti, le grand-père.
— C’est vrai qu’il était pas mal, d’ailleurs, si ma sœur a craqué, c’est qu’il lui convenait, car à vingt ans, ce n’étaient pas les mecs qui manquaient autour de ta grand-mère. En plus, ils s’aimaient vraiment, conclut Alphonse.
— Je crois aussi, répondit Lucas en sortant le béret rouge qu’il posa à côté de l’uniforme.
Dans un des coins, Lucas remarqua un paquet de lettres liées par un ruban bleu, l’adresse de la première enveloppe était destinée au sergent-chef Jean Albin, au dos figurait l’adresse de la maison actuelle.
— Ce sont les lettres de ma sœur ? interrogea Alphonse.
— Je pense.
— Tu vas les lire ?
— Non, elles sont personnelles, et comme ils ne sont plus de ce monde, je vais les brûler.
— Tu as raison, on continue l’exploration de la caverne d’Ali Baba, suggéra Alphonse en souriant.
Le paquet de lettres était posé sur deux boîtes à chaussures. Dans la première, Lucas découvrit un pistolet automatique, modèle 1950, enveloppé dans un tissu blanc.
— Il a ramené un souvenir, on dirait, ironisa Alphonse.
— Et il a l’air de fonctionner, constata Lucas en élevant le chargeur et en manœuvrant la culasse afin d’éjecter une balle éventuellement engagée dans le canon.
— Qu’est-ce que tu vas en faire ?
— Je devrais le remettre aux autorités de police, mais comme ici, la police, c’est moi…
— Elle est drôle celle-là !
— Je ne sais pas encore, on verra, dit Lucas en posant l’arme sur la table.
Alphonse sortit la seconde boîte et l’ouvrit. Elle contenait des papiers et des photos.
— Tu veux que j’étale le tout sur la table ? demanda Alphonse.
— Tu as raison, renverse et on triera.
Sur la table, les photos et divers documents s’étalèrent. Lucas prit le brevet de parachutiste et lut sur le verso, une série de chiffres : 71432.
— Ils n’étaient pas nombreux, les parachutistes, dit Lucas.