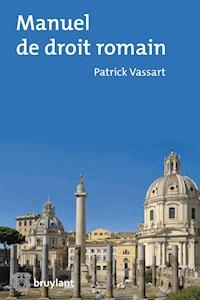
124,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bruylant
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
Ce Manuel se propose d'initier des étudiants en droit aux notions remémorées de la jeunesse de notre droit : le Droit romain, en particulier les normes dont il a irrigué le droit privé depuis plus de vingt-cinq siècles. Avec un seul parti-pris de méthode : envisager la découverte comme une promenade de prospection archéologique à travers le fécond champ gallo-romain du Code civil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.
© Groupe Larcier s.a., 2015Éditions BruylantRue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
EAN : 978- 978-2-8027-5014-7
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
« Ils mettent la chance en doute mais comptent le courage au nombre des certitudes. »
Avant-propos
Ce manuel, destiné en priorité à des étudiants de première année en droit, est une incitation à partager un étonnement : une cité que la légende dit avoir été fondée par un petit groupe* de jeunes en révolte, trop turbulents au regard de leurs voisins pour en recevoir l’hospitalité, s’est attachée à l’épanouissement de la jeunesse de notre droit.
Un juriste en devenir ne risque-t-il pas de voir altérée son incertaine vocation s’il se voit obligé d’accepter le legs, a priori poussiéreux, de textes transmis par les parchemins et papyrus qui ont survécu au naufrage de la plus grande partie des sources antiques ? Ou, du moins, de suggérer poliment et prudemment de délaisser l’herbier de si fragiles supports aux soins de bibliothécaires qui méritent le même respect qu’un philatéliste à l’ère du triomphe du courriel ? À chacun ses collections, et nul n’est tenu de visiter un musée d’histoire naturelle ou d’archéologie pour réussir l’examen préalable à la délivrance d’un permis de conduire. À moins qu’un zeste de curiosité ne conduise notre futur juriste à franchir la porte de l’une de ces bibliothèques et à se demander pourquoi ces vieux manuscrits font l’objet d’une hygrométrie aussi scrupuleuse que s’il s’agissait de conserver de grands crus classés…
Y a-t-il une lettre cachée ? Qui nous donnerait à lire et à considérer les termes de ce paradoxe : comment La société romaine1, marquée, à l’intérieur, de telles inégalités de conditions individuelles, à l’extérieur, d’un impérialisme qui constitue la trame de son histoire, a-t-elle pu faire éclore et léguer à la postérité une innovation aussi improbable que la norme juridique ? Un manuel ne suffira pas à répondre à cette question mais peut soutenir une expérience proposée en introduction aux études en sciences juridiques. Cette dernière expression, aujourd’hui en concurrence avec le mot « droit » lorsqu’il s’agit d’envisager le cycle d’études – à partir de legal sciences en anglais (langue dont les termes abstraits sont si imprégnés de leur origine latine), le mot « science » devant être entendu en l’occurrence au sens du mot latin scientia ou « savoir », comme dans la devise de l’Université Libre de Bruxelles Scientia vincere tenebras – de nature à troubler initialement des lecteurs moins férus de sciences exactes que de sciences humaines, renvoie au versant juridique de l’histoire dont les normes de droit positif sont le produit : animée par la conviction de la valeur pédagogique de l’explication historique – plus précisément généalogique – l’expérience consiste à donner à lire des textes du Code civil belge comme un palimpseste ou parchemin dont les manuscrits successifs ont été recouverts par des strates de libellés plus récents ayant abouti aux normes aujourd’hui en vigueur. Sans que le texte original et des versions intermédiaires n’aient pu être complètement effacées et ne puissent au contraire être restituées au point de permettre la redécouverte des archétypes ou premières occurrences des figures juridiques qui animent le droit civil contemporain.
Encore convient-il de procéder à certains choix et de ne pas confondre archéologie et tourisme : de même qu’un archéologue ne pourra procéder à des fouilles que sur un seul site la fois, n’explorerons-nous qu’un seul recueil de textes du droit civil : le Code civil belge dans son édition de l’année contemporaine de l’enseignement dont il sera le matériau brut. Enseignement dispensé à des étudiants de première année en droit à l’Université de Mons – ville au nom bien latin ! – dans la province du Hainaut, riche de quatre cents sites gallo-romains, chaque villa pouvant ressusciter une facette de la vie de nos lointains prédécesseurs comme tout Code civil national contemporain peut témoigner du fécond héritage juridique dont nous leur sommes redevables.
1. * Il serait anachronique de parler de « bande urbaine »…
Selon le simple et beau titre d’un recueil d’études de Paul Veyne.
Sommaire
AVANT-PROPOS
INTRODUCTION
SECTION 1 Le droit romain – droits objectif, subjectif ou positif
SECTION 2 Le droit romain et son histoire
SECTION 3 Distinction fondamentale : le droit public et le droit privé
PARTIE I LESPERSONNES
SECTION 1 Notion
SECTION 2 Capacité de jouissance et capacité d’exercice
SECTION 3 La personnalité en droit romain
SECTION 4 Début et fin de la personnalité en droit romain
SECTION 5 Capitis deminutio ou réduction de personnalité
SECTION 6 Capacité d’exercice
SECTION 7 Capacité des personnes morales
SECTION 8 Les droits subjectifs
PARTIE II LESBIENS
SECTION 1 Notion
SECTION 2 Le patrimoine
SECTION 3 Classifications des biens
PARTIE III LESDROITSRÉELS
SECTION 1 Introduction
SECTION 2 La possession et la détention
SECTION 3 Le droit de propriété
SECTION 4 L’usufruit, l’usage, l’habitation
SECTION 5 Les servitudes prédiales
SECTION 6 L’emphytéose et la superficie
SECTION 7 Le gage et l’hypothèque
PARTIE IV LESDROITSDECRÉANCE (LESOBLIGATIONS)
SECTION 1 Introduction
SECTION 2 Les sources des obligations
SECTION 3 La théorie générale des obligations
SECTION 4 Les principaux contrats
Introduction
Section 1
Le droit romain – droits objectif, subjectif ou positif
Le droit romain désigne l’ensemble des règles de droit qui ont gouverné la vie en société des personnes physiques (les individus) et morales (de droit public : l’État – la res publica ; de droit privé : les universitates personarum ou rerum) soumises au pouvoir politique romain pendant plus de deux mille ans : depuis la fondation légendaire de la ville de Rome le 21 avril 753 a.C. jusqu’à la fin de l’Empire byzantin en 1453 p.C.
Durant le premier millénaire, ce pouvoir politique est effectivement centralisé à Rome. En 330 p.C., la capitale de l’Empire est transférée à Byzance, rebaptisée Constantinople (ἡ Κωνσταντινόπολις : la ville de – l’empereur – Constantin ; il s’agit actuellement d’Istanbul, dénomination également d’origine grecque : εἰς τὴν πόλιν signifie « dans la ville » et évoque le mouvement du voyageur qui s’y rend).
Au cours du second millénaire, même après la perte de tout pouvoir politique sur la ville de Rome (déposition de l’empereur Romulus Augustulus en 476 p.C., reprise militairement par les généraux de l’empereur Justinien en 538, sans toutefois que l’administration byzantine ne puisse y être effectivement instaurée), les Byzantins se désigneront toujours comme les « Romains » – οἱ Ῥωμαῖοc en attribuant leur identité à l’origine romaine de leur empire. Durant plus de deux millénaires, le droit romain se développe et évolue donc dans le cadre de la continuité d’un même État, au point de vue du droit sinon de la géographie.
La notion de droit reçoit deux acceptions principales :
Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie des personnes physiques et morales en société (cf. « law »). Ces règles confèrent des droits subjectifs et des devoirs dont le droit objectif constitue le catalogue. E.g. la Faculté et les études de droit se réfèrent à la notion de droit objectif.
Droit subjectif : prérogative attribuée à une personne et reconnue par le droit objectif (cf. « right »). E.g. le droit de s’inscrire à la Faculté de droit et d’y entreprendre des études est un droit subjectif.
Un seul mot est utilisé en latin pour les deux notions : ius. Il s’applique tant au droit objectif, tel le ius ciuile ou droit civil propre à l’ensemble des citoyens romains, qu’à tel ou tel droit subjectif, tel le ius suffragii ou droit de vote d’un citoyen romain.
Le droit positif désigne le droit objectif en vigueur et appliqué à tel moment à tel endroit. Il change constamment : ainsi le Moniteur belge (recueil officiel quotidien du droit positif de l’État belge et de ses entités fédérées) publie-t-il, chaque jour ouvrable, de nouvelles lois (État fédéral) ou ordonnances (Région bruxelloise), de nouveaux décrets (Régions wallonne ou flamande), ou, au minimum, de nouveaux arrêtés d’application des lois, ordonnances et décrets en vigueur. Tout recueil de législation, tout code se doit de préciser la date à laquelle les textes qu’il réunit sont en vigueur (e.g. législation en vigueur le 1er janvier 2015 : ainsi l’éditeur est-il certain que ce jour-là – férié – le code n’a pas dû faire l’objet d’une mise à jour…).
Comme l’a écrit le philosophe présocratique Héraclite (sans songer prioritairement au droit…), « on n’entre jamais deux fois dans le même fleuve » : si l’eau (le droit positif) s’écoule et se renouvelle continuellement, en revanche le fleuve et ses rives (le droit objectif) demeurent. Nous étudierons le droit objectif, car il est le noyau et le commun dénominateur des normes dont le droit positif ne constitue qu’un instantané.
Section 2
Le droit romain et son histoire
1.DÉFINITIONDUDROITROMAIN
C’est l’ensemble des règles qui ont gouverné les citoyens romains au sein de leur État, sous les régimes successifs de la Royauté, de la République et de l’Empire, ainsi que leurs relations avec les sujets de l’État qui ne bénéficiaient pas de la citoyenneté romaine. Le droit romain ainsi envisagé est un droit objectif, étudié au point de vue de sa formation et de son évolution jusqu’à son apogée formel à l’époque de la codification réalisée sous l’autorité de l’empereur Justinien (entre 528 et 534 p.C.).
Pourquoi le droit romain n’est-il traditionnellement pas enseigné sous l’angle du droit positif arrêté à une date choisie de façon discrétionnaire, en fonction, par exemple, d’événements historiques particulièrement importants (e.g. les ides de Mars : date de l’assassinat de Jules César le 15 mars 44 a.C.) ? Parce que les sources recueillies (les textes juridiques conservés) ne permettent une connaissance globale du droit positif à une date déterminée qu’à partir du règne de Justinien 1er (527-565 p.C.), alors même que la période la plus créative du droit romain s’étend de la seconde moitié du deuxième siècle avant notre ère à la première moitié du troisième siècle de notre ère (période dite du « droit classique »).
2.LIMITESCHRONOLOGIQUESDUDROITROMAIN
A.Les origines de Rome
Selon une chronologie établie par l’écrivain Varron et adoptée par les historiens antiques (notamment Tite-Live et Denys d’Halicarnasse), qui en reconnaissent le caractère légendaire, la ville de Rome aurait été fondée le 21 avril 753 a.C. par Romulus et Rémus : ainsi les Romains datent-ils les années depuis la fondation de leur capitale, ab Urbe condita, littéralement « depuis que la Ville a été fondée » (e.g. César a été assassiné en l’an 709 de Rome).
Si l’existence même de Rome, son développement, la croissance de son territoire, son organisation sociale et son mode de vie au cours des quatre premiers siècles sont bien attestés et documentés par l’archéologie moderne, son histoire événementielle reste par contre tributaire de la tardiveté des sources écrites : les grands historiens grecs des 5e (Hérodote, Thucydide) et 4e (Xénophon) siècles avant notre ère n’en témoignent pas et les premiers historiens romains (plus exactement des poètes ou des annalistes) n’apparaissent qu’au 3e siècle avant notre ère.
C’est dire la fragilité et la limite des moyens dont pouvaient disposer, au tournant de notre ère, des historiens comme Denys (en grec) et Tite-Live (en latin) lorsqu’ils entreprennent de reconstituer l’histoire de Rome depuis ses origines : il s’agit avant tout d’une histoire légendaire, en ce sens qu’elle est jalonnée de legenda (expression de latin médiéval ; les anciens parlaient de fabulae) ou événements qui doivent être lus et rapportés, ou qu’il convient de rapporter si l’on veut comprendre l’édification de la puissance romaine à la lumière d’une tentative d’explication enchaînant causes et effets.
Tite-Live – dont l’œuvre est sobrement intitulée ab Urbe condita : « à partir de la fondation de la Ville (éternelle) » – explique clairement (dans la préface au premier livre) le sens que revêt l’histoire des origines de Rome telle que la tradition l’a véhiculée avec une grande mais invérifiable précision :
« Quant aux événements qui ont précédé immédiatement la fondation de Rome ou ont devancé la pensée même de sa fondation, à ces traditions embellies par des légendes poétiques plutôt que fondées sur des documents authentiques, je n’ai l’intention ni de les garantir ni de les démentir. On accorde aux anciens la permission de mêler le merveilleux aux actions humaines pour rendre l’origine des villes plus vénérable ; et d’ailleurs, si jamais on doit reconnaître à une nation le droit de sanctifier son origine et de la rattacher à une intervention des dieux, la gloire militaire de Rome est assez grande pour que, quand elle attribue sa naissance et celle de son fondateur au dieu Mars de préférence à tout autre, le genre humain accepte cette prétention sans difficulté, tout comme il accepte son autorité. »
Ainsi la légende des origines est-elle convoquée pour conférer des lettres de noblesse à l’impérialisme romain et peut-elle intéresser les juristes dans la mesure où elle inscrit la naissance du droit romain dans une ambivalence qui caractérisera toute son évolution : la norme juridique, appelée à désamorcer le recours à la violence en cas de différend, est généralement elle-même issue de rapports de force…
Le plus lointain ancêtre des Romains aurait été Énée, héros troyen (fils d’une déesse, Vénus, et d’un mortel, Anchise), mais simple « réfugié politique » lorsqu’il aborde le Latium, après une longue errance suite à la prise et à la destruction de Troie par la coalition des rois grecs venus laver l’affront de l’enlèvement d’Hélène par Pâris, enlèvement qui n’était lui-même qu’un avatar du défi trouvant son origine dans l’épisode de la Pomme de Discorde. D’abord bien accueilli par le roi Latinus dont il épouse la fille Lavinia, il doit cependant guerroyer contre un prétendant évincé, Turnus, avant de pouvoir faire souche en fondant la ville de Lavinium. Son fils, Iulus ou Ascagne, fonde à son tour une ville, Albe-la-Longue1, où lui succèdent treize rois.
Le dernier d’entre eux est Amulius, un usurpateur qui chasse l’héritier légitime, son frère aîné Numitor, dont il assassine les fils et veut priver la fille, Rhea Silvia, de toute descendance en lui imposant de devenir vestale (prêtresse du culte de Vesta). Elle met cependant au monde des jumeaux, dont elle attribue la paternité au dieu Mars. Amulius ordonne qu’ils soient noyés dans le Tibre. Mais le berceau, posé sur une nappe du fleuve en crue, n’est pas emporté lorsque l’eau se retire… Une louve est attirée par les cris des enfants et les nourrit jusqu’à ce que le berger Faustulus les recueille et les confie à son épouse, Acca Larentia, qui les élève. Arrivés en âge de combattre, les jumeaux ourdissent un complot, tuent Amulius et rétablissent leur grand-père sur le trône d’Albe.
Romulus et Rémus ne restent cependant pas à Albe (les Albains le souhaitaient-ils d’ailleurs ?), mais désirent fonder une ville à l’endroit où ils avaient été recueillis. Qui donc y régnera ? Impossible d’invoquer un droit d’aînesse entre jumeaux… Il faut dès lors que les dieux protecteurs des lieux les départagent et seul le recours aux augures2 peut indiquer la préférence divine. Rémus, le premier, aperçoit six vautours ; le double s’en présente à Romulus : faut-il faire prévaloir l’antériorité ou le nombre ? Romulus prend l’initiative, trace le sillon et élève une muraille délimitant la nouvelle ville. Par bravade, Rémus la franchit d’un saut : Romulus le tue et proclame « ainsi en ira-t-il dorénavant de quiconque franchira mon enceinte », fondant son pouvoir sur un fratricide et la première règle de droit sur le mode ultime de coercition…
La ville commence dans le dénuement et les fondateurs doivent avant tout pourvoir à la mixité de leur cité. Considérés comme une bande de brigands, ils sont éconduits de chaque cité voisine où ils formulent une demande collective en mariage. Ils doivent dès lors recourir à la ruse : ils invitent leurs voisins sabins à assister aux jeux qu’ils organisent ; à peine les spectateurs installés, c’est l’enlèvement des Sabines…
Outrés d’une telle violation des lois de l’hospitalité3, les Sabins se mobilisent et déclarent la guerre. C’est à l’intercession des Sabines qu’il y est rapidement mis fin : elles s’interposent entre leurs parents et leurs maris (jusqu’à une époque avancée de l’empire byzantin, le mariage romain constitue un fait et non un acte juridique : v. infra) et la paix est aussitôt rétablie, le roi des Sabins, Titus Tatius, étant appelé à régner de concert avec Romulus. Au décès de ce dernier se pose, pour la première fois, la question de la succession.
Romulus s’était entouré d’un conseil de cent sénateurs4 : le Sénat exerce l’interregnum en confiant le pouvoir, à tour de rôle, à l’un de ses membres, chaque fois pour cinq jours, chargé de prendre les auspices pour y repérer un signe divin indiquant qui devrait être désigné roi. Lorsque la designatio intervient, le candidat désigné ou designatus obtient la creatio ou pouvoir de convoquer (rogatio) l’assemblée des comices curiates, composée de trente curies soit dix pour chacune des tribus5 qui constituaient initialement la population romaine : celles-ci sont appelées à approuver la désignation et votent par acclamatio la lex curiata de imperio qui confère au roi le pouvoir ou imperium. Le roi prend à son tour les auspices pour être certain que les dieux confirment leur choix : c’est l’inauguratio qui fonde l’aspect religieux du règne, annoncé comme « faste » (fas qualifie tout ce qui est permis par les dieux et, en particulier, les jours propices à l’action). Romains et Sabins vivent désormais en si bonne entente que le deuxième roi de Rome est un Sabin : Numa Pompilius.
Ce dernier, beaucoup plus pacifique que son prédécesseur, entreprend de remplacer, comme fondements de la nouvelle cité, la violence et les armes par le droit, les lois et les bonnes mœurs. Il s’avère très doué pour conjurer la crainte des forces surnaturelles en établissant une forme de dialogue, voire de connivence avec Jupiter.6 Aussi instaure-t-il le culte et les rites propres aux premiers Romains et, ceux-ci étant encore passablement frustes, invoque l’autorité de la nymphe Égérie, avec laquelle il dit se retirer la nuit en colloque singulier. Un culte est notamment instauré en faveur d’une nouvelle déesse : Fides ou la Bonne Foi, la main droite se voyant conférer un caractère sacré (les Romains sont à l’origine de la symbolique de la poignée de main scellant un accord).
Le troisième roi, Tullus Hostilius, est cependant d’humeur plus guerrière et la solidarité fraternelle demeure étrangère aux Romains : à la rivalité d’Amulius et Numitor, puis de Romulus et Rémus, succède celle de Rome et d’Albe-la-Longue, encore capitale du Latium : c’est l’épisode du duel des frères triplés (« trigemini ») Horaces (romains) avec les frères triplés Curiaces (albains). Pour limiter les dommages de guerre, les deux cités concluent le premier traité dont Rome ait gardé le souvenir : la cité dont les champions seront vainqueurs exercera sur l’autre une autorité incontestée. L’un des Horaces finit par l’emporter. Le roi d’Albe, Mettius Fufetius, s’incline de mauvaise grâce et tente de susciter une coalition contre les Romains. Ayant ainsi violé le traité, il est exécuté7 et toute la population albaine est transplantée à Rome, Albe étant rasée. Voyons-y plus de sagesse que de cruauté : seul le roi adverse paie de sa vie le manquement à la parole donnée tandis que deux populations réunies ne se feront plus la guerre.
Le quatrième roi, Ancus Martius, petit-fils de Numa, s’efforce de réunir les qualités de ses trois prédécesseurs et passe, selon la tradition, pour avoir instauré les rites de la guerre « pieuse et juste » : lorsque Rome est appelée à faire valoir une prétention légitime envers ses voisins, une requête doit leur être formellement notifiée par un ambassadeur – le pater patratus qui préside le collège des diplomates appelés « féciaux » – et ce n’est qu’à défaut de satisfaction donnée à cette requête et en accord avec les sénateurs que la guerre peut être déclarée.
À l’alternance des rois romains et sabins succède la période des trois rois étrusques (la période de domination étrusque sur Rome est effectivement bien attestée par l’archéologie). Tarquin l’Ancien aurait été le premier à faire acte de candidature au trône et à mener une campagne électorale en vue de sa propre élection. Sous son règne s’impose la pratique de recourir aux augures et de prendre les auspices avant toute décision importante en politique intérieure et extérieure. Son épouse, la reine Tanaquil, est elle-même experte en interprétation des présages : ainsi prédit-elle un si grand avenir à un enfant esclave dénommé Servius Tullius que ce dernier est élevé dans la famille royale et devient le gendre du roi.
Quelle qu’ait pu être la condition personnelle de Servius, le message légendaire est évident : à Rome, tout est possible et le statut individuel n’est pas intangible, comme l’illustrera l’évolution de la notion de personnalité juridique (capacité de droit et de fait de l’individu : v. infra). Cette rapide élévation déplaît cependant aux fils d’Ancus Martius, laissés pour compte, qui complotent et assassinent Tarquin. Sa mort est toutefois dissimulée pendant quelques jours, le temps pour Tanaquil et Servius d’organiser un interim au terme duquel ce dernier succède, du seul consentement du Sénat et donc, contrairement à ses prédécesseurs, sans être élu (« acclamé ») par les citoyens.
Servius Tullius aurait été un roi non seulement bâtisseur – la muraille dont il entoure la ville la délimitera jusqu’à la fin de la république –, mais surtout réformateur.
Avant sa réforme administrative, la cité et les citoyens auraient été répartis administrativement par Romulus en trois tribus composées chacune de dix curies. Leurs assemblées – les comices curiates – étaient composées des seuls patriciens ou patres, descendants des fondateurs ou assimilés (tels les patriciens d’Albe), en âge de porter les armes, et étaient appelées à élire le roi, à décider de la guerre ou de la paix, à autoriser une adoption ou à constater un testament. Seuls leurs membres, en principe égaux en droit, avaient les droits et les devoirs du citoyen, chacun d’eux étant ciuis et miles : c’est le régime du citoyen-soldat. Cette égalité théorique paraît déjà dépassée lors de l’avènement de Servius, dans la mesure où, d’une part, des inégalités de fortune sont apparues entre patriciens, et, d’autre part, la population de la ville s’est fortement accrue de plébéiens, immigrés à Rome encore privés de droits et de devoirs politiques, ainsi que de droits civils.
Sur la base du lieu de résidence, Servius remplace les trois tribus primitives par quatre tribus urbaines et dix-sept tribus rurales, y incorporant les plébéiens. Ces derniers deviennent donc citoyens et peuvent ainsi bénéficier du ius militiae (droit de servir dans l’armée) et du ius tributi (droit de payer des impôts).
Les droits ainsi généralisés sont cependant aussitôt différenciés par un second critère de répartition des citoyens, sur une base capacitaire ou censitaire : en fonction de son patrimoine (qui conditionne sa capacité à pourvoir personnellement à son équipement de légionnaire), chaque citoyen est versé dans l’une des cinq classes dégressives (la première réunit les citoyens ayant un patrimoine de 100 000 as) servant à la fixation de la base d’imposition et de l’affectation militaire. Chaque classe est elle-même subdivisée en centuries. En dessous d’un patrimoine de 11 000 as, le citoyen est hors classe et, dès lors, ne paie pas d’impôt, n’effectue pas de service militaire et ne participe aux votes dans les assemblées appelées « comices centuriates » que pour un nombre très réduit de voix (u. infra).
Le sénat n’est, sous la royauté, que l’assemblée des anciens, dont les membres, nommés par le roi, assurent l’interrègne, proposent aux comices et ratifient l’élection de son successeur et le conseillent en toutes matières, mais ne légifèrent pas plus que lui ni que les comices : sauf peut-être en matière religieuse (où des « lois royales » écrites auraient pu fixer les rites à observer), le seul mode de formation du droit, sous la royauté, est la consuetudo ou coutume. Il s’agit de comportements dont le respect cohérent et continu par la majorité des citoyens indique le caractère pertinent et contraignant pour l’organisation de la vie en société.
Ce mos maiorum ou usage respecté par le plus grand nombre s’impose avec une telle évidence qu’il ne paraît pas nécessaire de le fixer par écrit (ce dont la valeur ajoutée serait d’ailleurs faible dans une société encore peu alphabétisée…) : le meurtre, l’incendie volontaire, la trahison de la cité, la violence entre citoyens, l’inceste sont prohibés de façon immémoriale. La connaissance et l’expression précises de règles coutumières plus détaillées sont laissées à l’expertise des pontifes.
Fixer à une époque de droit coutumier la réforme administrative si précise attribuée à Servius Tullius suggère dès lors un anachronisme : aussi est-il préférable d’évoquer à propos de la République le processus électoral ainsi mis en place, en ne faisant remonter à des temps plus anciens qu’un processus d’organisation de l’armée. La réforme judiciaire qui lui est également attribuée a pu, quant à elle, remonter effectivement à son époque. Avant Servius, le roi tranchait seul tous les procès, dans le cadre d’une procédure à forte connotation religieuse et exclusivement orale : chaque partie affirme solennellement sa prétention et prête serment devant le roi. Ce dernier examine les faits du litige et condamne comme parjure le plaideur qu’il estime avoir tort.
L’accroissement de la population a dû provoquer un surcroît de tâches judiciaires pour le roi et expliquerait la nécessité d’introduire une ordo iudiciorum priuatorum ou organisation des procès privés en deux phases : le roi est encore le seul magistrat, mais se borne à recevoir les serments des parties litigantes – c’est la phase in iure ou en droit – et puis défère leur litige à l’examen et au jugement d’un simple citoyen désigné comme juge : c’est la phase apud iudicem ou auprès du juge. Ce dernier est choisi par les parties, dès l’origine sans doute parmi les sénateurs, comme ce sera le cas sous la République.
La tradition prête encore à Servius Tullius d’autres intentions de réforme – dont celle d’abolir la royauté même à l’issue de son règne –, mais l’histoire et l’un de ses gendres en décident autrement : il est chassé de son trône et assassiné sur ordre de Tarquin le Superbe, qui se garde bien de demander l’assentiment des comices et du sénat à l’égard de son usurpation du pouvoir. Son règne reste dans l’histoire comme celui de l’assimilation de la royauté à la tyrannie.
Deux anecdotes plaisantes sont rapportées à son sujet par Denys d’Halicarnasse, qui donnent à entendre que, dans la mémoire collective romaine, l’expertise dans la négociation n’a pas tardé à l’emporter sur la superstition. Le roi se propose d’ériger, sur la colline tarpéienne, le plus vaste temple du Latium en faveur de Jupiter. Les premiers travaux d’excavation mettent au jour un crâne. Il convient d’interroger des experts au sujet de ce prodige et une délégation romaine est envoyée en Étrurie pour consulter Olenus Calenus, le meilleur des devins locaux. Le fils de ce dernier initie les délégués romains à la compréhension pertinente de l’avis sollicité, voire les met en garde contre la subtilité de son père… En effet, selon Pline8 l’Ancien qui relate l’épisode d’un strict point de vue romain, le devin tente de surprendre la vigilance des délégués en figurant le lieu de la découverte : est-ce ici (hic) que le prodige à interpréter s’est produit ? Non, c’est là-bas (illic), à Rome, répondent les délégués, qui n’entendent pas laisser le présage détourné au profit de l’Étrurie. Le devin s’incline et annonce le destin glorieux de Rome, qui se retrouvera à la « tête du monde » (caput mundi). Aussi la colline tarpéienne sera-t-elle désormais appelée le « Capitole », et Jupiter surnommé « capitolin ».9 Plus tard, une vieille dame, étrangère, propose au roi de lui vendre neuf livres d’oracles ; Tarquin refuse de les acheter ; la dame en brûle alors trois et renouvelle son offre ; le roi refuse à nouveau ; la Sibylle de Cumes en brûle alors trois autres et renouvelle une dernière fois son offre, toujours au même prix… Tarquin, impressionné, consulte les augures, qui opinent favorablement, et se décide enfin à acheter les trois livres restants, au prix initialement demandé pour les neuf (Nb : il n’y a pas de rescision pour lésion en matière de meubles et, de toute façon, seul le vendeur pourrait l’invoquer s’il vendait trop bon marché, non l’acheteur s’il achète au prix fort… v. infra) ! La sibylle disparaît, mais le précieux recueil des Livres Sibyllins sera conservé dans le temple de Jupiter au Capitole et consulté à la demande du Sénat chaque fois que Rome traversera de grands périls.
L’histoire ne dit pas si Tarquin a songé à les consulter pour son propre compte et, en tout cas, il n’y a pas vu venir la fin de la royauté, qui s’achève sur une affaire de mœurs : le viol de Lucrèce par Sextus, fils de Tarquin. La jeune femme se suicide et, devant l’indignation générale, les sénateurs prennent le pouvoir et abolissent la monarchie, Tarquin se réfugiant en Étrurie, non sans susciter deux coalitions (d’Étrusques puis de Latins) défaites successivement par la jeune république (siège de Rome en 508 a.C. et bataille du lac Régille en 499 : l’intervention décisive, au cours de cette dernière et aux côtés des Romains, des dieux jumeaux Castor et Pollux, fils de Jupiter, clôt l’horizon légendaire de la période de la royauté en consacrant symboliquement les bienfaits d’un exercice fraternel et collégial du pouvoir).
B.Institutions républicaines
Le fait divers qui aurait provoqué la fin de la royauté symbolise la déraison qui menace à tout moment le titulaire d’un pouvoir individuel et illimité dans le temps, même si ses qualités personnelles ont initialement permis son élection par le peuple (i.e. le populus ou, au sens juridique, l’assemblée des citoyens réunis pour exercer leur droit de vote, mais non évidemment une foule indistincte, dite multitudo).
De la royauté, les Romains conservent le principe de l’élection (principe qui ne va pas de soi, même en république : à Athènes, à la même époque, les archontes étaient désignés par tirage au sort10, seuls les stratèges – qui commandaient effectivement l’armée, sous la direction théorique de l’archonte polémarque, ministre de la guerre – étant élus) et le contenu de la fonction royale, moyennant trois modifications fondamentales :
il y a deux consuls, censés se contrôler mutuellement, chacun disposant d’un droit de veto – c’est l’intercessio – à l’égard des décisions de l’autre ; ils ne doivent pas nécessairement prendre leurs décisions en commun, mais tout acte de l’un doit donc au moins être tacitement accepté par l’autre ;
ils ne sont élus que pour une seule année, une réélection n’étant permise qu’après un intervalle de dix ans (délai dont le respect sera toutefois souvent négligé) ;
même s’ils doivent évidemment respecter scrupuleusement la religion d’État, la compétence de décision en matière religieuse est détachée de leurs fonctions et confiée à un rex sacrorum ou « roi des affaires sacrées ».
Les consuls sont élus par les comices centuriates instaurés par Servius Tullius. Si tous les citoyens (mais seulement les hommes en âge de porter les armes, indépendamment de leur statut de sui iuris ou d’alieni iuris : u. infra) y votent, seuls les patriciens jouissent de l’éligibilité ou capacité d’être élu, les plébéiens n’ayant que l’électorat (droit de vote). Pouvant seuls être magistrats, les patriciens ont ainsi seuls le pouvoir de soumettre des propositions de loi au vote des comices et de devenir membres du Sénat, soit à l’expiration d’une charge de consul, soit nommés par un consul.
Le Sénat n’a lui-même qu’une fonction consultative, mais son autorité et son influence sont très importantes eu égard à sa continuité, par opposition à l’annalité de la charge consulaire : il est difficile, voire impossible, pour les consuls de ne pas suivre les recommandations du Sénat en matière de politique étrangère, de finances publiques et d’organisation de la cité. Aussi les deux cent vingt premières années de l’histoire de la république seront-elles caractérisées, en politique intérieure, par la revendication par les plébéiens de l’égalité juridique avec les patriciens, tant dans le processus de décision politique qu’en droit privé.
La première expression collective de cette revendication est la retraite de la plèbe, en 494 a.C., sur le Mont Sacré, motivée par les abus de pouvoir des patriciens à son égard, abus plus sensibles dès le début de la république que sous la royauté. Cette sécession est très efficace dans la mesure où les patriciens ne peuvent – Rome étant continuellement en guerre avec ses voisins – se passer des légionnaires plébéiens. Ces derniers obtiennent dès lors le droit de se réunir en assemblée distincte – concilium plebis ou assemblée de la plèbe, organisée sur le mode des comices tributes dont la création est attribuée à Servius Tullius – pour élire des magistrats spécifiques :
les tribuns de la plèbe, investis du pouvoir d’intercéder en toutes matières où une décision à portée collective ou individuelle porterait atteinte aux droits de plébéiens : à cette fin, ils jouissent d’un droit de veto (ou intercessio) à l’égard des décisions des consuls (et des autres magistrats dont les fonctions seront distinguées ultérieurement) ; pour être mis en mesure d’exercer efficacement leurs droits, ils jouissent d’une immunité appelée « sacro-sainteté » ;
les édiles de la plèbe, appelés à veiller à un approvisionnement plus équitable des plébéiens (qui pâtissent directement des difficultés économiques liées aux guerres menées par les Étrusques et les Latins à l’instigation de Tarquin le Superbe), apparaissent comme les adjoints des tribuns, en parallèle avec l’assistance que fournissent les questeurs aux consuls (en matière de gestion des finances publiques et d’administration de la justice). Outre le pouvoir de désigner ces magistrats, les plébéiens réunis en assemblée peuvent également adopter des règles de portée générale – plebiscita ou plébiscites – comparables aux lois, si ce n’est qu’elles sont proposées non par les consuls, mais par les tribuns et ne s’appliquent qu’aux plébéiens.
Cette revendication d’institutions distinctes à vocation défensive est, à première vue, incompréhensible si l’on songe à l’électorat dont disposait la plèbe pour la désignation des consuls : pourquoi ne pas influencer plutôt la politique de ces derniers en soutenant, parmi les candidats patriciens, les plus sensibles à la légitimité des revendications plébéiennes ?
Parce que, si tous les citoyens votent effectivement au sein des comices, de sorte que les plébéiens ont a priori l’avantage du nombre, cette majorité n’est effective qu’au sein des comices tributes, mais non au sein des comices centuriates, ces derniers étant seuls compétents pour l’élection des magistrats. Or le système électoral complexe y biaise les calculs de majorité : celle-ci n’est pas basée sur le nombre total de voix individuelles, mais bien sur le nombre des majorités distinctes obtenues au sein de chaque centurie.
Une centurie n’est elle-même pas arithmétique quant au nombre d’individus la composant : le système de Servius Tullius étant censitaire (i.e. basé sur la capacité contributive fiscale de chaque individu en fonction de son patrimoine), chaque centurie correspond plus ou moins à la capacité fiscale globale de la totalité de ses membres. Ainsi, à l’origine, un nombre réduit de patriciens riches suffit-il à composer une centurie de la première classe, alors qu’il faut un nombre élevé de plébéiens pauvres pour composer une centurie de la cinquième classe…
Ce système aboutit au nombre de 98 centuries au sein de la première classe (dont 18 centuries équestres : celles des citoyens disposant des moyens de s’équiper pour guerroyer à cheval), pour seulement 20 au sein de chacune des classes 2 à 4, 30 pour la cinquième classe, et 5 seulement pour les citoyens hors classe (total : 193).
Comme les classes votent successivement et que la majorité au sein d’une centurie correspond à une seule voix dans le décompte final (quelle que soit, au sein de ladite centurie, la répartition des voix individuelles, seule comptant la majorité relative atteinte par l’un des candidats), il apparaît clairement que la première classe (qui compte à elle seule une majorité absolue du nombre total des centuries : 98/193) peut décider seule de l’issue de toute élection. Les classes suivantes ne sont appelées11 à voter qu’à défaut de résultats convergents au sein de la première classe, l’élection étant arrêtée dès qu’un candidat a obtenu la majorité dans 97 centuries.
Ce système n’est cependant ni de nature aristocratique (il n’a de caractère héréditaire que par l’héritage éventuel d’un patrimoine, non d’un statut juridique privilégié et intangible), ni de nature capitaliste (même s’il évoque la comparaison avec le pouvoir de vote des actionnaires au sein d’une actuelle société de capitaux) : dans une cité presque continuellement en guerre, il repose sur l’idée que les décisions doivent être prises en fonction de la contribution de chaque citoyen-soldat à l’effort militaire, le critère du patrimoine imposant au surplus une sincérité fiscale au respect de laquelle veilleront tout particulièrement les censeurs lorsque leur magistrature sera instituée à partir de 443 a.C.
Le fait même de déterminer l’appartenance à une classe en fonction du patrimoine conduit nécessairement à une mobilité socio-électorale, ne serait-ce qu’en raison de la division successorale du patrimoine au décès de chaque citoyen. Si ce régime a pu initialement favoriser les patriciens au détriment des plébéiens, l’appauvrissement de nombre des premiers et l’enrichissement de nombre des seconds ont conduit à une convergence progressive de la composition des centuries, de sorte que les revendications politiques ultérieures de la plèbe ne porteraient pas sur la réforme du système électoral, mais bien sur l’éligibilité, i.e. l’accès au droit d’être élu à toutes les magistratures.
C.Naissance du droit écrit : la Loi des XII Tables
Au début de la République, le droit reste étroitement lié à la religion et sa connaissance demeure l’apanage des patriciens : à défaut de règles écrites, seuls les pontifes (prêtres recrutés exclusivement parmi les patriciens) en détenaient l’expertise et la mémoire. Le droit coutumier non écrit peut suffire à véhiculer un nombre restreint de règles fondamentales de la vie en société d’une communauté peu nombreuse tant qu’il comporte plus de prohibitions – acceptées par tous – que de règles organisant des actes positifs.
Or la population romaine s’est accrue rapidement et cet accroissement va de pair avec une multiplication d’actes liés à la vie économique (les plébéiens, jouissant, en droit privé, du commercium ou capacité de conclure des actes patrimoniaux) : en particulier les transmissions de biens entre vifs ou à cause de mort, et les premiers contrats générateurs d’obligations à terme (tels la sponsio et le nexum : u. infra). Ces actes, issus de formalités précises à respecter, peuvent générer des litiges eux-mêmes tranchés par voie d’une procédure formaliste mise en œuvre par les consuls ou sous leur autorité.
Les plébéiens se plaignent dès lors d’être souvent traités de manière arbitraire par les patriciens, non tant en violation du droit qu’en application de règles qu’ils ne peuvent pas aussi bien connaître et dont ils ne peuvent maîtriser la mise en œuvre : ils exigent que le droit soit fixé par écrit et, au terme de joutes politiques où ils auraient réélus dix fois consécutivement les mêmes tribuns soutenant cette revendication, obtiennent qu’une commission soit envoyée en Grèce pour y étudier et s’inspirer de la méthode de Solon (désigné en qualité d’archonte plénipotentiaire à Athènes, en 594 a.C., pour y apaiser de graves tensions sociales à l’aide d’une profonde réforme législative et institutionnelle).
À son retour – l’histoire ne permettant pas, à vrai dire, d’affirmer s’ils sont partis pour la Grèce ou la Grande Grèce, i.e. les colonies grecques du sud de l’Italie – dix patriciens (les decemvirs) remplacent temporairement tous les autres magistrats et rédigent la Loi des XII Tables : d’abord dix puis, celles-ci s’avérant encore incomplètes, deux supplémentaires, pour la rédaction desquelles cinq decemvirs auraient été plébéiens, ce qui aurait constitué le premier accès de ces derniers à une magistrature générale.
Rédigée sur des tablettes de bronze, d’ivoire ou de bois affichées au forum, la loi n’a pas été conservée comme telle, mais nous en connaissons le contenu parce que tant d’extraits en ont été cités dans le Digeste ou dans des sources littéraires que son texte a pu être reconstitué.
Même si son style – recours fréquent à la forme de l’impératif futur « esto » (« qu’il soit ») – et son contenu – notamment la loi du talion – caractérisent une forme archaïque du droit, la loi des XII Tables, comme première source écrite du droit romain, représente déjà une importante voie de pacification des relations sociales dès lors qu’elle instaure notamment une forme de réparation du préjudice causé à autrui limitée à l’importance quantitative dudit préjudice (afin d’éviter l’escalade propre à la vengeance privée), voire substitue à la réparation en nature les premières modalités d’indemnisation par équivalent : ainsi un préjudice corporel peut-il, le cas échéant, être compensé par une indemnité consistant en biens d’une valeur déterminée par la gravité de l’atteinte portée à la victime.
Ainsi le droit se trouve-t-il caractérisé, dès sa naissance écrite et sa séparation formelle des normes religieuses et morales, par son aspect patrimonial. Il s’agit aussi, en matière non religieuse, d’une première source de création du droit : la coutume, en effet, n’est pas censée créer des règles dès lors qu’elle n’a pas d’auteur, mais est faite de normes acceptées par tous de façon immémoriale.
Les lois ou leges sont proposées par les consuls au vote des comices centuriates et s’appliquent à tous les citoyens, tandis que les plébiscites sont proposés au vote de l’assemblée de la plèbe (voire ultérieurement des comices tributes lorsque les plébéiens seront devenus majoritaires dans chaque tribu) par les tribuns de la plèbe et ne s’appliquent à l’origine qu’aux seuls plébéiens. Cependant la plus ancienne loi connue avec certitude (en dehors des XII Tables) est un plébiscite qui devait nécessairement s’appliquer aux uns et aux autres : c’est la lex Canuleia de 445 a.C., qui (vraisemblablement avec l’assentiment préalable du Sénat) satisfait une ancienne revendication de la plèbe, celle du droit à l’intermariage ou mariage entre patriciens et plébéiens, ces derniers acquérant ainsi le conubium ou droit aux iustae nuptiae ou droit de se marier en « justes noces », donc en noces conformes au droit. Il faut observer que toute loi et tout plébiscite sont intitulés lex et dénommés par les magistrats qui en ont proposé le vote aux comices centuriates (e.g. lex poetelia papiria : loi votée sur proposition des consuls Poetelius et Papirius, u. infra) ou à l’assemblée de la plèbe (e.g. lex canuleia ou lex aquilia : u. infra).
Les deux premières magistratures formellement distinguées de celle des consuls – en dehors de celle des questeurs (initialement nommés par les consuls, mais élus par les comices tributes à partir de la seconde moitié du 5e siècle) – consistent dans la dictature et la censure, toutes deux réservées à d’anciens consuls. Le dictateur est nommé par les consuls en charge, pour une durée maximale de six mois, en cas de crise extérieure grave : il s’agit dès lors avant tout d’un commandant suprême de l’armée (qui s’adjoint lui-même un magister equitum ou commandant de la cavalerie), même s’il a temporairement aussi les pleins pouvoirs en matières civile et judiciaire (e.g. Cincinnatus en 458 a.C.).
Les deux censeurs sont élus tous les cinq ans, pour une durée de dix-huit mois, par les comices centuriates et sont principalement en charge du contrôle des grands travaux publics, du recensement des citoyens (individus et patrimoines) et de l’établissement de l’album sénatorial : non seulement ils dressent la liste officielle des membres du Sénat, mais peuvent y adjoindre ou en omettre certains, après examen de leur probité et de leur respect des bonnes mœurs (possibilité d’exclusion pour indignité ou infamie). Cette fonction extrêmement prestigieuse, qui correspond donc aussi à un important pouvoir politique et extrajudiciaire (e.g. Caton le Censeur), subsistera jusqu’à ce qu’elle soit exercée puis abolie par l’empereur Domitien (qui a régné de 81 à 96 p.C.).
D.De la Loi des XII Tables au ius Flavianum
Les Romains continuent à étendre leur domaine territorial. Au 5e siècle a.C., ils conquièrent le Latium et soumettent une partie de l’Étrurie. En 390 a.C. toutefois, ils ne peuvent s’opposer à l’irruption des Gaulois commandés par un chef dénommé Brennus (nom qui signifie en fait « chef ») et Rome est prise et mise à sac.
Les tablettes affichant la loi des XII Tables ont été emportées avec le butin si elles étaient en ivoire ou en bronze, ou brûlées si elles étaient en bois. Les Gaulois toutefois ne s’établissent pas et remontent vers le nord de l’Italie (Gaule Cisalpine). Pendant huit cents ans, la ville ne sera plus occupée par un ennemi (jusqu’au sac par les Wisigoths du roi Alaric en 410 p.C.). Ce désastre militaire encourage les Romains à étendre leur suprématie sur les régions voisines et les cent vingt années suivantes sont consacrées à la conquête de l’Italie, de l’axe Pise-Rimini au nord jusqu’à Tarente au sud (prise en 272 a.C.).
En politique intérieure, les magistratures se spécialisent et sont progressivement ouvertes aux plébéiens. À cet égard, 367 a.C. marque un tournant : la lex Licinia Sextia accorde l’éligibilité au consulat ; deux préteurs, élus par les comices centuriates, sont investis de l’administration de la justice, en une compétence désormais spécifique et distincte de celle des consuls ; est créée également la fonction des édiles curules, au nombre de deux (patriciens), en charge de l’administration de la ville (voirie, organisation des jeux, police des marchés avec compétence judiciaire pour les litiges nés à l’occasion des actes qui y sont passés). À partir de 342 a.C., l’un des deux consuls doit obligatoirement être un plébéien.
Vers 312 a.C., le pouvoir de nommer les sénateurs passe des consuls aux censeurs : ce pouvoir est cependant devenu alors un devoir, dans la mesure où les censeurs doivent obligatoirement inscrire sur l’album sénatorial les anciens titulaires d’une fonction élective, donc les anciens magistrats, sauf sanction d’infamie. L’autorité du Sénat s’en trouve accrue, puisque tous ses membres ont été élus à au moins une magistrature et sont issus tant du patriciat que de la plèbe. L’égalité politique des patriciens et des plébéiens – sous réserve du privilège de continuer à élire les tribuns et les édiles de la plèbe – est atteinte en 287 a.C. avec l’adoption de la lex Hortensia qui assimile désormais les plébiscites (votés par les comices tributes) aux lois (votées par les comices centuriates).
Égalité politique ne signifie cependant pas encore égalité juridique. Si les plébéiens avaient certes obtenu la rédaction de la Loi des XII Tables et l’adoption ultérieure de lois écrites – ce qui en permettait une connaissance certaine – encore fallait-il être à même de pouvoir mettre en œuvre en cas de litige les droits ainsi connus. Or les textes de loi étaient particulièrement laconiques et la conclusion d’actes sur leur base restait soumise à un formalisme qui n’avait pas été divulgué : il fallait recourir à des formules précises, voire à des gestes rituels, dont l’interprétation avait été mise au point par le collège des pontifes, qui n’en avait fait aucune publication.
À défaut de respect des formes solennelles, l’acte voulu par les parties restait de nul effet, et il en allait de même si l’une d’elles intentait un procès : le préteur ne recevait pas son action (calquée sur les droits reconnus par la loi : il s’agit d’une legis actio ou action de la loi, i.e. fondée sur une norme incluse dans la Loi des XII Tables) et ne désignait donc pas de juge si elle n’avait pas employé les formules orales prescrites à peine de nullité (uerba certa). Au surplus, une action ne pouvait être soumise au préteur que lors d’un jour faste et non lors d’un jour néfaste, selon un calendrier fixé par les pontifes et mal connu, hormis des patriciens.
Ce n’est qu’en 304 a.C. que le scribe ou secrétaire d’Appius Claudius (patricien, qui, en qualité de censeur, en 312, dirigea la construction de la via Appia de Rome à Capoue, et comme consul participa aux guerres samnites), du nom de Cnaeus Flavius, publia le premier recueil (aujourd’hui perdu, en dehors des citations qui en ont été conservées) de formules orales des « actions de la loi », donc de modèles à suivre pour nouer valablement un procès : c’est le ius Flavianum. Flavius, élu édile curule en 304, publia aussi le calendrier judiciaire.
Cette initiative de divulgation fut approfondie, une génération plus tard, par Tiberius Coruncanius, le premier grand pontife d’origine plébéienne (en 300 a.C.), qui, outre qu’il fut consul, acquit une grande renommée par les consultations et les enseignements juridiques qu’il donnait en public. Ces deux jurisconsultes ont ébauché une nouvelle source du droit : la iurisprudentia ou expertise juridique portée à la connaissance du public (qui conduit à la notion actuelle de doctrine juridique). À ses origines, cette « jurisprudence » (au sens étymologique du mot, et non au sens contemporain d’ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux) n’est pas encore une source supplémentaire de création de nouvelles règles, par voie d’interprétation et de commentaire critique des normes existantes en vue d’en améliorer la pertinence, voire de les faire évoluer dans un but d’utilité sociale, mais elle a favorisé son futur épanouissement en extrayant le droit de la seule tradition ésotérique que se réservaient les pontifes.
E.Les grandes conquêtes et la fin de la période de l’ancien droit
La conquête du sud de l’Italie a confronté Rome aux deux autres grandes puissances politiques et militaires du pourtour méditerranéen au 3e siècle : d’une part, les royaumes hellénistiques issus du démantèlement de l’empire éphémère fondé par Alexandre le Grand, et, d’autre part, Carthage. Les cités de la Grande Grèce avaient vainement appelé au secours Pyrrhus, roi d’Epire, dont les éléphants avaient impressionné les Romains (qui n’en avaient jamais vu auparavant) sans toutefois les priver de la victoire finale après les premiers revers (cf. l’expression « victoires à la pyrrhus » qui désigne des succès sans lendemain et qui coûtent plus qu’ils ne rapportent…). Les anciennes colonies grecques de Sicile, devenues indépendantes, préférèrent se tourner vers Carthage, qui, de son côté, ne souhaitait pas voir s’accroître la puissance d’un état romain susceptible de porter ombrage à sa domination maritime et commerciale de la Méditerranée occidentale.
Les deux premières guerres puniques (Poeni = Carthaginois), respectivement de 264 à 241 et de 219 à 202 a.C., furent chaque fois longtemps indécises et très meurtrières. Rome n’y aurait sans doute pas survécu si la maturité de ses institutions républicaines et sa stabilité politique à l’issue de la longue rivalité entre patriciens et plébéiens ne lui avaient conféré un avantage décisif face à un exercice du pouvoir beaucoup plus personnalisé à la tête des armées de Carthage. Au cours de la première, Rome, dont les citoyens avaient plutôt, comme exploitants agricoles, une vocation « terrienne », dut développer sa marine pour soutenir une guerre principalement maritime contre Carthage qui, en la matière, avait déjà une expérience de plusieurs siècles. Pour soutenir l’effort de guerre et y faire contribuer les populations et cités italiennes soumises entre le 5e et le début du 3e siècle, Rome s’efforça aussi, avec succès, de transformer ses sujets en alliés. C’est ainsi qu’en 241, Rome put faire de la Sicile sa première province (gouvernée par un proconsul ou ancien consul désigné par le Sénat).
Affaiblie par la défaite de 241 et la guerre qu’elle dut aussitôt mener contre ses mercenaires impayés, Carthage ne put s’opposer à l’occupation romaine de la Sardaigne peu après, et, d’un même mouvement, de la Corse jusque-là encore dominée par des colonies d’origine étrusque. Le nord de l’Italie (Gaule cisalpine) fut soumis en 225, ce qui allait toutefois provoquer un ressentiment préjudiciable aux Romains au début de la deuxième guerre punique.
L’extension territoriale va de pair avec un accroissement des possibilités de libre circulation des ressortissants des populations et cités alliées ou soumises, et donc des échanges économiques entre Romains et pérégrins : un pérégrin12 est un individu libre qui n’a pas la citoyenneté romaine, mais peut valablement conclure un certain nombre d’actes juridiquement valables, sinon au regard du ius ciuile (droit ‘civil », donc, étymologiquement, propre aux citoyens), du moins au regard du ius gentium, formé d’un commun dénominateur de règles issues de cités étrangères et compatibles avec le droit romain. Ces échanges économiques entre particuliers peuvent générer des différends de droit privé qui, à partir de 242 a.C., feront l’objet d’une juridiction spécifique : celle du préteur pérégrin, compétent pour trancher les litiges entre pérégrins ou opposant un Romain à un pérégrin. Le second préteur, compétent pour les seuls litiges entre citoyens romains, est dès lors qualifié de préteur urbain.
Carthage commença à se relever de la première guerre punique en entreprenant la conquête d’une grande partie de l’Espagne, les Romains n’y voyant pas malice avant que les Carthaginois ne prennent la ville de Sagonte (en 219), alliée à Rome. Pour autant, ils restaient convaincus que Carthage n’entreprendrait pas de nouvelle guerre générale, à défaut d’avoir reconstitué sa marine. C’était sans compter sur l’audace stratégique d’Hannibal, qui entreprit d’envahir l’Italie par le nord, avec une armée terrestre : une telle épopée paraissait impossible au regard de la géographie, compte tenu de la difficulté matérielle de franchir les Alpes et du risque de multiplication de conflits avec les populations gauloises des territoires traversés.
Non seulement Hannibal franchit les Alpes, avec armes, bagages et éléphants, mais parvint à nouer des alliances avec des tribus gauloises et à compenser ainsi une partie des pertes humaines subies pendant le voyage. S’en suivent deux victoires carthaginoises en Gaule cisalpine (batailles du Tessin et de la Trébie fin 218 a.C.) et le désastre du Lac Trasimène le 21 juin 217.
À Rome s’ouvre alors un débat politique sur la stratégie à adopter et c’est à l’assemblée du peuple (et non, comme c’était la règle, aux consuls en fonction) qu’il revient d’élire dictateur le partisan d’une méthode de harcèlement et d’isolement d’Hannibal en évitant les confrontations directes : Fabius Maximus, surnommé Cunctator (« le temporisateur »), flanqué toutefois d’un maître de cavalerie tenant de la stratégie opposée, Marcus Minucius Rufus. La temporisation s’avère provisoirement pertinente, mais ne permet pas d’atteindre un résultat décisif à court terme.
Les consuls élus pour 216 sont partagés entre les deux options et les Romains victimes de la combinaison néfaste de ce débat avec le respect scrupuleux de la règle d’alternance quotidienne de commandement de chacun des consuls : le consul Terentius Varro, partisan de l’offensive, met à profit l’un de ses jours de commandement pour engager, le 2 août 216, la bataille de Cannes (Cannae en Apulie) qui tourne à la plus grande déroute militaire subie par les Romains avant notre ère.
Fabius Maximus est dès lors élu et réélu consul en 215 et 214, et peut enfin mettre sa stratégie en œuvre avec un appui politique suffisant : ne plus affronter Hannibal directement, mais porter l’offensive vers ses bases de ravitaillement, en Espagne et en Sicile (reconquise en 212), de sorte que l’armée carthaginoise (très peu soutenue par Carthage même) en soit réduite à vivre aux dépens des régions occupées en Italie et à se rendre ainsi impopulaire chez les alliés des Romains.
Après la reprise de Tarente (209) au cours d’un cinquième consulat de Fabius Maximus et la défaite d’une seconde armée carthaginoise (commandée par Hasdrubal, frère d’Hannibal) en 207, s’ouvre un nouveau débat au Sénat : d’abord achever la reconquête de l’Italie ou obliger indirectement les Carthaginois à la quitter en portant la guerre sur le sol africain (sachant le faible soutien politique et militaire dont y dispose Hannibal) ? Cette fois, Fabius Maximus est mis en minorité et Scipion (qui sera surnommé Africanus après la victoire finale), élu consul en 204, obtient le commandement qui le conduit à la victoire décisive de Zama en 202.
Il n’y a dès lors plus qu’une seule puissance concurrente de Rome pour le contrôle de la Méditerranée : celle des successeurs des diadoques (lieutenants d’Alexandre le Grand qui s’étaient partagé son empire en trois grandes zones d’influence : la dynastie des Lagides – les Ptolémées – en Égypte, la dynastie des Séleucides en Asie et celle des Antigonides en Macédoine).
Les Romains, heurtés par le traité d’alliance qu’avait conclu Hannibal avec Philippe V de Macédoine, prennent la défense des cités grecques révoltées contre ce dernier et font de la Macédoine un protectorat à partir de 197 a.C. En 196, ils proclament le rétablissement de l’autonomie des cités grecques (sous leur protection vis-à-vis de l’extérieur…). Le Séleucide Antiochos III veut intervenir à son tour en Grèce, mais est défait en 191 et, poursuivi par les Romains jusqu’en Syrie, doit se résoudre à conclure la paix d’Apamée. En 172, le roi Persée, fils de Philippe V, organise une révolte macédonienne, mais est vaincu à la bataille de Pydna en 168 a.C.
Une dernière révolte de la Macédoine, cette fois alliée à des cités grecques, aboutit à la destruction de Corinthe par les Romains en 146 : la Macédoine est réduite en province romaine, tandis que les cités grecques ne conservent plus qu’une autonomie municipale (la Grèce ne deviendra – cette fois pacifiquement – la province romaine d’Achaïe que sous le règne de l’empereur Auguste, à la fin du Ier siècle avant notre ère). En Afrique, l’intervention des Romains dans un conflit entre leurs alliés Numides et Carthage provoque en 149 a.C. la troisième guerre punique, qui s’achève par la destruction de Carthage en 146 et la création de la province d’Afrique proconsulaire.
Le vainqueur de Carthage, Scipion Émilien, achève en 133 la conquête de l’Espagne par la prise de la ville de Numance. La même année, le roi de Pergame Attale III, allié des Romains, leur lègue son royaume, qui devient la province d’Asie. Enfin, pour sécuriser ses voies de communication avec l’Espagne, Rome soumet en 125 la Gaule méridionale et en fait la province narbonnaise, achevant ainsi sa conquête du pourtour méditerranéen, à la seule exception de l’Égypte.
F.Procédure formulaire et émergence du droit classique
Le terme de cette période de conquêtes coïncide avec l’introduction d’une réforme de la procédure qui va permettre l’essor du droit privé et de ses deux sources les plus créatives : l’édit du préteur et la jurisprudence (au sens romain du mot).
Le ius Flavianum avait certes permis la diffusion des règles de la procédure orale des legis actiones ou actions de la loi, mais cette publicité n’avait nullement simplifié son formalisme rigoureux : tout au plus était-il devenu possible de s’en instruire autrement que par une consultation personnelle des pontifes, mais la nécessité d’observer les rites si précis en gestes et en paroles des « actions de la loi » rendait encore l’introduction de toute procédure fort aléatoire dès lors que la moindre erreur pouvait en entraîner la nullité pour vice de forme, de sorte que le préteur se refusait à désigner le juge auquel les parties entendaient soumettre leur litige.
Dans l’une des deux seules mentions de la Lex Aebutia dans nos sources, Gaius écrit13 : « Mais toutes ces actions de la loi furent peu à peu prises en aversion, car, en raison de la minutie excessive des anciens qui créèrent ces procédures, la situation en arriva à ce point que la moindre erreur entraînait la perte du procès. Aussi ces actions de la loi ont-elles été abrogées par la loi Aebutia et deux lois juliennes de sorte que nous procédions en termes appropriés, c’est-à-dire par formules. »
La réforme ne modifie pas le principe – alors déjà ancien et qui subsistera jusqu’à la fin du principat au IIIe siècle p.C. – du procès en deux phases : d’abord in iure devant le préteur qui reçoit les parties, puis apud iudicem devant le juge, un juré – citoyen choisi de commun accord par les parties sur une liste de jurés établie par le préteur : l’album iudicum, dont la composition variera selon l’époque (sénateurs, puis aussi des chevaliers, jusqu’à cinq mille personnes à partir de l’empereur Caligula) – qui les écoute et rend sa sentence. Ce qu’elle modifie profondément, c’est la mission du préteur lors de l’introduction de l’instance, à la phase in iure : au lieu de se borner à surveiller la stricte observance par les parties du formalisme de liaison du procès – litis contestatio – dont elles sont convenues et de délaisser la suite du procès au juge, il va désormais être chargé d’examiner la qualification juridique des prétentions du demandeur et des exceptions (au sens d’objections) du défendeur, afin de les exprimer en une formule écrite concise résumant en termes juridiques appropriés la question à trancher par le juge.14
Comme simple citoyen, ce dernier n’a en principe pas plus de formation juridique spécifique que les parties qu’il doit entendre et n’a pas nécessairement beaucoup d’expérience dans sa tâche puisqu’à chaque procès peut être désigné un autre juge : ce système repose sur l’idée que le droit civil est l’affaire de tous les citoyens et doit pouvoir être connu et respecté par tous, chaque citoyen se devant d’être à même – en qualité donc de juré – de décider si la prétention à un droit par l’un de ses concitoyens est fondée ou non. Cela étant, le juge ne pouvait se voir soumettre que les demandes telles que le demandeur les avait exprimées et, dût-il avoir un meilleur entendement juridique que ce dernier, n’avait nullement le droit de les rectifier ou de les compléter en cas d’erreur de droit, ni de suggérer un quelconque moyen de défense qui aurait échappé au demandeur : le plus strict respect du formalisme n’allait pas nécessairement de pair avec une connaissance adéquate du fond du droit à mettre en œuvre.
Dans la procédure dite formulaire





























