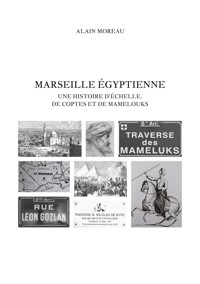
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
D’août à octobre 1801, plusieurs navires en provenance d’Alexandrie vont se succéder dans les ports de Marseille et de Toulon. À bord sont rapatriés des militaires de l’armée d’Orient qui, après une occupation de l’Égypte commencée en juillet 1798, vient de subir une défaite écrasante face aux Anglais et aux Turcs. À la mi-septembre, une frégate anglaise, La Pallas, débarque au Lazaret de Marseille 310 passagers, dont 80 Français. Les autres sont des Égyptiens. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, tous vêtus à l’orientale et parlant arabe. Parmi eux, nombre de Coptes et de Mamelouks. On extrait aussi de la cale un grand tonneau d’eau de vie où est conservé le corps d’un personnage important nommé Jacob Hanna... C’est à lui et à ceux et celles que l’on nommera bientôt « les réfugiés égyptiens » que ce livre est consacré. Il évoque à la fois leur vie à l’époque où l’Échelle du Caire, avec sa petite communauté française et son consul, faisait prospérer le commerce au profit de Marseille, puis, sous l’occupation de l’Égypte, leur collaboration avec Bonaparte et l’armée d’Orient. Après leur débarquement, il décrit comment ils se sont établis et ont vécu dans la cité phocéenne, qu’ils soient riches et prospères ou pauvres et démunis. Il s’étend enfin sur un épisode dramatique, quasi-absent aujourd’hui de la mémoire collective marseillaise, et dont ils furent les principales victimes. À Marseille, après la défaite de Bonaparte à Waterloo, qui sonna l’écroulement définitif de l’Empire, les journées des 25, 26 et 27 juin 1815 donnèrent lieu à une violente insurrection populaire qui entraîna un massacre politico-racial, dont le bilan sera évalué à 250 morts et blessés. Nombre de réfugiés égyptiens, femmes et hommes, souvent les plus noirs de peau, et demeurant dans la Ville vieille ou dans le camp du cours Gouffé, seront alors les martyrs de cette Terreur blanche et de la répression politique sous la seconde Restauration.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
L’Emprise du social (avec Ursula Menzemer) Éds
OFAJ, Armand Colin, 1985
Plus marseillais que moi, tu meurs !
Migrations, identités et territoires à Marseille
(avec Jocelyne Cesari, Alexandra Schleyer-Lindenmann)
L’Harmattan, 2001
Migration et racisme (avec Reiner Diederich, Gerhard Löhlein,
Antonio Mussimo, Élena Spinelli) Éds
Università La Sapienza Roma, 2003
Table des matières
Prologue
La France et l’Empire ottoman en Méditerranée
À propos des Capitulations
Les Échelles du Levant et de la Barbarie
Les consulats de France en Méditerranée
Le personnel consulaire : chanceliers et drogmans
L’Échelle d’Égypte et le commerce aux XVIIe et XVIIIe siècles
Le Caire et ses voies commerciales
Le consulat français dans l’Échelle d’Égypte
Composantes et évolution du pouvoir politique en Égypte sous l’Empire ottoman
L’organisation du pouvoir et le système des Mamelouks
L’évolution du pouvoir politique au cours des XVII
e
et XVIII
e
siècles
L’Échelle d’Égypte dans la tourmente du despotisme et de l’anarchie
La question de la conquête de l’Égypte
Aux origines de l’expédition
Les prémisses de l’expédition
Les premiers temps de l’expédition d’Égypte
Le départ pour l’Égypte et la prise de Malte
Le débarquement à Alexandrie et la prise du Caire
De la bataille navale d’Aboukir à la pacification du Grand Delta
Du manifeste de guerre de la Turquie à la première révolte du Caire
Le manifeste de guerre de la Turquie contre la France
Description du Caire vers la fin du XVIII
e
siècle
La première révolte du Caire
La pacification de la Haute-Égypte par le général Desaix
Desaix et Mu‘allim Ya‘qoub à la poursuite de Mourad bey
La vie passée de Mu‘allim Ya‘qoub
La campagne de Bonaparte en Syrie
De la prise d’El-Arich au massacre de Jaffa
Le contrôle de la Galilée et le siège infructueux de Saint-Jean d’Acre
Kléber commandant en chef de l’armée d’Orient
Le départ de Bonaparte et la promotion du général Kléber
De la prise de commandement du général Kléber à la convention d’El-Arich
Le contenu de la convention d’El-Arich
De la bataille d’Héliopolis à la mort du général Kléber
La mise en œuvre de la convention d’El-Arich
La seconde révolte du Caire
La création de troupes orientales
La mort de Kléber
L’avènement de Menou comme commandant en chef de l’armée
Une succession contestée
Menou administrateur
L’intervention des Anglais en Égypte
La volonté des Anglais de régler par eux-mêmes la question égyptienne
Le débarquement de l’armée anglaise sur la côte égyptienne
La fin de l’occupation française en Égypte
La capitulation du Caire et d’Alexandrie
Le départ des Français et de leurs alliés
L’embarquement de Ya’qoub Hanna et des Égyptiens pour Marseille
L’arrivée à Marseille
La mise en quarantaine et l’enterrement de Mu’allim Ya’qoub
L’accueil des réfugiés égyptiens à Marseille
Les nouveaux corps militaires destinés aux réfugiés égyptiens
La création de l’escadron des Mamelouks
La création du bataillon des Chasseurs d’Orient
Le devenir des civils réfugiés
Le cas des plus fortunés
Le cas des réfugiés démunis
La situation des réfugiés égyptiens à Marseille au début du XIXe siècle
Effectif et localisation spatiale
Habitat et mode de vie des réfugiés égyptiens les plus démunis
Un rendez-vous manqué : le projet d’indépendance de l’ Égypte de Ya’qoub Hanna
Théodore Lascaris, le chevalier de Malte faiseur de projets
Le projet d’indépendance de l’Égypte de Ya’qoub Hanna
Les démarches de la légation égyptienne auprès des autorités françaises
Les réfugiés égyptiens sous le Consulat
Le préfet Charles Delacroix et l’administration de Marseille (1800-1803
)
Les réfugiés égyptiens sous le mandat de Charles Delacroix : une communauté peu visible
Le devenir des réfugiés égyptiens sous le début de l’Empire
Les premiers temps de l’administration d’Antoine-Clair Thibaudeau, nouveau préfet des Bouches-du-Rhône
L’augmentation de la visibilité sociale des réfugiés égyptiens de basse condition
Surveillance et contrôle des minorités réfugiées
Une menace croissante pour l’ordre public : mamelouks, juifs algériens, ‘négresses’ égyptiennes…
Inquiétude et réactions de l’élite des réfugiés égyptiens à l’égard des mauvais sujets de leur communauté
Création du lycée impérial de Marseille et mise en place d’un cours de langue arabe vulgaire
La création du lycée impérial de Marseille
La mise en place d’un cours d’arabe vulgaire
Vers la chute du premier Empire
La brève embellie du port de Marseille et le retour des années sombres
Le blocus des côtes provençales : harcèlement et inquiétude des populations du littoral
La tentation de Paris : le cas des notables égyptiens
Les attraits de la capitale
L’installation à Paris de deux notables de la communauté égyptienne : Michel Abd el-Al et Georges Aïdé
La tentation de Paris : le cas des intellectuels
Gabriel Joubran (Mehenna Tadi ou Tady) ou l’adoption d’une identité parisienne
Ellious Bocthor, l’intellectuel autodidacte
Joseph Agoub, le poète orientaliste
De la fin du premier Empire à la première Restauration
Les derniers jours du premier Empire à Marseille
L’installation de Louis XVIII et la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814
La première Restauration
Organisation et politique du gouvernement sous Louis XVIII
Marseille sous la première Restauration
De l’île d’Elbe aux Cent-Jours
La marche de Napoléon sur Paris et l’effondrement de la monarchie
Le rétablissement du pouvoir impérial à Marseille (mars-avril 1815
)
Marseille occupée mais non soumise
Vers la seconde abdication de Napoléon
Napoléon face à la septième coalition des puissances européennes
Troubles et désordres à Marseille dans la journée et la nuit du 25 juin
La Terreur blanche à Marseille
La chasse aux bonapartistes
Chasse et massacre des Mamelouks
Après la fin des tueries et des pillages, le temps du bilan
Le devenir des réfugiés égyptiens après 1815
La répression des Mamelouks et des réfugiés les plus démunis
La religion comme facteur d’intégration de l’élite des réfugiés égyptiens après 1815
Conclusion
Bibliographie
Remerciements
Prologue
Mi-septembre 1801, un navire se présente dans la rade de Marseille. Vu de ce promontoire, à l’entrée du port, il est encore trop loin pour qu’on parvienne à l’identifier. Il se rapproche, il a fière allure, c’est un trois-mâts, mais impossible de deviner son pavillon, il faut attendre encore. Comme il doit louvoyer, le voilà qui vire sur bâbord, aucun doute, c’est bien un navire anglais ! Il poursuit sa route pour piquer vers l’anse du Lazaret. Il va prendre la quarantaine, on n’est pas prêt de voir ses passagers dans la ville. Le bâtiment est une frégate, La Pallas. Son commandant se nomme Joseph Edmonds. Il est parti de la baie d’Aboukir, le 10 août, et ramène d’Égypte 310 passagers, dont seulement 80 Français. Dans le livre de contrôle il est écrit que les autres sont Coptes. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, tous vêtus à l’orientale, ils parlent arabe, certains sont des Noirs. Quand on débarque de la cale un énorme tonneau d’eau de vie, chacun paraît particulièrement affligé, les femmes se lamentent. Dedans il y a le corps d’un homme. Tout mort qu’il est, lui aussi devra faire la quarantaine. Il n’est d’ailleurs pas le seul, on a déjà débarqué au Lazaret un cercueil en plomb qui renfermait un autre corps, celui du général Kléber, assassiné en Égypte par un fanatique. Le mort, qui repose dans le tonneau, s’appelait Jacob Hanna, un général, il était leur chef. Il est décédé pendant le voyage et sa veuve a insisté auprès du commandant pour que sa dépouille ne soit pas jetée à la mer, comme il est de coutume. Elle tient à l’enterrer à Marseille avec tous les honneurs qui lui sont dus. Mais qui est-il ? Il doit être important car le capitaine Edmonds a donné son accord. Lors des premières journées du voyage, ce dernier a eu de nombreux échanges avec Jacob, il a pu apprécier les propos de cet homme intelligent et réfléchi qui avait un grand projet. Ce projet, il va falloir qu’il en informe l’amirauté…
Jacob avait une ordonnance, un certain Théodore Lascaris, un aventurier un peu bizarre, souvent exalté. Il faisait partie de l’Ordre des Chevaliers de Malte. C’est lui qui assurait la traduction des échanges entre Jacob et Edmonds. Quelques jours plus tard, il établira la liste des passagers de La Pallas originaires d’Égypte. Il n’en mentionnera que 128. Pour quelle raison ? On ne sait pas. La liste en question est conservée aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Pour chaque famille embarquée, elle mentionne le nom des hommes, le prénom des femmes et des enfants, le nombre de domestiques. Parmi ces derniers, il y aurait d’anciens esclaves… Dans la liste est mentionné deux fois le nom de Sakakini. Nicola Sakakini et Gobran Sakakini, peut-être des frères. Il existe un boulevard Sakakini à Marseille, tout le monde le connaît. Quel rapport avec ces deux hommes ? avec l’Égypte ? Voilà qui est intrigant.
En cette période, plusieurs navires, comme La Pallas, vont se succéder, tant à Marseille qu’à Toulon. À leur bord, sont rapatriés, pour l’essentiel, des militaires de l’armée d’Orient qui vient de subir, en Égypte, une défaite contre les Anglais. Mais aussi de nombreux étrangers. Qui étaient ceux que l’on désignera longtemps comme les « réfugiés égyptiens » ? Quel hasard les avait conduits à Marseille ? que venaient-ils y faire ? étaient-ils seulement de passage ? allaient-ils s’y établir ? Et, en Égypte, comment vivaient-ils dans cette colonie de l’Empire ottoman ? Ce sont à toutes ces questions et à bien d’autres que ce livre tentera de répondre, en remontant loin dans le passé…
Lazaret de Marseille (France Maritime, 1852)
1. La France et l’Empire ottoman en Méditerranée
Pour comprendre les circonstances dans lesquelles ces hommes et ces femmes ont pu un jour quitter l’Égypte pour Marseille, il est nécessaire de remonter dans l’histoire pour approfondir les rapports que la France a entretenus avec ce pays, alors colonie de la Sublime Porte. Il faut évoquer le cadre géographique général dans lesquels ces rapports se sont inscrits, à savoir la mer Méditerranée avec ses côtes lointaines, dites du Levant, et celles plus proches, dites de la Barbarie. Il faut également rappeler le rôle déterminant qu’ont joué à cet égard la ville de Marseille et son port d’où partirent des hommes audacieux qui ont créé des voies maritimes et établi de nouveaux comptoirs marchands.
1. À propos des Capitulations
S’il est vrai que la
présence de Marseille dans les pays du Proche-Orient remonte aux croisades, c’est au XVIe siècle, qu’en matière de développement du commerce dans l’ensemble de la Méditerranée, se produit une accélération décisive que l’on a longtemps associée aux Capitulations de 1536 – ou de 1535, selon le calendrier utilisé. Ces Capitulations constituent un acte conventionnel, grâce auquel François 1er se voit accorder par Soliman le Magnifique, Sultan de l’Empire ottoman, des droits particuliers qui vont favoriser les intérêts français. Ainsi, dans le catalogue édité à l’occasion des grandes expositions qui se sont tenues à Marseille en 1982-1983, sous le thème L’Orient des Provençaux dans l’histoire, il est souvent question de ces fameuses Capitulations de 1536, dont on souligne leur grande importance pour le développement des activités commerciales du port de Marseille en Méditerranée. Toutefois, de nos jours, il existe chez les historiens un consensus pour affirmer que les Capitulations en question n’ont vraisemblablement jamais existé. C’est d’ailleurs dès 1955, et à la suite de l’historien roumain Nicolas Iorga, spécialiste de l’histoire ottomane, que Gaston Zeller, professeur à la Sorbonne, dans un article intitulé Une légende qui a la vie dure : les capitulations de 1535, présente une suite d’arguments convaincants qui rendent peu probables leur existence. Nous en retiendrons deux. En premier lieu, personne, à quelque époque que ce soit, n’a pu voir de ses propres yeux l’acte authentique en question, dûment signé par les deux parties. Aussi convainquant encore, au cours des siècles qui ont suivi la date présumée des Capitulations, aucune mention ne les signale et nul n’en a entendu parler. Et lorsqu’elles sont un jour évoquées, ce n’est qu’en 1777, à propos d’un manuscrit retrouvé dans les papiers de l’ambassadeur de l’époque, Jean de la Forest, document qui n’a rien d’officiel et qui semble constituer un simple projet de traité n’ayant pas abouti. Bref, les célèbres et fameuses Capitulations de 1536 paraissent devoir être rangées aux oubliettes. Est-ce que cela signifie pour autant que des accords assurant des privilèges en pays ottoman aux sujets chrétiens français n’ont jamais été passés ? Certainement pas. Les successeurs de François 1er et de Soliman le Magnifique vont bien signer régulièrement des accords qui conforteront et renouvelleront des avantages qui, dans toute la Méditerranée, les favoriseront en matière de liberté de navigation et d’implantation de comptoirs propices aux activités commerciales et aux échanges, tant sur les côtes du Levant que sur celles de la Barbarie. Ainsi, il n’existe aucun doute quant à la réalité des Capitulations de 1569 – 18 articles au total – signées par Selim II, accordant aux commerçants français des avantages particuliers dans l’ensemble de l’Empire ottoman. Les 27 articles des Capitulations de 1581 sont également incontestables. Et, au bout du compte, dans le dernier quart du XVIe siècle, grâce aux privilèges concédés, on observe bien une montée en puissance des activités commerciales des négociants marseillais avec l’ouverture de nombreux consulats français dans différentes Échelles et notamment, pour ce qui nous intéresse, en Égypte.
On peut résumer schématiquement en quoi consistaient ces privilèges acquis par les Français dans tous les traités que la Porte signera à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. D’abord, ceux de naviguer et de commercer librement, ce qui constitue l’essentiel pour mener à bien le négoce. Par ailleurs, en cas de conflits entre sujets français sur le sol ottoman, le consul de France avait autorité pour les régler et les juger lui-même. Il avait également compétence pour régler les successions. Enfin, les Français pouvaient pratiquer librement leur religion. Dans le cas particulier de l’Échelle du Caire – et d’Alexandrie –, dès 1683, la Porte réduit les droits de douane de 20 à 3% pour les seuls négociants français. Albert Vandal (1889) précise encore que le diwan se laisse arracher une série de concessions en faveur de nos marchands du Caire et d’Alexandrie pendant les années 1686 et 1687. D’où les progrès qui vont suivre de notre marine marchande en Égypte : Alexandrie et Rosette, qui, en 1688, ne voyaient annuellement que vingt-quatre des navires français, en attirent jusqu’à cent-quinze en 1725.
2. Les Échelles du Levant et de la Barbarie
À cette étape, il devient nécessaire d’étudier plus en détail le statut des Échelles, leur administration, la fonction des consuls, et la place qu’a pu occuper la Chambre de commerce de Marseille dans ce dispositif, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
D’abord qu’entend-on et que désigne-t-on par Échelle ? Le grand Larousse du XXe siècle nous explique que cette appellation ne s’applique qu’aux ports marchands de la Méditerranée soumis à la domination turque. Il précise ensuite que l’on parle d’Échelles du Levant ou de la Barbarie pour désigner « les jetées bâties sur pilotis, avec des marches, pour débarquer les marchandises et, par extensions, les ports ». Au-delà de cette définition, il est bon de rappeler qu’un moyen rudimentaire et spontané de débarquement de marchandises ou de personnes, en cas d’absence d’infrastructures adaptées, a généralement consisté en l’utilisation d’une simple échelle servant d’interface entre le navire et le lieu de débarquement. Il était d’ailleurs coutumier, dans le langage marin de la Méditerranée, de dire « faire échelle » ou « faire escale », quand on relâchait dans un port, en vue de charger ou de décharger des marchandises. C’est d’ailleurs ce que nous confirme le Littré dans son édition de 1877. Il énonce qu’en termes de marine, l’échelle désigne « le lieu où un bateau pousse à terre une échelle ou une planche pour y opérer le débarquement de ses passagers ou de ses marchandises ».
Cette dernière définition nous précise bien l’origine première du mot, mais nous apprend encore que c’est le lieu qui compte ici, plutôt que le moyen d’y débarquer, et on ressent la nécessité de se demander comment et sur quels critères l’on a pu passer de la simple échelle servant au débarquement primitif en un point de la côte méditerranéenne, à la grande Échelle établie et reconnue comme comptoir marchand, celle que l’on désigne avec un E majuscule. Dans le catalogue de L’Orient des Provençaux dans l’histoire (OdP, 1982), il est précisé qu’il faut deux conditions pour qu’une place soit reconnue comme Échelle. Elle doit conjointement être un centre commercial important et disposer de bonnes relations maritimes avec la France. C’est ainsi qu’une Échelle renommée, comme Constantinople, se présente à la fois comme un grand port et un vaste marché. En Égypte, la situation apparaît plus singulière car objectivement plus complexe. Si Alexandrie dispose bien d’un port sur la Méditerranée, c’est plutôt le Caire qui constitue le vaste entrepôt de tout ce qui est produit dans la vallée du Nil et des marchandises qui proviennent de l’extérieur. C’est donc là que se faisait l’essentiel des affaires. Rosette est, quant à elle, placée au bout d’un axe permettant aux produits du Delta de parvenir à la mer, et avec l’avantage que la branche du Nil, qui la relie au Caire, est assez commodément navigable. On peut encore mentionner qu’il était aussi possible, mais plus marginalement, de débarquer des marchandises à Damiette. Finalement, comme le souligne Mireille Linari (OdP, 1982, p.173), la vie économique du commerce égyptien demeurait concentrée au Caire, dont Alexandrie et Rosette n’étaient que des avant-ports.
Bouches du Nil par Charle, géographe, Paris : Maison Basset (1848)
C’est certainement Robert Paris qui, dans le tome 5 de l’Histoire du commerce de Marseille (1957), fournit une définition des Échelles intégrant tous les cas de figure ayant existé :
« Elles sont les places maritimes fréquentées par les bâtiments de commerce des puissances chrétiennes, où résidaient en permanence des négociants européens » et, par extension, « les ports où vivait une petite colonie de marchands, artisans et fonctionnaires formant une nation française, ainsi que les places commerciales non maritimes où résidait une collectivité analogue, comme Le Caire, Alep, Ispahan /… / en rapport étroit avec un ou deux ports, débouchés d’un marché continental plus important économiquement ou politiquement ».
Il faut encore ajouter que, sur la base de critères géographiques, on distinguait les Échelles du Levant – implantées loin de la France dans les régions de la Méditerranée orientale –, de celles de Barbarie, plus proches, tels que les ports du Royaume du Maroc, Alger, Tunis et Tripoli (de Libye).
Ces éléments posés, il reste à s’interroger sur la manière dont une Échelle et sa nation pouvaient être gérées et contrôlées administrativement, et comment cette administration a pu évoluer avec le temps… On découvrira qu’à cet égard, il y eut un avant et un après Jean-Baptiste Colbert, auquel s’ajoutera la période cahotante et troublée due à la Révolution française. Au XVIIe siècle, alors que les Échelles se mettent peu à peu en place, on peut considérer que la Chambre de commerce de Marseille constituait initialement l’unique organe de pouvoir à leur égard, même si Henri IV, dès 1599, avait poussé localement à la constitution du Bureau du commerce de Marseille, lequel était chargé de veiller au développement du commerce en Méditerranée. Le Conseil de la ville avait ainsi installé, en 1600, « quatre surveillants sur le fait du négoce » qui étaient des hommes d’affaires « apparents, dignes, suffisants et solvables » auxquels furent adjoints un trésorier et un contrôleur, tous élus par la communauté (Patrick Boulanger, OdP, 1982, p.153). Leur but : prendre garde aux affaires qui pourront concerner le négoce, commerce et trafic. Cet organisme anticipait ce que sera la future Chambre de commerce de Marseille – la première de France – créée en 1650. Institution autonome, elle sera chargée de désigner un consul pour chaque Échelle du Levant et de la Barbarie. À l’origine, ces consuls, marchands de leur état, étaient fermiers de leur consulat et se consacraient à la perception des taxes, dont ils avaient la concession.
À ce propos, il faut rappeler que la cité phocéenne avait une vieille expérience en la matière, puisqu’à l’image de certaines villes italiennes comme Pise ou Gênes, elle avait créé, dès le XIIIe siècle, ses premiers consulats afin de protéger ses marchands (Anne Mézin, 1997). Par la suite, sous le règne de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert décidera de mettre de l’ordre dans un domaine qui relève, à l’évidence, du commerce extérieur mais aussi de la politique extérieure. À cette fin, il centralisera l’administration des Échelles à Versailles. Pour autant, le rôle de la Chambre de commerce de Marseille restera important, même si les grandes décisions vont désormais dépendre du pouvoir central, qui nomme l’ambassadeur du roi à Constantinople et les consuls exerçant dans les différentes Échelles. Plus précisément, c’est le ministre-secrétaire d’État à la Marine qui, en tant que responsable du commerce extérieur, contrôle désormais celui de la Méditerranée. Il est donc investi de l’autorité suprême sur les Échelles du Levant et de la Barbarie et demeure en relation constante avec l’ambassadeur de Constantinople à qui il transmet ses consignes et avec lequel il correspond régulièrement (André Conquet, 1982).
3. Les consulats de France en Méditerranée
Concernant l’appareil consulaire, chaque Échelle est organisée et régie selon un règlement analogue. Le consul fermier, supprimé bientôt par Jean-Baptiste Colbert, n’est plus, du moins à terme. Le consul nouveau est un fonctionnaire royal, responsable de son administration devant le ministre-secrétaire d’État à la Marine et l’ambassadeur du Roi installé à Constantinople, auprès de la Porte. Dans son ouvrage très documenté, Mézin (1997) détaille le changement profond qui, suite à la volonté de Jean-Baptiste Colbert, affecte le statut de consul. L’article premier, titre IX, livre premier de l’ordonnance de la marine du mois d’août 1681, fait des consuls des officiers nommés par le Roi, fonctionnaires royaux au service des intérêts de la nation en matière de commerce. Et il leur supprime en droit tout caractère de possession individuelle. Dix ans plus tard, l’arrêt du Conseil du 31 juillet reprend l’ordonnance de 1681 en attribuant au Roi seul le droit de nommer les consuls et confirme également l’interdiction de commerce direct et indirect en la sanctionnant par « une privation de l’emploi et trois mille livres d’amende ». Cette interdiction sera étendue, en 1694, aux chanceliers des consulats du Levant et de la Barbarie. Elle est justifiée par la mise en place d’une rémunération du personnel consulaire breveté par le Roi, dont l’état « est une monarchie dont le commerce n’est pas la base ». Au-delà de ce principe de fond, il s’agit aussi, en ce qui concerne en particulier les consuls, de leur éviter tout conflit d’intérêt – comme nous dirions aujourd’hui – qui pourrait surgir dans l’exercice de leur fonction de magistrat, dès lors qu’ils seraient également négociants. Pour autant, comme le précise Mézin, il s’avère que de nombreux consuls sont d’anciens négociants et qu’ils ont été choisis précisément en raison de leurs compétences en matière de commerce. Rien de surprenant que ce constat : devenu agent du roi, le consul est désormais une sorte de fonctionnaire du gouvernement appelé à défendre partout les intérêts politiques et commerciaux de la France. Puisque voilà les consuls désormais fonctionnaires, il se doit qu’ils perçoivent des traitements. La Chambre de commerce de Marseille, bien qu’elle ait perdu, en 1691, le droit de les nommer et de leur donner des ordres, se voit placée dans l’obligation de les rémunérer. Elle entretient à ses frais toutes les Échelles du Levant et de la Barbarie au moyen d’un droit de tonnelage établi à son profit sur tous les bâtiments qui commercent en Méditerranée, le taux de ce droit variant d’ailleurs selon les Échelles. Ainsi, jusqu’à la Révolution, la Chambre de commerce assurera le financement des traitements et des dépenses de l’institution consulaire dans les Échelles.
Les appointements annuels des consuls variaient selon l’importance de celles-ci et, de ce point de vue, le consul d’Égypte, établi au Caire, était l’un des mieux lotis. Un état détaillé des dépenses de l’Échelle du Caire, en date du 27 janvier 1694, est rapporté par Paul Masson (1896) : sur une somme globale de 24 800 Livres, 4 000 L. sont allouées aux appointements du consul ; 6 600 L. à ses frais de table – nourriture de l’aumônier, chancelier, drogman (traducteur), domestiques, – et habits consulaires ; 900 L. pour les frais et présents qu’il doit faire en prenant possession du consulat ; 6 300 L. pour le loyer de sa maison – appointements du chancelier, drogman et autres dépenses extraordinaires ; 7 000 L. pour les pareils appointements, table et autre dépenses du vice-consul d’Alexandrie. Comme on le voit, les fonds alloués aux consuls par la Chambre de commerce ne comportaient pas seulement leurs appointements, mais également des sommes forfaitaires pour d’autres frais. Par la suite, à partir de 1720, les appointements stricto sensu du consul français au Caire passeront à 9 500 Livres pour atteindre 16 000 Livres en 1780 (Mézin, 1997).
La Chambre de commerce de Marseille avait encore d’autres responsabilités. Deux ans après le décès de son père en 1683, le fils de Jean-Baptiste Colbert, qui lui avait succédé comme Secrétaire d’État à la Marine, poursuivit la réforme des consulats et de l’administration des Échelles qui se mettait lentement en place et restait encore bien incomplète. Il est en particulier à l’origine d’une ordonnance de Louis XIV – en date du 21 octobre 1685 – qui charge l’assemblée consulaire marseillaise du contrôle des résidents dans les Échelles. Jusque-là, toutes sortes d’aventuriers pouvaient rejoindre celles-ci. Souvent sans ressources, parfois de peu de considération, espérant faire fortune à bon compte, ils pouvaient constituer une source d’ennuis et de menaces pour la petite nation française composée des marchands, artisans et fonctionnaires rassemblés autour d’un consulat dans un comptoir-marchand établi en pays ottoman. Sauf à être titulaires d’un passeport contresigné par le secrétaire d’État à la marine, l’Ordonnance d’octobre 1685 oblige les Français, voulant s’établir dans les Échelles, à posséder un certificat de résidence, d’une durée fixée à dix ans, en principe non renouvelable – sauf après un intervalle de cinq ans – délivré par la Chambre de commerce de Marseille. Celle-ci, de droit et de fait, était donc chargée d’assurer le contrôle des résidents des Échelles et de surveiller leurs mœurs tant commerciales que privées. Dans le cas où ils étaient négociants, les Français, en sus de l’autorisation de résidence, devaient fournir un cautionnement. Boulanger (OdP, 1982, p.187) rapporte qu’il s’agissait d’éviter que le paiement des avanies – impositions infligées par les autorités turques à un individu ou une maison –, ne s’abattit sur l’ensemble de la communauté des résidents français. Les cautions, qui étaient de l’ordre de 60 000 Livres, n’étaient toutefois pas réellement versées, ne devant servir qu’en dernier recours, ce qui explique que la Chambre était attentive à n’accepter que l’engagement de négociants solvables. Masson (1911) signale que plus tard, en 1754, le Bureau du commerce approuvera le rapport de l’intendant de Montaran qui demandait que les deux tiers au moins des cautionnements fussent effectivement versés. Notons enfin qu’en ce qui concerne les négociants autorisés à résider dans chaque Échelle, la Chambre de commerce en maintenait le nombre au strict nécessaire pour expédier les affaires des maisons de Marseille. On peut le confirmer, dans le cas de l’Échelle d’Égypte, à partir d’un état conservé aux archives des Affaires étrangères – rapporté par François Charles-Roux (1910) – qui, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, estime à seulement dix-sept le nombre de négociants, soit onze établis au Caire, quatre à Alexandrie et deux à Rosette.
Quelles étaient les professions qui, le plus souvent, composaient les petites communautés françaises établies dans les Échelles ? En général, elles regroupaient le personnel consulaire – consul, vice-consul, chancelier, drogmans –, les négociants, leurs commis, les artisans et, parfois les familles de tous ces Français, si elles avaient l’autorisation d’installation. S’y ajoutaient souvent un chirurgien et éventuellement les curés, chapelains, missionnaires et religieux sous la protection de la France, ainsi que des étrangers, sujets du Grand Seigneur, mais employés pour l’utilité de la nation. On peut également y inclure les capitaines des bâtiments marchands et leurs équipages.
Sur la base d’une composition de cet ordre, Mézin évalue la communauté des Français de l’Échelle d’Égypte à 88 personnes en 1764 et à 39 personnes seulement en 1782, après le transfert du consulat du Caire à Alexandrie. De son côté, Charles-Roux (1910), à partir d’un état incluant seulement le personnel consulaire, les négociants, les commis et les artisans, dénombre 51 personnes pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais sans précision de date. Il reste à observer qu’une communauté de sujets français implantés dans une Échelle n’était pas nécessairement établie en nation organisée avec une assemblée. Les nations organisées n’existaient que dans des communautés suffisamment importantes, comme c’était le cas au Caire. Mézin précise que dans les Échelles du Levant et de la Barbarie, qui étaient seulement de caractère commercial, la nation disposait d’une assemblée composée de tous les marchands, capitaines et patrons français présents sur les lieux, et placée sous l’autorité du consul. En étaient exclus les artisans établis sur place, ainsi que les matelots. La nation élisait en son sein un ou deux députés – pour un mandat de deux ans –, qui la représentaient auprès du consul. Réunie en assemblée par celui-ci, elle était chargée des affaires générales du commerce de l’Échelle.
4. Le personnel consulaire : chanceliers et drogmans
Si les députés se comportaient en assesseurs pour le consul, celui-ci, pour mener à bien son travail, avait à sa disposition un certain nombre de collaborateurs, dont le plus important était le chancelier. Ce dernier était, tout à la fois, greffier, notaire, huissier et archiviste. Jörg Ulbert (2016) nous apprend qu’il pouvait même servir de ‘caissier de dépôt’ car, dès le courant du XVIIe siècle, les voyageurs français avaient pris l’habitude d’utiliser le consulat pour déposer argent, marchandises ou effets personnels. Les marchands en feront de même concernant les liquidités nécessaires au commerce. Le consul s’appuyait aussi sur un drogman qui lui servait d’interprète et de traducteur. Sous Louis XVI, ce sont les drogmans qui occuperont la place des chanceliers, dès lors que ceux-ci seront supprimés, d’abord dans le Levant en 1776, puis en Barbarie, trois années plus tard.
L’histoire de l’évolution du statut des drogmans en pays ottoman est tout à fait particulière et mérite d’être examinée plus en détail. Que ce soit dans les Échelles, concernant les consuls et les marchands, ou à Constantinople, pour l’ambassadeur de France placé auprès de la Porte, il y avait nécessité de disposer d’interprètes comprenant la langue française et parlant, selon les lieux et les situations, l’arabe ou le turc, parfois les deux. Initialement, les intermédiaires traducteurs, auxquels on faisait appel localement, étaient sujets du Grand Seigneur mais non musulmans. Il s’agissait principalement de Grecs pour nombre d’entre eux, mais aussi d’Arméniens ou de levantins, parfois de juifs, comme en Égypte, on le verra plus loin (Boulanger, OdF, 1982, p. 205 ; Henri Dehérain, 1922). Très rares étant les consuls ou les marchands possédant suffisamment l’arabe ou le turc, l’utilisation de leurs services s’imposait quotidiennement et soulevait plusieurs problèmes. D’abord beaucoup avaient peu d’instruction et souvent des compétences linguistiques trop limitées. Leurs erreurs d’interprétation dans un sens ou dans l’autre, comme leurs maladresses, pouvaient faire échouer une négociation, qu’elle soit à caractère commercial ou diplomatique. Par ailleurs, n’étant pas sujets français, on ne pouvait leur accorder qu’une confiance relative quant à leur intérêt à défendre la nation. Pour la même raison, consul ou ambassadeur ne pouvait leur assurer la moindre protection sur la base des traités passés avec la Porte. Ils étaient donc totalement à la merci des autorités et des potentats locaux, souvent méprisants et injurieux à leur égard, et leur faisant parfois subir des châtiments physiques très violents. Dans le but de remédier à ces inconvénients, l’arrêt du conseil du 17 novembre 1669 ordonna « que dorénavant les drogmans et interprètes des Échelles du Levant, résidant à Constantinople, Smyrne et autre lieux, ne pourraient s’immiscer à la fonction de leur emploi, s’ils n’étaient Français de nation et nommés par une assemblée de marchands, qui se ferait en présence du Consul de la nation, ès main duquel ils prêteraient le serment dont leur serait expédié acte, en la chancellerie des dites Échelles » (cité par Masson, 1896).
Si les traducteurs devaient désormais être français, encore fallait-il en trouver parlant le turc, l’arabe ou d’autres dialectes levantins… Pour pallier cette carence, Jean-Baptiste Colbert, toujours lui, est à l’origine d’une institution dite des ‘enfans de langue’ créée et définie par l’arrêt du conseil de commerce du 18 novembre 1669 et celui du 31 octobre 1670. Ce dernier précisait :
« Afin qu’à l’avenir on puisse être assuré de la fidélité desdits drogmans et interprètes, il sera envoyé aux dites échelles de Constantinople et de Smyrne, de 3 ans en 3 ans, six garçons de l’âge de 9 à 10 ans, qui voudront y aller volontairement, lesquels seront remis dans les couvents des capucins des dits lieux, pour y être élevés et instruits à la religion catholique, apostolique et romaine et à la connaissances des langues, en sorte que l’on s’en puisse servir avec le temps pour interprètes ».
Cette formation avait forcément un coût, dont on devine qu’il échut à la Chambre de commerce de Marseille qui fut chargée de toutes les dépenses, tant de voyages que d’entretiens des enfants. Dans les premières années, ce dispositif fut plutôt mal accueilli, en particulier par les marchands mais, avec le temps, le commerce finit par en apprécier les bienfaits au point que bientôt les résidents des Échelles cherchèrent même à faire admettre leurs fils parmi les enfants de langue…
Le temps passant, la formation des enfants de langue sera l’objet d’une évolution qui, au moins en partie, semble liée à une rivalité entre l’ordre des Capucins et celui des Jésuites, ces derniers ayant joué de leur influence. Initialement les enfants étaient directement envoyés au collège de Constantinople tenu par les Capucins, la Chambre de commerce de Marseille leur payant 300 Livres par an pour chaque enfant (Masson, 1896). C’est sur place qu’ils étaient instruits dans les langues turque, arabe, et persane par un maître indigène, un codgea. Par la suite, au XVIIIe siècle, l’organisation du cycle des études va se dérouler en deux temps, d’abord à Paris, au collège des Jésuites, ensuite chez les Capucins à Constantinople. En 1721, une ordonnance constitue et définit l’École des Jeunes de langue de la manière suivante (Dehérain, 1922) :
« Sa Majesté ordonne qu’à l’avenir il sera élevé dans le collège de Louis le Grand à Paris, au lieu de douze jeunes orientaux, dix jeunes enfants français de l’âge de huit ans ou environ qui seraient par elle nommés et pris alternativement de familles de ses sujets habitant dans le royaume et de celles des négociants, drogmans et autres Français établis dans les Échelles du Levant, lesquels y seront instruits et enseignés dans la langue latine jusques et y compris la rhétorique et, en même temps, dans celles turque et arabe par deux maîtres de ces langues, qui iront les leurs montrer dans le dit collège, aux jours et heures indiqués, pour être ensuite les dits enfants de langue, envoyés au collège des Capucins à Constantinople, pour se perfectionner dans les langues orientales et être destinés aux emplois de drogman ».
Ainsi, les élèves concernés reçoivent d’abord, à Paris, un enseignement que l’on peut qualifier de classique auquel s’ajoute celui des langues orientales – turc, arabe, persan –, pour aller ensuite sur le terrain de l’application à Constantinople. Ce régime se révéla suffisamment efficace pour être maintenu à peu près tout au long du XVIIIe siècle. Au niveau du recrutement des élèves, Dehérain (1922) indique que statistiquement les jeunes furent davantage issus de familles établies en Orient qu’en France et, qu’avec le temps, une préférence fut souvent donnée aux enfants de drogmans « tant par justice que par convenance ». Il y eut donc des familles où l’on fut drogman de père en fils. En tout état de cause, quel que fut le lieu d’origine des parents, on ne peut qu’être admiratif de la confiance que ceux-ci accordaient à un dispositif d’éducation qui envoyait leurs enfants fort loin de chez eux, avec les risques que comportait à l’époque un voyage aventureux menant de Paris à Constantinople ou inversement, que ce soit par mer ou par terre. À partir des années 1670, le fait de former et de recruter des drogmans français ne va pas supprimer la possibilité d’employer aussi – et en complément –, des drogmans sujets du Grand Seigneur, en particulier dans les Échelles de taille importante. Si la question d’exclure totalement du drogmanat les sujets non français a souvent été posée, cette décision n’a, semble-t-il, jamais été prise, et pour la principale raison que la Chambre de commerce de Marseille y était franchement hostile pour des raisons surtout financières. À une lettre de Pontchartrain concernant cette question – rapportée par Masson (1896) –, elle répond en effet « qu’il n’est pas possible de n’avoir que le drogman français qui est dans l’échelle car, outre ce drogman, il est d’usage qu’il y en ait un autre à la porte de la maison consulaire et même d’autres pour le service des négociants. Ainsi, il est nécessaire qu’on se serve des Grecs ou autres gens du pays, les appointements desquels sont fort modiques, parce que ces sortes de gens recherchent ces emplois, plutôt pour s’exempter de payer le carach’ – capitation imposée, à partir de leur maturité, par le Grand Seigneur, aux sujets de sexe masculin qui ne sont pas musulmans –, aux Turcs, que la rétribution qu’ils en tirent ».
Voyons en quoi consistait l’état commun des drogmans en poste dans les Échelles. Ils portaient un costume coûteux, composé d’un bonnet fourré de martre et de zibeline – le calpak – et d’une longue robe orientale qui était ornée de fourrures, leur donnant fière allure, au point d’ailleurs d’être l’objet de nombreuses gravures artistiques, dont beaucoup en couleur. Pour autant, ils étaient partagés sur le principe de porter un habit oriental. Certains y étaient attachés et en tiraient fierté, d’autres déploraient de se voir vêtus comme des orientaux, estimant qu’ils recevraient davantage de considération de la part des Turcs, s’ils étaient habillés à la française. La rémunération des drogmans était très modeste et a fait l’objet, à toute époque, de plaintes répétées de leur part. En poste, bien qu’ils aient vécu chez le consul et mangé à sa table, leur traitement demeurait notoirement insuffisant. De manière générale, les consuls étaient d’ailleurs conscients de l’injustice de leur situation et n’ont eu de cesse, tout au cours du XVIIIe siècle, de demander à leur hiérarchie que la solde des drogmans soit augmentée.
Examinons maintenant quelle a été plus particulièrement la situation du drogmanat dans le cas de l’Échelle d’Égypte, sur laquelle Dehérain s’attarde un peu dans un article publié en 1931. Au XVIIIe siècle, les drogmans étaient assez nombreux et se répartissaient de la manière suivante : deux drogmans français, un jeune de langue et un drogman juif étaient rattachés au consulat du Caire. Parmi eux, le premier drogman, en sus de nombreuses fonctions protocolaires, avait pour fonction essentielle de servir d’intermédiaire entre le consul et le Pacha-gouverneur ou encore le Bey régnant. C’est d’ailleurs avec ce dernier que se traitaient les nombreuses affaires politiques et commerciales. Ce drogman n’avait guère de loisirs et devait toujours se tenir prêt à courir ou à enfourcher son âne, dès lors qu’il recevait la moindre injonction ou sollicitation d’une ‘Puissance’, laquelle au grand jamais ne se serait déplacée en personne. Une telle étiquette demandait d’ailleurs une bonne santé physique de la part du drogman concerné, ce qui pouvait parfois poser quelque problème, en particulier quand celui-ci commençait d’atteindre un certain âge. Il semble aussi que l’Échelle d’Égypte n’avait pas bonne réputation auprès des drogmans français. Preuve en est qu’au XVIIIe siècle, lorsqu’un poste se trouvait vacant au Caire ou à Alexandrie, chacun s’ingéniait à ne pas y être nommé. « Il n’y a, disait-on, que les infortunés et ceux qui n’ont point de protection qui peuvent y être envoyés ».
C’est qu’en effet les drogmans en poste en Egypte furent souvent l’objet de nombreux déboires, vexations et dangers. Bien que faisant pourtant partie de la nation, ils étaient très souvent dédaignés et publiquement méprisés, même par les négociants. Dehérain (1922) rapporte nombre d’anecdotes à ce sujet, dont celle où trois marchands français, profitant de l’absence du consul, intriguent et vont jusqu’à obtenir volontairement du kiaya des janissaires l’arrestation et l’expulsion d’un drogman qui, rappelons-le, avait le statut d’officier du consulat. Il faut dire encore que les autorités locales comme le Bey, par exemple, n’avaient aucune considération pour les traducteurs qu’elles considéraient comme de vulgaires serviteurs. Les invectives et les menaces de leur part étaient le lot quotidien des drogmans, et les châtiments physiques, parfois même l’emprisonnement, restaient de l’ordre du possible. Un député de la nation, nommé Boyer, en 1767, écrivait :
« Les drogmans ne veulent point servir et ils n’ont pas tort, étant continuellement menacés de mourir sous le bâton sur le moindre refus qu’ils marquent d’acquiescer à ce que l’on demande. Comme ils sont assurés qu’on ne sent (sic) tient pas ici aux menaces et que, le malheur arrivé, l’on se contentera de les plaindre pour toute consolation, ils ont un dégoût insurmontable pour le service des Échelles d’Égypte qu’ils ne cachent point ».
Reste que plusieurs drogmans, au cours du XVIIIe siècle, profitèrent tout de même de leur séjour au Caire ou à Alexandrie pour approfondir leurs connaissances de la langue arabe et des mœurs et usages en Égypte au point de devenir des savants compétents de l’orientalisme français. Ce fut le cas de Venture de Paradis qui, dans sa jeunesse, exerça au Caire – de 1770 à 1776 – et fut nommé, en l’an VI, interprète de l’armée d’Orient. Nous le retrouverons plus loin, lorsqu’il sera question de la campagne d’Égypte menée par Bonaparte.
2. L’Échelle d’Égypte et le commerce aux XVIIe et XVIIIe siècles
1. Le Caire et ses voies commerciales
L’Égypte, d’un point de vue géographique, occupe une place privilégiée entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie qui a longtemps éveillé l’intérêt de nombreux États européens. Avant que la liaison maritime avec les Indes orientales, passant par le cap de Bonne-Espérance, ne se soit progressivement banalisée dès la seconde moitié du XVIIe siècle, malgré la durée et les risques persistants d’un parcours – que l’on évaluait à l’époque à près de 4000 lieues –, l’Égypte était le passage obligé pour les échanges commerciaux entre les Indes orientales et l’Europe, et bien sûr l’Arabie. Pour autant, il ne faudrait pas croire que l’utilisation de la voie maritime passant par le Cap de Bonne Espérance ait anéanti tout commerce en Égypte ; ce serait une vision bien réductrice que de considérer les échanges commerciaux de ce pays du seul point de vue de ceux établis avec les pays européens. Comme le souligne, à juste titre, André Raymond (1984), dans un immense Empire ottoman s’étendant de la Crimée actuelle au Soudan et des frontières du Maroc à celles de l’Iran, la circulation des biens et des personnes était relativement facile. En conséquence, les courants commerciaux intérieurs – entre les différents pays de l’Empire – l’emportaient largement sur les courants strictement extérieurs, en tout cas, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Masson (1911) confirme que vers le milieu du XVIIIe siècle le commerce de l’Égypte avec la Turquie l’emportait très largement sur celui qu’elle entretenait avec l’Europe. Et si l’on prend l’exemple du café étudié dans le détail par Raymond (1973, 1984), l’Égypte, au XVIIIe siècle, importait du Yémen près de 100 000 quintaux de café, dont elle distribuait la moitié en Turquie contre seulement le cinquième vers l’Europe. Ce constat nous incite à examiner de près les voies commerciales organisées vers et à partir de ce foyer central du marché international que fut longtemps le Caire, ville importante, dont Constantin-François Volney (1787) estimait la population à près de 250 000 habitants, soit au moins le dixième de l’ensemble de la population vivant alors en Égypte.
En ce qui concerne les marchandises en provenance des Indes, elles étaient généralement débarquées à Moka, située à l’entrée de la mer Rouge. Elles étaient ensuite transportées à Djeddah (Jeddah), une petite ville portuaire – avec une rade très praticable –, établie plus à l’intérieur de la mer Rouge et située, comme on sait, non loin de la Mecque, dont la foire importante était fort renommée pour les produits des Indes et de l’Arabie que l’on pouvait y acheter. Toujours par voie maritime, elles parvenaient ensuite à Suez. Raymond (1973) fait justement observer que le port de Djeddah marquait la limite de partage de la mer Rouge entre les commerçants et navigateurs du Yémen, de l’Arabie et des pays de l’Océan Indien, d’une part, et ceux d’Égypte, d’autre part. Les premiers ne se risquaient que très exceptionnellement à remonter la mer Rouge au-delà de Djeddah jusqu’à Suez, zone où, en revanche, se cantonnaient les seconds. La navigation dans la mer Rouge était particulièrement délicate à cause de la présence de nombreux écueils dangereux mais aussi de vents dominants, variables selon les saisons. De juin à novembre, les vents du nord permettaient de faire le trajet de Suez à Djeddah ; de décembre à mai, ceux du sud imposaient de faire le parcours en sens inverse. La navigation était assez lente et ne se pratiquait que de jour. Il fallait au moins deux semaines sinon trois, pour aller de Suez à Djeddah, et près de huit pour le retour. Dans ces conditions, les navires basés à Suez ne parvenaient qu’à faire un voyage par an et ceux qui rataient la saison des vents du sud pour leur retour, n’avaient pas d’autre solution que d’attendre plusieurs mois pour apporter leur cargaison à Suez (Raymond, 1973). Les marchandises, une fois parvenues à Suez, étaient chargées sur des chameaux qui partaient en caravanes pour un voyage de près de trois jours les menant jusqu’au Caire.
De Moka à la Mecque par Charle, géographe, Paris : Maison Basset (1848)
Deux trajets terrestres étaient possibles, l’un plus court, par Al-Buwaïb, l’autre un peu plus long, par Bilbaïs, mais avec moins de marche dans le désert. À partir de Djeddah, s’il est vrai que la voie maritime jusqu’à Suez était la plus fréquemment utilisée pour le transport des marchandises, il existait tout de même une autre possibilité – mis à part la caravane du pèlerinage –, qui consistait à se rendre d’abord par voie maritime à Al Qousseïr (Kosseir), un petit port situé sur la rive ouest de la mer Rouge, à deux cents kilomètres environ de l’entrée du golfe de Suez. Ensuite on pouvait gagner le Caire par voie terrestre.
Sur le Nil, le Caire disposait avec Boulaq – situé à un peu plus d’un kilomètre au nord-ouest de la ville –, d’un avant-port intérieur, à partir duquel il était possible de communiquer, sur la façade méditerranéenne, avec trois ports d’importance très inégale : Alexandrie, Rosette et Damiette. La branche du Nil menant de Boulaq à Rosette était la plus navigable et donc la plus utilisée pour le transport des marchandises.
Celles-ci étaient embarquées sur des djermes (germes) – bateaux plats et non pontés, de faible tonnage, calant peu d’eau, gréés de voiles triangulaires –, permettant de naviguer sur le Nil et également en mer, à condition de demeurer à proximité de la côte. Les déplacements sur le fleuve n’étaient pas de tout repos, certaines tempêtes ou les crues pouvant être assez fortes. Sur cette portion du parcours, comme pour certaines des précédentes, il fallait aussi redouter les pillards prêts à saisir toute occasion pour dérober les marchandises, en particulier la nuit. Une fois parvenues à Rosette, les djermes, par l’une ou l’autre des deux passes existantes, franchissaient la barre pour se risquer en mer afin de terminer leur voyage à Alexandrie.
De la Mecque à Suez par Charle, géographe, Paris : Maison Basset (1848)
Histoire du Consulat et de l’Empire par M. Thiers (1855), carte n°13
Il semble aussi que pour cette dernière et courte étape vers Alexandrie, les grosses marchandises pouvaient être préalablement transbordées dans des bateaux plus considérables que les djermes naviguant sur le Nil. Globalement, Raymond (1973), sur la base d’un document daté de 1789, estime à une bonne centaine le nombre des djermes assurant la liaison entre Alexandrie et Rosette. De son côté, Masson (1896) précise que pour les marchandises de valeur et les voyageurs, c’est la voie de terre menant à Alexandrie en longeant la mer, et que l’on nommait d’ailleurs le chemin d’Alexandrie, qui était le plus souvent pratiquée :
« Sur ce chemin, qui traversait un désert, les caravanes étaient parfois arrêtées par des tourmentes de sable, plus souvent par les pillards arabes dont les tribus insoumises erraient dans le delta. Il y avait environ douze heures de route de Rosette à Alexandrie ; le plus souvent le trajet se faisait en deux jours, onze piliers plantés en terre indiquaient la route le long de laquelle on ne rencontrait à mi-chemin qu’une misérable hôtellerie, au bord de la lagune qu’on franchissait sur un lac ».
In fine, selon les circonstances, le transport ou le voyage entre le Caire et Alexandrie via Rosette – ou inversement – pouvait durer entre trois et sept jours. La plus grosse partie du trafic des marchandises passait par Alexandrie car c’était là que les chargements sur de gros vaisseaux pouvaient s’effectuer. La ville disposait de deux ports. Le port Vieux, à l’ouest, était très profond et bien protégé des vents du nord, mais il était réservé aux vaisseaux et aux galères du Grand Seigneur. Le port Neuf – ou port des Francs –, situé à l’est, était le seul autorisé à recevoir les vaisseaux marchands. S’il présentait l’avantage d’être vaste, il avait tendance à s’ensabler et à se combler progressivement par la négligence des Turcs qui ne faisaient rien pour l’entretenir. Masson (1896) souligne qu’il présentait aussi l’inconvénient majeur d’être ouvert aux vents du nord et nord-est, les plus dangereux, et que plusieurs écueils redoutables se trouvaient dans l’entrée.
À ce propos, un document du consul du Caire témoigne de la perte de huit bâtiments en 1769 et de dix en 1773 (OdP, 1982, p. 174). Volney, dans un passage de son livre Voyage en Syrie et en Égypte confirme cette description, mais peut-être en force-t-il excessivement le trait :
« Le port neuf, le seul où l’on reçoive les Européens, s’est tellement rempli de sable que dans les tempêtes, les vaisseaux frappent le fond avec la quille ; de plus, ce fond étant de roche, les câbles des ancres sont bientôt coupés par le frottement, et alors un premier vaisseau, chassé sur un second, le pousse sur un troisième, et de l’un à l’autre, ils se perdent tous. On en eut un exemple funeste il y a seize à dix-huit ans ; quarante-deux vaisseaux furent brisés contre le môle dans un coup de vent du nord-ouest… ».
Quand la mer était mauvaise, il était donc préférable d’aller mouiller plus à l’est, à Aboukir, où la rade était mieux protégée des vents par plusieurs petites îles basses. Là, les vaisseaux pouvaient attendre l’accalmie pour rejoindre ensuite Alexandrie.
À partir de Boulaq, nous l’avons évoqué, on pouvait aussi parvenir à Damiette qui, comme Rosette, était située à cinq milles environ de l’embouchure du Nil. Masson décrit Damiette comme une ville de 25 000 habitants, bâtie sur une branche du fleuve, dont les rives étaient beaucoup plus peuplées que celles de la branche de Rosette. Son territoire était très fertile et des jardins remplis d’orangers, de citronniers et de cassiers y abondaient. Sur le plan du transport des marchandises, si Damiette était implantée sur une branche navigable du Nil, elle ne pouvait toutefois faire grandement concurrence à Alexandrie, ni même à Rosette, car l’entrée de la bouche du fleuve n’y était praticable que par de très petits bâtiments et le passage de la barre était de plus particulièrement délicat.
2. Le consulat français dans l’Échelle d’Égypte
Pour mener à bien leurs affaires en Égypte, les marchands français, comptetenu des caractéristiques des voies commerciales que nous venons de décrire, avaient logiquement installé leurs comptoirs au Caire, à Alexandrie et à Rosette. Le Caire, comme entrepôt des produits de la vallée du Nil et de ceux provenant de l’extérieur, était le centre commercial principal ; Alexandrie, Rosette et Damiette faisant, comme on l’a vu, fonction de ports annexes pour l’embarquement et le débarquement des marchandises sur la façade méditerranéenne. Qu’en était-il alors de l’implantation du consulat français ? Longtemps Alexandrie en fut d’abord le siège. Dans leur relation de voyage, vers la fin du XIVe siècle, deux pèlerins florentins, Giorgio Gucci et Simone Sigoli signalaient déjà l’existence d’un « consul des Français et des pèlerins » dans cette ville, et c’est seulement en 1625 que le consulat va être déplacé au Caire, où il demeurera plusieurs décennies. Comme l’explique Amaury Faivre d’Arcier (2006), si la France se décide à y établir un consulat – au détriment d’Alexandrie –, c’est que malgré un détournement des voies commerciales liées aux grandes découvertes du XVIe siècle, le Caire, par la position géographique privilégiée de l’Égypte entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique, continue de s’affirmer comme un grand centre du commerce international. Il y aura cependant un retour temporaire du consulat à Alexandrie vers la fin du XVIIIe siècle, très exactement entre 1777 et 1793. On verra plus loin que ce ne sont pas des motifs liés aux activités marchandes qui expliquent ce déplacement transitoire, mais des raisons de sécurité liées aux troubles particulièrement importants qui agitent alors le pays, car, comme nous l’avons déjà entrevu à propos du cas des drogmans, l’Échelle d’Égypte fut souvent loin d’être un havre de paix et de sérénité, tant pour le consul que pour les marchands ou les autres membres de la nation française. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, il y eut bien des périodes un peu plus calmes que d’autres, mais globalement, par comparaison aux autres Échelles du Levant, vivre dans celles d’Égypte comportait davantage de risques et de désagréments. La plupart des relations de voyage ou des rapports de l’époque abondent en témoignages qui confirment, dans la durée, la mauvaise réputation de celle-ci.
Malgré ces inconvénients, du fait qu’il s’agissait d’une des Échelles les plus importantes du Levant et de la Barbarie par sa position géographique et le volume des affaires commerciales qui y étaient réalisées, elle restait prestigieuse et attractive pour les candidats au consulat, d’autant que l’exercice de celui-ci était doté d’appointements annuels parmi les plus conséquents. Paris (1957) estime, quant à lui, que si le consulat du Caire a toujours été considéré comme le plus honorifique, la cause en est des qualités que les difficultés à régler exigeaient de son titulaire. Il est donc instructif de repérer quelles étaient les difficultés en question ainsi que les caractéristiques du contexte qui les avaient fait naître et perdurer. À cette fin, il faut examiner quelle était la situation de l’Égypte dans l’Empire ottoman du point de vue de son rapport à la Porte, tout en prenant en compte les rivalités entre les forces locales en présence qui, sur toute la durée des XVIIe et XVIIIe siècles, sont à l’origine de conflits permanents bouleversant régulièrement tout ou partie du territoire ou de la société égyptienne. Dans cette approche on pourra aussi repérer un certain nombre d’éléments pouvant expliquer partiellement pourquoi la France, en la personne des membres du Directoire et de Bonaparte, prit un jour la décision apparemment soudaine de se lancer à la conquête de l’Égypte.
3. Composantes et évolution du pouvoir politique en Égypte sous l’Empire ottoman
1. L’organisation du pouvoir et le système des Mamelouks
La question du pouvoir politique existant en Égypte sous l’Empire ottoman est à la fois complexe et compliquée. Il serait d’ailleurs fastidieux de détailler les différents épisodes qui ont pu se succéder entre les factions qui ont voulu s’en emparer tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous nous limiterons donc à évoquer l’organisation du pouvoir mis initialement en place par la Porte et les raisons qui ont déterminé celle-ci à la concevoir sous une forme bien particulière. Nous décrirons quelles étaient les différentes forces qui l’exerçaient, et comment les rapports entre ces forces ont pu évoluer avec le temps sur la période des deux siècles qui nous intéresse plus particulièrement.
Avant l’arrivée conquérante des Turcs dans la deuxième décennie du XVIe siècle, l’Égypte et la Syrie étaient placées sous l’égide d’un sultanat qui avait été édifié par des Mamelouks depuis déjà près de deux cents ans. À cet égard, il est indispensable de préciser d’où venaient et qui étaient les Mamelouks, dont le statut bien particulier et l’équipement somptueux ont été à l’origine de nombreux fantasmes dans l’imaginaire orientaliste des Européens.
Le dispositif des Mamelouks a été conçu au XIIIe siècle dans le but de s’opposer à la menace que les Mongols – et plus marginalement les Croisés –, représentaient pour l’islam. Le terme mamelouk, on le sait, signifiant esclave, le principe originel de ce système, qui va perdurer sur plusieurs siècles, consistait à se procurer de jeunes chrétiens pour en faire des esclaves qui, par leur éducation et leur formation, deviendraient, à leur âge adulte, des guerriers musulmans redoutables et disciplinés.
Anouar Louca (2006) a brossé une description de ce processus :
« Ces adolescents sont arrachés par la guerre, le rapt ou la traite, à leur famille, à leur pays – la Géorgie, la Circassie, la Crimée – et, livrés aux trafiquants, sont vendus à un émir, dont ils formeront la garde. /…/ Ils sont toujours, blancs, chrétiens, non arabophones. Auprès de l’émir, ils reçoivent un prénom musulman, un générique désignant leur propriétaire ou leur prix, une éducation coranique et intensément militaire : maniement subtil du sabre et exercices de virtuosité à cheval. Devenus adultes, ils sont affranchis, autorisés à laisser pousser leur barbe, rétribués par les revenus d’un district territorial, et embrigadés au service du prince. Mais ces cavaliers d’élite, qu’on équipait alors luxueusement, masquaient dans le faste et le perfectionnement de la violence à l’arme blanche leur véritable condition de mercenaires absolus, acculés au point extrême où l’homme ne s’appartient plus ».
Mamelouk. D. É. État Moderne. Costumes et portraits. Vol II. Planche K
Ce sont de tels hommes qui furent initialement recrutés au Caire par le sultan ayyoubide al-Salih Najm al-Din (1240-1249). Avec le temps, ils constituèrent des ‘maisons’ suffisamment puissantes pour s’emparer du gouvernement et établir leur pouvoir sur l’Égypte. Entre les maîtres de ces maisons, à toute époque, comme il nous arrivera de l’évoquer plus loin, ce ne sera que compétitions, rivalités, alliances de circonstance, coups de force, conspirations et assassinats… Pour autant, après leur conquête de l’Égypte, les Turcs choisiront de composer avec eux, les laissant, en grande partie, continuer d’assurer l’administration du pays.
Un premier point est frappant, lorsque l’on décrit la population de l’Égypte aux XVIIe et XVIIIe siècles : celle-ci apparaît particulièrement multiple et disparate. On est d’ailleurs conduit à faire un constat similaire, si l’on cherche à repérer qui étaient les différents protagonistes du commerce exercé dans et à partir de ce pays. À l’origine de cet état de fait, et au-delà de divers aléas historiques qui ont pu y contribuer, on trouve d’abord la situation géographique exceptionnelle qu’occupe l’Égypte, ainsi que le rappelle la multiplicité des voies commerciales qui tout à la fois y convergent, la traversent et se dispersent dans de multiples directions. On sait que le fond autochtone de l’Egypte était constitué de Coptes chrétiens auxquels sont venus s’ajouter divers musulmans : des Turcs, des bédouins arabes, des Maghrébins (Maugrabins). S’y sont encore joints des chrétiens d’Orient : Grecs, Arméniens, Syriens. Sans oublier les juifs, ainsi que les esclaves – convertis à l’islam et amenés par force –, originaires de Nubie, d’Albanie, de Macédoine… Paris (1957) signale encore que mal enracinés, beaucoup de ces éléments extérieurs, surtout dans les villes, s’échauffaient facilement et saisissaient tous les prétextes pour s’opposer au gouvernement.
L’Égypte – et la Syrie – ont été conquises en 1515-1517. Après l’écrasement de quelques révoltes sporadiques qui s’ensuivirent, le régime ottoman, à partir du second quart du XVIe siècle, put s’implanter définitivement en Égypte. Vu l’immensité de l’Empire ottoman et les temps longs nécessaires aux communications et aux déplacements de l’époque, le gouvernement du Sultan établi à Constantinople ne pouvait centraliser le pouvoir ; il fallait donc déléguer. C’est le wali,





























