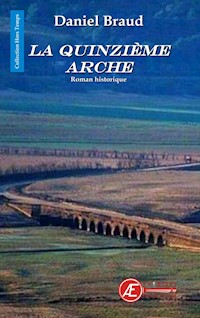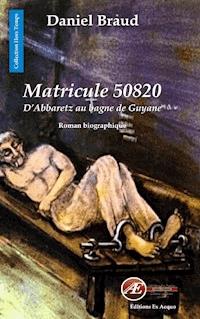
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hors Temps
- Sprache: Französisch
Destin d'un gamin de l'assistance au début du vingtième siècle
Il se nomme Joseph Ollivier. Abandonné à l’Assistance publique à l’âge de onze ans, placé comme valet de ferme dans la campagne de la petite bourgade d’Abbaretz, il commet l’irréparable à dix-huit ans en violentant et assassinant une fillette dans un village des environs. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, il subit sa peine dans les camps de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. Forçat pendant une vingtaine d’années, il est gracié et libéré après la décision de fermeture des bagnes guyanais.
Agrémentée de documents d’époque, cette biographie romancée dépeint la vie des « gamins de l’Assistance » employés au début du vingtième siècle comme commis de ferme, et la dure condition de bagnard que connurent les condamnés à la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni et à Cayenne.
« Là où je me trouve aujourd’hui, j’ai décidé de consacrer le temps qui me reste à raconter mon histoire. » Sous la plume de l’auteur, Joseph Ollivier prend la parole au fil du récit pour dire sa vérité et relater ce que fut sa vie d’enfant abandonné et celle d’assassin condamné aux travaux forcés à perpétuité dans les bagnes de Guyane.
Découvrez la biographie romancée d'un enfant abandonné qui devint un assassin condamné aux travaux forcés à perpétuité dans les bagnes de Guyane.
EXTRAIT
Il pleut. Un crachin malingre.
Ils sont deux.
Partis de Châteaubriant au matin, ils sont arrivés la veille au soir par la route d’Issé. Passé le pont de la Feuillée, leur carriole tirée par une ânesse famélique a longé la ferme du hameau de la Martrie, traversé le village de Lantilloux avant de gravir la côte qui mène aux « quatre routes » du bourg d’Abbaretz.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Daniel Braud, établi dans la métropole nantaise, est l’auteur de plusieurs ouvrages, polars, romans et recueils historico-régionaux qui font la part belle à sa région.
Après Le cri de la Madone voici sont second roman aux éditions Ex Aequo. L'auteur est membre du collectif des Romanciers Nantais et contributeur aux recueils de nouvelles proposés par le groupe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Résumé
Matricule 50820
Résumé
Il se nomme Joseph Ollivier. Abandonné à l’Assistance publique à l’âge de onze ans, placé comme valet de ferme dans la campagne de la petite bourgade d’Abbaretz, il commet l’irréparable à dix-huit ans en violentant et assassinant une fillette dans un village des environs.
Condamné aux travaux forcés à perpétuité, il subit sa peine dans les camps de Saint-Laurent-du-Maroni et de Cayenne. Forçat pendant une vingtaine d’années, il est gracié et libéré après la décision de fermeture des bagnes guyanais.
Agrémentée de documents d’époque, cette biographie romancée dépeint la vie des « gamins de l’Assistance » employés au début du vingtième siècle comme commis de ferme, et la dure condition de bagnard que connurent les condamnés à la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni et à Cayenne.
« Là où je me trouve aujourd’hui, j’ai décidé de consacrer le temps qui me reste à raconter mon histoire. » Sous la plume de l’auteur, Joseph Ollivier prend la parole au fil du récit pour dire sa vérité et relater ce que fut sa vie d’enfant abandonné et celle d’assassin condamné aux travaux forcés à perpétuité dans les bagnes de Guyane.
Daniel Braud, établi dans la métropole nantaise, est l’auteur de plusieurs ouvrages, polars, romans et recueils historico-régionaux qui font la part belle à sa région.
Après Le cri de la Madone voici sont second roman aux éditions Ex Aequo.
L'auteur est membre du collectif des Romanciers Nantais et contributeur aux recueils de nouvelles proposés par le groupe.
Daniel Braud
Matricule 50820
D’Abbaretz au bagne de Guyane
Biographie romancée
Dépôt légal décembre 2016
ISBN : 978-2-35962-884-5
Collection Hors temps
ISSN : 2111-6512
©2016 - Ex Aequo
© 2016 — Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite.
Abbaretz, dimanche 21 juillet 1929
Il pleut. Un crachin malingre.
Ils sont deux.
Partis de Châteaubriant au matin, ils sont arrivés la veille au soir par la route d’Issé. Passé le pont de la Feuillée, leur carriole tirée par une ânesse famélique a longé la ferme du hameau de la Martrie, traversé le village de Lantilloux avant de gravir la côte qui mène aux « quatre routes » du bourg d’Abbaretz.
Ils ont dételé derrière l’hôtel du Commerce, une bâtisse curieusement dotée d’une tour circulaire, dont les trois marches en pierre, à l’angle de la route de Puceul, donnent accès à la salle enfumée où le vin en chopine désaltère les assoiffés de tout crin. Bistrot qu’ils n’ont pas tardé à rallier après avoir remisé la carriole dans la vaste cour et abrité l’ânesse dans l’écurie Robert, le boucher du bourg. Ils ont passé la nuit au premier, à deux dans le même lit, dans la chambre du fond, celle que le patron réserve aux gens de peu.
Prosper Leborgne et Similien Morvan sont chanteurs ambulants.
Ils gagnent leur maigre vie en goualant sur les places publiques romances ou ritournelles et en vendant les « petits formats », les partitions papier des paroles et de la musique des airs qu’ils entonnent.
Aujourd’hui dimanche, c’est jour de fête dans le bourg de la petite localité, « les courses d’Abbaretz » comme disent les habitués, référence aux coursiers qui, déjà, s’impatientent à proximité de la ligne de départ, prêts à s’élancer pour une ronde de plusieurs tours sur les routes mal carrossées de la campagne environnante. Les forains ont dressé leurs stands de chaque côté de la grand-rue, bimbeloterie criarde pour attirer le chaland, manège et balançoires pour les enfants, tir à la carabine où l’on vient faire un carton, roue de la fortune au son de crécelle pour espérer gagner kilos de sucre et canards vivants.
Prosper Leborgne et Similien Morvan sont installés sur le parvis de l’église sous un vieux parapluie. Devant eux, une valise aux charnières démantibulées, fermée en raison de la pluie, repose sur une ancienne porte de récupération soutenue par des tréteaux et couverte d’une toile cirée aux couleurs délavées. Sur un fil de fer tendu à l’avant de la table de fortune, trois exemplaires papier identiques, mal protégés de la bruine, sont suspendus à l’aide de pinces à linge. On en devine le titre :
La complainte du Bois Vert.
Et en dessous, le prix : 6 francs{1}.
Autour d’eux, une affluence inhabituelle, un attroupement en rangs serrés malgré la pluie fine est l'augure d'une recette rondelette, de quoi voir venir pendant une semaine au moins. La curiosité malsaine se révèle souvent d’un bon rapport ! L’appât du gain a eu tôt fait de vaincre leur hésitation à chanter sur les lieux mêmes du drame, la promesse d’espèces sonnantes et trébuchantes a aisément pris le pas sur la pudeur, la dignité et la bienséance. Pauvre petite ! Dieu ait son âme et les deux compères le profit.
C’est le moment. Tout le monde retient son souffle. Similien Morvan, un grand maigrichon moustachu, cigarette roulée main accrochée au coin de la lippe, casquette vissée sur son crâne chauve, extirpe son accordéon de son étui, enfile les bretelles sur ses épaules et se tient prêt à jouer au signal de son partenaire. Ironie du mauvais sort, Prosper Leborgne est borgne, séquelle de Verdun où un éclat d’obus lui a emporté l’avant-bras gauche et une partie du visage. Une « gueule cassée ». Adieu les travaux de la ferme auxquels il était promis, reconversion grâce à sa voix d’ange légèrement voilée en chanteur des places et des villages pour une vie devenue difficile à gagner. Il se saisit de son tambour de basque, un tambourin à cadre de bois qu’il parvient à manier avec dextérité en le frappant en rythme sur son moignon. Un signe de tête à Similien, l’accordéon joue quelques notes languissantes avant que de sa voix claire il ne psalmodie : « Écoutez braves gens, écoutez ce qu’il advint à Abbaretz, écoutez la complainte du Bois Vert. » Un court silence puis, accompagné par le piano à bretelles, il attaque :
Dans l'arrondissement de Châteaubriant dans la Loire-Inférieure
Une fillette a quitté sa demeure pour aller dans les champs.
C'est dans le joli village du Bois Vert qu'habitait la gamine,
Pauvre petite qui vient d'être victime d'une brute sanguinaire.
Tandis qu'elle était allée dans les champs pour y garder ses vaches
Un valet d’ferme, une brute sauvage, s'approcha de l'enfant.
Mais la fillette fut prise de peur en voyant cette brute,
Elle se sauva, mais une courte lutte l'étrangla de douleur.
Mère, écoutez les cris de l'enfant chérie que pousse la gosse
Tandis que le lâche bandit serre sans répit son cou, c’est atroce.
Elle appelle sa maman en cris déchirants d'horrible détresse,
Oh pour vous pauvres parents quelle tristesse.
Comment se peut-il avoir de tel bandit sur la terre de France
Qui, achevant sans pitié l'innocence, assassinent nos petits.
Quand il eut mis à mort la pauvre enfant, il la viola comme une bête
Puis, tranquillement sans perdre la tête, il alla plaindre les parents.
Tandis que tombe la nuit, cet être maudit monte à bicyclette
Pour aller chez l’médecin, et sur son chemin poursuit une chansonnette.
Que l'on supprime bientôt ces tueurs de petiots, ces brutes inhumaines
Qui ne sèment que des sanglots, que des peines.{2}
Pas un murmure n’a troublé l’interprétation de Prosper Leborgne. Chacun a reçu les mots comme autant d’uppercuts à l’estomac, quelques poings, quelques gorges aussi, se sont serrés, des yeux se sont embués. Les têtes se baissent, la gêne est palpable. Un escogriffe à la carrure impressionnante n’en peut plus, il lâche brutalement : « C’est une honte ! » Encouragé, un autre grommelle : « Osez venir chanter ça à Abbaretz ! Enfants de putain ! »
Malgré leur embarras, faisant fi de leur mauvaise conscience, quelques badauds s’approchent de Similien qui vient d’ouvrir prestement la valise en claironnant : « La partition de la complainte du Bois Vert. Six francs l’une, dix francs les deux ! Demandez, demandez ! » Plusieurs exemplaires changent de main, Prosper enfouit les piécettes dans la poche de son pantalon tirebouchonné.
Un peu à l’écart, un couple reste statufié, blême. Elle, en tenue de grand deuil, tout de noir vêtue, lui, crêpe sombre à la boutonnière de sa veste de velours. Ils sont venus écouter, malgré le chagrin, malgré la haine. Elle ne voulait pas, il a insisté, s’est presque fâché, elle n’a pas osé le contrarier, elle l’a suivi. Les larmes jaillissent d’un coup. Soutenue par son mari, sanglotante et voûtée, la mère s’éloigne en direction du Bois Vert, là où moins de trois semaines auparavant, sa petite fille a été étranglée et violée.
Lucien Brangeon, journaliste, n’a rien manqué de la scène. Son flair l’a incité à venir aux « courses d’Abbaretz », sur les traces des deux musiciens qui se sont produits l’avant-veille à Châteaubriant. Il tient son article. Le mercredi suivant, son papier paraît dans le Courrier de Châteaubriant :
Complainte
Dimanche, nous avons eu à Abbaretz le spectacle d’un duo de chanteurs ambulants qui débitaient sur un air moderne des vers de mirliton consacrés au crime monstrueux du Bois Vert.
Qu’il y ait des camelots assez dénués de sens moral pour vendre n’importe quelle marchandise sur la voie publique, il ne faut pas s’en étonner. Mais qu’ils puissent librement exercer leur commerce et qu’il se trouve de très nombreuses personnes pour s’intéresser à eux et répondre à leurs sollicitations, quel scandale et quelle honte !
Une toute jeune enfant a subi les derniers outrages puis a été sauvagement étranglée par un gredin il y a quelques jours seulement... Les sanglots des parents, écrasés par la douleur, sont à peine étouffés. Et voilà que l’on chante l’immonde forfait…
Qui ne sent monter en soi un cri de révolte ?
Nous apprenons que les camelots, après Châteaubriant et Abbaretz, vont continuer leur tournée dans tout l’arrondissement : Derval, Nozay…
Qu’attendent les maires pour user de leur pouvoir de police et arrêter cette propagande immorale ?{3}
L’indignation du journaliste fait long feu. Rapidement, une deuxième version de la complainte du Bois Vert voit le jour, interprétée sur les places des villages du pays de Châteaubriant par un trio concurrent de Prosper et Similien.
L’assassinat d’une fillette peut profiter à qui sait en tirer bénéfice...
Poissevin à Guérande
1911 – 1919
Depuis le 15e siècle, la ville close de Guérande domine de ses remparts le contraste entre la tourbe noire de la Grande Brière et la blancheur des marais salants entre Saillé et la presqu’île du Croisic. Les quatre portes de l’enceinte fortifiée, aux points cardinaux de la citadelle, s’ouvrent sur une enfilade de boulevards circulaires ceinturant la cité médiévale.
Au début du 20e siècle, dans la période qui précède le déclenchement de la Grande Guerre, la commercialisation du sel, ressource principale de la ville, demeure encore régionale, confinée à un mode d'exploitation locale. Les paludiers du marais fournissent des négociants qui alimentent quasi exclusivement l’ouest de la France. À cette époque, le pays de Guérande produit aussi des vins rouges, le clos Saint-Aubin ou le clos Marsillé, grâce à des vignes qui, plantées sur les colluvions des coteaux argileux de Trescalan à Careil, sont vouées à disparaître progressivement dans l'entre-deux-guerres.
Contrairement à la quasi-totalité du nord de la Loire-Inférieure où le gallo prédomine, la presqu’île Guérandaise conserve encore largement son parler breton, cousin du vannetais, grâce aux forts liens économiques tissés avec la Bretagne bretonnante et à cause d’une autarcie importante du monde agricole doublée d’une mixité sociale quasi inexistante qui souffre du peu de communications ferroviaires vers la Basse-Loire. La gare, dont l’accès est protégé par une barrière métallique coulissante aux croisillons en forme de losange, est située à proximité du faubourg Sainte-Anne, elle accueille les voyageurs de la ligne reliant La Baule-Escoublac à Guérande. En 1907, une nouvelle liaison ferroviaire d’intérêt local, à voie métrique, est inaugurée dans les locaux d’une deuxième gare, toute proche. Construite par La Compagnie du Morbihan, elle serpente entre Guérande et Herbignac, via Piriac. Elle subsistera jusqu’à la veille du second conflit mondial.
Les distractions sont rares dans la presqu’île. Après une semaine de travail, les habitants de la région se livrent, le dimanche après-midi, à un jeu encore très populaire qui s’éteindra peu à peu après la Grande Guerre avant de renaître à la fin du siècle : la boule plombée. Comme à la pétanque, l’objectif consiste à se rapprocher au plus près du maître (le bihen en breton) avec la singulière particularité d’utiliser des boules de bois déséquilibrées par un lest de cinq cylindres de plomb. Essentiellement pratiqué dans le pays de Morlaix sur des allées en terre battue, ce passe-temps connaît à l’époque un succès populaire dans le Guérandais, probablement dû aux relations économiques privilégiées entretenues avec la Basse-Bretagne. Et lorsque qu’un joueur de boule plombée épouse une fille de la presqu’île guérandaise, la noce retentit du son de la veuze, une sorte de biniou qui n’en est pas un.
Dans la deuxième décennie du siècle, la vie routinière des paludiers et des paysans est bouleversée par la déclaration de guerre. Au-delà de la mobilisation des hommes dans la force de l’âge qui laissent femmes et enfants assumer les nécessités de l’existence, la création d’un camp d’internement, à la fin de 1914, génère des tensions à Guérande et aux alentours. Quelque 400 Allemands, Hongrois, Autrichiens, Turcs, Bulgares, et un nombre restreint d’Alsaciens-Mosellans, sont regroupés dans les locaux du Petit Séminaire, situés faubourg Saint-Michel. Julien David, le directeur du camp, développe plusieurs ateliers dans lesquels hommes et femmes volontaires produisent sabots, briquettes de chauffage, tonneaux, tricots et s’adonnent à la menuiserie, la vannerie et le maraîchage. Des manifestations d'hostilité de la part des habitants du cru et de certains partis politiques ne tardent pas à se faire jour, critiquant le « régime de faveur » accordé à cette population ennemie et la concurrence locale et déloyale qu’engendrent ces activités.
Le camp de rétention ferme à la fin de l’année 1919 au moment où la vie d’un gamin de la campagne guérandaise bascule quand ses parents se séparent. Il a passé sa tendre enfance dans un village situé sur la route de Saint-Lyphard, à trois kilomètres de la porte Saint-Michel de la ville close.
Le village de Poissevin, là où il a vu le jour.
***
Je m’appelle Joseph Ollivier, avec deux « l ». À l’heure où j’écris ces lignes, je sais que les semaines me sont comptées. Là où je me trouve aujourd’hui, j’ai décidé de consacrer le temps qui me reste à raconter mon histoire, celle d’une vie gâchée et pas banale à plus d’un titre.
Je suis né le 13 mars 1911 au village de Poissevin, sur la route de Saint-Lyphard en la commune de Guérande. J’ai été baptisé le lendemain par l'abbé Châtaignier, le curé de la paroisse dont je me souviens du nom à cause de Milo Samzun qui me répétait souvent, pendant nos séances de catéchisme, « Encore une châtaigne du Châtaignier ! » lorsque nous venions de recevoir une correction pour avoir commis une de nos innombrables bêtises habituelles.
Mon père, déjà, était absent lorsque j’ai vu le jour, parti on ne sait où exercer son métier de marchand ambulant. Un vrai globe-trotter, mon père. Engagé volontaire pour cinq ans à ses vingt ans, affecté au bataillon de la Martinique, il avait fait son temps aux Antilles avant de rencontrer ma mère à Angers à son retour. Un homme à femmes malgré un physique peu avantageux avec sa petite taille et ses cheveux roux. Que faisait dans cette grande ville, loin de Guérande pour l’époque, cette fille de la campagne ? Je ne l’ai jamais su parce que, chez nous, on ne posait pas ce genre de question. Probablement placée comme domestique ou journalière, telle que je l’ai connue pendant la courte période que j’ai passée avec elle. Toujours est-il que mes parents se sont mariés à Angers en 1904, puis ont entamé une vie de patachon entre Nantes, Couëron et finalement Guérande, à Poissevin dans la ferme du grand-père Guilloré. Très rapidement, ils ont commencé à se fabriquer des enfants.
Je suis le troisième de la « bouée », comme on disait par chez nous.
Quand la guerre a été déclarée, en août 14, mon père a été mobilisé et je ne l’ai revu que lors de ses permissions qu’il a mises à profit pour engrosser sa femme de deux autres filles avant leur séparation en 1919, peu après son retour. J’ai donc passé ces quatre années avec ma mère, mes frères et soeurs et mes grands-parents, à Poissevin. Notre vie autarcique de paysans campagnards nous a aidé à traverser cette période troublée assez sereinement, la basse-cour, le lait des vaches et les légumes du jardin ont assuré notre subsistance sans problème.
J’étais ce que l’on nomme communément un enfant difficile. Dès que j’ai su marcher, j’ai commencé mes bêtises, agrémentées, si cela se peut, de crises de larmes furieuses lorsque l’on me contrariait. Le mal a empiré avec l’âge. À six ans, j’ai martyrisé les vaches dans l’étable en m’amusant à les piquer au sang avec une paire de ciseaux que j’avais empruntée dans l’ouvrage de couture de la grand-mère. Une symphonie de meuglements des pauvres bêtes affolées ! Ma mère m’a fichu une de ces roustes, mais cela ne m’a pas calmé pour autant. À sept ans, j’ai fait ma première fugue – il y en aura d’autres –, je me suis sauvé de l’école et je suis parti à pied jusqu’à Saillé, dans les marais, je m’étais mis dans la tête de rapporter du sel à la maison parce que le grand-père avait dit la veille au soir que la soupe en manquait. Un paludier, au travail dans son œillet, étonné par ma présence, m’a questionné et ramené à Poissevin. J’ai encore eu droit à la badine de noisetier que ma mère avait pris l’habitude d’utiliser en me cinglant les fesses à grand renfort de : « Mais qu’est-ce que je vais faire de toi ? Rien que de la graine de vaurien ! Tiens, prends ça, et encore ça ! »
Heureusement, le grand-père Guilloré m’avait à la bonne, il réussissait à obtenir de moi à peu près ce qu’il voulait contrairement à sa fille à qui j’en faisais voir de toutes les couleurs. Quant à mon père, il venait si rarement à Poissevin qu’il me semblait presque étranger et qu’il se fichait bien de mes bêtises.
Mon grand-père Jacques était bilingue. Il se débrouillait avec un français plus empirique qu’académique, tel que pratiqué alors dans la région, mais il se sentait plus à l’aise avec le breton quand il s’agissait de nommer ou de décrire la flore et la faune de sa campagne. Il me régalait de ses kazeg-koad, le pic-vert, bran, le corbeau, kegin, le geai, linadenn, les orties, kaolenn, les choux, pourenn, les poireaux, et bien d’autres encore.
Pendant la guerre, trop vieux pour aller au front, il s’échinait aux travaux de la ferme et consacrait nombre de dimanches après-midi à sa distraction préférée : la boule plombée qu’il pratiquait avec des hommes de son âge à la Madeleine, un gros village sur la route de Saint-Lyphard, à quelque deux kilomètres de Poissevin. Après sa sieste dominicale, le rituel était bien rodé. Il feignait de partir seul, se retournait sur le pas de la porte et me lançait :
— Au fait, Joseph, p’têt ben que tu viendrais avec moi, non ?
— J’arrive grand-père, je claironnais, trop content de le suivre et délesté du poids de l’inquiétude qu’il ait pu m’oublier.
J’adorais l’accompagner. Je m’asseyais sur une des planches en chêne qui cloisonnaient l’aire de jeu en terre battue pour admirer les protagonistes qui faisaient preuve d’une habileté redoutable pour approcher au plus près du bihen. Car le maniement de la boule plombée est très subtil, un des plombs, le fort et, à l’antipode, le contrefort, un trou creusé dans le bois, déséquilibrent l'engin en lui donnant une trajectoire courbe difficile à maîtriser pour le néophyte. En gros, pour qu’elle aille à gauche, la technique consiste à la faire rouler – surtout ne jamais la lancer ! – à droite. Le grand-père Guilloré gagnait souvent à ce jeu-là. J’en étais fier.
Il acceptait parfois de m’emmener à Guérande, dans le tombereau attelé du vieux hongre breton à robe aubère, au pas lourd et balancé. Ses affaires faites, avant le retour à Poissevin, il respectait inévitablement le même cérémonial : passage par la gare, faubourg Sainte-Anne, pour voir le train de 16 h 52 en partance pour La Baule-Escoublac. La barrière de ferraille franchie, la bride du cheval nouée à la palissade en bois, le grand-père m’entraînait rapidement vers l’entrée du bâtiment blanc à toit-terrasse en ressassant l'habituel « Allez, presse-toi un peu, il va bientôt partir ». Un jour, je devais avoir sept ans, j’ai osé lui demander :
— Pourquoi tu veux toujours venir à la gare ?
Il a hésité quelques secondes avant de répondre dans son français bien à lui :
— Ben, quand j’étais jeune, j’aurais aimé devenir meneur de train, alors ça me plaît de voir la loco grincer et patiner au démarrage en crachant sa vapeur.
Je me le suis tenu pour dit. Dans mon for intérieur, j’étais heureux d’imaginer mon grand-père capable de dompter cette machine infernale écumeuse et suante.
Et puis, tout le temps qu’a duré la guerre, il « s’arrangeait » – peut-on parler de trafic ? – avec les internés du faubourg Saint-Michel, des Allemands, des Hongrois et même des Alsaciens qui étaient regroupés dans les locaux du Petit Séminaire comme potentiels ennemis de la France. Il leur fournissait des poulets de notre basse-cour en échange de menus services très mystérieux que je n’ai jamais réussi à élucider. Et pas question de lui demander d'éclaircissements, la seule fois où je m’y suis risqué, il m’a rabroué vertement en me menaçant de ne plus m’emmener, ce qui m’aurait privé de la visite à mon copain Jules, un jeune Alsacien de mon âge, comme moi prompt à faire des bêtises, avec qui j’avais sympathisé.
Un soir d’hiver, en rentrant chez nous, il m’a expliqué comment reconnaître les morceaux de lune, comme je disais à l’époque. Le crépuscule laissait place à l’obscurité, le vieux hongre avançait d’un bon pas en bronchant ci et là sur le sol inégal de la route de Saint-Lyphard.
— Tu vois, m’a dit soudain le grand-père, la lune est coupée en deux. C’est le premier quartier, elle va grandir de nuit en nuit pour devenir toute ronde dans une huitaine de jours. Et puis une semaine plus tard, ce sera le dernier quartier.
— Comment on les reconnaît, les quartiers ?
— Facile. Trace dans ta tête une ligne sur le côté ben droit de la lune, si tu peux écrire un p, alors c’est le premier, si tu peux former un d, c’est le dernier. Tu t’en rappelleras ?
Je m’en suis toujours souvenu.
C’est aussi à son contact que j’ai pris l’habitude de remplacer le « non » par le « point », très en usage dans la région, rehaussé du « dame » pour renforcer la réponse négative à une question incongrue. Lorsque, par jeu, je lui demandais régulièrement pour le taquiner :
— Grand-père, les coqs, ils pondent des œufs ?
— Dame point, es-tu bête ! Seulement les poules, réfutait-il invariablement.
J’ai conservé très longtemps ce tic de langage vernaculaire.
La vie s’écoulait ainsi à Poissevin, au rythme de mes fredaines, des journées d’école buissonnière, des corrections infligées par ma mère et des escapades en tombereau avec le grand-père Jacques.
Jusqu’à ce jour maudit où mon père a tout bouleversé, un dimanche, au début de 1919, peu de temps après son retour de la guerre. Il avait repris ses activités de marchand ambulant, découchait souvent, ne rentrait que rarement à la maison. Ce jour-là, il a fini par avouer à ma mère qu’il avait une liaison avec une autre femme, pas très loin de Nantes, et qu’il voulait vivre avec elle. Elle a blêmi, mais elle n’a pas dit un mot. Jamais mon père n’est revenu à Poissevin. Ils ont divorcé quelques mois plus tard alors que mon destin était déjà scellé : ma mère avait profité de la situation pour se débarrasser de moi. « J’en ai par-dessus la tête de tes bêtises. Tu vas aller avec ton père », m’avait-elle asséné. Malgré son peu d’enthousiasme, il avait accepté de s’encombrer de ma personne.
J’ai dû dire adieu à Poissevin et au grand-père Jacques, ours bourru au grand cœur, pour rejoindre Le Pellerin, au bord de la Loire, chez une mégère revêche dont mon père s’était amouraché. J’avais huit ans.
Les Coteaux au Pellerin
1919 – 1922
La commune du Pellerin s’étire le long de la rive sud de la Loire, au nord du Pays de Retz, à quelque 20 kilomètres de Nantes. Dans ces années d’après-guerre, ancré sur un territoire de polyculture traditionnelle et juché sur un promontoire de faible altitude, le bourg vit au rythme des activités maritimes du fleuve ligérien et de l’effervescence laborieuse du quai des Coteaux, la cheville ouvrière de la batellerie locale. Agrandis et rebâtis en briques au début du siècle, les anciens ateliers de bois fourmillent de tâcherons occupés à l’entretien et la maintenance des navires. Voiliers, vapeurs et dragues de Loire, hissés sur le slip de radoub s’y refont une santé. Un tout nouvel atelier de dépannage automobile vient même d’être construit pour requinquer et remettre en état les encore rares voitures du voisinage. Nombre de compagnons du quai sont des ressortissants des proches départements de la Loire-Inférieure : des bataillons de Vendéens, Morbihannais et Finistériens ont émigré de leurs campagnes pour contribuer à l’essor de la réparation navale au Pellerin. À quelques pas, le môle à double cale en pierre de taille construit à la veille de la Grande Guerre résonne des appels et des invectives des bateliers et des nombreux pêcheurs de Loire.
À l’est du quai des Coteaux émerge l’embarcadère du « ferry-boat », le Saint-Julien, qui effectue la liaison entre Le Pellerin et Couëron, sur la rive nord de la Loire. Embarcadère est d’ailleurs un bien grand mot pour un simple plan incliné de pierre qui plonge dans le fleuve. Les passagers y appareillent pour le Paradis, du nom du lieu-dit où accoste le Saint-Julien qui navigue d’une berge à l’autre en glissant le long d’une chaîne de guidage. Un bateau plat dont les deux cheminées crachent la fumée de sa machine à vapeur et sur lequel on prend pied grâce à une rampe d’accès mobile en bois manœuvrée par des câbles qui coulissent sur deux poulies.
À environ un kilomètre à l’ouest du quai, le promeneur bute sur l’embouchure d’un long ouvrage creusé pour pallier les écueils de navigation sur la Loire : le canal de la Martinière. Au milieu du 18e siècle, les bateaux qui remontent le fleuve rencontrent, entre Paimboeuf et Le Pellerin, d’importantes difficultés : ils sont contraints de louvoyer dans des passes incertaines et rétrécies entre des îles sablonneuses et mouvantes qui migrent au gré des courants, certains doivent même être halés pour parvenir à franchir ces obstacles périlleux. Après une vive opposition entre les « loiristes », partisans d’un aménagement du fleuve, et les « canalistes », adeptes de la mise en service d’un canal parallèle à la Loire, le projet de creusement d’un chenal navigable entre le Carnet et la Martinière est adopté. Pendant dix ans, de 1882 à 1892, des travaux pharaoniques vont permettre de mener à bien cette entreprise. Émigrés d’Italie, de Belgique, d’Espagne, d’Autriche, des ouvriers spécialisés complètent les effectifs de Français originaires de Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, de Vendée, du Puy-de-Dôme, d’Alsace et de Bretagne. Ils sont maçons, tailleurs de pierres, mécaniciens, ajusteurs, chaudronniers, charpentiers ou marins. Le gros des troupes est composé de manœuvres venus en nombre des communes avoisinantes et de toute la campagne bretonne. Dotés d’un statut précaire, corvéables à merci, équipés d’un outillage succinct fait de pelles et de pioches, ils sont affectés au terrassement des abords de l’ouvrage fluvial.
Ouvert à la circulation à l’automne 1892, le canal d’une quinzaine de kilomètres autorise désormais la navigation de navires de mer à fort tonnage qui contribuent à l’essor du port de Nantes. Un bassin de plus de cinq hectares attenant à l’écluse de la Martinière permet de réguler l’activité incessante grâce à la mise en attente des trois-mâts, steamers, gabares, chalands et toues qui remontent vers la Loire. Une ingénieuse machinerie à vapeur, dont la haute cheminée en briques s’impose dans le paysage, est le gage d’un fonctionnement très rapide des lourdes portes de quarante tonnes et facilite ainsi l’écoulement du trafic.
Après plus de vingt ans d’intense animation, le canal est fermé à la grande navigation en 1913, reste ouvert provisoirement à la batellerie jusqu’en 1921 lorsqu’il devient un cimetière où voiliers majestueux et vapeurs trapus y sont désarmés.
Un terrain de jeu sans pareil pour un gamin campagnard, téméraire et indiscipliné.
***
Je suis arrivé au Pellerin le 20 mars 1919, une semaine après l’anniversaire de mes huit ans que le grand-père Guilloré avait illuminé du dernier bonheur dont je me souvienne. Alors que j’étais sur le départ, mon père devait venir me chercher le lendemain, il m’a entraîné à l’écart et murmuré :
— Alors, Joseph, comme ça tu vas t’en aller.
— Ben…
J’ai baissé la tête sans pouvoir en dire plus. J’aurais tant aimé rester à Poissevin, quitter la campagne guérandaise m’angoissait, un saut dans l’inconnu, dans un autre monde.
— Tu es un homme maintenant, pas vrai ? a-t-il ajouté en me regardant de biais.
J’ai souri.
Il a fouillé dans la poche de son pantalon de velours marron rafistolé aux genoux avec de la toile bleue d’où il a sorti un petit paquet mal ficelé dans du papier journal.
— Tiens, pour tes huit ans, a-t-il marmonné, comme gêné, en me tendant l’objet.
— C’est quoi ? Un sucre d’orge ?
— Dame point ! Ouvre donc bécasse, tu verras ben.
J’ai déchiré d’impatience l’emballage grossier, écarquillé les yeux, incrédule, en découvrant le cadeau du grand-père. Un émerveillement. Un Coursolle. Un de ces couteaux au manche de laiton sculpté de scènes de la vie paysanne ou autre : un faucheur et un semeur sur celui que je tenais au creux d’une main tremblotante. Grande et petite lame, poinçon et tire-bouchon. Pas neuf, terni, rayé, fatigué d’avoir servi à mille usages, mais un trésor pour le gamin que j’étais. À coup sûr l’ancien couteau du grand-père. À la campagne, personne ne jette ce genre de compagnon de la vie de tous les jours. Recevoir un tel cadeau à huit ans représentait un gage de confiance, de maturité, quasiment un rite de passage à l’âge adulte. J’ai bafouillé un vague merci, le grand-père a tourné les talons sans un mot, les marques d’effusion n’étaient pas son fort, il leur préférait une réserve bourrue qui cachait mal une générosité à fleur de peau. Ce Coursolle, je l’ai gardé longtemps, il m'a été confisqué bien plus tard, très loin de Poissevin.
Elle s’appelait Louise. Mon père habitait chez elle depuis la scène mémorable du début de l’année, quand il avait annoncé à ma mère qu’il la quittait pour une autre femme. Il était venu me chercher trois semaines plus tard à la gare de Guérande où m’avait conduit le grand-père Jacques après que ma mère m’eut quasi banni de Poissevin. J’ai donc connu l’exil en train jusqu’à Couëron avec changement à La Baule-Escoublac.
— On va au Paradis, a marmonné mon père en descendant du tortillard.
— Où ça ?
— Au Paradis, a-t-il répété sans m’en dire plus, une de mes valises à la main.
Deux kilomètres à pied avant que je comprenne en apercevant, au bord de la Loire archipleine de la marée d’équinoxe, une modeste bâtisse à la façade pourvue d’une pancarte en bois défraîchie sur laquelle on déchiffrait avec peine « Café du Paradis ». Un bistrot miteux qui survivait grâce aux passagers du pompeusement nommé ferry-boat qui assurait la navette entre les deux rives du fleuve.
— J’ai soif. On va boire un coup en attendant le Saint-Julien. Un verre d’eau pour toi, une chopine pour moi.
— Le Saint-Julien, c’est quoi ?
— C’est le nom du bac qui fait la traversée jusqu’au Pellerin, a précisé mon père en ouvrant la porte du boui-boui.
Il n’y avait pas foule dans la salle enfumée, il a salué un buveur de sa connaissance et nous nous sommes attablés devant une fenêtre avec vue sur la Loire à travers des carreaux crasseux. En habitué des lieux, il n’a même pas eu à passer commande, une matrone mamelue lui a lancé du comptoir :
— Comme d’habitude, Élie ?
— Sûr ! Et un peu d’eau pour le môme.