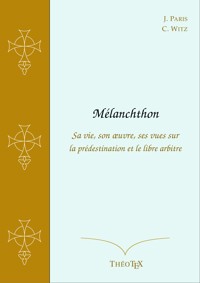
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Le doux Philippe Mélanchthon (1497-1560), ami intime du rude Martin Luther, a été un théologien de premier plan dans l'histoire de la Réforme ; son ouvrage principal, Les Lieux Communs, a été diffusé dans toute l'Europe, et réédité une vingtaine de fois de son vivant. Cette numérisation ThéoTeX regroupe deux thèses sur ce personnage d'exception, parues aux dix-neuvième siècle. La première, a été soutenue par Jean Paris, qui fut probablement pasteur à Gensac (en Gironde), et qui n'a pas laissé d'autres traces. Il expose une courte biographie de Mélanchthon, enfant surdoué d'un armurier nommé Schwarzert, puis les gigantesques travaux littéraires du jeune homme, devenu professeur de grec à Wittemberg. La seconde thèse est l'oeuvre de Charles-Alphonse Witz (1845-1918) qui a été pasteur à Vienne et auteur de nombreuses publications en allemand. Elle aborde un sujet délicat, puisqu'elle décrit le rejet progressif de Mélanchthon du déterminisme divin absolu qu'il avait d'abord adopté dans sa première édition des "Loci Communes" (1521). L'affaire en vint au point que Mélanchton eut à se défendre d'accusations de pélagianisme ou de semi-pélagianisme. A cinq siècles de distance on doit constater que le protestantisme évangélique a davantage retenu les vues modérées de Mélanchthon, que la négation intransigeante du libre arbitre humain des premiers réformateurs. Si aujourd'hui, plus par posture intellectuelle que par persuasion, l'extrémisme métaphysique connaît un certain regain de popularité, ce petit livre montrera que dès la naissance de la Réforme, un de ses plus importants acteurs avait su le mettre entre parenthèses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ce fichier au format EPUB, ou livre numérique, est édité par BoD (Books on Demand) — ISBN : 9782322485345
Auteur Jean Paris. Les textes du domaine public contenus ne peuvent faire l'objet d'aucune exclusivité.Les notes, préfaces, descriptions, traductions éventuellement rajoutées restent sous la responsabilité de ThéoTEX, et ne peuvent pas être reproduites sans autorisation.ThéoTEX
site internet : theotex.orgcourriel : [email protected]Nous n'avons pas la prétention de donner, dans ces quelques pages, une étude critique détaillée de l'œuvre et des doctrines de Mélanchthon. Un semblable travail réclamerait d'autres forces que les nôtres et dépasserait les bornes que nous nous sommes imposées. D'ailleurs, quand on veut regarder dans des existences comme celles des grands héros de la Réforme et de la pensée en général, si pleines et si fécondes, et surtout quand il s'agit d'un homme comme Mélanchthon, de son temps le docteur et le théologien de l'Allemagne, on se sent obligé de s'en tenir à des appréciations générales, sous peine d'avoir à écrire tout un ouvrage. Nous n'avons voulu faire qu'un simple « essai historique. » Parcourir rapidement la vie et l'œuvre de Mélanchthon, afin de faire ressortir le rôle qu'il a joué et l'influence qu'il a exercée parmi ses contemporains ; rappeler en quelques traits les principaux événements d'une carrière si agitée, et les juger sommairement dans leurs conséquences, tel est notre but. Dès lors, les charmes du détail eussent nui à l'harmonie de l'ensemble, et nous les avons supprimés.
Il faut faire deux parts bien distinctes dans les travaux de celui qui fut constamment l'aide et l'ami du grand apôtre de l'Allemagne, de Luther. Mélanchthon a été littérateur et philosophe, au moins autant que réformateur, et les traces qu'il a laissées dans l'enseignement universitaire ne constituent pas l'une des moindres parties de sa gloire : là même l'appelaient sa grande science et ses sympathies marquées. C'est dans sa chaire de professeur, dans le commerce de la jeunesse des écoles qu'il venait se reposer avec joie des luttes dogmatiques et des fatigues d'un combat qui déchirait son âme sensible et tendre. Pour être vrai et complet dans les limites de notre travail, nous aurons donc deux faces à étudier dans l'homme qui nous occupe : 1ole réformateur des lettres ; 2ole réformateur de la théologie.
Un mot seulement sur l'éducation de ses premières années.
Philippe Mélanchthon naquit à Bretten, ville du palatinat du Rhin, le 16 février 1497. Les biographes se sont fait un devoir de marquer la date précise ; et Melchior Adam rapporte que, de son temps, on lisait encore sur la maison où le réformateur était né, cette inscription :
Il était l'aîné des cinq enfants de George Schwarzerd, habile armurier d'Heidelberg. Dès sa plus tendre enfance, ses parents, gens pieux, s'appliquèrent à l'élever dans la crainte de Dieu et à lui donner une éducation religieuse, entachée sans doute des erreurs de l'époque, mais qui laissa dans l'esprit de l'enfant des impressions dont l'homme fut heureux de faire son profit. Son premier maître, Unger, homme distingué, lui enseigna la grammaire, et à l'école de Pforzheim où il fut placé chez une parente nommée Elisabeth, sœur du célèbre Reuchlin, il suivit les leçons de grec de George Simlera. Là, le jeune Philippe montra, par une étonnante application à l'étude, un esprit vif, une conception surprenante, ce qu'il serait un jour. Là aussi, il apprit à connaître Reuchlin. Ce savant célèbre, ravi des talents du jeune garçon, lui voua une affection paternelle ; il lui prêtait des livres, l'encourageait de ses conseils et le dirigeait dans ses études de latin et de grec. Ce fut lui qui, selon la coutume existant alors parmi les savants, changea son nom de Schwarzerd, qui veut dire terre noire, en celui de Mélanchthon, formé de deux mots grecs, μελας χθων qui a la même signification en grecb.
A l'âge de 13 ans, Mélanchthon fut envoyé à l'université de Heidelberg, où il s'acquit une telle réputation dans la connaissance des langues, qu'un de ses maîtres, malade un jour, le pria de le remplacer. A 14 ans il fut revêtu du grade de bachelier ; l'année suivante il demanda celui de maître ès-arts ; on le lui refusa, sous prétexte qu'il était trop jeune ; ce refus le détermina à quitter Heidelberg. A Tubingue, où il se rendit, il élargit le champ de ses travaux et étudia tout ce qu'on y enseignait, outre la théologie, les mathématiques, la médecine, l'astronomie. En même temps, il expliquait au public les grands auteurs latins dont il avait à rétablir les textes mal connus et défigurés.
Sur la proposition de Reuchlin, l'électeur Frédéric-le-Sage le nomma professeur de grec à l'université de Wittemberg. Il s'y rendit le 25 août 1518, et y prononça un discours sur les réformes à opérer dans l'enseignement, qui excita l'admiration de tous, en particulier celle de Luther.
C'est là que commence la vie publique de Mélanchthon. Fixé désormais à Wittemberg, devenu son centre d'action, il ne le quittera qu'à de rares intervalles, pour les seuls besoins de sa cause, et il y rentrera pour y mourirc. Dès ce moment, son œuvre se confond si bien avec sa vie, qu'il devient impossible au biographe de l'en séparer. En racontant l'une, nous ferons aussi connaître l'autre. Nous entrons donc dans l'étude de notre sujet.
Mélanchthon arrivait à Wittemberg précédé d'une grande réputation, annoncé à toute l'Allemagne intelligente par des savants dont l'autorité faisait loi et dont les éloges étaient enviés comme la plus haute des récompenses. Il n'avait pas trompé les prédictions d'Érasme qui, déjà en 1516, disait de lui : « Mon Dieu, quelles espérances ne peut-on pas concevoir de Philippe Mélanchthon, qui, quoique jeune homme et même presque enfant, possède une égale connaissance des deux langues ! Quelle sagacité dans l'argumentation, quelle pureté dans l'expression, que de lecture, quelle délicatesse et quelle finesse d'esprit ne trouve-t-on pas en luid ! » Et Mélanchthon avait alors 18 ans ! Trois ans plus tard, Reuchlin, qui l'avait guidé dans la carrière des lettres et qui, mieux que personne, avait deviné la valeur de cette pénétrante intelligence, écrivait à l'électeur Frédéric : « Je ne connais point d'homme en Allemagne qui lui soit supérieur, excepté Érasme, de Rotterdam, qui est hollandaise. » Aussi, fut-il vivement regretté à Tubingue ; et son ancien maître de grec, Simler, se fit l'écho de tous en s'écriant que la ville entière pleurait la perte qu'elle faisait, et qu'aucun des habitants de Tubingue n'avait poussé assez loin ses études pour pouvoir comprendre ce qu'ils perdaient par la retraite de ce grand hommef. Toutes les universités de l'Allemagne auraient voulu le posséder : quelques-unes essayèrent de l'attirer par l'offre d'une rétribution plus considérable : il avait donné sa parole à l'électeur Frédéric de rester à Wittemberg.
Le jeune professeur de 22 ans se mit sur-le-champ à l'œuvre. Son discours d'ouverture sur les réformes à apporter dans l'enseignement lui conquit l'estime et l'admiration de tous, et montra jusqu'où pouvait s'élever ce jeune homme à l'extérieur « pauvre », à la taille petite et fort peu imposante. Luther, qui était présent, comprit tout ce que la cause de la Réformation avait à gagner à l'acquisition d'un homme si nourri de science, dont le génie pénétrait si profondément la vérité, et qui, par son éducation et sa nature d'esprit, lui semblait appelé à une œuvre sœur de la sienne, l'indépendance et la réforme des lettres. Ces débuts le remplirent d'un enthousiasme qu'il ne put s'empêcher d'exprimer dans les termes les plus flatteurs pour Mélanchthon. Il témoigne, dans une lettre à son ami Spalatin, de l'accueil et de la gloire que l'orateur a obtenus, de l'étonnement où lui-même s'est trouvé en voyant tant de beaux dons s'allier à une apparence si chétive : « Habuit Philippus orationem plane eruditissimam, tan ta gratia et admiratione omnium, ut jam non tibi id cogitandum sit qua ratione eum nobis commendet : abstraximus cito opinionem et visionem staturæ et personæ, et rem ipsam in eo gratulamur et miramurg. »
Il y avait beaucoup à faire dans le champ de travail où Mélanchthon s'engageait. A part quelques esprits d'élite, la génération d'alors vivait d'un amas d'erreurs et d'ignorance. Les lettres étaient aussi négligées et défigurées que la religion : il fallait lutter contre les moines, qui ne pouvant faire partager aux princes l'éloignement ou la haine qu'ils avaient pour elles, s'efforçaient d'en éloigner les peuples ou d'en dénaturer le sens et la portée. Et les moyens de propagation manquaient ; les imprimeries étaient rares, les livres très chers et très rares aussi, les auteurs grecs surtout, comme le témoigne Vinshemius : « Je me souviens, dit-il, qu'après deux ans de séjour à Wittemberg, Mélanchthon expliquant les Philippiques de Démosthènes, nous n'étions que quatre auditeurs avec un seul exemplaire, celui de notre maître que nous étions forcés de copier sous sa dictéeh. » On sortait du moyen-âge ; le terrain n'était pas préparé. L'interprétation d'Homère, de Démosthènes, de Térence et des grands auteurs grecs et latins était pour le moins chose aussi nouvelle et aussi étrange en Allemagne que les dogmes de Luther.
Voilà, en deux mots, les difficultés que le professeur de Wittemberg avait à vaincre : il se mit à la tâche avec l'ardeur dont il était capable ; il s'y sentait appelé : aussi, le voit-on déployer dans ce rude labeur toutes les ressources de son esprit, tous les efforts d'une volonté doublée d'une conviction inébranlable. Ses amis, Luther en particulier, tout en lui témoignant leur admiration et leur dévouement, craignent pour sa santé et lui enjoignent, dans leur sollicitude, de se modérer et de réserver des forces pour l'aveniri. Mélanchthon, en effet, n'était pas seulement chargé du haut enseignement dans l'Académie ; il lui fallait descendre au rang de simple instituteur pour montrer à ses élèves les premiers éléments des langues : en même temps, il écrivait, publiait des traités, corrigeait des textes d'auteurs anciens oubliés ou entièrement faussés et dénaturés : « J'enseigne, dit-il, j'imprime des livres pour que les jeunes gens en soient pourvus ; je professe dans une école fréquentée pour leur apprendre à s'exercer. Déjà l'épître à Tite est sous presse. J'ai presque achevé un dictionnaire grec. Viendra ensuite une rhétorique. Après quoi j'entreprendrai la réforme de la philosophie, pour de là arriver tout préparé aux choses de la théologie, où, s'il plaît à Dieu, je rendrai quelque servicej. » Ajoutez à cela que Mélanchthon, poussé par son amitié pour Luther, était déjà engagé dans la cause de la Réforme ; déjà il en prévoyait les déchirements, et il gémissait tout haut de se voir arraché aux lettres et d'avoir à entrer dans la théologie, pour laquelle il ressentait une bien moindre affection. Et pourtant il suffisait à tant de travaux, dominant sa faiblesse, ses découragements, ses répugnances, par le sentiment de la nécessité et de la grandeur de sa mission. Ecoutez plutôt : « La vie de nos professeurs les plus occupés, dit M. Nisard, ne peut pas donner une idée de celle de Mélanchthon. Il faisait deux leçons par jour à l'Académie et probablement autant et de plus longues chez lui. Il prenait l'élève au sortir de l'enfance, le conduisant de degrés en degrés, des éléments de la grammaire jusqu'à l'étude de la théologie, qu'il regardait comme le couronnement de l'éducation littéraire. Il composait des grammaires grecques et latines, écrivait des traités élémentaires de toutes les sciences, distinguant dans chacune ce qui y appartenait naturellement de ce que la barbarie y avait importé d'étranger ou d'hétérogène ; séparant, par exemple, la philosophie de la théologie et la purgeant de ce grossier mélange des Ethiques d'Aristote et de l'Évangile, où l'on n'aurait su dire qui était Dieu, d'Aristote ou de Jésus. « Au reste, » ajoute avec raison M. Nisard, « il ne faut pas admirer sans réflexion une telle capacité de travail. Les forces de l'homme, à toutes les époques, sont mesurées à sa tâche. Or, du temps de Mélanchthon, on avait tout à faire et une foi en proportion de l'œuvre. La première moitié du XVIe siècle fut la période héroïque des temps modernes. Les travaux de l'esprit y sont les travaux d'Herculek. »
La sollicitude de Mélanchthon embrassait aussi l'ensemble de la vie et des travaux des étudiants de l'Université : il cherchait, par tous les moyens, à faire pénétrer en eux cet esprit nouveau dont il était animé. Il sentait que le meilleur moyen d'assurer l'avenir à ses idées réformatrices était de les semer dans le cœur de ceux qui portaient en eux-mêmes cet avenir. Toutes ses instructions à ce sujet portent l'empreinte de cette préoccupation. Mais ce n'était pas sans peine qu'il parvenait à imposer sa volonté. Des oppositions, des embarras journaliers et de toute nature lui venaient de la part des étudiants, des professeurs, ses collègues, ou des magistrats, et entre tant de personnes dont l'approbation était nécessaire, il était difficile d'obtenir un accord complet.
Livrés entièrement aux ressources de leur esprit et à leur conscience, les étudiants embrassaient certaines carrières sans discernement, sans prédisposition et parce qu'il en fallait une. Et là, ils erraient à l'aventure, selon le vent du jour et l'intérêt du moment, sans règle, sans but, sans expérience ; de là, des découragements nombreux, et par suite un abaissement général des caractères et du niveau scientifique et moral. Mélanchthon aurait voulu que les étudiants fussent entourés de plus de soins et de sympathie, qu'on veillât de plus près à leur développement intellectuel et religieux, que chaque professeur, en particulier, en prît un certain nombre sous son patronage pour les orienter dans leurs études, les guider dans la vie du secours de leurs lumières, de leur expérience, et cela « d'après les pratiques de la charité et de l'humilité de notre Sauveur. » Soit défaut d'intelligence ou jalousie, ceux-ci refusèrent de se charger d'une semblable tâche.





























