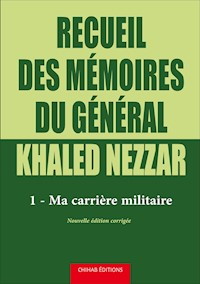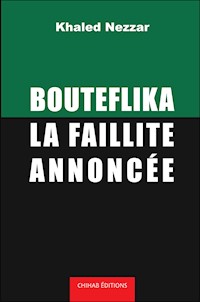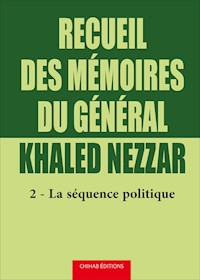MEMOIRES DU GENERAL
Khaled Nezzar
MEMOIRES DU GENERAL
Khaled Nezzar
Préface de Ali Haroun
Chihab Editions
Conception graphique : Chihab Editions
Illustration couverture : Lebcir Med Tewfik
Maquette de couverture : Nabet Messaoud
© Chihab Editions, 1999.
ISBN 9961-63-386-5
Dépôt légal : 4e trimestre 1999, n° 955 /99
A mes enfants
A mes petits-enfants
A ma famille
A mon épouse
A toutes les victimes du terrorisme.
Préface
Fin juin 1991, le gouvernement de Sid-Ahmed Ghozali, formé après une quinzaine de jours de consultations, entame enfin ses travaux. C'est alors que, pour la première fois, je rencontre le général Khaled Nezzar, ministre de la Défense.
Auparavant, je ne l'avais jamais vu. Il me semble même n'avoir pas entendu son nom, tellement je me désintéressais de toute activité politique depuis que la première Assemblée Nationale Constituante, où j'avais siégé comme député d'Alger, avait terminé sa législature. Nous subissions encore, durant les années 1963 et 1964, les effets néfastes de la crise de l'été 1962. Et comme nos visions respectives de l'appréhension du pouvoir divergeaient, il y avait naturellement peu de chance que nos parcours s'entrecroisent.
Assis tout près du chef du gouvernement, le ministre de la Défense se trouvait bien loin de moi qui me tenais à l'autre extrémité de la grande table ovale de la salle des délibérations. Au cours des six mois de ma participation au gouvernement, nous eûmes peu souvent l'occasion de nous entretenir.
Fin décembre 1991, l'Algérie est ébranlée par un séisme politique d'une ampleur inconnue sur l'échelle de Richter. Inéluctablement, la République allait tomber au pouvoir de certains, dont l'exploitation charlatanesque de la religion, poussée dans ses outrances extrêmes, inscrivait le nom de Dieu au fond d'un ciel serein par la vertu manipulée du Laser. Ils affirmaient a une jeunesse déboussolée que le Créateur leur manifestait son soutien par ce miracle divin, dont elle était témoin au stade du 5 Juillet. Le pays, déjà ébranlé par la régression socio-économique, menaçait de sombrer dans l'irrationnel, dont les prémisses se manifestaient, alors, par la «violence» quotidienne et l'intolérance obscurantiste.
Fallait-il se résigner et accepter le sort funeste qu'un scrutin discutable allait prescrire à un peuple berné et désemparé ? Chacun se trouvait alors confronté à sa conscience. Personne ne pouvait trouver, dans un confortable mutisme, le prétexte à fuir la nécessité d'opter, l'obligation de se situer face au devenir du pays qui, sous quinzaine, allait choir dans l'inconnu.
Lorsque, après le premier tour des élections législatives, se tient le conseil du gouvernement, l'heure de vérité devait sonner.
Boubekeur Belkaïd - avec sa lucidité et son courage habituels - affirme sa détermination à lutter de toutes ses forces pour sauver la démocratie et l'Algérie menacées de chuter dans les ténèbres d'une théocratie des siècles révolus. Plusieurs ministres abondent dans ce sens. D'autres se montrent plus circonspects. C'est alors que je découvre un ministre de la Défense que je n’imaginais pas. Khaled Nezzar estime que le résultat du deuxième tour allait entraîner, pour longtemps, l'exclusion de toute perspective de démocratie, de progrès, et rejeter l'Algérie hors du camp des nations civilisées qui feront le monde de demain. Il déclare sans ambages qu'il faudra, quelle que soit la décision du gouvernement, trouver le moyen adéquat pour éviter au pays cette régression programmée dont il ne se relèverait pas avant des décennies.
Il est des moments, dans la vie, où l'inévitable décision force l'âme a se découvrir dans toute sa nudité, son intime réalité. Et toutes ces qualités qui en font la grandeur, l'amour de la liberté, la tolérance et l'engagement jusqu'à l'extrême, pour la défense de ses convictions, ne résident pas toujours là où l'on croit les trouver1. Et je me surprends à reconsidérer les jugements formulés sur mes collègues.
Depuis, huit années se sont écoulées.
Aussi, lorsque le mois dernier Khaled Nezzar me demanda d'écrire la préface de ses Mémoires, tout en le remerciant de la confiance ainsi témoignée, je lui fis part de mes scrupules. Pour deux raisons, je n'en étais pas le rédacteur idoine. D'abord et avant tout, par manque de qualification militaire, n'ayant jamais fait partie de la carrière. Ensuite, nos parcours divergents depuis l'Indépendance - sauf au cours des deux années d'existence du HCE -, m'interdisaient de commenter ses analyses de stratégie politique internationale, et spécialement les événements qu'il a vécus au plus haut niveau de l'Etat.
Dès lors, ces pages de présentation se limiteront nécessairement à évoquer quelques chapitres de l'ouvrage, avec la conviction que les divers sujets traités, par leur variété, leur actualité et leur portée, ne manqueront pas de susciter l'intérêt d'observateurs plus avisés.
* * *
Il est indubitable que la publication des Mémoires du général-major Khaled Nezzar constitue une innovation dans notre pays contraint, pendant des décades, à ressasser les vérités officielles et dire des réalités politiques tronquées ou, à tout le moins orientées. Pour la première fois, le responsable de La grande muette s'exprime publiquement. Pour la première fois, un homme, que les circonstances avaient placé, à un moment donné, au sommet de la responsabilité étatique, relate des événements que, généralement, les Etats - même les plus libéraux - répugnent à divulguer avant de très longs délais. Aussi, faudra-t-il s'attendre à des appréciations divergentes et passionnées. Mais qui s'adresse au public s'attire la critique : la règle est constante.
Quoi qu'il en soit, dès les premières lignes de l'ouvrage, l'on découvre la sensibilité d'un homme qui, par cette tendresse filiale pudiquement abordée, s'avère capable d'ouvrir son cœur et dévoiler ses sentiments profonds, alors qu'il a pu paraître, aux yeux de certains, réservé, dur, peut-être bourru... enfin, d'une rigueur toute militaire. Il était bon, par ailleurs, d'évoquer cette école d'enfants de troupe de Koléa et de rappeler le nombre remarquable de ses anciens élèves rejoignant la lutte de Libération ou morts au combat. Les convictions patriotiques, nationalistes ou révolutionnaires n'ont, certes, pas éclos uniquement dans certains établissements prédestinés par la nature pour détenir le monopole du désir de liberté, d'émancipation et d'indépendance. De même, se trouvent opportunément rappelés le calvaire de ces Algériens enrôlés de force en 1916 dans l'armée coloniale française autant que ses tragiques conséquences dans les Aurès - comme à Tlemcen d'ailleurs - ce que la majorité de notre peuple semble ignorer aujourd'hui.
Tout cela gagnait à être dit. Sans complexe aucun.
Évoquée avec une grande sincérité, la carrière militaire de l'auteur n'est ornée d'aucune fioriture. Quant à ses analyses de stratégie générale, exposées parfois de manière abrupte, mais toujours avec conviction et sans jamais rechercher la polémique, des spécialistes en la matière ne manqueront sans doute pas de les réexaminer, avec tout le profit à tirer d'observations indispensables à l'étude des relations de l'Algérie avec l'ensemble de ses voisins africains et méditerranéens.
Quant aux faits relatifs au 19 juin 1965, les Mémoires, en fournissant des précisions inconnues jusqu'à ce jour, permettront de mieux en cerner autant les raisons profondes et les préparatifs immédiats, que les causes internes ou les implications extérieures. Que cette action ait été salutaire, comme l'affirme l'auteur, surtout au regard de l'activisme populiste et du spontanéisme désordonné du président de l'époque, on ne saurait sérieusement le contester. Mais, bien entendu, chacun est librede qualifier l'événement en fonction de sa propre vision. Toute tentative violente d'accès au pouvoir s'apprécie en fonction du résultat. C'est connu. Les coups de force qui réussissent sont des révolutions. Ceux qui échouent, des putschs. Et leurs auteurs sont criminels ou, pour le moins, factieux. Lorsque son juge d'instruction demanda au malheureux général Boulanger le nom de ses complices, il répondit : «Toute la France, y compris vous-même, Monsieur le juge, si j'avais réussi». Aussi convient-il de respecter ceux qui voient dans l'action du 19 juin un redressement révolutionnaire, à charge pour eux de tolérer d'autres qualifications. D'ailleurs, le temps est le grand éclaireur de vérité. Malgré les triomphes innombrables de l'épopée napoléonienne, le dix-huit brumaire, acte fondateur du pouvoir du Premier consul, n'est pas encore retenu comme un titre de gloire du futur Empereur. Aussi paraît-il nécessaire d'accepter nos mutuelles analyses, en attendant que, dans sa pérennité, l'Histoire se prononce.
Il était temps que l'on parlât enfin de cette armée des frontières autrement que par ouïe-dire ou à travers de vaines disputes, rarement engagées par ceux qui ont réellement vécu dans ses rangs. Dans son émouvante simplicité, est retracé l'héroïsme quotidien et discret de ces djounoud chargés de franchir le barrage avec le lourd armement destiné aux wilayate, de l'ouvrir au passage des responsables. Soutenant, entre les lignes Challe et Morice, un harcèlement permanent, ces hommes contraignaient l'armée coloniale à mobiliser trois cents mille de ses soldats le long des frontières, allégeant d'autant le fardeau qui pesait sur les maquis de l'intérieur. Le nombre de djounoud et cadres tombés au champ d'honneur ou grièvement blessés, explique éloquemment l'intensité des combats d'une armée qui n'est pas restée l'arme au pied, en attendant l'ouverture des barbelés électrifiés. Certes, les wilayas du centre ont, sans aucun doute, cruellement souffert du manque d'armement censé leur parvenir des frontières de l'Est et de l'Ouest. Mais que pouvait-on exiger de ces hommes dont chacun, traversant les lignes chargé de deux fusils, mille cartouches et deux obus de mortier, devait, pour parvenir à destination, parcourir, à pied, trois ou quatre cents kilomètres, au milieu des accrochages, embuscades, ratissages et autres bombardements de l'armée coloniale et dont la plupart tombaient en cours de route ?
Sans doute, l'auteur s'est-il fait violence pour raconter cet épisode regrettable de notre Histoire, où ses éléments se sont trouvés opposés, les armes à la main, aux djounoud des wilayas III et IV. Événement redouté par tous, il devait, malheureusement, marquer les premières semaines de l'indépendance algérienne. Pour le meilleur et pour ce qui ne l'est pas, notre passé récent ne saurait continuer d'être occulté aux yeux des nouvelles générations.
Pour revenir à ce passé, les éclaircissements fournis par les Mémoires quant aux événements d'octobre 1988, permettent de mieux se forger une opinion - complot ou manipulation - même si, pour certains, il ne sera guère possible d'infléchir une conviction déjà ancrée et scellée par le ciment de leur tendance partisane. Il est cependant réconfortant que, par la voix du premier de ses membres, qui, en même temps, se trouvait être ministre de la Défense nationale, l'ANP ait reconnu que les cas de torture révélés lors des événements d'octobre constituent «une salissure qu'il faudra s'employer à effacer». Comme il le déclare, seule une justice indépendante serait garante des droits imprescriptibles de la personne humaine, car la recherche de l'efficacité ne saurait excuser les infractions aux lois et l'atteinte à l'intégrité physique ou morale de l'individu. De même, l'éclairage est mieux centré, aussi bien sur les premières manifestations du terrorisme intégriste - ce que l'opinion n'ignorait pas totalement - que sur les différends du sérail.
Opposant, dans les années 1990-1991, le président de la République, le chef du gouvernement et le tout nouveau ministre de la Défense, ces différends avaient été, comme à l'accoutumée, sérieusement occultés.
Nombre de nos hommes politiques ou de faiseurs d'opinions n'ont pas manqué de scepticisme - et c'est leur droit - à l'égard de l'option républicaine et démocratique affichée par certains cadres de l'ANP. Certes, les comportements de casteprivilégiée, affichés par certains militaires durant les décennies de plomb, pouvaient justifier ces réserves. Il serait cependant injuste, aujourd'hui, de réfuter l'évolution bénéfique des mentalités au sein de l'Armée. Rédigé par les généraux Mohamed Lamari, Abdelmadjid Taghrirt et Mohamed Touati, le rapport de décembre 1990, transmis au président Chadli Bendjedid, se félicite de l'instauration de la démocratie à travers le multipartisme et la liberté de la presse. Il déplore, également, que certaines formations politiques à caractère religieux aient bafoué les règles du jeu démocratique, que le Fis en particulier ait pu, par la subversion, instaurer un climat d'insécurité et d'intimidation, porter atteinte aux libertés individuelles comme aux symboles de l'Etat, soumettre à sa mainmise les mosquées du pays en vue d'imposer un régime totalitaire par la dislocation de l'Etat démocratique... toutes perspectives auxquelles l'Armée ne saurait souscrire.
L'un des mérites des Mémoires, est d'avoir rendu publique cette position cardinale de l'Armée Nationale Populaire, permettant au lecteur de juger son orientation politique sur la base d'un document authentique. Prévoyant le développement des mécanismes de comportement basé sur l'irrationnel, le rapport de décembre 1990 prédit des résultats électoraux favorables à une majorité intégriste. Or, aux yeux des rédacteurs du texte - garants de la démocratie et du caractère républicain de l'Etat - l'avènement d'un tel régime est «manifestement inadmissible, car historiquement contraire à l'idéal de Novembre, juridiquement anticonstitutionnel et moralement antinationaliste». Décrivant longtemps à l'avance sa vision prémonitoire, que la suite des événements allait totalement confirmer, le rapport proposait une action urgente, préalable et salvatrice, susceptible d'éviter les désastres annoncés. Il ne paraît pas que les destinataires lui aient accordé l'importance qu'il méritait, ni donné la suite qu'il appelait. Aussi, pourrait-on mieux, aujourd'hui, situer les responsabilités des décideurs de l'époque.
En mai 1996, le général Nezzar, rompant le silence qu'il s'était jusque-là imposé, relatait les circonstances justifiant et nécessitant l'arrêt du processus électoral de janvier 1992. Cet événement a pesé lourd sur le devenir immédiat du pays. Il a divisé la classe politique dont une partie le qualifiait - et persévère encore aujourd'hui - de coup de force ou coup d'Etat. Cette analyse a sérieusement influé sur l'opinion publique étrangère, spécialement sur les grandes démocraties occidentales. Ainsi, les tenants d'une société théocratique soumise exclusivement à la loi divine, dont ils s'attribuaient d'emblée le monopole de l'interprétation, passaient aux yeux de l'Occident pour les véritables défenseurs de la démocratie, puisqu'ils invoquaient la volonté populaire exprimée le 26 décembre 1991. Ces mêmes fous de Dieu vouaient aux gémonies toute autre règle et toute constitution au nom de leur crédo «La mithaq, la destour, qal Allah qal Errassoul2»
Expliquer que l'arrêt du processus électoral ne constituait pas la condamnation du processus démocratique n'était pas aussi évident. Au nom d'un démocratisme idéal, fallait-il confier le pouvoir aux agents de l'intégrisme totalitaire, peu importe qu'ils aient clairement et préalablement annoncé leur résolution de tordre le cou à la démocratie, qualifiée expressément de kofr (impie) ? Aussi, pour tout analyste objectif, sauver la République et ce qu'elle implique en fait de respect des Droits de l'Homme, de promotion des libertés, d'acceptation de l'autre, ne saurait constituer un «délit» répondant à des «violences», malgré toutes les apparences contraires et les sophismes suicidaires.
Lorsque Boudiaf chargea certains d'entre nous d'aller éclairer les pays d'Europe occidentale, particulièrement réticents, sur les circonstances de la démission du président Chadli et la suspension des élections, l'accueil fut loin d'être compréhensif. Nos interlocuteurs européens ne pouvaient concevoir que l'islamisme politique allait nécessairement transformer notre démocratie balbutiante en dictature religieuse totalitaire. Pour eux, l'alternance droite-gauche ou conservateurs-progressistes, entrée dans les mœurs, ne menaçait en aucune façon les fondements essentiels de l'Etat et de la Nation. Il aurait suffi à la prochaine échéance électorale de voter différemment !... Evidemment, les porte-parole de l'intégrisme à l'étranger omettaient prudemment de rappeler, qu'une fois au pouvoir, ils ne prévoyaient plus d'élections, puisqu'ils appliqueraient la Sublime constitution : la chariâ. D'ailleurs, si la dawla islamiya3avait été proclamée, en permettre la substitution par quelque régime que se soit eut été un péché irrémissible.
Nous invoquions les précédents iranien et afghan, ainsi que les conséquences désastreuses d'un fondamentalisme perverti pour les peuples qui le subissaient. Nous rappelions comment d'un scrutin régulier peut naître un pouvoir despotique, capable de donner corps aux pires aberrations de l'esprit, s'il s'inspire d'une idéologie contraire aux normes actuelles de l'humanité. Nous évoquions la progression du nazisme dans la société politique allemande, son accession au pouvoir par la voie d'un scrutin parfaitement régulier, et la vanité de toute tentative de l'en exclure par la voie des urnes. Notre cas était particulier !...
Nous paraissions d'autant moins convaincants que les dirigeants du principal parti politique algérien condamnaient l'arrêt du processus électoral, que d'autres chefs historiques, dont la voix amplifiée par des organisations internationales puissantes et entendue à travers l'Europe, dénonçaient le scandale du coup d'Etat. Les représentants du FIS criaient à la trahison en exhibant le Journal Officiel algérien qui publiait - sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi dès lors que le second tour ne s'était pas encore déroulé - les résultats du scrutin et qui, au-delà du vieux continent, trouvaient des oreilles complaisantes aux Etats-Unis d'Amérique.
Mais à bien réfléchir, qu'en est-il des coups d'Etat ? Il est dans leur nature d’attenter aux victimes qui, par hypothèse, sont les détenteurs du pouvoir. Il est aussi de principe que le chef d'Etat déposé s'y refuse et, si sur le moment il craint de le manifester, il ne manquera pas de le dénoncer à la première occasion. L'histoire des successions violentes au pouvoir est parsemée d'arrestations, d'incarcérations, de confiscations, d'exils et, souvent, de mort des dirigeants écartés. Heureusement, pour le pays, il n'en fut pas ainsi en janvier 1992. Et l'ouvrage de Khaled Nezzar, qui relate avec une précision inédite cet épisode déterminant de notre passé récent, permet de relever qu'aucune des caractéristiques néfastes du coup de force ne s'y retrouve.
En réalité, il semble bien que les protagonistes se soient résolus, devant les conséquences prévisibles immédiates du vote du 26 décembre, à la seule issue possible, dans le cadre du respect des institutions constitutionnelles : la démission du président. Y a-t-il été contraint ? Les Mémoires rapportent les quatre entrevues avec le président de la République précisant qu'à la troisième - le lundi 6 janvier 1992 - il manifesta son intention de se retirer, confiant à l'Armée le soin de trouver la solution convenable, recommandant «d'éviter toute chaouchara» (grabuge). Après ces révélations, peut-on encore, de bonne foi, qualifier de coup de force ou de coup d'Etat la démission du président et, par voie de conséquence, l'arrêt du processus électoral ? Certes, Chadli Bendjedid ne s'est pas exprimé. Il se maintient dans la réserve qui sied aux hommes investis des responsabilités suprêmes. Aussi, nos hommes politiques feraient-ils mieux de manifester plus de sérénité dans l'appréciation des graves événements contemporains qui ont traumatisé la société et failli ensevelir la République.
Une dernière remarque.
Parfois, le vocabulaire des Mémoires pourrait paraître d'une franchise brutale et l'expression sans doute cavalière. C'est, semble-t-il, moins de l'impertinence qu'une manière abrupte de dire la vérité. Je n'ai pas manqué d'en faire part à l'auteur qui, dans sa réponse, ne semblait animé d'aucun désir de choquer ni, encore moins, de nuire à quiconque. Mais, à l'occasion, il me rappela cette anecdote. Lors de la Seconde Guerre mondiale, le général Patton fut informé que la copie de ses notes destinées au quartier général d'Eisenhower serait désormais acheminée au chef de l'état-major des forces armées américaines, le général Marshall, particulièrement pointilleux sur le langage. Il lui appartenait dès lors de bien surveiller son vocabulaire. A la veille de pénétrer en Allemagne, à la tête de ses blindés, Patton rédigea son rapport et l'expurgea consciencieusement de tous les termes un peu crus qui, habituellement, émaillaient son texte. Au moment de le transmettre, il crut devoir ajouter une information. En bas de page, il précisa en post-scriptum : «Dans moins d'une semaine, je pisserai dans le Rhin !»...
Il n'est certes pas dans la vocation habituelle des militaires de terminer leur carrière à l'académie des belles lettres.
Ali HAROUN
Alger, le 23 septembre 1999
CHAPITRE I :A mon père qui m'a tout donné
C'est au douar Thlet, à Seriana, que je naquis un 25 décembre 1937. Les colons donnèrent à Seriana le nom de Pasteur, dont le buste se dresse jusqu'à présent au milieu du village. Je n'oublierai jamais cette journée mémorable del'Indépendance lorsque les moudjahidine, descendus du maquis, prirent la statuette pour cible après avoir fini de détruire le Monument aux morts. Attachée à une corde, la statuette, traversée par deux balles dont elle garde toujours les stigmates, fut traînée sur la place du village jusqu'à ce que les sages eussent appris à la foule excitée qui était Pasteur. Le savant supplicié fut alors remis à sa place.
Je me souviens aussi que les instituteurs avaient pour habitude de lire, à chaque rentrée scolaire, la lettre qu'avait écrite Pasteur aux élèves du village. Mais de la lettre, je ne sais ce qu'il est advenu.
Ma famille tire ses racines de deux hameaux de cette région qui relève de la commune mixte d'El-Ksar, actuellement Tahammemt, dénommés Lemtaras et Leqlalat. Quand ma mère mourut en 1944, mes grands-parents prirent soin de moi jusqu'à ce que mon père se fût remarié. La vie était dure pour les habitants de la région. Elle l'était d'autant pour ma famille qui vivait du cheptel, de maigres vergers et de ce qu'elle pouvait tirer d'une terre très aride.
Mon père, de son prénom Rahal, venait de terminer son service militaire. La Seconde Guerre mondiale battait son plein. Il s'attela à un petit commerce et se mit à l'élevage. Mais il montra ses limites de commerçant et abandonna cette activité quelque temps plus tard. Il se mit alors, avec un de ses compagnons, à l'élevage et fut, là aussi, rattrapé par la malchance. Le charbon, maladie incurable à l'époque, avait décimé en une semaine la totalité de son cheptel. Mon père s'essaya alors à la boucherie. Mais les crédits impayés finirent par avoir raison de son commerce.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il se fit employerpar la commune à titre temporaire. Comble de dérision, pour lui qui fut sous-officier, titulaire de la Médaille militaire et de la Croix de guerre et qui passa quinze ans dans l'armée française. Aidé par un autre employé, il avait pour tâche la réfection de la voirie et l'entretien des écoles. Il s'occupait également de menus travaux de la commune et des chantiers de chômage. Tout ceci contre un maigre salaire en sus d'une pension militaire du même ordre.
Avec ce salaire dérisoire, il devait subvenir aux besoins d'une famille composée de 14 membres. Mon père colmatait les brèches en cultivant des légumes dans un jardin et en entretenant un poulailler et un clapier.
Alors qu'il était dans l'armée, mon père apprit quelques méthodes de soins rudimentaires. Ces connaissances lui permirent de soigner les malades, nombreux en ces temps de guerre. D'ailleurs, il me vient toujours à l'esprit les Chroniques des années de braise qui montre les affres du typhus à cette époque. Je me rappelle ces voisins qui enterrèrent leur fille le matin, puis leur fils l'après-midi. Je me souviens aussi qu'un piquet d'alerte avait été mis sur pied à l'intérieur du cimetière, qui fut chargé d'enterrer les victimes en nombre incalculable.
Durant ces années de braise, mon père se démena avec les autorités françaises. Il organisa une soupe populaire dans le village et s'affaira à soigner les malades qui formaient une longue chaîne devant notre maison. Il les soignait avec les moyens du bord. Du Permanganate de Potassium, au mieux. Il utilisait les antiseptiques qu'il pouvait avoir sous la main et traitait les plaies de tous genres en apparence bénignes mais qui ne pouvaient que s'aggraver faute d'hygiène. Il réduisait les fractures à l'aide d'attelles et préparait, pour les traumatismes des membres inférieurs et supérieurs, de l'eau chaude salée, puis prescrivait une cure étalée sur plusieurs séances. Perspicace, il flairait les cas graves et enjoignait aux parentsde transporter le malade vers Batna. Un jour, le voyant extraire une dent à un villageois, je lui demandai s'il ne prenait pas trop de risques. Il me répondit, souriant : « Si la dent ne bougeait pas, je ne l'aurais jamais touchée ! ».
Au débarquement des Américains, la situation d'une partie des Algériens s'améliora un tant soit peu, à partir du moment où certains des villes et villages avaient la chance de s'approvisionner en denrées de première nécessité. C'était l'année des bons d'approvisionnement. Dans les campagnes, la majeure partie de la population continua à souffrir dans le plus grand dénuement. Au comble de la misère venait s'ajouter l'envahissement du territoire par les sauterelles qui ravagèrent le peu de récoltes. Les autorités qui voulaient les combattre à l'époque, utilisèrent un insecticide mélangé à du son. La lutte anti-acridienne emporta le peu qui restait de l'élevage.
Mon père a passé le plus clair de sa vie à œuvrer pour le bien. Même âgé, il se porta volontaire pour l'entretien de la mosquée du village. Il se levait au petit jour pour annoncer la prière. Je me rappelle que durant le mois de Ramadhan, il prenait sur lui d'annoncer la rupture du jeûne aux douars environnants, en tirant au canon de fête. Les gens étaient trop pauvres, à l'époque, pour pouvoir disposer d'une montre. J'entendais souvent les habitants du village dire que Rahal travaille pour le jour du Jugement dernier.
En 1974 encore, les malades recouraient à lui pour des injections, au point que la famille le lui interdit. Il avait pris de l'âge et sa vue avait faibli. Nous l'avertîmes un jour que ce qu'il faisait était risqué. Il s'en abstint depuis.
J'étais à Biskra à la tête de l'Ecole des forces spéciales au début des années 70 lorsqu'un jour, une délégation de sages du village accompagnés du maire, vint me demander d'intercéder auprès de mon père pour qu'il reprenne son activité médicale. Je leur répondis que ce qu'ils demandaient était impossible car quelque erreur pouvait s'avérer fatale pour le malade.
Féru de chasse - il chassait encore à l'âge de 78 ans - il distribuait la majeure partie du gibier à l'entrée du village. Et je me souviens qu'étant jeune, alors que je l'accompagnais, je priais Dieu qu'il ne chassât pas le lièvre car j'eus eu la charge de le porter tout le temps que devait durer la chasse. Mais il faut dire que les quelques moments de répit que nous prenions dans un coin du verger familial, au milieu des chênes, bercés par le clapotis de l'eau ruisselante, nous procuraient un plaisir immense. Nous cassions la croûte avec ce que nous avions sous la main. Il nous arrivait aussi de profiter de l'hospitalité de la famille qui prenait la peine de nous ramener un repas chaud, du mieux qu'elle pouvait.
Mon père mourut à l'âge de 82 ans. J'étais à Tindouf et j'appris la nouvelle en retard. Décédé à la maison, son corps dut être transporté à la morgue le temps pour moi de regagner le village pour assister à son enterrement.
Tout ce que fit mon père de son vivant émanait de cette tendresse qu'il cachait dans son for intérieur. Le villageois qu'il était ne laissait jamais transparaître un sentiment de faiblesse. Mon père ne m'embrassait que rarement mais il aimait bien me prendre par la main quand il se promenait dans le village ou au souk.
J'entrai à l'école tardivement. J'avais huit ans. La guerre avait poussé les écoles à fermer. J'avais appris une partie du Coran en même temps que j'acquis l'alphabet latin. Mon père m'avait inculqué le peu de français qu'il avait appris durant son passage dans l'armée française. Je n'oublierai jamais ma première leçon. L'instituteur avait écrit sur le tableau : «Décembre 1945». J'allai à l'école indigène qu'on appelait l'école el-fouqania,car perchée sur les hauteurs du village.
Il me fallait marcher deux kilomètres pour y arriver. Les «enfants des Arabes», que nous étions, étudiaient la tête rasée par crainte de propagation des poux. Les conditions étaient très difficiles. Je pus rejoindre la seconde école deux années plus tard, mais je ne sais si cela avait été rendu possible grâce à mes efforts ou parce que mon père avait servi dans les rangs de l'armée française. Il est possible que les deux raisons aient concouru à mon inscription dans une école réservée aux fils de colons.
Après quatre années d'études, je réussis à passer l'examen de la sixième, que nous appelions l'examen de la bourse. J'avais, à cette époque, deux instituteurs exceptionnels : Monsieur Burochau ne cultivait pas de sentiments racistes à notre égard. Je me souviens qu'il est resté jusqu'à l'Indépendance. Il avait été appelé à enseigner à l'école el-fouqania. Les habitants de Seriana lui avaient réservé un accueil chaleureux.
Monsieur Burochau se consacra avec son épouse, qui avait ouvert bénévolement une école de couture pour les filles,aux garçons du village qu'il encourageait à exercer des activités sportives. Joignant le geste à la parole, il décida d’aménager un stade et forma plusieurs équipes.
Les enfants pratiquaient le football et l'athlétisme entre autres. Il organisait des excursions et des randonnées dans la montagne avoisinante où il mettait en pratique les leçons de sciences naturelles qu'il dispensait en classe. Nous le voyions porter sa pioche sur l'épaule, arrachant des épineux, azezzou en berbère, qui allaient servir à allumer le poêle durant l'hiver rigoureux des Aurès. Nous rentrions ensemble, lui la pioche toujours sur son épaule, nous les épineux sur les bras. Mes études dans la seconde école durèrent deux années.
L'institutrice, Mademoiselle Calvière était née au village. Sa mère, meunière, était en même temps le scribe bénévole du village.
Mademoiselle Calvière était persuadée que j'étais en mesure de passer l'examen de la bourse et elle m'aida pour cela. Elle me prenait chez elle après l'école et me donnait des cours supplémentaires. Cela prenait environ deux heures par jour. Elle m'offrait souvent du café et parfois même du chocolat.
Les cours étaient chargés au point où nous étions surmenés. Nous allions à la mosquée tôt le matin apprendre le Coran jusqu'à huit heures, ensuite nous nous dirigions vers l'école avant de revenir à la maison manger un bout de galette. Direction l'école française, puis de nouveau l'école coranique jusqu'à la tombée de la nuit. Quand je me plaignais à mon père de ce rythme effréné, il me répondait : «Le français c'est la langue du pain, le Coran celle de la religion». C'est comme cela que les Algériens percevaient les choses à cette époque.
De tous les élèves de Seriana, seuls deux avaient réussi à poursuivre leur enseignement hors du village : le fils d'un paysan aisé et moi-même. Je me souviens que le paysan avait envoyé son fils à Batna où il n'y avait que deux collèges, l'un technique, l'autre moderne. Mon père était trop pauvre pour pouvoir m'acheter l’indispensable trousseau et encore moins m'assurer les frais de transport et autres dépenses. Je ne pouvais donc aller à Batna.
Mademoiselle Calvière proposa à mon père de m'envoyer à l'école des enfants de troupe qui se trouvait à Miliana, avant d'être transférée à Koléa, près de la capitale, pour devenir après l'Indépendance l'Ecole des cadets. Mon père acquiesça. Je lui en étais reconnaissant quand bien même sa décision avait pour conséquence mon enrôlement sous les drapeaux français pour cinq ans. Je savais l'expérience amère de mon père dans l'armée. Si amère qu'il dut l'interrompre. Il nous disait : «J'ai jeté le bâton et m'en suis allé». Il fut enrôlé de force à l'âge de dix-huit ans. C'était en 1916, à l'époque du soulèvement des Aurès contre l'embrigadement forcé des Algériens dans l'armée française qui les envoyait au front durant la Première Guerre mondiale.
C'était «l'année des Sénégalais». Il existe d'ailleurs un endroit situé entre Oued El-Ma et Seriana appelé « La grotte que décima le chant du coq», en berbère thakliâth yekhla ou gazidh. Les anciens racontent que les soldats français campaient dans les parages lorsque les habitants qui s'y étaient réfugiés avec leurs animaux furent trahis un matin par le chant d'un coq. Sommés de sortir, ils se défendirent farouchement, les hommes utilisant les quelques armes dont ils disposaient, les femmes jetant de l'eau et de l'huile bouillantes sur les militaires. Ils furent massacrés hommes, femmes et enfants. A la même période, les pères de familles furent arrêtés et conduits à la prison de Batna. Les forces d'occupation exigèrent, en contrepartie de leur libération, l'engagement d'un membre de la famille dans les rangs de l'armée. Ce que fit mon père, contraint. Il se retrouva, après deux mois d'instruction militaire à Batna, dans le feu de la guerre à Verdun et Douamont, en France, puis au Maroc et en Syrie. Il fut rappelé en 1939, mais son enrôlement ne dura qu'un mois.
Attendant un quatrième enfant, il fut exempté. Il était retenu à la caserne de Batna dans la perspective d'être mobilisé sur le front avec le grade d'adjudant. Moins d'un mois après, il reçut l'acte de naissance de son quatrième enfant et fut démobilisé conformément à la loi. J'avais à peine deux ans, à cette époque.
A Koléa, tout était fait pour que nous ne dépassions jamais le grade de sous-officier. L'administration de l'école usait de tous les subterfuges pour ralentir notre cursus en nous faisant refaire l'année pour une raison ou pour une autre.
Plus nous avancions dans les études, plus nous prenions conscience de ce qui se passait autour de nous. Cette prise de conscience s'est affinée au déclenchement de la Révolution de Novembre 1954.
Je n'étais pas en âge de m'intéresser au mouvement national, ni de comprendre ce qui se passait dans le monde des grands. Mais je me souviens que les habitants du village parlaient avec fierté de la révolte des Algériens à Sétif, Guelma et dans d'autres régions du pays, en mai 1945. Ils étaient tout heureux d'apprendre la nouvelle.
C'est dans les monts de Belezma que le soulèvement contre l'embrigadement forcé eut lieu en 1916. Les Aurès c'était aussi le fief des révoltés que l’armée coloniale appelait les menafguia. Dans les Aurès, on était sur le qui-vive. Quelque chose devait se préparer.
Les habitants eurent vent des massacres et apprirent que 45000 Algériens tombèrent. Je me souviens qu'à Seriana, il y avait un «deuxième bureau» comprenant des militaires français et quelques goumiers venus d'autres régions. Ils terrorisaient les villageois en appréhendant chaque jour trois ou quatre Algériens, mains liées. La nuit, on entendait des coups de feu et le matin on retrouvait leurs corps gisant à même la place du village.
Quatre habitants du village, militants du FLN, s'engagèrent comme supplétifs et, moins d'un mois après, profitant du manque de vigilance des soldats français, volèrent les armes des militaires et rejoignirent le maquis. Des quatre, Boudiaf Amor, Aïchour Mohamed Salah, Announ Mokhtar et Abdesselam Tayeb, trois sont encore vivants.
Je voudrais évoquer également l'histoire d'Ahmed Imerzouguène qu'on surnommait, au maquis, Si Ahmed El-Jadarmi. Je le revois toujours debout, dans sa tenue militaire, isolé du reste du groupe. Aidé par les maquisards de la région, il avait tué tous les gendarmes et pris leurs armes. Seul le chef absent ce soir là fut épargné.
Si Ahmed donna beaucoup à la Révolution dans la Wilaya I et monta en grade jusqu'à être nommé à la tête d'une unité spéciale. Mission qu'il accomplit jusqu'à sa mort. Le jour où tombait Si Ahmed à Djebel Ouastili, les autorités colonialesexposèrent son cadavre au village et forcèrent hommes, femmes et enfants à méditer sur le sort réservé aux «fellagas» en les faisant tourner autour du cadavre.
Bouzid, un autre chahid du village, fut retrouvé mort dans la décharge du village, en face de la laverie communale, la tête fracassée. «Les soldats de l’armée coloniale lui avaient placé un bâton de dynamite dans la bouche avant de le faire exploser», me racontait mon père.
Je me rappelle aussi du khodja du village. Arabisant, il assurait la tâche de secrétaire du caïd. Quand le khodja se déplaçait dans les villages et les hameaux pour procéder au recensement des populations, je l'accompagnais durant les vacances et reportais les données en français. Il agissait en véritable commissaire politique, tant il parlait aux Algériens de la Révolution et de l'avenir du pays.
Lorsque les autorités coloniales apprirent que le khodja était chargé d'approvisionner l'ALN dans la région, elles essayèrent de lui soustraire des informations sur les positions et les refuges des moudjahidine. Il fut torturé mais ne divulgua aucun secret. Il fut tué en essayant de s'échapper.
Cela faisait longtemps que notre hameau, base de soutien des moudjahidine, était ciblé par l'armée coloniale. Je fus réveillé un matin par le bruit d'hélicoptères qui volaient en direction de Lemtaras. Mon père, qui avait compris de quoi il s'agissait, se dirigea vers le square du village pour mieux observer ce qui s'y passait. Je restai toute la journée en sa compagnie à regarder de loin les mouvements de véhicules et d'hélicoptères français. L'armée ramenait des hommes de la montagne vers un point appelé Lemzara puis, après triage, libérait une partie et embarquait l'autre dans des camions en direction de Batna.
Ce jour-là, beaucoup furent tués sur place. Il y avait parmi les morts, trois frères. C'étaient mes cousins et ceux de mon père. Ceux qui échappèrent à la mort, étaient déjà au maquis ou le rejoignirent.
A la fin de la Révolution, ma famille comptait des dizaines de morts dans ses rangs, tombés au champ d'honneur, mon frère aîné Mokhtar fut emprisonné et torturé aux moyens électriques.
La dernière fois que je vis mon oncle paternel Merghad, dit El-Hadj, il était emmené dans un GMC en direction du camp de regroupement de Djorf. Je le reconnaissais à sa grande silhouette et à sa barbe rousse. Relâché avec obligation de se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie, il prit le maquis quinze jours plus tard. Il tomba au champ d'honneur deux mois et demi avant le cessez-le-feu, alorsqu'il était aux prises avec l'ennemi. Ses compagnons racontent qu'il tirait au fusil-mitrailleur posé sur les épaules d'un djoundi.
Je peux dire que le premier révolutionnaire activant dans les rangs de l'ALN tombé au champ d'honneur, le fut à Seriana. Il s'appelait Mezoudji Ahmed, dit «Grourou», originaire d'Ichmoul dans la daïra d'Arris. Cela s’est passé le 13 novembre 1954, lorsque l'attaque de Grine Belkacem eut lieu. Certains parlent d'un premier chahid à Mostaganem, mais je ne pense pas qu'il eût été militaire. Loin de moi, toutefois, l'idée de semer le doute dans l'Histoire de mon pays.
Je me dois de rappeler aussi que Si Laïb Amor, du village, fut le premier à rentrer dans la caserne des Spahis de Batna avec Si El-Hadj Lakhdar et son groupe, le 1er novembre 1954, afin de récupérer des armes.
Seriana ne tarda pas à comprendre que la lutte armée avait commencé, la nuit du 1er novembre, lorsque les colons se regroupèrent dans la salle des fêtes le soir, les armes à la main. Jusqu'au 13 novembre, les habitants n'avaient pas encore su que la Révolution venait d'être déclenchée le 1ernovembre. Durant ces treize jours, les colons organisèrent une garde d'une dizaine de personnes équipées de bâtons mais qui se sauvèrent dès qu'elles comprirent qu'elles faisaient face à une véritable Révolution dans une région réputée pour ses multiples soulèvements.
Cette nuit-là, un garde champêtre et un colon, Vezon, furent, le premier tué et le second blessé. Vezon était mécanicien et meunier mais il était devenu du jour au lendemain un riche propriétaire terrien. Il s'était associé avec un Algérien. Parce que Français, il avait droit aux crédits de la Maison de l'Agriculture.
En août 1955, j'étais en vacances quand je vis pour la première fois des B29 - des bombardiers quadrimoteurs - bombarder les montagnes avoisinantes. Je garde en mémoire aussi les camions chargés de Marocains, des tabors vêtus de leurs kachabias rejoindre leur pays au lendemain de l'Indépendance de la Tunisie et du Maroc, en 1956. Les Marocains retiraient leurs hommes qui avaient activé en Algérie dans les rangs de l'armée française entre 1954 et 1956.
Je ne pourrai jamais oublier l'image de deux frères dont les corps étaient criblés de balles. C'était en août 1956, la veille de l'Aïd el-Fitr. Je revenais de Strasbourg, en France, où j'avais pris mes vacances d'été. Un matin, je remarquai une effervescence inhabituelle des habitants du village et vis des soldats français, descendus de la montagne, se désaltérer à la fontaine. Ils revenaient d'une embuscade qu'ils avaient tendue la veille. Nous retrouvâmes les corps des deux enfants cachés dans les buissons près d'une source. A la vision des douilles éparpillées, nous comprîmes alors que les soldats français avaient vidé leurs chargeurs sur deux garçonnets, l'un âgé à peine de dix printemps, et l’autre ne dépassait pas quinze ans. Les deux frères étaient partis remplir un peu d'eau pour préparer du sirop que leur père, rentré tard ce soir-là, venait d'acheter à l'occasion de la fête.
Le jour de l'Indépendance, je revenais de Bouhadjar. En rentrant chez moi pour la première fois, je fus choqué par ce qu'il était advenu de mon village. Seriana était triste à voir. J'apprenais que de ma grande famille de moudjahidine peu avaient survécu à la guerre. Je ne retrouvai que des femmes, des enfants et des chèvres. Je ne pus supporter cette image désolante. J'étais désarmé face à cela pensant au fond de moi-même que le village étant une même famille, tous devaient évoluer ensemble.
Quand la guerre de libération éclata, je terminais ma dernière année à Koléa. Nous étions à cette époque conscients de la situation, tant la politique avait investi les écoles. Bien sûr, la plupart des enseignants faisaient de la politique mais à leur manière. A Koléa, il n'y avait qu'un seul enseignant algérien. Monsieur Mohamed Saïd Aoudjehane qui entretenait d'excellents rapports avec les élèves. Il adoptait un comportement patriotique exemplaire et marquait ses cours de maths d'une empreinte subtile. Aux faibles, il disait : «Ils feront de toi un caporal ; tu ne distingueras pas ta gauche de ta droite et ils te mettront un balai dans la main gauche et un fusil dans la main droite et te répéteront à l'oreille «Fusil ! Balai ! Fusil ! Balai ! et ainsi de suite». Monsieur Aoudjehane jouissait d'une intelligence peu commune et d’une très grande pédagogie. Sans se référer aux livres, il nous dictait des exercices, fredonnant au passage un air kabyle tout en recherchant l'énoncé du problème. Compétent, il remplaçait souvent le principal de l'école. Quand nous lui demandions pourquoi il ne se présentait pas à l'examen d'agrégation, il nous répondait, évasif, que son statut d'Algérien ne le lui permettait pas. Déjà en 1916, le Code de l'indigénat faisait que mon père, qui était sous-officier, percevait un salaire inférieur à celui de son homologue français et n'avait pas droit au salut d'un subalterne français.
En 1962, je rendais visite à Aoudjehane en compagnie de Bekka, Guenaïzia et d'autres camarades au lycée Duverrier (Ibn Roshd actuellement), à Blida. Il était très heureux de nous revoir. «Cela ne m'étonne pas de vous», s'exclama-t-il. Plus tard, il fut, je crois, nommé directeur de l'école polytechnique d'El-Harrach.
Au déclenchement de la Révolution, la plupart des enseignants appelaient à une Algérie française. L’un d’eux, Mr Baufaron, enseignant de français, avec son accent bourguignon, vidait sa rancœur sur les Algériens. Il aimait à répéter à celui qui voulait bien l'entendre : «Donnez-moi donc une Jeep et une mitrailleuse, et je traverserai les Aurès !». Les élèves, du fond de la classe, réagissaient en murmurant. Parmi eux, je me rappelle, il y avait Azzoune, originaire de Koléa, Salim Saâdi, devenu plus tard officier de l'ALN puis de l’ANP, et plusieurs fois ministre. Et l'enseignant de renchérir : «C'est ça, murmurez !» Ainsi, les punitions et les brimades pleuvaient.
A Koléa, comme dans les autres lycées et collèges, certains élèves prirent fait et cause pour l'appel du 19 Mai 1956. Ils durent interrompre leurs études et rejoindre les rangs de l'ALN. Au maquis, je rencontrai quelques-uns de mes camarades, «Ali Al-Qahira» et Benacer Abdelwahab qui termina sa carrière comme colonel de l'ANP. «Ali Al-Qahira» était surnommé ainsi parce qu’il fut envoyé au Caire pour une courte période de formation. Benacer Abdelwahab avait subtilisé le pistolet de son père, garde champêtre, pour rejoindre, lui aussi, le maquis à l'âge de quinze ans. Un troisième, dont la renommée s'étendait sur toute la Wilaya V, dirigeait un groupe de commandos. Ce ne sont là que quelques-uns parmi des dizaines d'élèves qui sont morts au maquis ou qui ont accompli leur devoir durant la guerre de libération.
J'avais dix-sept ans et demi quand je rejoignis l'école de Strasbourg pour y effectuer une année de formation. Je devais revenir à Koléa pour une autre année d'enseignement général qui devait s’achever par un concours. Au terme de celui-ci, je devais retourner à Strasbourg puis à Saint-Cyr pour une autre année, ce que l’on appelait à l'époque le «cycle long». Mais je ne revins pas.
J'avais eu l'occasion, au moment où je quittais Strasbourg, de profiter de la «promotion Lacoste». Lacoste voulait, par cette mesure, renforcer l'idée du maintien de l'Algérie sous le joug colonial et permettre à des Algériens d'accéder à des postes de responsabilité. Je fus choisi parmi ceux qui devaient, après leconcours à El-Harrach, rejoindre Saint-Maixant. C'était en 1956.
Alors que je passais quelques jours de vacances avant de rejoindre ma nouvelle école en France, des moudjahidine m'approchèrent par le truchement de mon cousin El-Djamî, plus âgé que moi, tombé depuis au champ d'honneur, pour me demander de déserter les rangs de l'armée française et rallier la Révolution. J'eus pour première réaction de me confier à mon père. Il en fut très touché. Il me voyait mal monter au maquis à mon âge, d'autant, ressentait-il, que beaucoup de membres de ma famille avaient déjà pris les armes. Autant le sentiment de mon père était compréhensible, autant je ne tardai pas à prendre la décision de me mettre aux côtés des moudjahidine. Mais cela devait se faire loin de Seriana.
A vrai dire, je vivais déjà la Révolution à l'école et au sein de ma famille. Une question me taraudait sans cesse l'esprit : comment se peut-il que je combatte les miens ?
Cinq des cousins germains de mon père, tous frères, étaient soit morts au combat, soit combattaient dans les rangs de l'ALN. Pendant qu'un sixième avait fui en France. Un jour, alors que j'étais encore à Strasbourg, je reçus la visite de ce cousin que j'appelais «oncle Bachir» parce que plus âgé que moi. Toujours en vie, il a plus de quatre-vingts ans aujourd'hui. Il avait troqué son chèche qu’il ne quittait jamais contre un béret basque. Il m'informa qu'il était détenteur d'un message pour mon père. «Hadj Lakhdar, me dit-il, m'a envoyé une lettre dans laquelle il me menace pour avoir quitté le village sans en avoir été autorisé». Hadj Lakhdar était chef de zone dans la Wilaya I.
J'allai à Ville-Rupt, en Moselle, voir le cousin de mon père Bachir, durant les vacances, puis je revins lui rendre visite une seconde fois, lorsque j'appris qu'il avait été arrêté par les forces coloniales. Il collectait des fonds pour la Révolution ; emprisonné jusqu'en 1962, il ne fut libéré de la prison d'El-Mellaha, près de Annaba, qu'à l'Indépendance.
Ce jour-là, je rencontrai des gens de Seriana. Certains avaient fait l'école primaire avec moi. Il y avait, je me souviens, Lakhdar Haddad, aujourd'hui retraité de la Police, et d'autres camarades. Haddad se confiait souvent à moi et ne se séparait jamais de son pistolet qu'il cachait sous son matelas. Je leur fis part de ma volonté de rejoindre le maquis, ils ne repoussèrent pas ma demande et tentèrent de me mettre en contact avec l'extérieur, au Luxembourg, mais en vain.
Après Saint-Maixant, en mars 1957 - j'étais aspirant à l'âge de dix-neuf ans et demi - je fus affecté avec d'autres Algériens au 13e Régiment de tirailleurs stationné à Landau, en Allemagne. Les autorités militaires voulaient ainsi éviter que les Algériens ne rallient la Révolution en les éloignant autant que faire se peut.
Mon père avait appris ma désertion, mais faisait semblant de ne pas s'en soucier. Il répondait aux militaires français qui me recherchaient : «Je vous ai confié mon fils, le reste c'est votre affaire». En guise de représailles, l'armée française ordonna à mon père de laisser la porte de la maison ouverte de jour comme de nuit. Les soldats français faisaient des descentes chez moi quand bon leur semblait. Cela dura quatre longues années.
Je rejoignis Landau avec un groupe d'Algériens, dont Abdelmalek Guenaïzia, avec qui je m'évadai pour monter au maquis. Nous étions arrivés à Landau après que «la lettre des 56», rédigée par le lieutenant Rahmani, fut signée par cinquante-six officiers algériens. La lettre, adressée au président de la République française, stipulait qu'il soit épargné aux officiers algériens de tirer sur leurs frères. Comme la réponse tarda à venir, les cinquante-six officiers se réunirent pour décider des suites à donner à leur démarche.
Certains, tels Abdelkader Chabou, Mohamed Zerguini, Ben Abdelmoumène, Boutella, Othmane et d'autres, décidèrent de se mettre à la disposition de l'ALN, pendant que d’autres choisirent de se maintenir dans les rangs de l'armée française. Il y avait parmi ces derniers un capitaine dont j'ai perdu le nom, signataire de la lettre des 56, qui nous avait concocté un dîner au mess des sous-officiers pour tenter de nous convaincre que vu notre jeunesse, notre éventuelle mauvaise conduite pouvait nous causer du tort alors qu'eux, anciens ayant participé à des guerres, n'étaient pas aussi vulnérables.
Nous comprîmes vite que ses responsables l'en avaient chargé. J'avais appris par la suite que ce capitaine avait été affecté dans une caserne chargé du recrutement à Tébessa. Mais il n'y avait pas que lui. Le commandant Derdour, l'officier Lakhdar et le lieutenant Safir avaient, eux aussi, opté pour l'armée française. L'officier Lakhdar fut blessé la veille de l'Aïd el-Adha, près du quartier militaire par le sergent Zerzouri, qui vit aujourd'hui à Annaba. Le lendemain matin, les frères m'apprirent que l’armée française savait que l'auteur de l'attentat contre l'officier Lakhdar avait réussi à se faufiler à l'intérieur de la caserne. Le sergent Zerzouri tenta alors de traverser les frontières allemandes mais le contact entre les militaires algériens du 13e Régiment et la fédération de France du FLN n'étant pas rétabli, il fut arrêté à la frontière et conduit à la prison de Landau. Nous eûmes peur qu'il ne parlât sous la torture. J'appris par la suite qu'il déclara avoir tiré sur l'officier Lakhdar pour une histoire de mœurs. Il me vient à l'esprit, ici, Moussa Hamadache, d'El-Harrach, à la carrure sportive qui prenait sur lui de distribuer les tracts et qui réussissait la prouesse de pénétrer jusque dans les bureaux des officiers par la cheminée. D'autres étaient chargés de mettre le feu aux dépôts d'essence. J'avais eu la chance de faire la rencontre du sergent Leboukh à Landau. Il sera emprisonné plus tard durant quatre ans. Au lendemain de l'Indépendance, il termina sa carrière de militaire dans les rangs de la Gendarmerie nationale. Le sergent Leboukh avait investi en moi sa confiance la plus totale. Il m'informa que le FLN avait chargé les sous-officiers d'activer et avait, dans le même temps, demandé aux officiers de ne pas se mouiller dans des opérations pour éviter qu'ils soient suspectés. «Nous avons besoin de vous pour autre chose», me confia-t-il. Bien sûr, nous payions nos cotisations qui s'élevaient à deux mille francs anciens.
A Landau, nous profitions beaucoup des maladresses des militaires français. Les autorités coloniales avaient commis deux erreurs : la première était qu'elles envoyaient en Allemagne tous les insoumis et les appelés dont la plupart étaient membres de l'OCFLN ; la deuxième était que l'armée française ne lançait des avis de recherche contre les déserteurs qu'après onze jours. C'était la loi. Je me souviens que nous avions traversé la ville de Bâle, au sixième jour de notre désertion, après avoir passé quatre jours en Allemagne.
Je fis part au sergent Leboukh de ma volonté de rallier la Révolution. Il me promit de me faire rencontrer son responsable et me fixa rendez-vous dans un jardin public au cœur de Landau. Là-bas, un homme devait se rapprocher de moi et me donner le mot de passe : «Donnez-moi du feu !». Dans mon attente, je remarquai une voiture de marque Tonus qui fit plusieurs tours avant qu'un sergent-chef dont le nom est Lakhdar n'en descendît. Je le connaissais et le côtoyais quotidiennement mais ne savais guère qu'il militait au point que j'omis le mot de passe. Lakhdar se rendant compte de ma confusion, me pria tout de même de l'accompagner jusqu'à la voiture. Une deuxième personne était restée à l'intérieur pour surveiller le moindre mouvement suspect. Nous nous dirigeâmes vers le quartier militaire où je fis la rencontre de l'adjudant-chef Djebaïli, une autre figure oubliée de l'Histoire de la guerre de libération, mort dernièrement. Il servit lui aussi dans les rangs de la Gendarmerie nationale après l'Indépendance. L'adjudant-chef Djebaïli, responsable du FLN pour le 13eRégiment des tirailleurs, m'avait informé que le contact avec l'organisation en Allemagne et la fédération de France du FLN fut interrompu. Il me demanda de remettre des photos d'identité au sergent