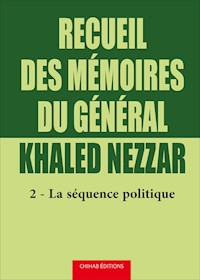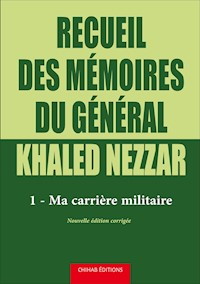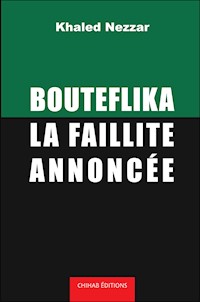RECUEIL DES MEMOIRES DU GENERAL KHALED NEZZAR
Avec la collaboration de
Mohamed Maarfia
II – La séquence politique
Khaled Nezzar
RECUEIL DES MEMOIRES DU GENERAL KHALED NEZZAR
Avec la collaboration de
Mohamed Maarfia
II – La séquence politique
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2018.
ISBN : 978-9947-39-322-2
Dépôt légal : octobre 2018.
Dédicace
Ce n’est pas par narcissisme que j’ai entrepris l’écriture de mes mémoires. Seul m’a inspiré le souci de rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme et aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe de l’ANP, ainsi qu’aux membres des services de sécurité, tous corps confondus, qui se sont sacrifiés sans compter pour éviter que le pays connaisse la régression que des forces du passé lui avaient programmée. Le combat n’a pas été sans sacrifices et sans deuils. Mais ils l’ont mené d’une façon soutenue et courageuse et je suis fier d’avoir été un des leurs. Ensemble, nous avons, de l’autre côté du précipice, installé puissante et résolue, la tête de pont autour de laquelle se sont regroupées les forces vives de la nation qui ont fini par défaire l’hydre terroriste. Le plus dur a été accompli. Il reste aux élites civiles et militaires, au-delà des conjonctures et des péripéties, à aller de l’avant pour répondre aux aspirations profondes de notre peuple.
L’histoire des périls sans nombre, des actes d’héroïsme, des défaitismes et des lâchetés qu’a connus l’Algérie, au cours de la décennie terrible qui a marqué nos mémoires, il était de mon devoir de l’éclairer par mon témoignage et mes explications.
J’ai dit, à propos de la première partie de mes mémoires, que c’était seulement mon histoire que je racontais. Cette seconde partie, que j’édite aujourd’hui, est le récit de ce qu’a vécu l’Algérie depuis octobre 1988 jusqu’à la fin du mandat du HCE qui recoupe la fin du mandat du président Bendjedid qui a démissionné le 11 janvier 1992.
A ceux qui sont morts, aux vivants, à ceux qui combattent encore, merci.
Khaled Nezzar
Préface
Le grand portail métallique passé, il faut encore marcher quelques dizaines de mètres sur un large chemin asphalté bordé d’arbustes plantés derrière un muret en pierres sèches. La maison est au sommet du monticule que prolonge un terrain gazonné où virevoltent des chiots prompts à venir protester de leur bonne éducation aux visiteurs inconnus. Nezzar attend sur le perron. Il est, comme à son accoutumée, à l’heure. Il tousse. Une toux enrouée de fumeur invétéré. Le vieux soldat aurait pu faire sienne cette sentence de Bernard Shaw : « Cessezdefumer ? Riendeplusfacile, lapreuve, j’airéussiplusieursfois ! ». Cet homme à la volonté de fer est venu à bout de toutes les misères, mais le tabac a toujours eu le dessus.
Le bureau est spacieux. C’est son domaine réservé. Des étagères sombres en bois de cèdre des Aurès style berbère garnissent les murs. Des livres d’histoire surtout. Nezzar collectionne tout ce qui s’est écrit sur la guerre d’Algérie. La table de travail est encombrée de papiers, de quelques bibelots et d’étuis à stylos. Il veille parfois jusqu’à une heure avancée de la nuit face à un écran de belle taille. Le téléphone sonne. Les notes de la charge de la brigade légère de Lord Cardigan pendant la guerre de Crimée de 1858. Le clairon insiste. Nezzar l’ignore. Quand le numéro qui s’affiche ne figure pas sur son agenda, il ne décroche jamais.
Malade, il a réalisé cette extension du corps de la grande villa en 2010. C’est là où il reçoit. « C’est ici que mon corps sera exposé lorsque l’heure viendra ». Dehors, il pleut soudain des cordes. Le deuil de l’air pénètre dans la pièce. Il balaie le doux sentiment de chaleur et de confort qui régnait l’instant d’avant. Le soldat a résisté à tout. Une série noire de petites et de grandes tentatives de l’autre, la Camarde, celle qui revient inlassablement à la charge prétextant l’âge ou la saison. La vessie, le trijumeaux, des électrodes au cerveau et le cœur soutenu par un pacemaker. Le pécule initial robuste et sain des crêtes de Lamtarass qui frangent l’Aurès, à l’ouest, a été l’armure qui lui a permis de franchir les basses pressions rencontrées sur le chemin et, sans doute aussi, en dehors du tabac qui le fatigue énormément, un régime alimentaire frugal et sain. L’effort fourni pour survivre a laissé des traces. Il explique, la canne toujours à portée de la main et le spray antidouleur, son pain quotidien. Les médecins lui font subir des contrôles aux protocoles sévères auxquels il se soumet avec beaucoup de résignation. Au moment où ils désespèrent, il remonte la pente. D’année en année, plus péniblement. Ce jour-là, il revient tout juste du cimetière. Les cimetières d’Alger sont devenus un lieu de rendez-vous quasi quotidien pour les anciens. Les derniers partent un à un, quelquefois après de longues éclipses. Subrepticement. Avec beaucoup de pudeur. Le dernier, un compagnon des années de la Guerre de libération et des grandes manœuvres du plateau de Tindouf, l’avait supplié : « Nevienspasmevoir ! ». L’ancien coureur de djebels voulait que ses amis conservent de lui l’image qui est restée dans leur mémoire et non pas celle que le terrible mal qui l’a emporté a façonnée. Le recueillement dure un moment. Il focalise des images. Une séquence d’histoire déroule ses ombres et ses lumières derrière le rideau opaque qui vient de tomber. Faits saillants dit avec ces mots simples qui viennent du fond du cœur. Des détails reviennent cocasses ou poignants : le docteur Zemouchi, médecin de l’ALN, le portefeuille en peau de chagrin de Khelil1 ou le regard perdu de celui qui reste seul dans la maison déserte, quand les objets deviennent inanimés, parce que celle qui leur donnait une âme s’en est allée.
Quelquefois, pour « en griller une » à son aise, il entraîne l’ami de passage hors du bureau vers le banc en ciment blanc, glacé et inconfortable, placé derrière une table épaisse comme une plaque de base d’un tube de 81mm. L’« extra-muros » dure cinq minutes ou deux heures, selon le temps qu’il fait. Ne supportant pas le tabac, je me place de telle sorte à éviter d’inhaler la fumée en suppliant le génie joufflu du vent à y aller tout son content vers l’autre bout de la table. Quand il fait la sourde oreille, j’use du bronchodilatateur pour éviter l’asphyxie. Peu importent les petits inconforts du scribe quand le sujet en vaut la peine. Mes rencontres avec l’ancien ministre de la Défense sont, depuis qu’il a décidé de publier ses mémoires, fréquentes. Je le laisse parler. Je ne l’interromps jamais. A l’usage, j’ai constaté que par des associations d’idées dont je ne maîtrise pas le cheminement. Il s’éloigne soudain, part très loin dans le temps, vers l’idée, le visage, le nom, l’objet immergé, puis le souvenir revient, par une sorte d’effet physique net et buriné ou effiloché comme ces images incertaines qui peuplent certains rêves.
« Quand l’heure viendra ». Comme il ne fait jamais dans la grandiloquence, il affiche sa sérénité par l’anecdote, par l’ellipse. Sais-tu, me dit-il, que, jeune, j’avais peur de traverser le cimetière du village ? Le nôtre était le théâtre d’étranges phénomènes – des feux follets véloces – que les anciens expliquaient par l’intervention des djinns. J’ai découvert plus tard que la sarabande des silhouettes ignées, qui me faisaient transpirer d’angoisse, n’étaient rien d’autre qu’effets de magnétisme et de champs électriques. L’appréhension de l’« après » n’effleure pas celui qui sait que l’ultime passage est inscrit dans la logique des pôles. Le corps s’éteint quand ils consomment toute leur énergie.
Le téléphone sonne encore. Cette fois-ci, il répond. L’homme qui appelle remercie, au nom de la famille du défunt, le général pour sa générosité. « C’estlamoindredeschosesqued’affichermasolidaritéaveclafamilledemoncompagnon ». Il n’a jamais manqué d’être présent pour les veillées funèbres du troisième jour. Il ne raterait pour rien au monde les retrouvailles avec ceux qui ne sont pas encore partis et qui se retrouvent, une dernière fois, sous le toit de celui qui vient de les quitter. Mon regard est attiré par un article d’El-Watan que Nezzar était sans doute en train de lire. Il parle des psychothérapies tentées pour guérir les plaies de la mémoire. Il ne conçoit pas autrement le but des livres qu’il signe. Un exercice de thérapie par la vérité et par le courage de dire.
Je ne veux pas lui faire remarquer qu’il a déjà parlé plusieurs fois du sujet qu’il aborde aujourd’hui, A quoi bon ? Il continuera de toute façon.
Le premier livre des mémoires est sorti en décembre 2017. Il retrace une carrière militaire riche en péripéties ; carrière étroitement accolée à l’histoire de l’Algérie.
Quand il est allé présenter le livre à la presse, rares ont été ceux qui ont voulu approfondir les points abordés. Les inquisiteurs du « qui tue qui » étaient là en force. L’un deux, attaquant par le flanc « l’infiltré » parvenu au sommet de la hiérarchie de l’ANP par la diagonale immergée de l’anti-Algérie, sorte de cinquième colonne, la cocarde tricolore cachée sous la casquette. « Sij’étaiscequevousdites, serais-jedevenuministredelaDéfense ? ». Et l’effronté d’insister : « C’estlapreuvequevousétiezbienpréparéetbiensoutenu ! ». Langage de sourds.
Nezzar ne s’émeut pas. Le jeune procureur n’a pas lu le livre. Il était là dans un but « politique ». Il ne sait rien des exploits de Youssef Latrèche, de Mohamed Ben Messabih, de Mokrane Aït Mehdi qui ont inscrit sur les flancs pelés du Djebel El-Mouadjène, à quelques kilomètres de Souk-Ahras, en avril 1958, une impérissable page de gloire. Youssef Latrèche et les autres, les compagnons de Nezzar.
***
Eh ! Pourquoi le scribe quitte-t-il le rôle passif et muet du « nègre » pour aller pontifier sur l’estrade en rappelant les exploits d’autres DAF2 ? Parce que ce « nègre »-là est aussi témoin. A l’occasion du 50e anniversaire de la bataille de Souk-Ahras, l’ancien ministre des Moudjahidine m’avait demandé d’aller « là-bas » et de retrouver ceux qui ont survécu aux combats et à un demi-siècle de solitude. Souk-Ahras, les collines d’El-Mouadjène... L’épitaphe était là, visible sous les lichens. Poignante et sobre. Sculptée par l’impact d’une tranche d’obus sur le flanc du rocher où Youssef Latrèche avait tenu huit jours durant. Vanuxem3, sidéré par la résistance des Algériens et par l’ampleur de ses propres pertes, répétait : « TuezYoussefLatrèche ! ». « IlyadeuxfaçonsdemourirpourlaFrance, celledeVerdunetcelled’El-Mouadjène », avait écrit plus tard un autre général.
Hommage rendu par l’ennemi à ceux qui ont quitté la cour de la caserne, le mess des officiers et l’amphithéâtre de l’Ecole de guerre, pour venir mourir à El-Mouadjène pour l’amour de l’Algérie.
Le jeune septique qui émettait des doutes sur la sincérité de l’engagement des DAF dans les rangs de l’ALN n’a pas lu le livre de Nezzar. Il ignore tout des combats de Souk-Ahras et des dizaines d’autres batailles qui ont vu les moudjahidine venus des horizons les plus divers combattre et mourir côte à côte. Est-ce sa faute ? En Algérie, l’histoire depuis longtemps, est dite par ceux qui ne l’ont pas faite.
Nezzar parle, donne des interviews et écrit. Ceux qui auront la patience de lire cette seconde partie de ses mémoires mesureront la dimension des hommes, qui ont été dans la même école que celle qu’ont connue Youssef Latrèche, Aït Mehdi ou Messabih, et qui ont barré la route à l’intégrisme. Ils comprendront pourquoi ils sont tant vilipendés par ceux qui ne leur ont jamais pardonné d’avoir été là quand tout s’est écroulé.
***
Le procès de Paris a instruit le général sur le degré de compréhension des principes qui l’ont fait agir, lui et ses compagnons, en janvier 1992. La conjoncture politique de l’époque avait fait réagir différemment personnalités et médias. Il va loin dans le passé pour expliquer l’immense déficit de communication qui avait rendu confus ou inaudible ce qu’il a fait à Paris quand il est allé affronter ceux qui calomniaient l’ANP. Il parle, écrit, donne des interviews. Il se bat. Lorsque la camorra, qui a fait de l’Algérie sa préoccupation quotidienne, heureuse de trouver un débatteur aussi porteur sur le plan médiatique, tend un piège à Paris ou à Genève, elle sait qu’il ira. Il sait aussi que c’est un piège et il y va quand même. Et on s’aperçoit que l’hameçon a joué dans l’autre sens. Il tire la ligne et voilà frétillants sur le sable les « ténors de la désinformation », barons politiques du régime de Bendjedid reconvertis dans l’opposition, droit-de-l’hommiste fulminant des colères, has-been égrenant leurs illusions perdues, petits déserteurs de l’ANP ayant vendu leur âme à des diables gigognes. Celui qui sert la soupe dans le jardin n’est pas celui qui tire les ficelles dans la cour. Confronté à une autre cabale, dix ans plus tard, par les mêmes qui avaient tenté le coup à Paris, revenus à la charge en espérant le voir se réfugier dans le bunker de la « souveraineté nationale non négociable ». Au contraire, il avait fait face « pour expliquer et non pour m’expliquer », dit-il. A cette occasion, de nouveau encore, médias et hommes politiques y sont allés de commentaires contradictoires. Nezzar ne laisse personne indifférent. Pétition de soutien et contre-pétition se sont croisées, avec les mêmes mots et les mêmes analyses que ceux de 2002. Quelquefois, le désir de franchir la palissade derrière laquelle se sont retranchés ceux qui n’ont jamais renoncé à leurs phantasmes, malgré les enseignements que le temps a asséné, il va chez eux, auprès du média qui les représente et qui répercute leurs thèses, pour expliquer encore et toujours. Succès mitigé. On ne vient pas à bout de la montagne avec une pioche. « Il serait trop facile de ne plaider que devant les convaincus », dit-il.
L’exercice a été instructif, au moins à un titre : si l’islamisme a été vaincu sur le plan militaire, il a, sur le plan des idées, encore de beaux jours devant lui. C’est à peu près ce que disait feu le général Mohamed Lamari. Les déboires récurrents de Nezzar devant des juges étrangers en sont la meilleure preuve.
Beaucoup estiment que si l’ancien ministre de la Défense avait respecté la loi non écrite du système – la grisaille atone de la retraite –, sa stature se serait estompée en silhouette et il n’aurait pas attiré tant d’inimitiés.
Jeter la suspicion sur la sincérité de son engagement dans la guerre de libération, garder le silence sur son action résolue pour faire condamner et punir les atteintes aux droits de l’Homme, étouffer sa voix par des interpellations comminatoires, déconsidérer par des analyses spécieuses son combat pour défendre l’honneur de l’armée de son pays, participent à la tentative de dévoiement de la démarche salvatrice qui a été la sienne et concourent à la répétition des cabales dont il fait régulièrement l’objet.
Faut-il essayer de comprendre ce que cachent tous ces complots ou détourner le regard ? Les amnésiques – les plus nombreux – tentent de rejeter les souvenirs difficiles qu’évoque le nom de Nezzar à la périphérie de leur cercle de perception au moment où le bruit et la fureur, qui épousent le tracé exact de nos frontières, montent crescendo.
L’ombre de la stature du commandeur, affreusement déformée par des caricaturistes experts, projetée sur la table des convives de la peur que nous sommes devenus, dérange notre fausse quiétude. Nous regardons mais nous refusons de voir. Nous avons tout vécu, mais nous refusons de croire que nous pourrions encore subir. C’est l’âge d’or de l’amnésie. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes réconcilié et, ainsi, nos maux enrobés de mots soporifiques, nous feignons d’ignorer le bruit de la vague écumante et désordonnée qui prend d’assaut et emporte, l’un après l’autre, des bastions longtemps réputés inexpugnables.
Le secret désir d’oubli que nous cultivons au plus profond de nous-mêmes emmaillote douillettement nos têtes. Un peu comme l’autruche, nous conjurons par le sable dans nos yeux l’apocalypse syrienne, le chaos libyen, la duperie tunisienne, l’infernale équipée de Daech, le crissement horripilant des yatagans qui s’aiguisent dans notre Sud immédiat et les diatribes féroces des vicaires autoproclamés de Dieu qui, insidieusement, « talibanisent » de nouveau nos villes.
A l’heure où des pays entiers s’écroulent dans un fracas de fin du monde, à l’heure où tous les revanchards entonnent leurs vieux couplets, ces mémoires sont une invite à méditer sur les conséquences de la banalisation du sursaut salvateur de janvier 1992, sur le silence quand nos jeunes soldats continuent de mourir. Dramatique faiblesse des hommes qui, pour une once de fausse quiétude, ferment les yeux.
Pourquoi se préoccuper de ce qui se passe ailleurs, puisque l’innommable ne reviendra plus ? Le brave soldat Sweig nous inspire.
***
Dans L’arméealgériennefaceàladésinformation, livre écrit dans l’urgence pour répondre à l’opération du « qui tue qui », vaste entreprise de désinformation qui a fait bruire à l’unisson beaucoup de médias étrangers, Nezzar a dit beaucoup de choses. Aujourd’hui, il va encore plus loin.
Ayant vécu les événements de l’intérieur, se trouvant à un poste de hautes responsabilités, les révélations qu’il fait permettent d’appréhender autrement les paroles et les actes des responsables de l’époque. Il revient sur les journées qui ont vu la venue au pouvoir de Chadli Bendjedid au lendemain de la mort de Houari Boumediene. Il souligne la responsabilité de la police politique qui avait inventé la formule de « l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé » et il s’étend sur les conséquences de tout ordre de ce parti-pris : la lente dégradation de la situation économique, politique et sécuritaire, jusqu’à l’explosion d’octobre 1988.
Se rend-t-il compte qu’en parlant de la police politique comme il le fait, il prêtera le flanc aux critiques de ceux qui diront : Pourquoi n’a-t-il pas agi quand il était au sommet de la pyramide, rabedzaïr (l’omnipotent) de ce temps-là ? Voilà qu’il parle à présent comme le plus irréductible des opposants. Ceux qui étaient à ses côtés savent ce qu’il a tenté et ce qu’il a essayé de faire. Le système, après son départ, a repris « ses droits ». Le système est comme une bille de mercure. Elle se divise et se démultiplie dès qu’on la touche. La pente, c’est-à-dire les circonstances, lui font reprendre sa texture première. La densité du métal fait le reste.
Il rappelle, presque heure par heure, ce qui s’est produit au cours de la journée du 10 octobre 1988 et explique comment l’armée, sollicitée par le pouvoir politique, a rétabli l’ordre dans la capitale. Il ne cache rien des erreurs, des disfonctionnements, des manipulations et des bas calculs qui ont fini par produire l’effusion de sang.
Qui était en réalité Bendjedid ? Quelles étaient ses relations avec le haut commandement de l’armée ? Comment expliquer sa lente évolution jusqu’au moment où il commence à envisager un partage du pouvoir avec les intégristes du FIS ? Nezzar révèle les métamorphoses de Bendjedid, soumis à un véritable lavage de cerveau par des penseurs islamistes qui avaient réussi à gagner sa confiance en lui faisant miroiter une salafia respectueuse du pouvoir. Quels sont les hommes qui ont eu une influence déterminante sur l’état d’esprit de Bendjedid et qui ont inspiré nombre de ses décisions jusqu’au raz de marée islamiste des législatives du 26 décembre 1991 ? Nezzar n’est complaisant avec personne, mais sans outrance langagière. Il est sévère avec Mouloud Hamrouche, dont la démarche a été, selon lui, aventureuse et irresponsable. Il estime que Mouloud Hamrouche voulait récolter pour son seul bénéfice le fruit de la montée des salafistes et du délitement de l’institution présidentielle, mais il reconnaît, malgré tout, que les idées de Mouloud Hamrouche étaient courageuses et innovatrices.
Il suit la lente et inexorable montée du FIS facilitée par les reculades et la permissivité du pouvoir, ainsi que par l’opportunisme d’une grande partie du personnel politique de l’époque.
Il rappelle les mises en garde de l’armée en direction du président de la République afin qu’il mesure que ce qui se jouait à la fin de la décennie 1980 était le destin de l’Algérie. Le caractère de Bendjedid, ses peurs et le forcing de ses conseillers rendront inéluctable l’issue que les militaires prédisaient.
***
Depuis des mois, il se confie. Je note ou bien, trop pris moi-même par le récit, j’oublie de noter, mais comme il revient souvent sur le même sujet, je ne culpabilise pas. Quand il relie, il s’étonne : « Ai-je bien dit ça ainsi ? ». Et il biffe. Surtout quand les mots lui semblent trop rugueux. Nous reprenons des pages entières : le Soudan de Tourabi, ingérant, féroce et offensif quand la gouvernance de Bendjedid avait fait de l’Algérie l’homme malade du monde arabe. Le Qatar avec sa grosse Bertha cathodique lançant des volets de diatribes. La gauche française malade de ses échecs historiques et qui n’en finit pas de se concocter des labyrinthes idéologiques où elle se perd, s’essouffle, se rabougrit et éclate. Désespérée de voir l’Algérie, sa douleur ancienne, échapper au chaos que lui prédisent inlassablement ses Cassandre attitrés, elle est aux commandes des machineries graissées par la bonne huile des droits de l’Homme. ONG vertes, sélectives assumées, maniant à en perdre haleine sur les plateaux de télévision, le pinceau merveilleux des droits de l’Homme. « Nous n’avons pas cédé ! », répète Nezzar. Il parle. Aucune question n’est taboue. Cette seconde partie de ses mémoires n’est pas un brulot ni une tentative de régler des comptes, même si, parfois, le boulet frappe la cible de plein fouet. La vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ce livre est loin d’être une répétition de ce qu’il a déjà écrit, mais on retrouve, çà et là, des pages déjà lues. Les années tamisent les scories, émoussent les passions et donnent aux mots, hier aiguisés et tranchants, plus de pleins et plus de déliés.
Je suis attentif aux différences de versions afin de poser plus tard les questions qui donneront au récit ses teintes vraies, sa cohérence et sa linéarité.
Je revois souvent ma copie pour coller de plus près à son idée. A propos du réacteur d’Aïn Oussera. « L’Algérie ne sera jamais une menace pour la paix dans le monde. Quant aux Français, les générations qui ont soi-disant apporté la civilisation aux indigènes en les pillant et en les massacrant ne sont plus. Maintenant la France a établi des rapports de coopération avec nous. Nos armes les plus efficaces seront l’unité de notre peuple, la cohésion et la force de notre armée et la non-dépendance économique ». Il se tait un instant, puis il ajoute, comme pour lui-même : « Les gesticulations de l’extrême-droite et les nostalgiques de la colonisation savent qui nous sommes. Ils ne s’y frotterons jamais ». Il résume toute la politique étrangère de l’Algérie par une citation : « A un Finlandais auquel on demandait comment faisait son pays pour avoir de bons rapports avec la puissante ex-URSS, il répondait : “Nous avons un bon ministre des Affaires Etrangères” ».
Un geste de la main me fait comprendre que ce qu’il dit ne doit pas être transcrit. Que c’est une confidence qui doit en rester là. Il sait que je ne noterai pas ce qu’il préfère ne pas divulguer, surtout quand il s’agit des petites faiblesses de ceux qu’il a côtoyés. Quand l’autre, des décennies plus tard, se hisse sur des semelles compensées pour faire plus grand que nature, il bougonne ce mot qui invite ceux qui fabulent à la prudence « quand les anciens du village sont encore de ce monde ». Il sait que ce livre va être sujet de polémiques. Il répare ce qui a été dit petitement ou faussement sur ceux qui ont été affublés de guillemets réducteurs et placés dans la case « janvier » du calendrier pour mieux souligner qu’ils ont agi à contretemps du siècle et que leur intervention, soudaine et violente, dans la sphère politique, a fait avorter une révolution morale et sociale et qui n’en finissent pas de subir le venin de ceux qui ont été absents à l’heure de vérité ou qui n’ont jamais mesuré à quoi l’Algérie avait échappé, et à qui elle doit son salut.
***
Nezzar ne se veut le porte-parole de personne, ni d’une institution quelle qu’elle soit, ni du fameux « groupe des quatre » inventé par la rumeur, ni celui d’une coterie cachée. Il se confond en dénégations. « J’ai toujours veillé à ce que seul celui qui est au commandement et qui en assume les servitudes ait le privilège de décider et de parler au nom de l’institution. » Mais cette limite qu’il se fixe ne l’empêche nullement de signifier que la retraite est un état majeur qui permet de dire les choses qui se sont déroulées il y a deux ou trois décennies sans le filtre des prudences langagières et la barrière des tabous.
« L’important n’est pas de savoir si je parle au nom d’Untel ou d’Untel, mais de s’interroger si ce que je dis est en contradiction avec les principes qui ont fait agir un certain nombre d’hommes, au moment où l’avenir de l’Algérie était en jeu ».
Il a vécu très mal l’interdiction qui a été faite aux anciens officiers de l’armée de s’exprimer sur la situation de leur pays. Mais il la respecte dans son esprit et dans sa lettre. Lors de la présentation de son livre, il a refusé de répondre à ceux qui voulaient avoir son opinion sur telle ou telle échéance. « Je suis en dehors de tout maintenant, je ne veux parler que d’histoire », a-t-il dit à ceux qui étaient venus à la recherche du scoop. Il est reconnaissant à Bouteflika d’avoir résisté à ceux qui voulaient entraîner l’Algérie dans des interventions armées en dehors de nos frontières et de l’avoir soutenu face à la compétence universelle de juges étrangers.
***
Que représente maintenant Nezzar dans l’ANP et qu’est-il pour cette même ANP ? On se souvient que, lors du procès qu’il avait intenté en 2002 à Paris à un de ses diffamateurs, il s’était défendu d’être le porte-parole de l’armée, mais il s’était défini comme son parfait représentant. Dans toutes ses interventions, il rappelle inlassablement les étapes de sa vie d’homme en son sein, depuis les combats de la Guerre de libération nationale, en passant par l’équipée égyptienne et jusqu’aux grandes manœuvres du plateau de Tindouf. Il connaît sa mécanique interne et il a usiné quelques-uns de ses rouages vitaux. Il a distingué certains des hommes qui la commandent aujourd’hui et aidé à définir les codes qui la régissent. Le sursaut salvateur de janvier 1992, dont il a été le principal maître d’œuvre, a été fait au nom des principes de Novembre et, elle, partie prenante, l’a assumé jusqu’au bout par la lutte sans merci qu’elle a menée contre le terrorisme islamiste et qu’elle continue de mener sous son commandement actuel, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il ne concède pas un seul pouce de terrain. Mais, au-delà du symbole, que reste-t-il de l’influence de Nezzar au sein de l’ANP ? En un mot, Nezzar est-il un « parrain » disposant de relais puissants ou juste un homme dont l’action a été en totale adéquation avec le sentiment de l’immense majorité de ses pairs ? Le fait qu’il l’ait commandée pendant quelques années et qu’il exprime son respect pour ses compagnons, ne fait pas de lui, pour autant, le machiniste au long cours qu’on décrit. Une armée moderne est soumise aux dynamiques des changements et des évolutions. Elle est régie par des organigrammes précis et des canevas transparents. Elle n’obéit pas à des codes élaborés dans des cryptes cachées. Les hommes qui la commandent passent le témoin à d’autres au gré des mutations ou des départs à la retraite. Celui qui l’a quittée il y a vingt ans, serait bien en peine de s’y reconnaître, si tant est qu’il oserait s’y aventurer. Mais, si sur le plan organique, Nezzar est définitivement extramuros, il demeure, cela étant dit, qu’il partage les mêmes valeurs avec ceux qui ont repris le flambeau. C’est cette conviction commune qui est importante. Tout le reste est secondaire.
***
L’Algérie était décérébrée, stérilisée par les pratiques du parti unique et fragilisée par le délitement de l’institution présidentielle. Elle vivait dans l’incertitude du lendemain. Le FIS commençait à imposer par l’intimidation son projet de société et s’organisait militairement pour conquérir le pouvoir. La peur s’était emparée des cadres et de la société civile. Le régime de Bendjedid vacillait et semblait en passe d’entraîner l’Etat dans sa chute.
Les résultats du premier tour des législatives de décembre 1991 résonnent comme un coup de tonnerre. Bendjedid n’a plus d’échappatoire. Il est au pied du mur. Que faire ? Accepter le verdict des urnes et tenter d’être « le verrou constitutionnel qui empêchera le FIS de mettre ses menaces à exécution » ? Il n’en a ni la volonté ni les moyens pour le faire. Il démissionne en confiant la situation à l’armée.
Le processus électoral est interrompu. L’Algérie retient son souffle. Que va-t-il se passer ? Le monde stupéfait observe et prédit le pire.
Nezzar revient sur ces moments particuliers que vit un homme porté, malgré lui, au sommet et dont le moindre acte peut être déterminant dans un sens ou dans l’autre. Il souligne l’engagement, le courage et la détermination de ses compagnons, soldats de métier, aguerris par les combats de la Guerre de libération, endurcis par les vents des étendues sahariennes, élevés dans le culte de la Révolution de Novembre et le respect de ses géniteurs et qui n’ont tenu compte, dans ces moments de grandes incertitudes, que des intérêts supérieurs de leur pays.
La Révolution de Novembre est le dernier recours. Un homme l’incarne par ses combats et ses sacrifices.
***
Mohamed Boudiaf accepte de revenir parce que son pays est dans une crise et que personne ne sait vraiment de quoi sera fait demain. Il sait que si on ne fait rien, bientôt l’antagonisme des schismes, le heurt des doctrines violentes, compliquées et infécondes de l’islam politique jetteront l’Algérie dans un processus sans fin de guerre des régions, des tribus, des clans et des familles. Les documents trouvés dans les bureaux des chouyoukh le jour de leur arrestation, démontrent l’ampleur du complot étranger qui avait été ourdi pour faire de l’Algérie une sœur mineure de l’Iran des Ayatollahs, une succursale du Soudan de Tourabi ou un Etat théocratique vassal de la monarchie des Al-Saoud. L’impérialisme, forcé au repli en 1962, trouverait dans l’alibi de la « protection des minorités », la « sauvegarde de ses intérêts » ou la « nécessité de mettre à l’abri ses sources d’approvisionnement en hydrocarbures », l’occasion de revenir en force pour « mettre de l’ordre » dans ce que ses stratèges appellent le « ventre mou de l’Europe ».
Déjà, l’intervention commence à poindre avec des allusions d’abord voilées, puis de plus en plus explicites, à la « bombe atomique algérienne ». Un attaché militaire d’une ambassade d’un pays occidental est surpris en train de prendre des photos au téléobjectif du site d’Aïn Oussera. Il est expulsé.
Boudiaf n’est pas homme à dire à ceux qui le sollicitent : « Voilà le résultat de ce que d’autres militaires ont fait depuis le CNRA d’août 1957 jusqu’au choix de “l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé” ». Une série de putschs, de passé-outre, de faits accomplis, de choix économiques erronés, de monologues et de violences policières ont mis le pays là où il se trouve maintenant.
Sans doute comprend-t-il que ceux qui viennent de donner un coup d’arrêt au processus suicidaire qu’annonçait le vote de décembre 1991, ont une vision des choses identiques à la sienne. Sans l’avoir jamais rencontré, ils savent qui il est. Ceux qui pensent à lui comme à un retour aux sources, un retour à la véritable légitimité historique les convainquent aisément. Quand il vient à Alger, ils lui disent : « Nous ne voulons qu’une chose : éviter à l’Algérie la régression ». Il ne peut pas leur tourner le dos.
Nezzar raconte sa découverte de l’un des pères fondateurs de la Révolution de 1954. Comment il avait commencé son magistère, quelles étaient ses idées pour remettre le pays sur les rails et quelles étaient ses relations avec l’armée.
Quelles sont les priorités du HCE4 dans une situation de faillite financière, de terrorisme islamiste et d’embargo international ?
Il ne s’étend pas longuement sur les actions du HCE. Il préfère l’approche humaine à la compilation. Nous découvrons un Tedjini Heddam inattendu, dans la tradition de ceux qui ont fait la grandeur de l’islam ; un Ali Haroun, plus avocat que ministre et qui mène son action entre les jalons des droits de l’Homme ; Ali Kafi, « grand et petit en même temps, comme le sont toujours les grands hommes » ; Rédha Malek, le grand intellectuel humaniste, homme de paix et de raison, que l’horreur que subit son peuple amène à utiliser les mots des guerriers.
Les pages que consacre Nezzar aux actions du HCE rappellent, pour les hommes de sa génération, sur le plan des défis à relever, ce qu’a accompli le CCE5 au lendemain du Congrès de la Soummam. La comparaison est-elle osée ? Beaucoup de moudjahidine la valident. Qu’on en juge : 1956, la Révolution a pris de l’élan mais elle est à la recherche d’un second souffle. Le poids de la population pied noire installée en Algérie pèse sur les décisions du gouvernement français. Il donne à l’armée française le sentiment qu’elle défend la France et que sa lutte contre le FLN est légitime. Les politiques parisiens proposent des solutions : l’assimilation ou l’intégration. Face à la sourde oreille de la résistance, ils recourent à la répression totale. Le CCE jaillit des profondeurs de la Révolution qui s’est retrouvée et exprimée dans le Congrès de la Soummam, s’organise, bande ses forces et devient le fer de lance de la nation en guerre. Il est évident, qu’au début de la décennie 1990, le contexte n’était pas le même qu’en 1956, que les problèmes étaient différents, que le FIS n’était pas une armée d’occupation ou ses affidés une population étrangère réimplantée en Algérie. Mais, sur le plan du sursaut, face à la contre-révolution qui niait l’authenticité algérienne du peuple, en tentant de l’affubler d’us et d’oripeaux étrangers à ses pères, face aux violences quotidiennes pour imposer un projet de société rétrograde contraire à celui pour lequel plusieurs générations s’étaient sacrifiées, face aux errements des élites politiques traditionnelles, en valeur absolue, les couleurs des deux moments sont superposables.
Le HCE est dans la droite ligne de ces directoires providentiels d’unité et d’action, qui émergent quand les périls menacent, s’imposent, font barrage, se renforcent et engendrent une résistance plus organisée et plus vaste. Au-delà de Mohamed Boudiaf, au-delà de Khaled Nezzar et de leurs compagnons, on peut dire que le HCE n’est pas à contre-courant du temps mais, au contraire, en phase avec le siècle, en phase avec l’immense espoir des Algériens.
Nezzar nous fait découvrir un «AliKafiinattendu, hommedesontemps, grandetpetitenmêmetemps, commelesontsouventlesgrandshommes ». Ali Haroun semble être celui qui a été le plus proche du ministre de la Défense. Venus de deux méridiens différents, les deux hommes accordent leurs aiguillent à la même horloge. Quelquefois remontant à l’envers les chiffres du cadran, ils retrouvent ce qui les avait unis jadis et qui de nouveau les rapproche. Le HCE était un directoire fermé, presque anonyme ; il émettait des signaux auxquels beaucoup ne croyaient pas. Nezzar, pour la première fois, va au-delà de la palissade et nous introduit dans le cercle où se révèlent les caractères et les motivations profondes. Et nous découvrons soudain que ces hommes ordinaires, que l’histoire a placés dans une situation extraordinaire, ont été à la hauteur des défis.
Nezzar parle de ce que l’ancien exilé de Kenitra comptait faire pour réussir. Il souligne les obstacles que ce dernier avait rencontrés sur son chemin. Les chefs de partis perdus d’égo, murés dans des postures d’opposants hermétiques quand les périls commandaient de donner du sens à « l’Algérie d’abord ! ». Ils n’avaient accordé aucun répit à Mohamed Boudiaf.
Il place à la tête du peloton des opposants Abdelhamid Mehri, qui avait privilégié les intérêts du FLN au détriment de ceux de l’Algérie. Le FLN absent sur le terrain, incapable de défendre les idées de ses lointains fondateurs, peinant à avoir une existence propre et qui finit par devenir un supplétif du FIS. N’eût été les priorités de l’heure, Boudiaf l’aurait dissous. Mais l’idée figurait dans son agenda. Il l’aurait fait tôt ou tard. Nezzar parle souvent d’Aït Ahmed dont les idées ne reflétaient pas la réalité du FFS, parti de démocrates et de progressistes.
Qui a tué Mohamed Boudiaf ? Pour éclairer ce tragique épisode, Nezzar donne son analyse sur la « mafia-politico-financière » qui aurait, selon la rumeur, commandité l’assassinat. Il décrit l’atmosphère empoisonnée qui régnait en Algérie en cette fin de juin de l’année 1992. Il cite longuement Ahmed Djebbar, un proche de Boudiaf qui a répondu, en son âme et conscience, devant un tribunal, aux allégations de ceux qui voulaient impliquer l’armée dans la commission de l’acte de Lembarak Boumaârafi.
Mohamed Boudiaf tombe sur la scène – dans le labyrinthe – emporté par le torrent chaotique des passions et des folies de ce temps-là, le mot islam à la bouche et la main ouverte tendue vers son peuple.
***
Les menaces sur la vie du ministre de la Défense se font de jour en jour plus précises et plus nombreuses. Il échappe à des attentats. Celui de février 1993 manque de peu sa cible. Pour éviter à l’armée de se trouver du jour au lendemain sans chef au cas où…, il exhume Liamine Zeroual de son exil batnéen. Nezzar raconte comment cela s’est fait et quelles ont été les conséquences de son choix pour le pays, pour l’armée, ainsi que pour sa propre personne. Ni reproches ni acrimonie, mais la réalité froide et nue. Comme lorsqu’il évoque Boumediene, Bendjedid et les autres, il dit les hauts et les bas du personnage. « Et encore une fois pour l’histoire ! ».
Il évoque avec beaucoup de considération Sid-Ahmed Ghozali.
« Ghozali a affronté la grève insurrectionnelle de juin 1991 et ses excès, l’ingérence étrangère (des Soudanais couverts par une invitation d’Abassi Madani ont été arrêtés par nos services), le feu roulant des médias arabes, l’hostilité du FLN, la crise financière, la malveillance de ses prédécesseurs à la tête du gouvernement, les conflits sociaux, l’indécision de Bendjedid et tant d’autres fâcheuses péripéties. Sans jamais nous immiscer dans son travail – nous avons été attentifs, présents, vigilants et mobilisés. Il l’a toujours su et, fort de cette conviction, Ghozali a été le seul à décider et à agir. Il a bien mérité de son pays ». Mais ces bonnes paroles en direction du chef du gouvernement de Bendjedid et de Boudiaf ne l’empêchent pas de dire ses fragilités et ses erreurs.
Quand il parle de Belaïd Abdesslem, il décrit l’homme dans sa rigueur, dans ses simplicités et dans sa férocité, lorsque ce dernier fait tourner le kaléidoscope des images qui semblent, malgré le passage des années. Il évoque ce chef de gouvernement qui n’a pas pu donner du sens à la formule qui a retenu l’attention des militaires. Nezzar et ses compagnons, économes des souffrances des Algériens, n’ont pas souscrit à l’état d’exception demandé.
Fin janvier 1994. Fin de mission pour le HCE. L’échéance de décembre a été outrepassée d’un mois, le temps de mettre la dernière main au rapport final de la commission du dialogue national. Nezzar explique pourquoi aucun des membres du HCE n’a été candidat à la présidence de la République.
« Il était important de démontrer à ceux qui nous ont compris, soutenu et aidé que l’arrêt du processus électoral n’a pas été décidé pour préserver des acquis et des privilèges. Le respect des engagements vaut toutes les démonstrations ». Mais il donne aussi d’autres raisons, inédites et passionnantes.
On était presque arrivé à la fin de la rédaction, lorsqu’il m’annonce avoir trouvé le titre de cette seconde partie de ses mémoires : « La séquence politique ». « Séquence ? ». Je doute quant à moi de la pertinence d’un tel terme. Le mot séquence suggère une action brève et limitée, même si elle s’inscrit dans un déroulé plus vaste. Je le trouve trop technique. Il ne rend pas la réalité de ce qu’a connu le pays pendant plusieurs années et, d’une certaine façon, il enserre l’action dans une parenthèse. Les décisions et les actes de Nezzar ont eu des effets et un retentissement qui dépassent le cadre d’une « séquence ». Il n’éveille pas la curiosité de celui qui regarde les titres d’un livre à travers une vitrine. Je le lui dis. Il en convient, mais il insiste pour maintenir le mot « séquence » car, pour lui, malgré la densité des événements qu’il a vécus et la façon dont il les a affrontés, ces deux années sont, d’une certaine façon, loin d’égaler son parcours militaire de presque quarante années de service et en totale contradiction avec ce qu’il a toujours été et ce qu’il a toujours souhaité : rester en dehors de la politique. Cette séquence s’est imposée à lui et il aurait aimé s’en passer n’eût été l’appel du devoir. Je propose des sous-titres sobres et forts. Il accepte. Des mots qui résument le livre et donnent le ton. Ce qu’il a fait, pourquoi et avec qui, depuis octobre 88 jusqu’au moment où, en janvier 94, il tire, de ses propres mains, le rideau sur sa carrière politique.
Le livre comportera deux parties : la première, « La montée des périls », la seconde : « Les années HCE ».
Une troisième partie devait relater ce qui est arrivé à ceux qui ont résisté quand d’anciens militants du FIS, appuyés par des partis politiques étrangers, des ONG et des personnalités algériennes auto-exilées en Europe, ont lancé la vaste opération de désinformation dont le but était de mettre au compte de l’armée algérienne les crimes que commettaient les GIA en Algérie. A la réflexion, il a jugé de ne pas aborder pour l’instant ce sujet.
« De toute façon, le monde a fini par découvrir que tout ce que nous avons dit, à propos des fous de Dieu, était encore au-dessous de la réalité ».
Mohamed Maarfia
Août 2018
Chapitre i :L’Algérie au moment de la disparition de Houari Boumediene
Le président Houari Boumediene rend l’âme après une longue agonie. La maladie a eu raison de ses forces. Elle a raison de la volonté de son entourage qui espère, jusqu’au bout, une rémission du mal et qui mobilise ce que la planète a de sommités médicales pour prolonger sa vie. A l’heure où cet homme hors du commun quitte ce monde, ce monde qu’il a prétendu changer, les Algériens d’Est en Ouest et du Nord au Sud oubliant qu’ils devaient, en partie, à sa politique leurs difficiles conditions de vie, le pleurent sincèrement. Le petit peuple lui fait des funérailles extraordinaires. Lui qui a tant méprisé les forums où les foules grisées par des slogans creux hurlent et trépignent, il a droit, pour son ultime voyage, à un hommage extraordinaire des Algériens.
Dans les salons cossus, on égrène le chapelet rugueux des erreurs, des excès, des violences, des échecs, mais l’Algérie profonde, indifférente aux difficultés de son quotidien, ne retient qu’une seule ligne du bilan : le chiffre infini de la sincérité de l’homme.
Quelles sont les supériorités qui élisent Boumediene à la considération des humbles ? L’empire incontesté du pouvoir absolu qui produit par ses monologues et ses règles sévères l’aversion et le rejet oint, chez lui, de bonne intention les paroles et les actes.
L’étendue de ses cumuls, le poids de sa dextre, qui soulèvent tant de haines chez certaines élites, suscitent paradoxalement la dévotion du peuple, parce qu’il comprend qu’ils servent ses intérêts.
Les combats qu’il mène pour s’imposer lui inculquent un principe simple : être toujours maître du rapport de force. Son sens du caractère de ses compatriotes « indisciplinés », « frondeurs » et « violents », sa prétention à être le seul à savoir ce qui est bon pour eux, influencent sa démarche. Boumediene assume sa dictature, mais il dit, en prévision du tribunal de l’histoire, qu’il traduit en actes la volonté du peuple. Lorsque les buts poursuivis sont « l’édification d’un Etat qui survivra aux hommes et aux événements, la justice sociale, l’industrialisation du pays, l’éducation pour tous et la solidarité avec les faibles et les opprimés à travers le monde », ces nobles fins justifient, dans son esprit, tous les moyens.
Houari Boumediene, une fois seul aux commandes6, gouverne avec une poignée de fidèles attachés à sa personne, depuis son séjour marocain pendant la guerre de Libération nationale. Ces fidèles, dont beaucoup n’ont ni passé historique ni vraies capacités intellectuelles, occupent les postes régaliens où se décide l’avenir du pays. Ils inspirent les grandes orientations du régime destinées, selon eux, à mettre en place une économie performante pour une société égalitaire. Malgré les milliards de pétrodollars investis et les ukases péremptoires, le projet se révèle peu à peu utopique. Le surinvestissement forcené et mal dominé par une ressource humaine inapte au but visé, la marginalisation des compétences dès qu’elles commencent à devenir critiques, l’erreur d’avoir donné la priorité aux industries, dites « industrialisantes », au lieu de privilégier les PME grandes créatrices de richesses, l’idéologie appliquée à la terre qui empêche de régler juridiquement le problème du foncier et rend aléatoire toute tentative de parvenir à l’autosuffisance alimentaire7, les moyens policiers et bureaucratiques utilisés pour rigidifier le dirigisme tatillon qui considère chaque avis discordant comme une « atteinte à la révolution », affectent, dès le départ, l’offre économique et sociale généreuse de Houari Boumediene.
Je me souviens de ce jour qui répare par sa symbolique les déficits du bilan que l’on ne cache plus. Je suis de ceux qui ne sont pas peu fiers de croiser dans les couloirs du Palais des nations des hommes venus de « là-bas », des djebels et des campagnes, gauches, intimidés, éblouis par les lustres, les lambris, les fauteuils, les tapis, le décorum, le protocole, soudain mis à l’aise par ce président au regard sévère qui les exhume de leur monde aux échos si longtemps atones, si longtemps hermétique et qui leur révèle avec véhémence, avec éloquence – au-delà des chiffres, des bilans et des projections auxquelles beaucoup ne comprennent rien – le lien dynamique entre les causes et les effets.
Houari Boumediene, fils de paysan pauvre, né dans ce Guelmois où les meilleures terres sont accaparées par l’envahisseur étranger ou par ses mercenaires locaux, ne peut pas ne pas vouloir réparer les injustices faites aux exclus, aux serfs d’hier.
Des réminiscences dramatiques inspirent ses mots : l’état des paysans dans l’Algérie coloniale. L’insoutenable misère. L’insoutenable mépris. Les cohortes d’hommes dévalant les jours de grand souk de leurs collines, pieds nus, gandouras rapiécées, debout tout le long du jour devant un misérable étal de quelques légumes ou de quelques œufs.
Il a le sens de la formule qui touche le cœur et le fait longtemps vibrer : « Prenezgarde, sijamaislarévolutionagraireéchouait, vousresteriezàjamaisdesesclaves ! ». Et ses mots sont homologués par son auditoire, tels que sortis de sa bouche, comme les véritables étalons de leur droit légitime à s’imposer sur leur terre reconquise. La réappropriation par l’Etat du patrimoine spolié, son découpage et sa redistribution à ceux qui le travaillent sont la pierre angulaire de la réforme agraire initiée par lui.
A la fin de son discours, un murmure indéfinissable naît sur les gradins de l’amphithéâtre, puis le bris de la distance, souhaitée par l’ordonnateur de l’événement, casse les règles du protocole. Les hommes enturbannés se pressent autour de lui en foule épaisse. Boumediene est dans son élément ; jovial, disert, heureux. Sourires, accolades, bons mots du terroir… On sent qu’il touche du cœur – et son émotion est partagée par tous – à ce but qui embellit son visage si anguleux, si dur : la dignité reconquise des humbles et des déracinés. Il leur permet d’avoir une autre représentation du monde. Ce jour-là, il grandit encore dans notre estime. L’ALN était composée essentiellement de paysans et de fils de paysans. Les violences que leurs pères avaient subies avaient commencé par la terre et pour la terre. Les hommes de l’ALN avaient pris le fusil au nom de la terre, celle du terroir et celle, plus vaste, qui s’appelle le pays. Dans le Palais des nations qui brille de mille feux, Boumediene met le cachet authentificateur de la révolution sur cet aboutissement : la justice sociale par la terre.
La justice sociale par la nationalisation des terres. Le progrès, le confort et l’accès à la culture par la promotion de l’habitat8. Le pouvoir d’achat par la distribution des bénéfices, je crois et j’adhère passionnément à la démarche, tout comme des milliers d’autres cadres de la nation. Nous nous sommes mobilisés. L’ANP donne le meilleur d’elle-même. Officiers et soldats payent de leur personne.
Les dogmes de Houari Boumediene sont nos dogmes. Nous sommes à l’unisson avec lui quand il clame sa foi en un monde libéré des préjugés, de l’exploitation et la domination : « CequiestbonpourlaPalestineestbonpourl’Algérie » ; « Notrepétrolen’estpasorphelin » ; « AlgerseralaMecquedesrévolutionnaires ». Après la débâcle de juin 1965 des armées arabes face à Israël, sa colère, décuplée par l’humiliation et par sa découverte soudaine de la realpolitik des Soviétiques9, ce cri de viscères : « IlsveulentécraserlesArabes ! ». Nous avons l’insigne honneur de participer avec notre sueur aux chantiers ouverts par Houari Boumediene : Abadla, la route transsaharienne, le Barrage vert et tant d’autres projets gigantesques, pharaoniques, à la mesure de notre espoir et aussi cet autre chantier, le canal de Suez, pour dire avec notre sang le rejet de la défaite. Je suis, moi, dans le peloton de tête, dans l’Egypte humiliée, mais éternelle et insoumise, avec ma 2e brigade blindée.
Liès Boukra, dans son excellent ouvrage Algérie, laterreursacrée, évoque le développement économique et l’élévation du niveau de vie des populations réalisés par le régime de Houari Boumediene. Je cite : « Troisplansdedéveloppementsuccessifsvontmettreenœuvrelastratégiealgériennededéveloppement » : un plan triennal (1967-1969) et deux plans quadriennaux (1970-1973 et 1974-1977). Le premier plan quadriennal se distingue déjà par le volume des investissements : 33,1 milliards de dinars, avec pour objectif un accroissement de 37% du PIB. Lors du second plan quadriennal, les investissements s’élèveront à 110 milliards de dinars. C’est un niveau d’investissement jamais atteint jusqu’alors dans aucun pays du monde, en un laps de temps aussi court : près de 28% du PIB en 1969 et plus de 50% en 1977. Le secteur industriel se taille la part du lion : 45% de la somme globale investie lors du premier plan et 43,5% lors du second, contre 15% seulement pour l’agriculture dans les deux plans. Les résultats de ce gigantesque effort d’investissement sont palpables. L’Algérie s’est couverte de chantiers pendant cette période. Des centaines d’usines voient le jour. L’Algérie se donne les moyens de fabriquer des tracteurs à Constantine, des camions à Rouiba, des moissonneuses-batteuses à Sidi Bel-Abbès, de l’acier à El-Hadjar… ElleliquéfielegaznaturelàArzewetraffinedupétroleàSkikdaetàAlger.
Endeuxdécennies, l’AlgérieaprisplaceparmilespuissanceséconomiquesduBassinméditerranéen. SonPIB (36milliardsdedollarsen1980), laplaçaitimmédiatementaprèsl’Espagne, àégalitéaveclaTurquieetlaYougoslavie, devantlaGrèce, lePortugal, leMarocetl’Egypte. Alamêmeannée, lerevenupartêted’habitantétaitde1 935dollars, ledoubledeceluiduMarocvoisin. Cesvingtansdecroissanceaccéléréesesontaussitraduitsparuneaméliorationincontestableduniveaudeviedespopulations. Plusde600 000emploisontétécréés. De1966à1987, lapartdeslogementsreliésauréseaud’eaucouranteestpasséede34%à60% ; cellebénéficiantdel’électricitéestpasséede30,6%àplusde72% ; celledelapopulationpossédantaumoinsunappareildetélévisionpassede4%à60%. Lenombredemédecinsestpasséde1 219en1963à17 760en1987 ; celuidespharmaciesde204à1 752etceluideschirurgiens-dentistesde151à5 684. Enmatièred’enseignement, l’effectifestpasséde809 000en1963-1964àplusde5millionsen1987-1988, dansleprimaire ; celuidusecondaireestpasséde19 500à600 000durantlamêmepériode ; enfin, celuidusupérieurestpasséde2 800à174 000. Ces chiffres enregistrés au-delà de la décennie 1970, sont le résultat de l’effort consenti par Boumediene. Ils sont à porter son actif.
Un homme seul
Mais ce bilan, globalement positif, aurait pu être encore meilleur si Boumediene avait été moins fermé aux avis critiques et aux débats démocratiques.
Le paysan rétabli dans ses droits est abandonné à lui-même. Où sont les écoles d’agriculture qui doivent former les centaines d’ingénieurs capables de le conseiller et de l’orienter ? Où sont les administrateurs qualifiés à même de le gérer ? Les mentalités ne sont pas préparées pour ce bond en avant et les outils d’encadrement et de contrôle sont déficients. Le rétrécissement des surfaces cultivables par l’érosion naturelle10 ou par l’envahissement du béton, déséquilibre définitivement le rapport du ratio nombre d’habitants/nombre d’hectares. Le paysan « fonctionnarisé » et caressé dans le sens du poil ne sait plus se lever aux aurores pour creuser son sillon. Les œufs qu’il consomme sont importés et la baguette du boulanger remplace la galette traditionnelle. Le mimétisme idéologique et les grands thèmes de la guerre de Libération nationale aveuglent toute une catégorie de cadres de la nation, même ceux dont les racines sont rurales, surtout ceux-là, devrais-je écrire, ceux supposés connaître l’agriculture et la mentalité du paysan.
Chez moi, lorsque deux paysans se rencontrent loin du terroir natal, la question qui fuse immanquablement est : « Keche’sabas’na ? ». Oui, e’saba : la bonne récolte ! La récolte salvatrice, el-âoula(les réserves)qui garantit l’autosuffisance alimentaire à la famille. Hélas, l’agriculture étatisée n’assure plus leur âoulaaux Algériens.
Des cargos traversent les océans pour venir accoster à nos ports. Nous sommes devenus tragiquement tributaires des importations pour vivre. Nous empruntons. Oui, nous empruntons pour manger ! Et la dynamique de l’endettement est un nœud coulant qui se resserre de plus en plus sur l’Algérie.
Le peu de succès des expériences de l’agriculture et des industries nouvellement créées impose à celui qui s’est investi de la mission de changer, par l’incantation, la nature des hommes, de recourir, pour racheter ses options fondamentales, à l’assistanat. La redistribution de la rente pétrolière, voulue d’abord comme palliatif provisoire, conduit à l’anesthésie générale de la société.
L’idéalisme et l’approche émotionnelle de ma génération masquent les impératifs concrets, incontournables d’un vrai développement de l’agriculture.
La stabilité politique à tout prix, donnée comme condition nécessaire pour raccourcir le temps et réussir un saut qualitatif, impose le silence à ceux qui, dans le pays, y compris au sein de l’ANP ou dans la haute direction du FLN, tentent de débattre démocratiquement, non pas des chantiers ouverts, mais de la conception des ouvrages, du choix des hommes et des moyens destinés à les mettre en œuvre.
S’il eut, vers la fin, douté du chemin suivit, aurait-il incurvé sa trajectoire ? Au prix de quel retour en arrière ? De combien d’arrêts d’étapes ? De quelle reconfiguration ? Mais il ne doute jamais. Cette obstination, sourde aux avertissements – même de ceux qui lui sont proches –, indifférente aux décevants bilans d’étapes, tient pour peu de choses les réalités du terrain, fait taire les voix sceptiques ou discordantes et transforme la trajectoire large, burinée et applaudie par le plus grand nombre en fuite en avant sur le chemin étroit, abrupt et épineux qu’emprunte le solitaire.
Tour à tour, partent les compagnons de la première heure, puis ceux de la seconde. Kaïd Ahmed, le commandant Slimane que les moudjahidine appelaient familièrement « Slimane Klata ». Sa situation au ministère des Finances est déjà inconfortable face aux passés-outre du Président et de certains ministres proches de ce dernier. Responsable de l’appareil du parti11, il met en garde contre la nationalisation des terres et leur découpage sans « filet de protection ». Il lui en coûte son poste et l’exil ; puis Ali Menjeli, également son adjoint à l’EMG, qui veut voir s’instaurer des débats libres au sein du Conseil de la Révolution et s’appliquer la règle de la majorité pour les décisions engageant l’avenir ; puis Medeghri dont on dit qu’il s’est suicidé ; puis Cherif Belkacem pour son franc-parler et ses réserves ; puis Bouteflika, forcé à une longue éclipse américaine et tant d’autres, frères, amis ou compagnons, y compris dans l’armée, balayés d’un revers de l’avant-bras, contraints au silence, à l’exil ou au suicide. Le colonel Zbiri qui facilite sa victoire de 1962, le commandant Abderrahmane Bensalem, la valeur robuste et sûre de la Base de l’Est et de la Zone Nord, pendant la guerre de Libération nationale, le commandant Saïd Abid et tant d’autres encore…
Deux décennies de monologues et de faits accomplis rétrécissent la scène politique algérienne, y compris le Conseil de la Révolution, comme une peau de chagrin. Oui, à la fin de la décennie 1970, à la veille de sa mort, Boumediene est un homme seul. Qui peut assumer l’héritage, en corriger les insuffisances et le faire fructifier ?
Cette « décérébration » du pays apparaît tragiquement lorsqu’il disparaît brutalement. N’ayant aucun compétiteur à même de lui disputer la préséance, Chadli Bendjedid, chef de la 2e Région militaire, membre du Conseil de la Révolution et bénéficiant du parti pris de la Sécurité militaire et des calculs étroits de quelques officiers, devient président de la République. Il succède, sans aucun pécule particulier, à l’homme qui a, pendant deux décennies, rempli l’espace par sa forte personnalité, son charisme et son omnipotence.
Le drame de Houari Boumediene est sa prétention à se mesurer seul à une divinité silencieuse, glaciale, impitoyable d’indifférence et de mépris : le temps ! Il tente de rétrécir la longue durée que nécessitent les gestations, les évolutions, les mutations et les maturations pour la calquer sur sa brève durée de mortel. C’est le produit de cette équation impossible que Houari Boumediene laisse à l’Algérie.
La mort suspecte de Houari Boumediene
La politique extérieure de Houari Boumediene, innovante et hardie, dérange et inquiète. Elle dérange des régimes arabes qui bradent leurs richesses naturelles pour bénéficier de la protection de ceux qui les exploitent. Elle inquiète des puissances régionales en proie à une boulimie de territoires. Elle inquiète les Français qui voient d’un mauvais œil l’émergence d’un pays fort, prospère et bien armé12, capable de contrer leur politique traditionnelle en Afrique et de représenter, à terme, une menace pour leur sécurité nationale. Depuis la nationalisation des hydrocarbures en 1971 et la « mainmise militaire » de l’Algérie sur le Front Polisario, Houari Boumediene est loin d’être l’ami des monarchies lointaines ou proches, des Français et des Américains13 et surtout celui d’Israël. Les votes aux Nations unies, les interventions sur le canal de Suez, le Front du refus et l’aide financière et militaire accordée aux mouvements de libération à travers le monde, font que beaucoup de pays considèrent l’Algérie de Boumediene comme l’ennemi n°1.
Ma conviction rejoint celle de beaucoup d’Algériens. Houari Boumediene est probablement victime d’un complot fomenté par des ennemis puissants et déterminés. Peu importe la main qui administre le poison. Les coupables sont à rechercher parmi ceux qui ont intérêt à voir l’homme, qui est en passe de faire de l’Algérie la « Prusse » de l’Afrique du Nord, disparaître.
Le service de protection rapproché de Houari Boumediene, et à sa tête Abelmajid Allahoum et Ferhat Zerhouni, ne fait pas le poids face aux professionnels formés et outillés pour des actions de ce genre.
Certains acteurs français, dont le très efficace Jacques Foccart, n’ont pas besoin d’explications détaillées, dès que le principe de l’élimination de tel ou tel dirigeant arabe ou africain est retenu par le pouvoir politique. La liste est longue de ceux qui figurent sur les pages noires du SDECE14 pour ne parler que de ce service. Nous en savons quelque chose pendant notre guerre de Libération15.
La SM
A la fin de l’année 1979, la 3e Région militaire aligne les unités les plus nombreuses de l’armée. Le SOST (Secteur opérationnel sud Tindouf), dont je suis le chef, compte l’essentiel de ces forces. Nous pensons, mes compagnons et moi-même que les auto-désignés « décideurs », déjà à l’œuvre à Alger, élargiraient les consultations aux personnalités nationales qui ont joué de grands rôles pendant la Révolution et qui sont demeurées à l’écart du régime, à toutes les institutions civiles qui subsistent et, bien sûr, à tous les chefs de Régions et commandants de forces. Mais le passé-outre est déjà en marche. L’appauvrissent du collège pensant de l’Algérie, résultat de deux décennies de pouvoir personnel, permettent à une poignée de policiers, lovés au sein de l’institution militaire, de décider de l’avenir du pays. Curieux critère de choix que celui de « l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ».
Dans L’arméealgériennefaceàladésinformation, je parle de la façon dont les choses se passent : Salim Saâdi, dont je suis le second à Béchar, me demande de me rendre à Alger pour rencontrer Kasdi Merbah afin de lui recommander de ne prendre aucune décision hâtive avant que l’ensemble des responsables militaires ne se réunissent et n’étudient la situation née de la vacance du pouvoir. Cette initiative de Salim Saâdi intervient après une réunion avec l’ensemble des officiers de la 3e Région militaire qui est, étant donné la sensibilité de notre frontière occidentale, la plus puissante en termes de moyens militaires.
Salim Saâdi connaît très bien Chadli, tout comme moi-même, qui est son adjoint pendant la guerre de Libération nationale. Nous sommes tous les deux convaincus que le chef de la 2e