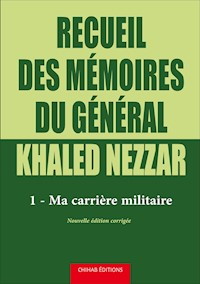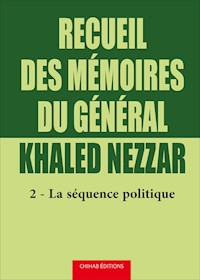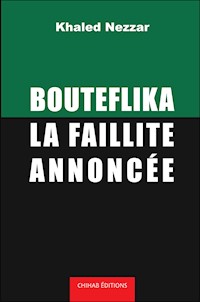
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Chihab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Ce Livre a été édité une première fois en 2003. Le premier mandat d’Abdelaziz Bouteflika arrivait à échéance et le second se profilait à l'horizon alors que plusieurs signes avant-coureurs annonçaient une situation dramatique pour le pays sous son règne. Cela se révélera tout au long de ces vingt dernières années de pouvoir, allant de déliquescence en déprédation. Bouteflika, un mandat pour rien, est écrit sans complaisance aucune et commente les événements du moment avec un sens aigu. Il convie à un exercice de pédagogie. Lors de sa sortie, il rencontra beaucoup d’entraves, à commencer par les pressions auxquelles étaient soumis les éditeurs et les difficultés imposées aux libraires et aux distributeurs. Sa diffusion à grande échelle fut empêchée, privant ainsi l’opinion publique d’un modeste témoignage qui aurait sans doute pu concourir à accélérer la chute du régime dont les millions d’Algériens souhaitent le départ seize ans plus tard, par des manifestations pacifiques qui forcent le respect et l’admiration du monde entier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BOUTEFLIKA
LA FAILLITE ANNONCÉE
Khaled nezzar
BOUTEFLIKA
LA FAILLITE ANNONCÉE
CHIHAB EDITIONS
© Éditions Chihab, 2019
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-348-2
Dépôt légal : mai 2019
Avertissement
Pourquoi je réédite le livre
Au nom de quelle éthique, au nom de quelle morale devrais-je m’abstenir de rééditer le livre que j’ai consacré, trois années à peine après qu’il eut étrenné son trône, et qui – prémonitoire – dressait déjà la liste de tout ce qu’avait commis et tout ce qu’allait commettre « le moins mauvais des candidats ».
Les outrances de langage, le régionalisme, les ruses, les intrigues, la corruption et la primauté des intérêts de la famille et du clan ont été érigés en mode de gouvernement. Les dérapages verbaux qui ont rameuté certains médias contre l’institution militaire ont conduit des magistrats étrangers à ouvrir des procédures et à émettre des commissions rogatoires. Ces initiatives ont démontré en quelle piètre estime notre pays était tenu. Sans ces dérapages, aucun lobby étranger n’aurait osé s’attaquer à la souverainetéde l’Algérie.
Le rabaissement du prestige du pays a été la conséquence logique des errements de tout ordre d’Abdelaâziz Bouteflika.
Il était né pour être président, « ne sachant rien faire d’autre que commander », confiait-il à un célèbre journaliste. Pendant vingt ans, frustré de parole, sevré de podiums, il s’était mis, dès sa prise de fonction, à courir d’une capitale à l’autre. Narcisse, fou de son image, se mirant dans les galeries des glaces de tous les palais du monde.
L’exercice d’un pouvoir sans limite a épaissi et opacifié les parois de la bulle où il s’était enfermé. Il ne pouvait plus voir le pays tel qu’il était. Il s’était fabriqué une Algérie à sa convenance : obéissante, veule, obséquieuse, courbée. La Constitution triturée, rafistolée, revue, corrigée, adaptée à sa pointure était devenue, sous son emprise, une machine folle, une arme capable de faire mourir et capable de ressusciter, capable de ruiner et capable d’enrichir, capable d’emprisonner par une lettre de cachet et capable de libérer par un coup de téléphone.Il était devenu le maître des carrières. Un souffle, une chiquenaude et la « figurine » sombrait. Que lui importait le passé, les enfants, les sentiments,le désarroi de celui qu’il avait décidé d’écraser. Les institutions de la République étaient son gant de fer pour imposer tous ses caprices.
Il était atteint de cette fièvre incurable : l’addiction maladive au pouvoir qui finit toujours dans la démesure de l’arbitraire par la loi du fait accompli.
L’AVC de 2013 ne l’a pas incité à la contrition et à l’humilité ; il a voulu passer outre l’implacable verdict de la providence par le procédé du clone.
« Les Dieux aveuglent celui qu’ils veulent perdre », disaient les anciens Grecs.
Peu à peu, le nom d’Abdelaâziz s’est effacé du lexique, remplacé par celui de Saïd. L’omnipotent, l’omniscient, le très redouté, le très redoutable Saïd, maire du palais, exhibant son propre frère, hagard, les yeux exorbités, les traits tirés, la lippe baveuse, déchu de sa dignité, poussé sur un tapis rouge par un commis au brancard, l’exposant à la commisération des Algériens et aux quolibets de l’étranger. L’étranger a trouvé un mot rare pour décrire l’indescriptible : « alacrité ». Les amuseurs, sur les plateaux des télévisions, utilisaient un autre crayon, trempé celui-là dans le fiel du rire insultant : « mort vivant », « fantôme », « zombi » et j’en oublie.
Il n’y a pire offense pour un chef d’Etat que les quolibets des saltimbanques. L’image poignante de ce visage ravagé par l’acharnement thérapeutique, saisi subrepticement par un visiteur de marque, a fait le tour du monde et nos diplomates, malgré eux, ont été instruits de sommer le photographe clandestin de ravaler sa pellicule au risque de perdre quelques marchés juteux.
Les Algériens seront à jamais marqués par ce que cet ambitieux à l’égo démesuré leur a fait subir. Plus que la ruine de l’économie et le pillage du Trésor public, l’atteinte à leur dignité marquera à jamais leur mémoire.
Mots entendus un jour dans une rue en colère, d’une capitale africaine : « Ici, ce n’est pas l’Algérie ! » Il a fait de l’Algérie l’étalon du ridicule et de la honte.
On a de la peine à placer sur le long curseur des folies humaines le délire de cet homme venu au pouvoir par la confiance de l’armée et les espoirs de tout un peuple.
Derrière le constat « des forces extraconstitutionnelles décident à la Présidence », apparaît le coup d’état violent que Saïd, le clone, a imposé aux Algériens. Il a mis en place une mécanique de pouvoir pour obtenir l’exécution du moindre de ses ordres. Ceux qui ont joué le jeu en sachant très bien l’état d’incapacité du Président en titre sont aussi coupables que lui. Le peuple brocarde leur nom tous les jours. Les titres n’ont pas rehaussé les fonctions. Ils les ont avilis.
Saïd a construit à ses courtisans le corridor de Sadig, la skifa de la tentation. Ils en ressortaient alourdis et patauds, parce que leurs poches remplies. Ils payaient leur dû au vizir par leurs petites pierres apportées au socle du grand frère : la caresse des mots indécents et soyeux que le peuple appelle « la brosse ».« Il gouverne avec sa tête ». « Son quotidien intellectuel est supérieur à celui de tous les Algériens réunis ». « Dieu a envoyé Mohamed à l’ou’ma et Bouteflika aux Algériens ».
Chacun tentant de fabriquer un centimètre de plus à la dimension du bonhomme. Ils ont fait d’un vieil homme muet, paralysé et absent « l’immense moudjahid » dont les portraits envahissants occultaient la blancheur des façades, un génie immortel : « Même mort nous voterons pour lui ». « Quand la maladie frappera, qu’elle prenne mes enfants et qu’elle l’épargne, lui ». Il était sidna Ibrahim El-Khalil, l’imperturbable prophète qui, le couteau sacrificiel à la main, s’entendait dire, par l’innocent déjà terrassé : « Que ta volonté soit faite, ô mon père », cette âya fabriquée par Moad Bouchareb pour servir sa carrière a fait frémir d’indignation tout un peuple.
Pour des intérêts bassement matériels, ils ont vendu leur âme. Tristes sires contraints de faire dans les surenchères et la démesure des louanges indécentes, pour garder leur place dans le machin.
Le 22 février 2019, ce coup de tonnerre dans leur ciel serein a mis en branle le tsunami qui a renversé le régime usurpateur de Saïd, bâti sur la violence,la corruption et le mensonge.
Les derniers totems du culte de la personnalité,de la déification du « guide » ont disparu les uns après les autres : Sadam Hussein, Mouammar Kadhafi, Zine El-Abidine Ben Ali, Hosni Moubarak et les autres prédateurs à vie peuplant les parcs naturels d’Afrique, aussi fameux que les premiers par les crocs et les griffes.
Tyrannosaures dont les longs règnes ont semé la désolation et la ruine. Aucun d’entre eux n’a jamais pensé que l’heure des comptes sonnerait tôt ou tard. Ils ont péri d’ignominieuses façons, qui sous la potence, un deuxième dans le noir et l’étroit d’un caniveau, un autre dans le silence et la solitude de l’exil, et un autre encore contraint de subir l’opprobre du peuple, la trahison de ses complices de la veille et le verdict des juges, ceux-là mêmes qui, hier à son commandement, condamnaient ses opposants. Le nôtre, celui que le mauvais sort et l’aveuglement de certains nous ont imposé pendant vingt longues années, condamné à mourir chaque matin quand, les yeux ouverts après une nuit agitée, il se pince la cuisse et qu’il s’aperçoit qu’il est toujours vivant.
Voilà le triste sort qui attend ceux qui, devenus puissants par la force d’une Constitution retaillée à leur mesure, ou par quelque autre accident de l’histoire, oublient l’adage ancien « Ki trouh etga’taâ es’nassel » (quand sonnera l’heure de l’infortune, aucune force au monde n’arrêtera la chute).
Khaled Nezzar
Préambule
Après avoir consenti davantage que la plupart des pays colonisés un très lourd tribut pour sa résurgence sur la scène internationale, l’Algérie a reconquis son indépendance dont le substrat essentiel repose sur la dignité de son peuple. Mais depuis plus de quarante ans, qu’en est-il de l’homme algérien ? De ses droits imprescriptibles ? De ses libertés individuelles et publiques ?De ses garanties démocratiques de citoyen face au pouvoir ? De ses attributs de gouverné face aux gouvernants ?
Certes, le pouvoir initial de l’Algérie libérée ne s’est pas établi sur des rapports de droit, entre l’Etat naissant et le citoyen à peine émergé des affres de la condition de sous-homme colonisé. Après l’occasion manquée au cours de la réunion du Conseil National de la Révolution, tenue à Tripoli en 1962, on ne pouvait espérer voir le pouvoir s’instaurer après débat démocratique entre le peuple et son nouveau dirigeant.
Cependant, au fil des années, l’Algérie s’essaye avec plus ou moins de bonheur à conquérir son droit à la démocratie. Nombreux et variés, les obstacles qui en ont ralenti la concrétisation se rattachent d’abord aux survivances de l’ère de la légitimité révolutionnaire, justificatrice de toutes les appréhensions du pouvoir.
Par la suite et durant la «décennie rouge», le terrorisme intégriste déclarant hérétique toute tentative démocratique, devait lourdement contribuer à ce blocage. Même les impitoyables mutations économiques et les contraintes d’un environnement international circonvenu ou abusé par les interprètes à sens unique des Droits de l’Homme, ont brossé le tableau le plus odieux d’une Algérie qui, d’après eux, s’enfonçait irrémédiablement dans la dictature tortionnaire. Ces facteurs n’ont apparemment guère favorisé l’évolution vers la démocratie tant souhaitée. Mais, aussi paradoxal qu’il puisse paraître, le pays au summum de la souffrance n’a jamais désespéré d’y parvenir.
Ainsi, malgré les errements graves des régimes précédents, quelles que fussent les tares des scrutins antérieurs, on n’ose plus désormais afficher des résultats électoraux défiant la vraisemblance. Le pluralisme balbutiant, et son corollaire la liberté d’opinion, s’efforcent de s’imposer comme acquis indiscutables.
Les trois dernières élections présidentielles, certes pas totalement exemptes de critiques, se sont néanmoins déroulées sans irrégularités criardes et le transfert du flambeau d’un pouvoir au suivant, depuis la fin du mandat du Haut Comité d’Etat jusqu’à Bouteflika, en passant par Zeroual, s’est effectué dans le calme et la sérénité, méconnus par nos moeurs politiques antérieures.
Or, l’on assiste depuis quelques semaines déjà à une campagne électorale dont les premiers débordements incitent à une interrogation angoissée… Le scrutin d’avril 2004 s’annonce sous des auspices que les initiatives du pouvoir en place rendent de jour en jour plus inquiétants. Le président actuel entend-il briguer à nouveau les suffrages des électeurs, comme apparemment il semble le vouloir ? Dans l’affirmative, les multiples et dispendieuses sorties présidentielles sur le territoire national, alors que durant les quatre années écoulées notre Président préférait sillonner le vaste monde, laissent perplexe le citoyen et surtout le contribuable qui assiste effrayé et impuissant à la dilapidation illégale des ressources de l’Etat au bénéfice d’un candidat dont le camouflage derrière l’habit du Président de la République n’abuse personne.
Que l’administration, par des procédés inavouables, tente de porter atteinte à l’indépendance du parti politique majoritaire dans le pays, et c’est tout l’acquis du pluralisme démocratique chèrement payé depuis 1988 qui s’effondre.
Que certains grands commis de l’Etat mettent les prérogatives de leur charge à la disposition d’une tendance partisane, fût-elle celle du président-candidat, et c’est la régression vers les années de plomb, la langue de bois et l’unanimisme tremblant des trois premières décennies de l’indépendance que l’Algérie actuelle récuse définitivement.
Aussi, les artisans d’une telle manoeuvre se tromperaient lourdement d’époque. L’Algérie d’aujourd’hui n’est plus celle des années 60 et 70, l’Algérienne et l’Algérien qui ont su mettre en échec la plus grande entreprise d’asservissement de leur histoire, par leur sursaut salvateur de janvier 1992 où certains, étrangers à nos souffrances ont cru déceler une « violence », ne se laisseront plus priver du droit imprescriptible de choisir, hors de toute contrainte étatique et administrative ou manipulation des urnes, les hommes chargés de présider à leur destinée.
Nostalgiques d’un temps révolu, certains attardés ne perçoivent pas que le pays est à un tournant de son histoire.
Sous les diverses bannières politiques et quels que soient les lieux de confrontation, la lutte des Algériens est une et indivisible, dès lors que sont communes leurs aspirations à la liberté,au progrès, à la démocratie.
***
D’emblée, il me paraît indispensable de préciser qu’en écrivant ces lignes, je n’ai aucune querelle à régler. Je n’ai non plus aucune inimitié envers quiconque. Et d’ailleurs pourquoi en aurais-je, puisque j’ai clairement exprimé parfois de manière abrupte je le concède ce qui me pesait sur le coeur.
Lorsque j’ai cru me tromper, j’ai humblement rectifié. C’est pourquoi je n’ai pas de rancune à assouvir. La seule passion qui m’anime c’est de tenter d’éveiller mes concitoyens face au choix déterminant qui se posera lors du prochain scrutin présidentiel. De toute mon âme je voudrais leur dire :
« Hommes et Femmes de mon pays unissez-vous tant qu’il est encore temps pour barrer la route aux adeptes des temps révolus. Unissez-vous pour définitivement briser à l’intégrisme sanguinaire toute velléitédes’emparer du pays commeotage. Unissez-vous pour la démocratie républicaine, évitant à l’Algérie le statut avilissant d’un sultanat médiéval. »
Alger le 17 août 2003
L’année terrible
1994 est l’année du constat que l’idéologie islamiste qui a décidé, par la violence absolue, de parvenir au pouvoir, a échoué. Pendant deux années – les années HCE1 – la stratégie de la terre brûlée mise en œuvre par les groupes armés a intégré, non seulement la destruction du tissu économique, la liquidation physique de l’intelligentsia, mais aussi l’isolement du pays par l’assassinat des étrangers, l’exportation de la violence et bientôt par le détournement de l’avion d’Air France. L’encouragement des chapelles idéologiques partageant avec eux les mêmes valeurs, la complicité par le silence des hommes de religion dans les temples reconnus de l’exégèse coranique, la collusion d’une partie de la classe politique, dite « conservatrice », les prises de position et les actions de personnalités historiques, lesquels, par calcul partisan ou esprit de revanche (souvent les deux), considèrent l’intervention de l’armée pour arrêter le suicidaire processus électoral comme « une grave atteinte à la démocratie »2, les « erreurs » d’appréciation des chancelleries étrangères, la trahison ou la fuite de beaucoup d’intellectuels, le simplisme débile de certains clercs3, avaient donné aux intégristes des raisons de croire à leur inéluctable victoire.
Le terrorisme islamiste, ainsi politiquement aidé ou ménagé, prospérant par la crainte qu’il inspirait – et chez le petit nombre par les promesses d’une utopique cité islamique idéale – avait étendu ses tentacules à travers le pays. Mais sans jamais pouvoir menacer sérieusement l’Etat.
L’armée, avant même l’arrêt du processus électoral, était devenue la cible des groupes armés. L’attaque de la caserne de Guemmar, le 25 novembre 1991, marque le début de l’offensive contre les forces armées. L’AIS et les différents GIA, vont multiplier les embuscades, les attaques à la bombe et les coups de main contre les installations militaires, causant des centaines de tués4.
La connivence objective avec l’islamisme politique violent sera dans quelque temps démontrée à Rome. San Egidio, en introduisant un doute sur la nature de l’intégrisme et en occultant ses méthodes sanguinaires et ses buts5, sera un concept politique destiné à imposer une vision mensongère de la réalité algérienne, et tendra, corollairement, sous le fardage de cautions « démocratiques » délirantes6 vers une reddition de la république.
En tentant de discréditer la partie du peuple qui refuse le diktat islamiste7 et en présentant l’armée comme un des « belligérants » hostiles à la voix du dialogue et de la réconciliation, car « menacée dans ses privilèges », les conjurés de Rome exacerberont la déstructuration de la société, déséquilibreront davantage la scène politique, porteront gravement atteinte au moral de l’armée et des services de sécurité et donneront un supplément d’âme au terrorisme.
Le refus de la redditionde la républiquedonnera aux GIA, ainsi sortis de leur isolement par San Egidio, un alibi politique de taille pour porter leur barbarie à des sommets rarement atteints à travers l’histoire.
L’économie minée par les germes destructeurs que comportaient les options socialistes des années 60 et 708, ravagée par la gestion incompétente de Abdelhamid Brahimi, accablée par la baisse simultanée du dollar et du prix du pétrole et par le service d’une dette extérieure importante, est moribonde. Le service de cette dette, qui absorbe 70 % des recettes du pays, a contraint l’Algérie à réduire ses importations ; ce qui a eu pour effet de ralentir davantage l’appareil économique, d’augmenter le nombre des chômeurs et de porter le désarroi, de la jeunesse surtout, à son comble. Le gouvernement, pour éviter un effondrement total du pays, se tourne vers les organismes financiers étrangers (FMI et Banque Mondiale) qui imposent des mesures draconiennes pour accorder leur soutien.
C’est ainsi que peut se résumer la situation du pays en cette fin de l’année 1993.
Le HCE, dont j’étais membre, avait fait le serment de gérer le pays, uniquement, pendant la période qui correspondait à ce qui restait du mandat de Chadli Bendjedid. Il n’était nullement question de prolonger outre mesure la présence de cette « présidence » collégiale au-de là.
1994, pourquoi Bouteflika fut-il pressenti ?
La fin de la mission du HCE approchait, il fallait à tout prix éviter la vacance à la tête de l’Etat. La situation particulière que connaissait le pays ne permettant pas, malheureusement, d’aller à des élections. Le nom de Abdelaâziz Bouteflika fut proposé au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. Je fus mis au courant et nous en discutâmes longuement. Nous conclûmes que, malgré certains « handicaps »9, il pourrait être l’homme de la situation.Il avait, nous disait-on, l’intelligence et le savoir-faire pour capitaliser ce que nous avions déjà engrangé. Le passé-outre péremptoire : « l’Algérie avant tout ! » fit taire toutes les réticences. Qu’importe les griefs anciens. Il y avait péril en la demeure.
La direction de l’armée, en refusant de s’impliquer directement dans la gestion, était soucieuse de prouver que les grandes décisions prises depuis 1992 ne l’avaient été que dans l’intérêt du pays. L’ANP devait rester unie, homogène, vigilante et offensive pour combattre efficacement le terrorisme !
Nous voulions également mettre l’ANP à l’écart des empoignades que connaissait l’arène politique afin de préserver sa cohésion et son prestige. Elle devait rester coûte que coûte la gardienne intraitable de l’intangibilité des frontières, de l’unité nationale, de la nature républicaine de l’Etat et de l’option irréversible sur la démocratie, la modernité et le progrès. Ces idées simples, qui émergeaient au-dessus du foisonnement idéologique alentour, étaient le ciment de notre cohésion. Il n’était pas question de les mettre aux enchères. Gérer directement les affaires publiques serait mettre ces valeurs non négociables à la portée de partis et de personnes, dont certains étaient atteints de la rage. Les politiques pouvaient, eux, discutailler à loisir avec ceux qui parlaient de ²régionalisation², ceux qui espéraient (en aidant par leurs médias, et leur hospitalité, les GIA) agrandir leur territoire. Ceux enfin qui,se posant en vicaires d’Allah, prétendaient dispenser le paradis pourvu qu’on accepte leur dictature.
Ce recul de l’armée de la scène politique n’est donc pas la manœuvre hypocrite de décideurs tapis dans l’ombre pour tirer les ficelles sans prendre eux-mêmes de risques, se contentant d’agiter des marionnettes, des comparses. C’est une décision qui préserve le contrat moral entre l’institution militaire et le peuple algérien, pour la sauvegarde de son patrimoine idéologique, cet héritage indivis, fruit d’innombrables cimetières et de séculaires espérances.
Cette raison – qui n’est pas la seule, mais qui est la principale – qui tend à perpétuer à l’Institution militaire son rôle de défense de l’Etat et des idéaux républicains qui l’inspirent, ont fait que j’ai quittéla fonction de ministre de la Défense nationale afin de me consacrer uniquement à ma mission politique au sein du Haut Comité d’Etat.
La fin d’année 1993 était pour moi un dilemme, j’étais ciblé par les tueurs islamistes. Ils avaient déjà tenté de m’assassiner à trois reprises, en 1991 pendant l’état de siège, en 1992 chez moi (la tentative sera déjouée par une sentinelle) et une troisième fois, le 13 février 1993. Ils pouvaient récidiver n’importe quand. Ministre de la Défense nationale, je risquais de disparaître sans laisser de responsable à même d’assurer à l’armée la continuité du commandement dans le respect des grands équilibres qui l’articulent : sa composante populaire, la promotion des cadres en fonction de l’engagement et de la compétence, et la préservation, par leur constant rappel, des dénominateurs communs qui soudent ses rangs.
Ce corps hiérarchisé à l’extrême et sur lequel reposaient, plus que jamais, les espoirs de toute une population, devait être mis à l’abri des ruptures et des secousses. Il fallait à la tête du ministère que je commandais, un responsable ayant eu sous ses ordres,à un moment ou à un autre, l’ensemble des officiers et possédant les qualités susceptibles de le faire accepter par tous. Liamine Zéroual faisait l’affaire. Après avoir présenté la situation aux cadres supérieurs de l’Armée, je la soumets au Haut Comité qui l’entérine.
Je fais ce bref rappel pour démontrer que notre préoccupation à l’époque était de deux ordres : préserver l’unité de l’armée en lui assurant un commandement adéquat et lui préserver son rôle de gardienne des valeurs de la république en l’éloignant, autant que possible, de la scène politique. Par éthique, et par respect pour mes compagnons du HCE, je ne voulais pas, moi, eux partis, “rempiler” avantageusement quelque part.
Nous nous mîmes à la recherche d’une personne pouvant faire face à la situation en ces circonstances difficiles. Lorsque le nom de Bouteflika a, pour la première fois, été prononcé par des militaires, j’avais déjà quitté le MDN10. Cet ancien membre, très médiatisé, du Conseil de la Révolution qui avait dirigé l’Algérie pendant presque 15 ans, semblait avoir le profil qui convenait pour faire face à tant d’épreuves. Il appartenait à la génération qui avait combattu pour l’indépendance et il avait été proche de Houari Boumediene, l’homme des grandes ambitions pour son pays.
La journée des dupes,manœuvres et psychodrames
Bien avant que Bouteflika ne fût pressenti pour exercer la magistrature suprême, il avait émis le vœu d’être reçu par moi. C’était vers la fin