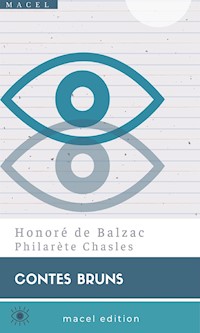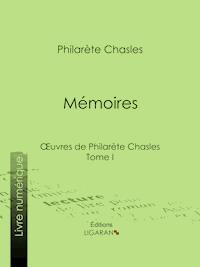
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est à l'âge de trente ans que M. Philarète Chasles a déjà eu la pensée d'écrire ses mémoires ! Ne se croyant pas destiné à une longue vie, peut-être même doué d'une seconde vue, il prévoyait la mort subite inattendue qui le foudroya à Venise."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’est à l’âge de trente ans que M. Philarète Chasles a déjà eu la pensée d’écrire ses mémoires ! Ne se croyant pas destiné à une longue vie, peut-être même doué d’une seconde vue, il prévoyait la mort subite et inattendue qui le foudroya à Venise.
Sa volonté a été de revivre par le souvenir, et de parler encore à ses concitoyens et d’eux et de la patrie.
Voici la première préface faite en 1828 ou 1830 :
Un homme n’intéresse et sa vie n’a de prix que par ses rapports avec l’époque où il est né. Qu’est-ce que notre individualité auprès de cette masse de générations qui vont s’engouffrant dans les âges ? Une feuille de la forêt ; une goutte d’eau de la mer ; un grain de poudre dans les champs. L’égoïsme des Mémoires serait inexcusable, s’il n’avait que lui-même pour fin et pour but.
Mais telles circonstances peuvent naître et entourer un berceau, développer une existence, planer sur un tombeau, de manière à faire d’un seul homme, même inférieur et médiocre, une spéciale et caractéristique curiosité de son époque. Alors qu’il s’explique, qu’il s’analyse ; il fera de l’histoire : chacune de ses révélations sur lui sera précieuse ; quand même il n’aurait point de génie, il en apprendra plus à son lecteur qu’un homme de génie qui devinerait au lieu d’avoir observé. Le hasard d’une naissance, la singularité d’une éducation, peuvent donner de la valeur à toute une existence ; il serait dommage que de tels êtres, si complètement fils de leur temps, mourussent sans se déployer et se soumettre à l’analyse, sans donner sur leur propre caractère les lumières qu’eux seuls possèdent.
Je ne sais quel vague pressentiment me dit que je n’ai pas une longue vie à passer. Erreurs, défauts, vertus, dévouements, folies, bienfaisances, duperies, générosités, m’ont précipité vers une situation singulière, d’où je ne sortirai peut-être que par une mort violente. La source première d’une vie si étrange et si malheureuse est dans ma naissance et dans mon temps ; dans l’éducation que cette époque m’a donnée, dans le développement de mon esprit et de mon âme. J’aime la bonne renommée ; ma réputation est sinon flétrie, du moins compromise. J’aime la gloire ; je n’ai rien fait pour elle. Mon avenir obscurci, mon cœur brisé, ce pressentiment douloureux d’une fin prochaine et misérable, me font prendre la plume. Je voudrais dire ce que je suis, pour que l’on ne me peigne point sous de fausses couleurs ; je voudrais, à défaut de ces travaux utiles que je n’ai pu accomplir, laisser au moins une image de moi, non difforme et fausse, comme la créent les hommes menteurs, mais réelle, mais digne d’intérêt, d’estime et de pitié.
Je n’ai que trente-deux ans ; et sans doute, à ma place, plus d’un de mes contemporains vivrait en paix. Mais les blessures morales que le monde m’a laissées sont profondes ; et cette douleur que d’autres ne ressentiraient pas, il faut l’expliquer, il faut l’arracher à l’ironie et à l’injure. Si j’ai été bon, que le souvenir de ce qu’il y a de mieux en moi ne soit pas anéanti. Si j’ai été faible, que cette faiblesse, souvent généreuse, ne soit pas transformée en bassesse. Si les hommes parmi lesquels j’ai vécu m’ont méconnu et brisé, que justice leur soit faite. Si à mon dévouement l’ingratitude, à mes plus nobles efforts la malveillance, ont répondu, que je ne m’éteigne point sans laisser une trace, même légèrement et facilement effacée, de ce dévouement et de ces efforts.
Je suis fils de l’un de ces hommes qui concoururent de toute leur puissance au renversement du trône de Louis XVI. Mon père vota la mort de ce roi. Une enthousiaste ardeur, un esprit cultivé, une faconde hardie, une ambition plus vive qu’habile, un sincère amour des institutions républicaines, une parfaite sincérité dans ces opinions, isolèrent mon père, Pierre-Jacques-Michel Chasles, de la foule des démocrates. Personne ne reproduisait plus complètement que lui ces puritains, dont la pensée enflammée d’un seul désir, mais convaincue et naïve, eût détruit le monde pour construire la République de Jésus-Christ. Roturier, et devenu secrétaire d’un ministre, Loménie de Brienne, il subit avec douleur les humiliations que lui imposaient sa situation et son avancement. Longtemps, comme il me l’avoua lui-même, il couva cette haine de la monarchie, haine trop excitée par tant de vices joints à tant de médiocrité, de dédains et d’injustices. Dans le cours de la Révolution, il prit parti avec les plus véhéments, condamna Louis XVI au supplice, partit aussitôt pour l’armée, se battit bravement, se fit casser la jambe gauche devant Menin, jura de demeurer sur le champ de bataille tant que la ville ne serait pas prise, y resta sous un feu de mitraille opiniâtre ; se fit à lui-même l’opération d’enlever les esquilles de sa jambe brisée ; revenu à Paris, voulut relever la Convention croulante ; entra dans la conspiration de prairial, et fut enfermé dans le château de Ham. Bonaparte régna ; mon père, dévorant son courroux impuissant et sa douleur, se retira dans un asile profond, rompit avec tous ses anciens amis et passa ses derniers jours à regretter le passé, à mordre son frein et à prédire un avenir de République. C’était un homme peu commun. La sagesse d’un jugement froid lui manquait. Sa sincérité était extrême. Son caractère était un produit extraordinaire d’une époque extraordinaire. Il était né sensible ; il avait voulu se faire austère. Professeur de rhétorique dans sa jeunesse, il s’était plié comme il avait pu au vulgaire dialecte des clubs. Il était entré dans les ordres ; et dans sa vieillesse il porta le titre et jouit de la retraite de général de division. Ses mœurs premières étaient élégantes ; il avait revêtu, avec le républicanisme, la sévérité. L’entraînement de son âme était sans bornes ; ses intentions portaient toutes un caractère d’enthousiasme admirable ; ses actions, mues par une exaltation si vive, pouvaient subir plus d’un reproche. L’habitude d’un théâtre tragique et public lui rendait la vie domestique impossible. Enfin, c’était l’idéal de cette puissance d’imagination fougueuse, que le bien séduit et qui souvent se trompe dans son élan.
Je reçus une éducation de fièvre grandiose et de sensibilité violente qui fut le premier chaînon de toute ma destinée. Je tenais de ma mère un caractère concentré, doux et réservé, qui ne s’accordait en rien avec l’ardeur véhémente de mon père. L’effet d’une telle éducation sur moi fut singulier. Au lieu de me précipiter dans toutes les idées que mon père m’offrait confusément, je les savourais, je les méditais, je les couvais ; elles s’enfonçaient dans mon cœur ; elles y restaient à jamais gravées. Un esprit tenace et une âme constante ne laissaient s’évanouir aucune de ces impressions. Je les ai conservées, et leur bizarre mélange a décidé de tous mes sentiments, de toutes mes fautes, de tout ce qui m’honore, de tout ce qui m’isole, de tout ce qui me perd, de tout ce qui me navre et me voue au malheur.
Mon père, singulier en tout, et n’ayant autre chose à faire qu’à élever son premier enfant, me traita comme une République à fonder. Il résolut que rien de mon éducation ne ressemblerait aux éducations communes. Né en 1799, au mois d’octobre, dans une petite propriété voisine de Chartres et appartenant à mon père, je fus, tout au sortir du sein maternel, plongé dans la cuve bouillante où le vin nouveau frémissait. Les préceptes de Rousseau furent suivis jusqu’à l’âge de quatre ans. Mais alors on changea de route. À cinq ans, je savais lire ; à six ans, j’écrivais ; à huit ans, je savais le latin et traduisais Horace. Au lieu de catéchisme et de livres enfantins, on me donna Plutarque, Anacharsis et Cornélius Népos. Chaque jour, il fallait copier une page de prose républicaine ; des fragments de romans héroïques ou sentimentaux s’y mêlaient ; c’était Clarisse Harlowe, Grandisson ou Cleveland. Jamais éducation ne fut plus entièrement, dois-je le dire ! plus follement dirigée, vers la passion, vers le désintéressement, vers l’abnégation de soi, vers l’analyse de son propre cœur, vers le culte d’un héroïsme idéal. Qu’on y ajoute la continuelle présence de mon père, ses discours enflammés, ses commentaires véhéments, son adoration pour Jean-Jacques. Ma première pensée nette et décidée fut qu’il était nécessaire de s’oublier soi-même et de sacrifier aux autres sa personnalité.
Par une étrangeté nouvelle, les penchants de mon esprit me portaient plutôt à l’observation des hommes, et à une sagacité assez fine, qu’à cette duperie généreuse que la religion m’avait inculquée. J’alliai ces deux contrastes ; et, de bonne heure, je m’habituai à me résigner, non en aveugle, mais les yeux ouverts ; à me sacrifier sans enthousiasme, à résoudre de bizarres dévouements dont l’inutilité m’était connue. Dans cette étude psychologique que je fais sur moi-même, je dois dire que, si des rapports éloignés semblent rapprocher mon éducation de celle d’un homme éloquent, Jean-Jacques Rousseau, les facultés éminentes de cet écrivain sublime m’étaient refusées. D’autres facultés, plus humbles, étaient les miennes ; et qui verrait ici un parallèle insolent et niais entre l’auteur d’Émile et celui qui trace ces paroles m’outragerait sans motif.
Je commençais ainsi avec ce siècle, avec ce siècle d’orage et de chaos. Les éléments fébriles m’environnaient. Je cherchais à les classer ; je systématisais toute cette atmosphère ardente qui tourbillonnait autour de moi. Les principes paternels n’avaient pas pu me donner une très haute vénération pour la République française ; j’eusse été girondin, mais non montagnard. Quant aux autres dogmes de ces croyances, elles pénétrèrent profondément dans mon être. Élève de Rousseau, sans autre foi que celle de Dieu, de la nature et d’une sensibilité qui, développée si tôt, ne tarda pas à devenir maladive, je me consumai de bonne heure en des méditations et des rêves dangereux. À la lecture de ces œuvres mâles et fières qui avaient entouré mon berceau, se joignirent bientôt Mme de Staël, Goethe, Chateaubriand. La flamme environnait cette éducation toute intellectuelle. Je ne prétendais point devenir auteur. J’eusse voulu devenir grand par les évènements. Un mélange d’orgueil, de méditation, de tendresse, m’enivrait dès le premier âge ; et la puberté, qui vint de bonne heure, augmenta cette fièvre morale à laquelle on m’avait si imprudemment livré. Mon enfance, je ne sais si j’en eus une. Les exercices du corps et les jeux puérils me furent inconnus. La gaîté, la légèreté, l’étourderie des premiers jours de l’homme, étouffés par une précocité si malheureuse, disparurent avant que j’eusse dix ans. Vous vous trompiez, mon père, en renversant ainsi l’ordre de la nature. Après avoir été un enfant-homme, je suis un vieillard-jeune. Ces pages ne renfermeraient-elles que cette seule leçon, elles seraient utiles, et je ne me repentirais pas de les avoir écrites.
Que veux-je faire ? Ce ne sont pas mes propres mémoires, ce n’est pas même l’histoire du temps où j’ai vécu. Arrivé au seuil de la tombe et ayant subi à peu près toutes les impressions, vibré à tous les grands souffles de mon temps, je veux conserver le souvenir de ces émotions que personne ne songe à recueillir. Ma personnalité n’est pas en jeu. Il ne s’agit pas d’un lutteur vaincu qui se venge de ses défaites ou qui les explique. Pas davantage n’apporterai-je des documents diplomatiques nouveaux à l’histoire de mon temps. J’ai vécu près d’un siècle ; j’ai beaucoup senti, beaucoup pensé et beaucoup vu. C’est ma seule raison pour écrire.
L’égoïsme est donc parfaitement absent de cette œuvre. Toute prétention au beau style lui est également étrangère. J’ai assisté à l’un des plus étonnants spectacles du monde, à la descente progressive d’un peuple qui croyait s’élever, qui croyait en lui-même et qui tombait, de chute en chute, et de profondeur en profondeur, sur la pente de la décadence. J’ai connu tous les acteurs. J’ai été accessible à toutes les impressions, je dis aux honorables et aux généreuses forces. On ne m’a rien caché parce que je n’étais le rival de personne. On m’a laissé voir tout le fond des mœurs, on m’a laissé libre de tout analyser, de soupeser les mérites, de lever les masques, de défaire les draperies et de mieux comprendre le mouvement général en le saisissant dans les mouvements partiels des individus.
N’ayant point de vanité, je n’ai point souffert de cette situation ; mais chaque pas en avant dans la carrière de la décadence française me pénétrait d’amertume, et chaque vilenie de caractère et d’acte, chaque individu servile ou vénal me marquait à l’âme d’une pointe aiguë. J’ai beaucoup souffert de cette peine intérieure.
Ô pouvoir du vrai ! Suprême loi ! Essence souveraine et profonde de l’art même et de la poésie, qui semble vivre de fictions ! Ce n’est point la grandeur d’un homme qui rend ses confessions intéressantes, ce n’est pas son héroïsme ou les curieuses aventures dont sa vie a été bercée qui nous attachent, nous entraînent et nous suspendent à son récit. Dès qu’il est vague ou incomplet, ce récit, c’est que le conteur ment ; fût-il Napoléon, le dégoût s’en mêle. Le retrouvez-vous intéressant, vif, sympathique, c’est qu’il est vrai ; fût-il une femme de chambre comme Mlle Staal-Delaunay et n’eût-il absolument rien à nous dire, comme elle, sinon que sa maîtresse l’ennuyait et que son amant lui plaisait davantage, nous l’écoutons aussitôt, nous la suivons, nous l’adorons, non pas elle, mais le vrai qui est en elle ; le vrai délié, fin et net, qui sort par petits filets de cette plume sobre et sans couleur. Le dernier siècle qui sépara Louis XIV de Louis XV est mieux raconté par elle, qui parle seulement d’elle et de futilités, que par Voltaire lui-même. C’est qu’elle est vraie.
Je ne serai pas plus ridicule que cette femme d’esprit en étant vrai comme elle. Je ne prétends pas à son charmant babil. Comme elle je ne dénigrerai rien, je ne m’exhausserai pas et ne disposerai pas les flambeaux pour faire de ma personne un appareil d’optique ; ce jeu de la vanité qui s’illumine elle-même me cause de la pitié. C’est le siècle, le temps, les autres, la vie – ce siècle qui m’emporte, cette scène mouvante dont je fais partie, que je ne peux m’empêcher de redire. Je ne parlerai de mes impressions que pour mieux répandre la lumière de ce que j’ai vu, en prêtant au récit la chaleur de ce que j’ai éprouvé. Voir ne suffit pas ; l’émotion est la plus vive partie de l’observation. Je serai vrai dans les deux échos de ce que j’ai vu – et j’ai beaucoup vu – de ce que j’ai senti, et j’ai beaucoup souffert.
La première et obscure souvenance qui ait imprimé son émotion et son empreinte dans les plis de mon cerveau est triste et singulière ; elle caractérise bien son temps, et on ne pourrait inventer mieux, si l’on était romancier. Je me rappelle une chambre carrée et noire, des volets toujours fermés, une sonnette enveloppée de coton ; des personnes qui marchaient sur la pointe des pieds, qui se parlaient bas, qui couraient à la porte, qui poussaient lentement un volet et l’entrebâillaient, enfin qui avaient peur ; cela se passait autour d’un petit lit ou berceau tout blanc, posé au pied du lit de ma mère et où je reposais. Ce quelque chose de sourd, d’étouffé, de comprimé et de passionné à la fois, qui a pesé sur toute ma vie comme un nuage orageux et mat sur une campagne, semble dater de cette époque. Je n’avais pas plus de cinq ans, et ce très clair souvenir est pour moi comme d’hier. Le crépuscule de la chambre sombre ne m’a jamais quitté, même dans mes jours de joie ou dans mes heures de succès. Une petite serinette qui éveillait l’enfant dans cette obscurité profonde m’annonçait la douce et charmante figure de ma mère, toute fraîche, jeune, dont je vois encore les joues roses, les cheveux noirs et le sourire inaltérable, sourire qui se maintint dans la vie la plus douloureuse et malgré une sensibilité délicate jusqu’au malheur. Victorine-Thérèse Halma était d’une famille protestante de Sedan, originaire de Hollande et tenant aux célèbres imprimeurs Halma, de Rotterdam ; veuve de M. Durége, que la révolution avait emporté, elle rencontra mon père, ramené de Ham aux Invalides, et épousa, à vingt et un ans, mon père, qui en avait quarante-cinq et qui était proscrit. Une jambe de moins, cassée sur le champ de bataille de Hondschoote, et l’âge, qui s’avançait, n’enlevaient rien à cette ardeur de tête, de cœur et de tempérament, à cette fougue du dix-huitième siècle dont mon père était un des représentants les plus extraordinaires et les plus excessifs. C’était la fièvre passée à l’état normal, de la lave au lieu de sang, la foudre éternellement grondante, une trombe au lieu d’un souffle de vent pour enfler la brise ; notre siècle n’a plus aucune idée de ces existences dont Diderot, l’abbé Raynal et Mirabeau ont inauguré l’avènement. La pitié, la charité, les sentiments généreux lui étaient naturels ; l’habitude de conspirer et celle de déclamer comme Mably faisaient partie de sa vie. C’était au commencement de l’empire. Napoléon ne voulait laisser désormais déclamer que Talma, gronder que son canon et conspirer personne. Voilà l’explication de cette chambre voilée, de ce tombeau de ma naissance. Mon père ne paraissait pas ; il restait enfermé dans un petit cabinet, relisant Rousseau, à ce qu’on m’a dit, car il était essentiellement sincère. Ma mère, toujours fraîche et souriante, pleurait silencieusement ; elle m’embrassait et la serinette du matin faisait son office.
Ce n’était pas une plaisanterie que la proscription en ce temps-là ; le jeu politique où l’on risquait fort peu en 1846, avait alors pour enjeu la tête des joueurs ; les crieurs des rues causaient cette anxiété qui pénétrait même sous mon berceau. Mon père avait pris une part très active aux derniers efforts de la République, il était revenu sans permission se cacher à Paris avec une jeune femme, ma mère, et son fils aîné, moi qu’il nommait Philarète, espérant bien que ce nom-là ne se trouverait pas dans le calendrier et que je partagerais ses dogmes. Il se trompait. Saint Philarète fut un saint ermite, et j’avoue que tout en reconnaissant la sincérité de mon père, je ne partage nullement son enthousiasme contre le Christianisme et cette ardeur du dix-huitième siècle qui l’embrasait.
Mes premiers éveils ne furent pas littéraires ou livresques, comme dit Montaigne, mais causés par le spectacle de mes semblables. Je me rappelle très clairement qu’il n’y avait que les hommes qui m’intéressassent, et j’y regardais, mais j’y regardais à fond. Je sondais la caverne de l’âme, autant qu’il était en moi. L’étonnement que l’être humain me causait peut se comparer à celui qu’éprouverait un paysan qu’on mettrait dans une horloge immense, au milieu de toutes les poulies et de tous les poids. Des livres purement livres je faisais dès lors peu de cas. Le premier qui m’ait fort attiré, ce furent les Confessions de Jean-Jacques, le second Clarisse Harlowe. Je voyais les reports de l’horloge.
La naïveté avec laquelle ma surprise se manifestait ne me rendait guère aimable. J’étais un enfant singulier, point méchant, mais qui n’était pas facile à comprendre et qui déplaisait de temps à autre. Ce bon Armand Dailly, un excellent Jocrisse qui jouait alors à l’Odéon, en a su quelque chose. C’était une face de paysan bête, qui riait niais, parlait niais, marchait niais, pensait de même et qui avait eu l’esprit d’appliquer tous ces mérites aux jeux de théâtre. Il ne jouait pas, il arrivait en scène où il était lui-même. Un jour que je le voyais arroser ses guimauves, tout petit que j’étais, admirant ses jambes écarquillées et ses yeux aussi, je lui dis avec un enthousiasme réel : « Ah, monsieur, si vous jouez les bêtes, comme cela doit être naturel ! »
J’avais cru lui faire un compliment.
Au moment où je suis né, l’avortement des utopies que l’on avait prétendu et espéré réaliser était complet. Les marches éclatantes ou plutôt les courses et le vol rapides de cet épervier à jambes de cerf, Bonaparte, à travers l’Italie, résumaient énergiquement la Révolution active, vengeresse, immorale et victorieuse. On pillait tout, on battait tout, on prenait tout. Aucun principe n’était éclos pour remplacer le principe monarchique mort, que l’idée de l’honneur chevaleresque. Ma mère, réfugiée avec mon père, blessé et boiteux, dans un creux de vallée, entre les blés de la Beauce et les bois du Perche, y pleurait son premier mari ; mon père ruminait ses auteurs anciens, ses espoirs déçus et ses griefs. Sa fortune était atteinte, non détruite. Il acheta un petit bien, Poiffonds.
Poiffonds, cette retraite que j’ai été visiter vers 1867, par curiosité, s’appelait ainsi, Poiffonds, du fonds des pois ; et la triste uniformité des plaines de la Beauce s’y abaissait un peu, creusant un petit nid de verdure et de fraîche solitude qui, dans ces parages monotones, ne manquait pas de grâce et de poésie, le village ou hameau de Majuvilliers y touche. Les toits en chaume, surplombant, recouvrent encore les huttes assez régulières des manants (manentes), toits dont les lignes plates attristent profondément l’œil, provoquent l’ennui et disent encore très haut l’antique égalité de la servitude. Hélas ! on était revenu en 1798 à la même servitude sous forme démocratique ; une réaction cruelle, une route tortueuse et oblique avaient ramené la France de la Saint-Barthélemy aux Septembriseurs, à Barras et à Bonaparte. La faiblesse morale de la Gaule romaine avait reparu tout entière. En vain soulevée un instant par les philosophes du dix-huitième siècle et par l’exemple des protestants du Nord, elle retombait sur elle-même lourdement. L’un de ceux qui avaient tenté cet effort pour réaliser le désir de toutes les nobles âmes était mon père. On l’avait amnistié, puis emprisonné, puis relâché. Enfin, avec sa jeune femme, très différente de lui, il était venu prendre asile dans cette retraite obscure où je vis le jour, en automne, pendant la vendange.
Il ne pouvait être question de me baptiser. La France, avec sa fureur ordinaire d’évolutions contradictoires, était tombée dans la haine des prêtres et du culte depuis 1750 ; elle abhorrait fanatiquement le fanatisme. Après avoir puni l’homme comme coupable envers Dieu, elle se mettait à punir Dieu des vices de l’homme. Tout le monde était superstitieux, c’est-à-dire que la masse croyait à l’impossible ; elle était fanatique, c’est-à-dire qu’elle élevait des autels à ses idoles, souvent sanglantes, toujours stupides. Seulement, elle avait changé d’idole ; c’était elle-même.
Mon père appartenait à cette génération. Mais jamais il n’a versé de sang, et ce qui me le rend singulièrement cher et particulièrement vénérable, c’est qu’il a aimé Dieu, la probité intellectuelle, la foi dans le vrai et la charité envers les hommes. Sur les points fondamentaux, il ne doutait pas ; si les doutes philosophiques du dix-huitième siècle l’avaient pénétré, son Évangile, faux ou vrai, contenait les plus précieux fragments de la civilisation et de l’avenir. Le passé romain et grec altérait seulement cette morale et cette politique ; à cette superstition du Passé se joignait celle de la République nouvelle et avortée. Il s’enfermait là-dedans comme dans une citadelle qui avait trois enceintes ; d’abord le Selectœ e Profanis, ensuite la Montagne et enfin Washington. Malheureusement, cette dernière enceinte était la plus éloignée du cœur et de l’esprit de mon père, et c’était le Selectœ qu’il préférait. Il avait vu l’honnête et héroïque Goujon quitter la prison pour aller à l’échafaud et les deux montagnards qui s’étaient embrassés en pleurant s’étaient promis, si leurs jeunes femmes leur donnaient un fils, de l’appeler du même nom : Philarète ; un nom grec ; un nom d’Anacharsis, correspondant à la religion sincère de ces honnêtes âmes. Sous Cromwell et du temps de Charles Ier, les ardents, les enthousiastes nommaient leurs fils d’après la Bible : « Nehemiah J’espère-en-Dieu, Jésus-est-mon-Sauveur. J’allais être un de ces témoins, un de ces signes de mon temps. Ce nom grec qui voulait me consacrer au culte du bien ; de la Vertu (Arêtés) et de l’Amour (Phileïn) me prédestinait à la vie la moins en harmonie avec mon temps ; sur ce fleuve d’intérêt, d’intrigue et d’or (Ploutos) ma nacelle allait voguer ; et je m’en tirai comme je pus, par un perpétuel naufrage, sans cesse réparé, toujours renouvelé.
Point de fraude. Vie simple, studieuse, aimante. Nulle intrigue ; aucune ambition. Voilà les règles intimes que j’ai suivies. Je nie que ce soit là une règle idéale et une vie ridicule. Seulement elle n’allait pas à la France de 1800. La France périssait par les défauts gaulois et les tendances sauvages que j’abhorrais ; elle méprisait le genre de défauts qui pouvaient se mêler à mon mysticisme. Je n’ai jamais voulu m’accommoder aux lâchetés tyranniques dont elle s’honore. Charlotte Corday, tuée ; – Marat, adoré ; – Napoléon Ier, subi ; – Napoléon III, accepté ; – le pouvoir donné à Barras ; – des honneurs à Fouché ; – Louis-Philippe, appelé et mis à la porte ; – en littérature, Baour-Lormian préféré à Paul-Louis Courier ; – Voilà le pays… De telles mœurs ont heurté les miennes. Voilà tout. Je n’ai jamais toléré ces injustices. Je n’ai pas pu me prêter à ces folies, guerres et coteries ; éternelle incertitude, éternelles réactions de fureurs contraires et dans ses sens les plus divers ; cela m’a blessé. Avez-vous, dira-t-on, le droit de juger votre temps ? C’est précisément ce droit que la France a perdu, à force de faiblesses, de contradictions et de chutes. Je l’ai gardé comme le plus précieux privilège ; et ce que l’on me reproche comme un orgueil téméraire est la preuve de ma raison.
Ceux qui, comme moi, sont nés entre 1798 et 1800, sont tristes. Ce sont les fils du désastre. Le naufrage des nobles idées les a bercés. La génération héroïque antérieure, celle de Desaix et de Kleber mourait alors sur le champ de bataille. Elle avait eu pour nourrice l’Utopie sublime de 1789 ; et pour prédécesseurs immédiats les hommes de la génération philosophique, les Turgot, les Necker, les hommes de l’espoir et de l’aspiration ardente vers le bien. Le génie des Turgot s’était levé dans l’aurore boréale des idées les plus pures, en 1780 ; notre enfance à nous, en 1800, voyait s’éteindre et se couvrir de larmes le soleil couchant des libertés publiques. Quels vices, ceux du Directoire ! Quelle lâche aventure, celle du 18 Brumaire ! Quelle littérature, celle de Fontanes et d’Esmenard ! Quels hommes, Savary et Fouché ! Quelles âmes, Talleyrand et Fesch ! Quelle probité, celle de nos armées pillant l’Italie ! Quelle honte, Venise et le Tyrol privés de leurs libertés par des gens qui prétendent aimer et fonder la liberté ! Au premier coup de marteau que lui assène Bonaparte, le monde délabré du Midi s’écroule. Malte, Venise tombent sans coup férir.
Les démoralisateurs de la France depuis 1800. On ferait un très beau livre avec cela. Bonaparte est le plus terrible. Jean-Jacques utopiste l’ébauche, Machiavel sans cœur l’achève. Lui-même il a traversé ces deux phases. La politique de rapine en France avait été inaugurée déjà par la spoliation des Émigrés et celle du Clergé. La politique de force et de meurtre par les assassinats ; la politique de la force alliée à la fraude a enfin triomphé avec le 18 brumaire. Le génie de Bonaparte, avec une miraculeuse énergie géométrique, a trouvé le point d’incidence où la violence de Marat touche à l’intrigue des Girondins ; et la rhétorique de Raynal à la hache du Licteur. Cette combinaison, mise en œuvre avec un sang-froid extraordinaire a tout renversé ; surtout elle a détruit le sens moral du pays anéanti à jamais.
Je ne me donne point pour victime. L’homme qui a écrit ceci a voulu être ce qu’il a été. Il n’a aucun droit de se plaindre. Il ne prétend point attirer l’attention et l’admiration sur lui-même. Peindre un état social curieux, le signaler à l’avenir, après l’avoir vu d’autant mieux et d’autant plus à fond, que je n’ai sympathisé d’aucune manière avec ses diverses évolutions et que je l’ai contemplé sans me tromper sur l’avenir, pendant cinquante années, que de chute en chute, d’espérance en espérance et de vanité en vanité, il se précipitait dans la décadence, passant de l’enthousiasme à la luxure, de la fureur à l’énervement, et de la rage de tuer à la rage de discourir pour s’arrêter enfin dans un marécage de faux luxe et de profonde misère ; – voilà ce que je veux accomplir – un enseignement.
N’étant ni meilleur ni pire que tout le monde, je suis devenu autre. J’ai différé de tout le monde non par ma faute ou ma vertu, mais par l’action de ce qui m’a entouré.
Ma petite enfance à laquelle ma mère présidait, me sourit encore ; ce souvenir me charme profondément. Il y avait les deux colosses de Notre-Dame devant moi, sur la place Notre-Dame où mon père avait choisi son asile ; et les chansons mélancoliquement joyeuses de ma mère, et l’intérêt profond des leçons paternelles, qui m’initiaient à la vie de la conscience en me repliant sur moi-même : car mon père, disciple fidèle de Locke, de Franklin et de tout ce dix-huitième siècle, ne manquait pas de me forcer chaque soir d’inscrire sur un registre ce que j’avais fait dans la journée. C’est le confessionnal ouvert pour soi-même, on s’écoute, on se pèse, on se juge. Et quelles que soient les hallucinations ou les sophismes de la personnalité, c’est un excellent exercice. Cette gymnastique du MOI et de la force morale gêne infiniment les pays où le moi est condamné à disparaître sous la pression d’un maître. La collectivité uniforme mène très nécessairement à la servitude. Il n’y a pas de Liberté possible dans une pâte pétrie par une seule main, roulée, jetée au moule, devenue homogène et s’arrondissant ou s’allongeant à la voix et sous le poing du boulanger. De deux choses l’une, ou créez des hommes vivant pour eux-mêmes ou fondez-les dans une masse qui seule existera. Mais n’espérez ni des individus libres si vous les broyez, ni des masses dociles si vous en isolez les parties constitutives. Ou asservissez, ou délivrez !
J’ai été dès ma naissance, une âme libérée, un homme délivré, un esprit qui a eu conscience de sa volonté. Ce rayon du soleil moral a éveillé ma vie. Étouffé un moment par la servitude des collèges français, il a reparu en Angleterre avec une intensité et une pureté extrêmes. Mais, revenu en France, il a trouvé des ténèbres extérieures de rapacité, d’égoïsme et de cruauté si serviles qu’il n’a plus été qu’un martyre. J’ai donc souffert horriblement comme l’animal hors de son atmosphère, comme le poisson hors de l’eau ou l’oiseau hors de l’air souffrent de la difficulté de respirer ; l’esclavage moral de tous m’étouffait. Les uns allaient à leurs rapines, les autres à leurs bassesses. Et moi ? Où aller ? Aux femmes ? Mais que valaient-elles ? Les hommes ne valaient pas même les femmes. Leurs vacillations, leurs faiblesses, leur débilité de conscience, leurs habiletés flottantes, leurs ruses de valets, leurs mensonges de courtisanes, leur violente prise du bien d’autrui, leur asservissement banal à la foule, leur bas respect pour la mode, leurs chaînes d’opinion (et je parle des éclatants et des glorieux) m’étouffaient. Il me semblait que j’étais jeté dans un bagne ; je ne m’y accoutumais pas ; et attristé, je m’attendais chaque jour à trouver pis encore. Aujourd’hui aucune lâcheté ne m’étonne. Aucun vol ne me surprend. Aucune ignoble intrigue ne me trouve aveugle. Mais j’en souffre ; j’aurais besoin d’autre chose et je hais… quand je voudrais aimer.
L’amour des semblables, le besoin de faire du bien, le goût des beaux vers et des études animaient toute la maison paternelle, surtout émanaient de ma mère. Il fallait la voir, toute poétique et idéale, bien que ménagère, vaquant aux soins de la maison, réglant tout, songeant à tout et ne perdant jamais le respect d’elle-même. Ce vieil hôtel Flavencourt avec ses vieilles pierres moussues et ses grands thuyas en était tout animé et tout égayé. C’était chez elle une douceur vive et une gaieté attendrie que je n’ai vues à personne. Elle avait gardé du sauvage et du simple, de l’ingénue même et du naïf dans ses souvenirs de famille frisonne et protestante. Je n’ai, dans ma longue vie, connu personne dont les passions eussent une pureté aussi ardente et une aussi souriante ardeur. Les Ardennes, leurs bois épais, le souvenir d’un premier mari adoré, amenaient des larmes dans ses beaux yeux noirs, qui restaient fixés sur une contemplation muette pendant de longues heures, et tandis que ses larmes coulaient doucement, ses lèvres roses souriaient toujours. Je la regardais et j’apprenais à lire ou les vers de Racine ou même ceux de Bernis dans la petite édition Cazin, à tranches dorées, facile à mettre en poche ; une vingtaine de volumes, toute sa bibliothèque ; car elle ne changeait guère de lecture et relisait en méditant.
Il faut que je commence par dire que tous les récits sur mon père, et ceux surtout de la biographie Michaud sont d’une fausseté absolue ; même les noms qu’on lui donne sont faux. Quant à ma mère, elle n’aura que moi pour historien, et si on a beaucoup parlé de mon père, on n’a jamais rien dit d’elle. Le mensonge finit les peuples ; le sophisme en est l’instrument, la passion en est le moteur. De toutes les lignes imprimées en France entre 1789 et 1869 à peine quelques-unes sont vraies. Attaquer l’ennemi, écraser, calomnier, revendiquer, apologétiser, c’est tout. À peine Chateaubriand ou Mme de Staël ont-ils, de temps à autre, échappé à cette fureur universelle de mensonge guerroyant. Servir son intérêt, voilà le but.
De justice pas une trace. Le Jacobin écrit que Marie-Antoinette est une tribade et l’imprime. La notion du juste et du vrai s’évanouit. Pour que l’histoire future se retrouve un jour et se liquide enfin au milieu de tant de ténébreuses rages, elle aura beaucoup à faire. Chaque passion associée à chaque intérêt obscurcit tout, armée d’esprit, versant l’encre et l’argent. On marche au combat. Les pamphlets ne suffisant plus à cette œuvre, on a imaginé de recueillir et de classer dans un arsenal spécial tout ce qui était de nature à tuer l’ennemi ; je le sais, ayant moi-même pénétré dans une de ces fabriques de calomnies dont on voulait me faire ouvrier. C’est ainsi que Feller a compilé son dictionnaire contre les esprits forts ; Rabbe son dictionnaire contre les dévots ; Michaud le sien contre les hommes de la République ; Jouy et Arnault le leur contre les hommes de la Royauté. Pauvre pays ! défais-toi donc de la haine, éternel rocher de Sisyphe qui retombe toujours sur celui qui le roule ou le lance ! Le sang keltique a des bouillonnements si rapides et des violences si furibondes ! Impossible. Les plus honnêtes gens se ruent en iniquités effroyables ; comme les plus honnêtes chiens se jettent sur la bête, lèchent le sang, dépècent les lambeaux et ne savent pas même qu’ils sont féroces.
L. Michaud, d’une famille de roture, frère d’un imprimeur de Paris, appartenait à ce groupe bourgeois antirévolutionnaire qui se reliait aux vieux parlementaires, groupe qui ne s’était pas détaché de l’ancien monde, en avait emprunté un certain goût d’élégance, un certain parfum de savoir antique, une attache sincère bien que légère au culte catholique et aux idées religieuses, et comprenait Dussault, Geoffroy, de Feletz, Hoffmann. Ce groupe était aimable. La douceur et la paisible modération des mœurs, la culture des lettres classiques, de petits vices moraux sans éclat et sans effronterie, une activité d’esprit agréable et vivifiante, l’horreur des excès sanglants, la répugnance pour les utopies folles, du bon sens, mais dans une certaine mesure et sans grandeur aussi, les derniers reflets d’une civilisation brillante empruntés aux salons d’autrefois, et devenue moins lascive, moins étourdie, moins insolente, leur rendaient très odieux tous les souvenirs de la Révolution et très à craindre le retour de la République. Vers la fin du Directoire, ce groupe, impuissant quant aux faits, s’était rendu puissant par l’esprit. Ce fut lui qui soutint les Débats, annoncés et créés d’abord en 1789 ; – lui qui prépara ensuite, couva et fit éclore le grand dictionnaire biographique, où les morts devaient être classés, jugés, immolés, s’ils étaient ennemis ; justifiés, s’ils étaient amis ; et à la fin duquel, dans un supplément consacré à cet usage, petite salle expiatoire, les vivants eux-mêmes devaient être soumis à la même préparation. Michaud, que j’ai connu dans sa vieillesse, avait été proscrit par la République ; prosateur froid, érudit sans profondeur, poète sans éclat, de l’école fine et délicate de Fontenelle, Voltaire et Lamothe Houdart, il réunissait toutes les qualités de goût épuré, de sensibilité raffinée, de grâce sociale et de critique pénétrante, qui caractérisaient le groupe spécial dont j’ai parlé. Son Printemps d’un Proscrit est du Cooper écrit dans le boudoir, en souvenir des bois et des prairies, un moment aperçus. C’était une grande figure maigre, douce, à l’œil vif et noir, à la perruque noire, au maintien indolent et de bon goût. Il attirait, il plaisait, il séduisait même. Toute cette génération de royalistes en lutte, longtemps persécutés, était charmante ; les anciennes qualités s’étaient affinées, épurées, les vices affaiblis et tempérés ; mais c’étaient des hommes de parti. Ils se vengeaient et frappaient. Aussi faut-il se défier de tout ce qu’ils ont écrit, surtout de leur grande biographie. Ce n’est pas de l’histoire, c’est de l’artillerie.
CHASLES (Pierre-Jacques-Michel), ex-député d’Eure-et-Loir à la Convention nationale. Né à Chartres en 1752, – a fait ses études à Paris, – a professé la rhétorique au collège de Chartres, – après trois ans de professorat, devient chanoine de la métropole de Tours et commensal de l’archevêque, M. de Conzié, – perd en 1789, par suite de la révolution, sa fortune et son état, – ne s’en déclare pas moins le partisan et l’ami, – revient à Chartres, – y établit à ses frais un journal patriotique, est nommé à diverses fonctions publiques, – entre autres à celles de principal du collège et de maire de la ville de Nogent-le-Rotrou , – et, en dernier lieu, à la Convention nationale, – vote la mort de Louis XVI sans sursis et sans appel au peuple, – après le jugement, est envoyé en mission dans les départements et aux armées, – se fait remarquer à l’armée du Nord par son courage et son stoïcisme, qui font de ce représentant un soldat improvisé d’un désintéressement absolu, étranger à toute espèce de faction, de coterie et de parti ; il s’est fait peu d’amis et n’a point eu de prôneurs, quoique sa blessure lui permît d’en espérer, – né plébéien, il s’est constamment et invariablement montré le défenseur de la classe plébéienne.
Je n’eus pas le spectacle, mais seulement l’impression du premier de tous ces écroulements successifs qui devaient avoir pour témoin ma vie entière. C’était en 1804. J’avais quatre ans et demi. J’étais ce petit mollusque de la végétation humaine qu’on appelle enfant avant l’éclosion de l’étincelle intellectuelle ; cela existait en moi, mais je n’existais pas. La vie de l’esprit dormait dans cette pulpe inconsciente, et attendait l’éveil. Tout à coup des sons de cloches, des airains violemment ébranlés, se ruèrent par vagues épaisses, comme une avalanche, sur cette ébauche de cerveau. Je me trouvais à une trentaine de pieds de terre, dans un des cabriolets hissés sur d’immenses roues, que depuis cette époque on n’a plus revus. Le cabriolet, cage étroite et très exhaussée, cette machine que Carle Vernet et Boilly ont placée dans leurs caricatures, était traîné par un petit cheval étique, que mon père, me tenant sur ses genoux, fouettait rondement pour le faire avancer dans une rue assez étroite, remplie de peuple. Je vis, j’entendis et je parlai pour la première fois. Cette volée de cloches vibrantes partait de Notre-Dame ; nous traversions la Cité sous cette harmonie. Elle m’étourdissait. La figure ardente et grave de mon père se pencha vers moi, et, tout en hâtant le cheval pour lui faire atteindre le Pont-au-Change, il me dit : « On couronne un empereur ! » – J’ai encore dans les oreilles ces paroles tristes prononcées sans émotion, les muscles de la face contractés et le front extraordinairement plissé. Ce fut ainsi que je vis mon père pour la première fois. Il fuyait, craignant pour lui-même les premiers accès de la ferveur politique nouvelle, toujours signalés en France par quelques emprisonnements ou quelques massacres. Il avait cinquante-cinq ans ; et son audacieux visage, sentimental cependant, sillonné de rides profondes, un œil bleu que la flamme intérieure allumait comme une torche et qui se voilait souvent de larmes ; une tête portée en arrière comme celle d’un lutteur ; un triste sourire sur des lèvres délicates que nul excès de table ou de débauche n’avait détournées, une physionomie volcanique, plus animée que résolue, et plus fière que reposée ; un grand mélange de souffrances physiques, morales, intellectuelles, et de combats intimes, faisaient de lui un ensemble complet et extraordinaire, que le philosophe le plus subtil aurait eu de la peine à déchiffrer et qui devait frapper d’étonnement, presque d’une terreur religieuse, le petit être endormi sur ses genoux. Après avoir eu cette perception magnétique, unique, mais nette et profonde, détaillée et très complète, je retombai à l’état de plante vivante, et n’en sortis qu’à six ans. Mais ces cloches m’avaient communiqué ce qui m’attendait en France ; pour elle une série de funérailles ; pour moi l’écrasement de l’individu qui ne sait pas tromper, qui ne veut pas tromper, et qui voit le milieu dans lequel il se meut.
Malgré ses opinions républicaines, mon père n’était pas conspirateur ; Mme Récamier et Mme de Staël l’étaient. De leurs salons est sortie la chute de l’Empire. La Restauration y est née. Elles avaient raison de conspirer contre Napoléon. En 1804, on tuait le malheureux Bourbon d’Enghien ; on exilait, on exportait, on mentait, on fusillait et l’on opprimait. La France étourdie qui avait bondi d’enthousiasme en 1789 sous Louis XVI était retombée dans la stupeur en 1793, sous Robespierre, pour s’exalter encore d’admiration sous le premier consul et retomber dans la stupeur sous l’Empire. Cent Mme de Staël et cent Mme Récamier auraient suffi à nous épargner bien du sang et bien des hontes ; de même que cent Turgot et cent Bailly auraient appris au pays la consistance et l’honneur. Mais que pouvaient faire trois ou quatre élus du droit et du bien, au milieu de la foule stupide, sans principes et sans idées ? Je grandissais au milieu de ces iniquités, acceptées ou subies. Grâces soient rendues à Dieu, mon père y était étranger. Il rongeait son frein dans la solitude. Comme lui, quelques hommes ne prirent point part à la curée de l’Empire naissant après avoir tenté de fonder la liberté ; ils furent rares. On ferait un noble livre intitulé les Belles actions de la Révolution et de l’Empire. Toutes les cocardes et toutes les opinions y auraient leur place. On en ferait un affreux intitulé les Servitudes et les Hontes.
Je crois que l’étouffement de la France libérale, entre 1800 et 1810, c’est-à-dire entre ma deuxième et ma douzième année, fut pour beaucoup dans la trempe amère, repliée, résignée et désolée de mon âme, et dans le développement mélancolique et observateur de ma pensée. Nulle existence, si obscure qu’elle soit, n’échappe au contrecoup lointain des évènements publics. Mon père, le votant, que la plus légère suspicion aurait envoyé à Sinnamary ou livré au premier tribunal venu, se maintenait dans la solitude et le silence. On lui avait fait offrir, par l’intermédiaire de Fouché, de cet étrange Mercure politique, une sénatorerie et la croix d’officier, s’il voulait se rallier à l’Empire. Plusieurs hommes de ses amis, devenus des personnages impériaux, Noël, Fontanes, Jard Panvilliers, Fouché, Lanjuinais, avaient à cœur de le sauver et le protégeaient. Il n’accepta pas les ouvertures de Fouché. Il ne les refusa pas. Expliquons cela.
Comme tous les fondateurs républicains, tous gens bien élevés, il était non pas le brutal jacobin et le fougueux démocrate que l’on aurait pu supposer, mais le personnage incarné d’une théorie, – le disciple raffiné du dix-huitième siècle et des jésuites, l’un des produits les plus civilisés et les plus complexes de cet ancien monde qu’il renversait. Si Robespierre avait gardé de son existence d’avocat bel esprit et de province les manchettes et le jabot, le gilet rose et la parole cadencée ; si Louvet, l’adversaire acharné de Robespierre, n’avait rien perdu en 1793 des traditions galantes de Crébillon fils, mon père, que la Révolution avait trouvé professeur de rhétorique, homme d’église, grand-vicaire et secrétaire de M. Conzié, resta (même après le baptême double de la révolution et de la mitraille) ce qu’il avait été, c’est-à-dire un illuminé savant du dix-huitième siècle, un homme de cour, sachant son monde et mêlant à l’essai de Phocion les habitudes des abbés de cour.
Nul ne tournait mieux que lui les vers latins ; il y avait même dans sa facture quelque chose de plus sévère que dans les poèmes ovidiens de l’école jésuitique ; une solidité grave, plus voisine de Lucrèce et de son génie énergique que du père Rapin et du père Vanière. Et la philologie latine ! Et la syntaxe et la grammaire générale et universelle ! Comme il les adorait ! Une fois l’orage révolutionnaire apaisé, il se replia sur ses études favorites. Cela était sincère ; et en véritable enfant de son siècle et un peu de la sacristie, il pensa en profiter. Je crois même que son goût classique contribua beaucoup à le sauver. Il avait fait ce qu’il fallait pour tomber sous la vengeance du régime impérial et bourbonien. Le bannissement, l’incarcération, Cayenne, le menaçaient de tous les côtés ; mais devenu grammairien enthousiaste, et fabriquant de beaux vers latins, le conventionnel se fit oublier sans lâcheté et pardonner sans bassesse.
Analyser, s’enquérir, se rendre compte, c’est vivre par soi-même. Ce n’est pas obéir, accepter et servir. Quiconque analyse se révolte contre la foi. Même Mendelssohn, par exemple, est moins musicien que penseur. Raphaël Mengs et Winckelman ne sont plus assez artistes étant plus philosophes. Rechercher le vrai est cependant nécessaire au genre humain qui vieillit, et la synthèse mensongère doit céder à l’analyse inexorable. Les hommes de 1789 et ceux de 1793 avaient ce sentiment, mais vague. Ils ne savaient comment franchir l’abîme qui sépare le monde de l’analyse infatigable, nécessaire aux nouveaux, de la foi allumée sur les hauts lieux par le monde ancien. Ils mêlaient tout cela de la façon la plus extraordinaire.
Mon père savait bien, comme Franklin, Bentham, Bacon, Fellenberg, et tous les grands esprits du Nord et de l’Amérique, que l’université de Charlemagne, reconstruite par le génie des Jésuites, est incompatible avec la liberté d’un peuple ; qu’il est ridicule d’élever le jeune moderne, qui est l’égal de tous, sur le type des enfants de Pélopidas et des régions à esclaves, et que sacrifier dix années à l’unique étude de l’idiome latin, écrire en latin, peser des dactyles, arranger des spondées, s’enfermer dans les prosodies mortes des langues disparues, c’est s’enchaîner à la servitude des temps primitifs. Comment donc faire pour vivre dans la cité antique, tout en prétendant à l’indépendance moderne ? Mon père ne savait pas un mot d’anglais, pas un mot d’allemand. Quant à Sénèque, Virgile, Horace, il les connaissait par cœur. Jamais phrase cicéronienne ne s’est déroulée avec une plus abondante variété d’expressions, avec une facilité d’euphonisme plus séduisante. Il ne s’était pas demandé une seule fois si l’homme qui invitait à dîner César triomphant de la République ; si le délicat poltron qui avait jeté ses armes et pris la fuite à Philippi ; si le Berger de Mantoue, plus Grec que Romain, plus tendre qu’une femme, étaient de bons modèles pour les nouvelles républiques. Le génie de l’antiquité, si contraire au génie nouveau, lui apparaissait si beau de forme, qu’il n’en pénétrait pas le fond, l’essence, la profondeur. Ses études philosophiques, manquant de points de comparaison entre les diverses branches du langage humain, s’arrêtaient à la Minerva de Sanctius, à Dumarsais, Condillac, Facciolati et Court de Gébelin. Mais, humaniste excellent et théologien de premier ordre, il avait éclairé mieux que personne l’anatomie de la phrase et sa constitution nécessaire, ses trois éléments du sujet, du verbe et du régime. Cette triplicité de l’unité, qu’il commentait avec éloquence, le crayon blanc à la main, devant son tableau noir, lui causait des ravissements presque mystiques. Il composait la pensée d’après le système de Locke et en réduisait l’expression à ses trois termes nécessaires. Si j’ai naturellement construit ma phrase et bâti mon style, c’est grâce à ces nombreuses et ennuyeuses, mais admirables leçons, où mon père suivait à travers ses déguisements et ses ellipses, ses détours et ses souterrains, le déploiement ou la marche de la pensée. Je compris de bonne heure qu’il n’y a pas de différence entre l’organisme humain, avec son corps physique, son âme sensitive et son esprit actif, et la phrase même avec son sujet, son verbe et son régime. La phrase « J’aime » se résout en je (sujet), – sens (verbe), l’amour (régime). Je touchais ainsi, sans que mon père s’en doutât, le problème mythique du langage.
J’ai senti toutes les joies et toute la plénitude de vie de la jeunesse avec une puissance et une énergie excessives. L’isolement dans la jeunesse exerce une compression dangereuse. La sève concentrée devient ardente jusqu’à la douleur. Pendant que mon père, dans son cabinet de travail où il ne travaillait pas le moins du monde, regardait la fumée de sa pipe s’exhaler comme le souvenir de la République perdue, je montais sur les abricotiers de la pelouse, bien loin de la maison de pierre de taille, dans un fond, au milieu d’un gazon bien vert, et là je me laissais balancer au souffle du vent d’automne et à l’impulsion de la branche moussue avec un indicible bonheur. C’était le temps où Napoléon passait à travers les zones et les trônes de l’Europe comme un boulet de canon à travers les murailles. Ô le profond mépris que cela m’inspirait ! Comme toutes les choses pratiques de la vie humaine et surtout de la politique me semblaient méprisables ! Dans ce vieil hôtel Flavencourt, avec ses pierres grises et son orangerie calquée sur Versailles, aucune âme n’était impériale. Ma mère était Ardennaise, protestante et de race Teutonique frisonne ; elle était noble et populaire, comme il convient d’être quand on a le cœur haut ; son malheur dans le présent l’inclinait vers le passé. Elle eût mieux aimé la République que Napoléon ; elle eût préféré le vieux temps à la République. Quant à mon père, il exécrait d’autant plus le Corse conquérant qu’il se reprochait de n’être plus Brutus, et le désespoir le prenait quand il se souvenait du joug qu’il lui fallait porter. Je grandissais au milieu de tout cela, sans but, sans patrie ! J’avais pour patrie le gazon, le ciel, les idées, la région des idées. C’était une adoration sincère que je portais à l’arbre, à la feuille, à l’étoile. De la France impériale je n’aurais pas donné un fétu ; je ne tenais pas au sénat, je ne craignais pas les soldats. J’étais détaché d’avance des faiblesses et des adorations de la communauté française. Douleur effroyable, je l’ai portée toute ma vie et je la traînerai dans le tombeau. Que ceux qui raisonnent théoriquement sur les constitutions et les lois apprennent ceci : quiconque détruit le groupe social fait un crime. Ce groupe fût-il mauvais, il vaut mieux que le brisement du groupe des idées républicaines au centre de fer.
Je me suis donc élevé au centre du mal, au foyer de la douleur, dans le débris et la ruine. Une certaine jouissance orgueilleuse compensait alors cette amertume. Je me sentais vivre très fortement, d’une vie particulière, et comme mis à part pour une œuvre spéciale. Hélas, il n’y avait pas d’œuvre, que celle-ci : redire la mort de mon pays.
Dans la maison bizarre que mon père avait achetée, dans le vaste parc devenu jardin et écourté depuis, où l’École normale a été établie plus tard, les admirables journées que je passais ! C’était une féerie. Je m’imbibais de l’essence de ces beaux livres, l’Allemagne, Dix ans d’exil, la Révolution française,