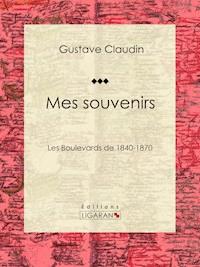
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je n'ai jamais rien été, je ne suis rien, et je ne serai jamais rien. Pourquoi alors, me demandera-t-on, raconter vos souvenirs ? Pourquoi ? Parce que, favorisé par le hasard, j'ai eu cette bonne fortune, depuis 1840, d'être toujours placé aux premières loges pour voir et entendre les comédies et les tragédies qui ont été jouées à Paris, et approcher de très près les grands comédiens qui ont tour à tour paru sur la scène."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335054200
©Ligaran 2015
Je n’ai jamais rien été, je ne suis rien, et je ne serai jamais rien. Pourquoi alors, me demandera-t-on, raconter vos souvenirs ?
Pourquoi ? Parce que, favorisé par le hasard, j’ai eu cette bonne fortune, depuis 1840, d’être toujours placé aux premières loges pour voir et entendre les comédies et les tragédies qui ont été jouées à Paris, et approcher de très près les grands comédiens qui ont tour à tour paru sur la scène.
Cela dit, rien n’étant ennuyeux comme un préambule, j’entre tout de suite en matière.
Je suis né à la Ferté-sous-Jouarre, département de Seine-et-Marne. À cette époque le siècle était majeur. Je n’ai jamais été au collège. J’eus pour professeurs deux séminaristes : l’un s’appelait Alexandre Leduc, latiniste distingué ; l’autre, Hégésippe Moreau, un charmant poète mort tout jeune à l’hôpital. Pour les sciences, j’eus pour précepteur l’abbé Rigaud, un jésuite fort riche qui, s’il avait daigné écrire, aurait prouvé qu’il était un savant de premier ordre.
Ce fut avec Hégésippe Moreau que je terminai mes classes. Après m’avoir bien saturé de latin, de grec, d’histoire, de rhétorique et de philosophie, il me conduisit à la Sorbonne au mois de juin 1837 et me fit passer mon examen de bachelier. Je fus interrogé par des hommes illustres qui s’appelaient Victor Leclerc, lequel eut la bonté de me pardonner un contresens que je fis en traduisant un passage du discours de Démosthène pro Corona, par Saint-Marc Girardin, qui me demanda le nom de la femme de Marc-Aurèle, et par Jeoffroy, député-rapporteur de la question d’Orient en 1840 et auteur d’un remarquable traité de métaphysique.
Hégésippe Moreau, que mes parents aimaient beaucoup, me traitait plus en ami qu’en élève. Quand je fus reçu bachelier, il me dit de sa voix douce : « Maintenant tu as le droit de lire les mauvais livres, et tu vas venir au théâtre avec moi. »
Il me conduisit au Vaudeville, situé alors dans cette rue de Chartres qui n’existe plus. Là il était heureux. Étienne Arago, qui était directeur, jouait les pièces qu’il lui apportait et qu’il ne signait pas. Le poète Moreau faisait la cour à mademoiselle Anaïs Fargueil, qui était alors belle comme le jour et dans tout l’éclat de sa splendeur.
Ceux qui n’ont point connu Moreau ont écrit sur lui une foule de choses fausses. Il était né à Provins. C’était un enfant naturel, beau à faire des passions. Il fut élevé au grand séminaire de Fontainebleau et s’en fit chasser pour avoir écrit à dix-sept ans une chanson qui figure dans ses œuvres et qui est intitulée : Les noces de Cana. Cette chanson racontant la gaieté de Jésus avait pour refrain :
On chassa le séminariste. L’abbé de Lamennais, qui avait connu l’incident, le défendit mollement.
Avant d’être mon précepteur, Moreau avait été ouvrier typographe. Il était poitrinaire et mourut peu de temps après notre arrivée à Paris, c’est-à-dire en février 1838, à l’hôpital de la Pitié, où le poète Henri Berthoud, rédacteur du Charivari, alla chercher sa dépouille pour lui rendre les derniers devoirs. Il fit sur sa mort des vers magnifiques qu’on retrouverait dans la collection du Charivari.
Il y a dans les œuvres d’Hégésippe Moreau, que ses amis ont réunies dans un volume intitulé : le Myosotis, des petits chefs-d’œuvre. Le Hameau incendié, la Fauvette du calvaire, les Petits Souliers, la Souris blanche, Thérèse Sureau sont des merveilles en vers et en prose. Hégésippe Moreau avait l’horreur des pédants et ne parlait jamais littérature. « J’aimerais mieux » disait-il en répétant le mot de Raffet, jouer aux » boules devant l’Observatoire, que de causer littérature ; » et il ajoutait : « Fuis les pédants, ils te mangeraient le goût. » Dans ses papiers, on a pu retrouver des fragments malheureusement trop incomplets d’un poème sur le fanatisme religieux dans lequel, comme épisode principal, il parlait de cette vieille bonne femme boiteuse et dévote arrivant en retard pour apporter son fagot au bûcher sur lequel on brûlait Jean Huss. Il y avait là une pétarade sublime sur le Sancta simplicitas ! qu’il m’avait lue et que j’ai eu le tort impardonnable d’oublier complètement.
La plupart des écoliers ne conservent pas un bon souvenir de leurs maîtres. Je fais exception. Alexandre Leduc et Moreau sont restés dans ma mémoire comme mes premiers amis.
En 1838, j’étais à l’École de droit et j’habitais, rue Favart, chez un ami de mon père. Tous les matins, à huit heures, je partais pour l’École, et, arrivé au Pont-Neuf où il y avait alors des baraques, je prenais du café au lait. Tandis que je mangeais, je voyais passer régulièrement un carrosse jaune et bleu de la cour, conduisant au collège Henri IV le duc d’Aumale et le duc de Montpensier, qui n’avaient point encore terminé leurs études.
À l’École de droit, j’eus des condisciples très distingués. Je citerai d’abord M. Adelon qui, tout professeur de médecine légale qu’il était à la Faculté, suivait le cours de M. Bugnet avec son fils, M. Adelon, qui devait être, en 1870, sous-secrétaire d’État. Il faut citer encore M. Girod de l’Ain ; M. Denormandie, qui fut gouverneur de la Banque de France et qui est sénateur ; M. Andral, qui fut président du conseil d’État ; puis mon ami Félix Loyer, un philosophe et un sage. Ces messieurs ne s’occupaient pas encore de politique. On s’en rapportait au gouvernement pour conduire les affaires de la France ; nous n’avions pas le suffrage universel ni ces politiciens qu’il devait faire naître.
L’École de droit et le quartier Latin étaient cependant de l’opposition. Nous lisions le National et nul ne songeait qu’on pût aller plus loin en politique que ce journal. Nous allions en corps féliciter M. Laffitte quand il était nommé président de la Chambre des députés, puis vociférer un peu sous les fenêtres de la Conciergerie quand on y mettait en prison l’abbé de Lamennais. Tout le tapage se bornait là, et cela ne faisait point baisser la Rente 5 0/0, qui était à 124 fr. On était heureux, chacun se tenait à sa place, sûr du lendemain.
C’était, en effet, un bon temps que celui-là. Louis-Philippe régnait et ne gouvernait pas ; ses fils guerroyaient en Afrique ; Victor Hugo était pair de France, Arago directeur de l’Observatoire, Lamartine, Berryer, Montalembert tonnaient contre le ministère, Delacroix peignait ses chefs-d’œuvre, Henri Heine envoyait ses lettres sur Lutèce à la Gazelle d’Augsbourg, Royer-Collard faisait des mots, le comte d’Orsay donnait le ton, Alexandre Dumas écrivait les Mousquetaires, Eugène Suë publiait les Mystères de Paris dans les Débats et le Juif-Errant dans le Constitutionnel, Balzac nous donnait le Lys dans lavallée, Toussenel les Juifs rois de l’époque, Considérant, élève de Fourier, socialisait dans un journal, le baron de Rothschild négociait des emprunts, Armand Marrast dînait au Café Hardi avec ses collaborateurs du National, Romieu et Henry Monnier faisaient des farces, et Gavarni des caricatures ; Rubini chantait Don Juan aux Italiens, Duprez, les Huguenots et la Favorite à l’Opéra ; M. Dupin faisait des calembours ; le marquis de Saint-Cricq, avec sa figure rouge comme une praline encadrée dans ses favoris blancs, portait son chapeau sur l’oreille ; lord Seymour égayait le carnaval, le major Fraser était pantalonné à la cosaque, Rachel interprétait les tragédies de Corneille et de Racine et les drames de madame Delphine de Girardin ; Frédérick Lemaître et madame Dorval jouaient au boulevard du Crime, Alfred de Musset dînait avec le docteur Véron au Café de Paris, Nestor Roqueplan n’avait pas de tic ; Auber, triste comme Hamlet, montait à cheval ; Béranger ne faisait plus de chansons, Ledru-Rollin entrevoyait déjà dans ses rêves le suffrage universel, le marquis du Hallays payait au poids de l’or la fleur qu’il achetait, chaque soir, à l’unique bouquetière du boulevard et M. Narcisse de Salvandy présidait la distribution des prix à la Sorbonne.
Ainsi qu’on le comprend, je veux éviter de parler de moi. Je ne suis aucunement intéressant, et j’ai hâte de parler des hommes politiques, des auteurs dramatiques et des artistes que j’eus, étant très jeune encore, l’honneur et l’avantage de connaître.
Mon père avait de fort belles relations. Il me conduisit chez le baron Ducharmel, un de ses amis, qui habitait un hôtel rue Cadet. M. Ducharmel avait un salon. Il était le fils aîné du baron de Bonnefoy, qui avait été, sous Louis XVI, gardien de Trianon. Ce baron mourut à quatre-vingt-quatorze ans ; c’était un petit marquis du XVIIIe siècle, l’un des derniers représentants d’un monde aboli. Il était, cela va sans dire, plus royaliste que le roi. On a coutume de dire que c’est là un tort ; c’est au contraire, à mes yeux, un mérite. Il faut, pour être suffisamment royaliste, l’être plus que le roi. Il doit en être de même pour un républicain.
Dans ce salon du baron Ducharmel je rencontrai Scribe, Bayard et Mélesville, qui étaient vers 1840 les grands pourvoyeurs des principaux théâtres. Ces messieurs me réclamaient, faute de mieux, pour faire un quatrième au whist. Pour les punir je coupais avec rage les cartes maîtresses.
Bayard me fit obtenir mes entrées au théâtre et dans les coulisses des Variétés. Je fus très fier de cette faveur, et, à partir de cet instant, je me pris pour quelque chose dans les lettres. Je rêvais d’écrire des comédies, des drames, des romans, et surtout de rédiger un feuilleton dramatique. On m’eût proposé d’écrire dans la Ruche des écoles, dans l’Abeille cauchoise, ou dans toute autre feuille plus ridicule, que j’eusse accepté tout de suite, et tenu tête à Jules Janin et à Gustave Planche.
À cette époque on jouait aux Variétés les Saltimbanques, ce qui me permit de faire la connaissance d’Odry, qui était fort spirituel, de mademoiselle Flore, qui était très grasse, de Hyacinthe, qui avait le nez très long, et de mademoiselle Esther de Bongard, qui était fort belle. Ses yeux noirs, sa peau blanche troublèrent mes nuits. Je la dévorais des yeux chaque soir, alors qu’au troisième acte des Saltimbanques, costumée en Espagnole, elle dansait la cachucha sur la place de Lagny. Mais mademoiselle Esther avait à ce moment-là un fort bel amoureux : c’était le comte Tristan de Rovigo, brillant officier qui fut tué en Afrique dans une escarmouche avant la bataille d’Isly. Mademoiselle de Bongart était de noble origine. On vendait son portrait avec ses armes ; elle portait mi-parti d’or et d’azur à une fasce de même de l’un en l’autre, avec cette devise : Bon sang ne peut mentir.
Par Esther de Bongard je connus Tristan de Rovigo qui, lui-même, me fit connaître son frère le duc René de Rovigo. Enfin René de Rovigo, avec lequel je restai très lié, me fit connaître Émile de Girardin, qui faisait déjà dans toute la presse de Paris la pluie et le beau temps, puis Villemessant, qui cherchait sa voie et créait par-ci par-là des petits journaux, tous plus amusants les uns que les autres, dans lesquels René de Rovigo écrivait.
À cette époque Émile de Girardin était jeune. C’était un élégant cavalier mis à la dernière mode. Il portait des pantalons modèles, des bottes vernies resplendissantes, et se rendait à la Chambre des députés dans un tilbury qu’il conduisait lui-même.
Madame Delphine de Girardin, sa femme, était dans tout l’éclat de sa beauté et de son talent. Elle était blonde et se coiffait à l’anglaise. Ils habitaient à cette époque l’ancien hôtel Choiseul-Gouffier situé alors rue Saint-Georges ; cet hôtel n’existe plus.
Leur salon était le rendez-vous de tout ce qu’il y avait de plus illustre dans la politique, les lettres, les sciences, les arts, la noblesse et la finance. C’est dans ce salon que je vis pour la première fois M. Guizot, alors président du conseil, que M. de Girardin soutenait énergiquement dans le journal la Presse ; le chancelier Pasquier, M. le marquis de Boissy, pair de France ; M. de Montalembert, M. de Belleyme ; M. Gabriel Delessert, préfet de police ; M. Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas, Balzac, Alfred de Musset, Théophile Gautier, Méry, Mérimée, le père Enfantin, Lamennais, le docteur Cabarrus, M. Ferdinand de Lesseps, Gozlan, Alphonse Karr, Delacroix, mademoiselle Rachel ; madame Sophie Gay, mère de madame de Girardin ; madame Sand, Jules Sandeau, le comte d’Orsay, Alfred de Vigny, Michelet, de Genoude, de Lourdoueix, Scribe, Rossini, Meyerbeer, Decamp, Horace Vernet, Paul Delaroche, le baron Taylor, Véron, Sainte-Beuve et bien d’autres.
Dans ce milieu j’étais fou ; je n’avais ni assez d’yeux pour voir, ni assez d’oreilles pour entendre, et j’étais honteux de ne rien être. Je fis part de mes soucis à M. de Girardin, qui me permit de collaborer aux faits divers du journal la Presse ; j’avais le pied dans l’étrier. Sic itur ad astra, me dit-il, en me regardant d’une façon ironique avec son lorgnon dans l’œil.
M. Guizot surtout captivait toute mon attention. Il était alors à l’apogée de sa gloire. À sa réputation de grand lettré et de grand écrivain il ajoutait celle de grand politique et de grand orateur. On se souvient des belles luttes oratoires qu’il soutenait à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés contre MM. Berryer, Lamartine, Montalembert, Billault, Ledru-Rollin, Odilon Barrot, Thiers, Maugui, Michele de Bourges, Dufaure, le comte Molé et le duc Victor de Broglie. Il fallut une révolution pour l’éloigner du pouvoir. On a dit qu’il était tombé parce qu’il avait refusé la réforme électorale, c’est-à-dire l’adjonction des capacités on le blâma partout. M. Ledru-Rollin nous apporta le suffrage universel, que M. de Cormenin avait trouvé. Il y a de cela quarante-cinq ans. Ce suffrage universel a-t-il fait la France plus grande ? De plus habiles que moi décideront la question.
À tous ces prestiges M. Guizot en ajoutait un autre, celui que les Anglais appellent la respectabilité. M. Guizot était austère, puritain. Le dimanche, comme un simple bonnetier de la rue Saint-Denis on le rencontrait dans le parc de Saint-Cloud, donnant le bras à sa vieille et respectable mère, dont il ne pouvait s’occuper que ce jour-là. Il se dérobait aux réceptions officielles pour dîner en tête-à-tête avec elle. Cette simplicité de mœurs était touchante. Elle était d’ailleurs partagée par presque tous les hommes éminents de cette époque. M. Villemain et M. Cousin vivaient de la sorte.
M. Villemain était désolé, quand il était au pouvoir, d’être séparé de ce que M. Thiers a appelé plus tard ses chères études. Il avait horreur des réceptions et n’assistait aux grands dîners et aux fêtes qu’avec humeur. Quand le roi Louis-Philippe l’engageait à venir au château d’Eu, son bagage tenait dans un journal qui contenait, à ce que prétendaient alors les mauvaises langues, un rasoir, un faux-col et le grand cordon de la Légion d’honneur.
M. Cousin lui ressemblait par beaucoup de côtés. Il n’aimait que l’étude, et maugréait d’être ministre parce que cela l’empêchait d’écrire ses livres. M. Cousin était d’ailleurs un type. Ce philosophe perdait la raison quand les autres philosophes, comme Pierre Leroux et Jouffroy, se permettaient de ne point admettre sans réserve son éclectisme.
Plus tard, sous le second Empire, M. Cousin, ayant dit adieu à la politique, s’était fait l’historien du XVIIe siècle qu’il aimait avec passion. Lui, qui n’avait jamais remarqué une jolie femme dans un salon, se prit d’un violent amour pour la duchesse de Longueville, à laquelle il accordait toutes les perfections. Les Mémoires du temps étaient unanimes à constater que la duchesse de Longueville n’avait pas de gorge, ce qui le contrariait beaucoup. Aussi quelle ne fut pas sa joie, lorsqu’on vint un jour lui montrer un portrait authentique de la sœur du grand Condé, qui la représentait avec un corset abondamment pourvu. Fort de cette découverte, il écrivit un chapitre spécial là-dessus, et malmenait ceux qui semblaient douter, ainsi que pourraient l’affirmer ses secrétaires qui vivent encore. Mérimée lui-même, qui vivait à Cannes près de M. Cousin pendant les dernières années de sa vie, dut croire à la gorge de la duchesse.
Le roi Louis-Philippe poussait la simplicité encore plus loin que ses ministres. On l’appelait le roi-citoyen. Dans le faubourg Saint-Germain, resté légitimiste, on riait beaucoup de sa redingote verte, de son chapeau de castor blanc et de son parapluie. M. Victor Hugo avait pour lui le plus grand respect, malgré les épigrammes qu’il lui a décochées dans son roman des Misérables. Il a dit de Louis-Philippe qu’il était inaccessible à l’Idéal. C’était à M. Fontaine son architecte et son restaurateur de palais, bien plus qu’à lui que s’adressait ce reproche. Il a dit encore que, par sa tenue, Louis-Philippe participait tout à la fois de Charlemagne et d’un avoué : ce sont là de bien légers travers, compensés par les vertus les-plus grandes. Ce fut d’ailleurs la destinée de Louis-Philippe d’être mal jugé et méconnu. N’étaient-ce pas ceux qui avaient diminué de moitié sa liste civile qui lui reprochaient de n’être plus entouré, dans son palais, de mousquetaires, de chevau-légers et de cent Suisses ?
Dans le faubourg Saint-Germain et dans les journaux légitimistes, on était très dur pour lui.
Mais on ne parvint point à le dépopulariser, parce qu’il était bon, juste, consciencieux. Nul roi ne fut plus avare que lui du sang et de l’argent du peuple sur lequel il régnait, sans le gouverner. On n’a point oublié la fameuse formule disant que le roi régnait et ne gouvernait pas, ce qui faisait écrire ironiquement à Alphonse Karr dans ses Guêpes : « Le roi règne, comme la corniche règne autour d’un plafond. « Le Charivari dépensait un esprit énorme à le caricaturer. Il donnait à sa tête la forme d’une poire. On riait de ces gamineries, et on n’en aimait pas moins le roi.
On savait à quelle torture le ministre de la justice le soumettait, lorsqu’il lui apportait le dossier d’un condamné à mort qui faisait appel à sa clémence. Louis-Philippe, enfermé dans son cabinet, revoyait les pièces du procès avec la plus minutieuse attention, et ne refusait la grâce que quand sa conscience d’homme et de chrétien le lui défendait. Sans l’insistance de ses ministres, il eût gracié tous ceux qui avaient attenté à ses jours. Ce fut avec une joie très sincère qu’il apprit, en 1846, que le prince Louis-Napoléon s’était évadé du fort de Ham.
Comme tous les hommes qui ont connu l’adversité, il était plein de pitié pour ceux qui souffraient. Ne chassant pas, il méditait sans cesse. On sait avec quelle résignation il s’inclina toujours devant les décisions du Parlement, acceptant où plutôt subissant pour ministres ceux qui avaient la majorité. Il n’aimait pas M. Thiers, mais il se réconciliait avec lui quand les Chambres le voulaient. Louis-Philippe, tout en restant chrétien, était au fond un peu voltairien. Cela tenait à cette éducation du XVIIIe siècle qui lui avait été donnée.
Quant à la reine Marie-Amélie, c’était une sainte, religieuse sans ostentation, d’une tolérance absolue et d’une charité inépuisable. Il n’était pas d’œuvre de bienfaisance à laquelle elle ne s’intéressât. Elle était vénérée par tous les pauvres.
Les fils du roi, qui avaient tous été élevés au collège et qui ne se doutaient pas qu’un jour leur père dût régner ; avaient des amis dans tous les rangs.
Le duc d’Orléans élégant, distingué, affable, était l’ami des hommes de lettres et des peintres. Delacroix, Decamp, Alexandre Dumas étaient ses intimes, ainsi que ceux du duc de Nemours.
Tous ces jeunes princes faisaient un peu leurs fredaines. On les voyait, le soir, après avoir dit bonsoir à leur père, se promener dans les rues, puis entrer dans les petits théâtres, aux Variétés, au Vaudeville, au Palais-Royal, et s’amuser comme des bien heureux, lorsque, bien entendu, les grades qu’ils avaient dans l’armée ne les appelaient pas en Afrique, où ils servaient avec le maréchal Clausel, Bugeaud, de Lamoricière, Changarnier, Cavaignac et Bedeau.
Ainsi s’explique la douleur grande et profonde que ressentit la France entière lorsque, le 13 juillet 1842, le duc d’Orléans fut tué dans un accident de voiture. Le deuil fut général et spontané. Paris et toutes les grandes villes furent plongées dans la consternation. J’étais à Auteuil ce jour-là, dans le jardin d’Esther de Bongard, lorsqu’un ouvrier effaré vint nous apprendre cette catastrophe. L’oraison funèbre du duc sortit dans toutes les bouches. Victor Hugo, Alexandre Dumas et d’autres illustrations prononcèrent des paroles magnifiques. De tous les coins de la France, le roi reçut les compliments de la plus respectueuse et sincère condoléance. La France plaçait son espoir dans le duc d’Orléans, qu’elle savait tout à la fois bon, brave et juste. Tu Marcellus eris… pensait-on de toute part. Qui sait ce qui se serait passé le 24 février 1848 si ce prince si Français, si moderne et si libéral eût vécu !
En 1842 il n’y avait encore ni chemins de fer ni télégraphe électrique. Or, ce 13 juillet, je partais le soir pour le Havre. Ce fut par les voyageurs de la diligence qu’on apprit sur la route de Paris au Havre, la nouvelle de la mort du pauvre duc d’Orléans. Partout cette nouvelle causa la plus douloureuse impression. Le lendemain, au Havre, la ville était morne. On avait suspendu les affaires, on se réunissait par groupes dans les rues pour s’entretenir de ce grand malheur. Les navires du port avaient mis leurs pavillons en berne. Les théâtres restèrent fermés. On vit le jour suivant les paysans normands accourir de tous les côtés pour vérifier si la nouvelle était exacte. Ce qui se passa au Havre se passa par toute la France.
Ce fut à Florence qu’Alexandre Dumas, que le duc d’Orléans protégeait, apprit la triste nouvelle. Il était auprès du prince Jérôme Bonaparte. Il ne put retenir ses larmes, et, se jetant dans les bras du prince, il lui dit : « Permettez-moi de pleurer un Bourbon dans les bras d’un Bonaparte. »
On comprendra qu’il n’y a pas de transition possible dans cette évocation de mes souvenirs, et qu’il me faut passer brusquement d’un sujet à un autre.
Et d’ailleurs il se passa tant de choses à Paris de 1840 à 1842. Paris à ce moment changea d’aspect, et le monde élégant dut lui-même changer d’habitudes. En voici la cause.
Jusqu’à 1840 l’endroit le plus élégant de Paris fut le Palais-Royal. La foule y était telle, qu’on se portait dans ces galeries, aujourd’hui presque solitaires. Le Palais-Royal devait sa splendeur aux maisons de jeu et aux demoiselles aussi légères que charmantes qui y avaient élu domicile. Par malheur, en 1837, le gouvernement abolit les jeux publics. Cette réforme éloigna les visiteurs et les demoiselles, qui durent, les uns trouver ailleurs des distractions, les autres chercher fortune vers d’autres parages.
On se réfugia sur les boulevards, en passant par la Bourse et la rue neuve Vivienne, tout récemment percée. À partir de cet instant, le Palais-Royal devint triste, et il vit disparaître, les uns après les autres, les établissements les plus renommés tels que le restaurant Véry, les Trois Frères Provençaux, le café Valois, le café Lemblin et le café de Foy. Seul entre tous, Véfour résista, appuyé d’un côté sur la Comédie-Française et de l’autre sur le théâtre du Palais-Royal. Cette décadence se fit sentir ailleurs.
Elle tua le restaurant célèbre du Rocher de Cancale, situé rue Montorgueil, qui, tant qu’il exista, fut un des cabarets les plus élégants de Paris.
Paris était peuplé de Parisiens, et c’était l’élite de ces Parisiens qui occupait le boulevard et le considérait comme son fief. En vertu d’une sélection qui n’était contestée par personne, on n’y était admis qu’autant qu’on apportait une supériorité ou une originalité quelconque. Il semblait qu’il existât une sorte de barrière invisible et morale qui interdît l’accès de cette enceinte aux médiocres, aux incolores et aux insignifiants qui pouvaient passer, mais qui ne s’y arrêtaient pas, ayant tous conscience que leur place n’était point là.
C’était, je le répète, des Parisiens endurcis qui occupaient le boulevard et lui donnaient tout son prestige. Par malheur l’année 1848 et les années suivantes amenèrent ce que je demande la permission d’appeler l’invasion des Barbares. Ils vinrent, non conduits par Attila, mais amenés par des chemins de fer qui, au fur et à mesure qu’ils furent construits, mirent Paris à quatre, six ou dix heures des grandes villes qui, sous le régime des diligences et des chaises de poste, en étaient séparées par de longues journées de marche.
La vapeur, appliquée non seulement sur terre mais sur mer, mit Paris à dix jours de l’Amérique et de l’Orient. Alors les Bourguignons, les Provençaux, les Gascons, les Bretons, les Basques, les Flamands, puis les Américains du Nord et du Sud, les Russes, les Turcs, les Égyptiens, les Chinois, qui ne connaissaient Paris que par les descriptions superbes qu’ils avaient lues, conçurent le dessein de le visiter. Ils se mirent en marche, et, un beau jour, débarquèrent par toutes les gares.
Comme ces visiteurs avaient des bourses bien garnies, ils se dirigèrent tout droit vers les quartiers les plus à la mode. Les vrais Parisiens disparurent dans la foule, et ne purent se retrouver. Le soir, les restaurants où ils avaient coutume de dîner, les loges et les stalles de spectacle où ils allaient écouter des opéras et des comédies, étaient pris d’assaut par des cohortes de carieux voulant, comme le baron de Gondremark de la Vie parisienne, s’en fourrer jusqu’au cou.
Si cette invasion n’avait dû être que de courte durée, les Parisiens, semblables à ces oiseaux qui marchent par bandes, se seraient retrouvés ; mais par malheur il était écrit qu’elle devait continuer et de venir plus intense d’année en année. Les expositions universelles, ces tournois pacifiques qui n’ont jamais fait baisser le prix des bas, mais qui, en revanche, ont fait beaucoup augmenter le prix des biftecks, vinrent mettre le comble. Les Parisiens durent capituler, et consentir à ce que leur ville ne leur appartînt plus, et devînt le caravansérail, la guinguette, la gare des habitants des quatre parties du monde, qui, s’ennuyant chez eux, trouvaient agréable de venir à Paris se distraire un instant.
On aurait bien tort de croire que j’exagère les choses. Elles se passent absolument ainsi. Dès qu’il y a la moindre fête à Paris, tout est envahi, non par les habitants de la ville, mais par des provinciaux et des étrangers amenés par les trains de plaisir. Tel jour l’Opéra-Comique est loué par des Angevins, au Vaudeville ce sont des Lyonnais, à la Comédie-Française des Marseillais, au Gymnase des Tourangeaux. Puis viennent des Américains, des Espagnols, des Brésiliens et des Italiens brochant sur le tout. Ces soirs-là Tortoni est la tour de Babel. On y entend parler toutes les langues.
Mais, pourrait-on me dire, de quoi viens-je me plaindre ? Ces étrangers, contre lesquels je m’élève ne font-ils pas la fortune de Paris, et cette fortune, l’a-t-on achetée trop cher, parce que, pour l’acquérir, il a fallu bouleverser une fourmilière élégante, un petit coin de Paris très coquet, et troubler dans leurs habitudes des viveurs et des fainéants ? J’admets toutes les raisons qui s’imposent, mais, tout en les admettant, je puis bien, d’une façon d’ailleurs très platonique, regretter certains tableaux disparus et tenter, à l’aide de mes souvenirs et avec une patience d’archéologue, de les reconstituer tant bien que mal, afin d’en donner une idée, même confuse, à ceux qui ne les ont pas vus.
Qui sait si ceux qui liront ces détails ne seront pas d’accord avec moi, pour reconnaître qu’on a gâté le Paris de ce temps-là, que le Paris actuel ne le vaut pas, et qu’à la suite de ces perturbations, la race des Parisiens a disparu comme celle des carlins ?
Par le boulevard, on entendait déjà, de 1840 à 1848, l’espace compris entre la rue Drouot et le nouvel Opéra. L’aspect a beaucoup changé. Il y avait alors dans le paysage beaucoup moins de Crédit lyonnais et beaucoup plus de bains chinois. Les deux galeries du passage de l’Opéra étaient fort animées. Il y avait là des marchands de musique, des bouquetières et des confiseurs dont nous ne possédons plus que l’ombre rabougrie. Ces galeries étaient le lieu de rendez-vous des chanteurs de l’Opéra et des Italiens.
C’était là que demeurait le Persan, ce personnage si poli et si convenable qu’on voyait partout, à l’Opéra, aux concerts du Conservatoire et au bois de Boulogne. Il portait une jupe de soie blanche et par-dessus une robe chamarrée, puis il était coiffé d’un bonnet pointu en fourrure d’astracan. Ce Persan, qui habita Paris pendant trente ans, était toujours seul et ne parlait jamais. J’ai connu son voisin de stalle à l’Opéra, qui pendant dix ans n’échangea pas une parole avec lui. On racontait sur lui des légendes. Selon les uns, c’était un pacha qui avait l’Orient en horreur, et, selon les autres, un marchand de cachemires enrichi. Il y avait des mauvaises langues qui prétendaient qu’il avait tout simplement vendu des dattes et des pastilles du sérail. Il mourut sous le second Empire, très estimé dans son quartier. Il ne possédait ni femme, ni sérail, ni parents, et avait toujours été seul dans son appartement.
Au coin de la rue Laffitte, il y avait, de 1840 à 1848, un bureau de tabac où les élégants du boulevard allaient acheter leurs cigares. Dans ce temps-là, la régie livrait aux amateurs des cigares à quatre sous la pièce, excellents et bien supérieurs à ceux qu’il faut aujourd’hui payer seize ou dix-huit sous. Ces cigares ne portaient pas de jarretières, mais étaient faits avec du vrai tabac de la Havane. Alfred de Musset allait deux fois par jour dans ce bureau, attiré, dit-on, par une certaine demoiselle blonde aux yeux flamboyants.
Cette maison, qui appartenait à lord Seymour, avait un vaste perron circulaire de plusieurs marches, qui faisait instinctivement lever la tête vers un balcon où on pensait que le soir devait apparaître une belle marquise pour entendre une sérénade. On ne voit plus maintenant à Paris des constructions aussi élégantes.
Le perron a été démoli et transformé en étalage où s’épanouissent des gilets et des paletots.
Le quartier général de tous les personnages qui formaient l’élite dont je parle était le Café de Paris, situé au coin de la rue Taitbout. Le restaurant occupait toute la maison. On arrivait aux grands salons du rez-de-chaussée en montant un perron de trois ou quatre marches, tout à fait pareil au perron de Tortoni.
Le Café de Paris possédait les plus grands cuisiniers. Ces artistes culinaires se préoccupaient de ce que les gourmets qu’ils faisaient manger pensaient de leurs plats. Ils jubilaient quand le maître d’hôtel venait leur dire que M. Véron, le marquis du Hallays, lord Seymour ou le prince de la Moskowa avaient été contents de leurs sauces.
Les habitués du Café de Paris avaient tous élevé cette prétention de bien manger et de bien boire, et de n’avoir jamais mal à l’estomac. Aussi ne faisait-on passer sur leur table que les poissons les plus frais, les viandes les plus succulentes et les vins les plus généreux.
« Je te pends, maroufle, disait Roger de Beauvoir à l’un des cuisiniers, si tu t’avises de me servir des sauces rousses, ou de me faire manger des viandes rôties autrement qu’au bois. »
Il serait fastidieux d’insister davantage sur ces détails de cuisine ; cependant je ne puis passer sous silence la supériorité avec laquelle, au Café de Paris, on savait apprêter un plat si simple qu’on appelle le veau à la casserole.
Alfred de Musset en mangeait trois fois par semaine, et quand Balzac et Alexandre Dumas s’étaient surmenés au travail, ils venaient tout exprès se refaire avec ce mets qu’ils digéraient sans le sentir, et qui leur rendait les forces perdues.
Il s’élevait parfois des schismes parmi ces gourmets. Méry était le schismatique, quand il venait proclamer, en sa qualité de Marseillais, la supériorité de la cuisine à l’huile sur la cuisine au beurre. Parfois deux ou trois convives se ralliaient à son avis, mais cela n’avait pas de suite, le schisme s’éteignait, et on revenait à la cuisine au beurre.
Il y avait beaucoup de passants qui dînaient au Café de Paris, mais sa vraie clientèle était composée d’habitués qui avaient leur table retenue. Comme tables principales, il faut citer celles du docteur Véron, du marquis du Hallays, de lord Seymour, du marquis de Saint-Cricq, de M. Romieu, du prince Rostopchine, du prince Soltikoff et de lord Palmerston, qui, à Paris, ne dînait jamais ailleurs.
Presque tous les soirs il y avait échange de politesse entre ces tables. M. Véron, qui aimait le vin de Musigny, en offrait au marquis du Hallays, lequel, de son côté, envoyait au docteur les morceaux les plus fins. Le vin de Bourgogne avait ses partisans, qui prétendaient que les crus les plus fins de Bordeaux n’étaient que de la tisane. La discussion s’animait, et alors Roger de Beauvoir, Romieu et le comte d’Alton-Shée intervenaient brusquement pour proclamer la supériorité du vin de Champagne, qui seul savait les mettre tous en belle humeur.
Le docteur Véron, qui dirigeait alors le Constitutionnel, dînait très souvent avec Malitourne et Alfred de Musset qui lui promettait des romans qu’il n’écrivait jamais, puis avec Eugène Suë, qui lui avait donné le Juif-Errant et les Sept Péchés capitaux. En ce temps-là, Eugène Suë était très élégant, quoique un peu gros. Il était du Jockey-Club.
Bien que travaillant beaucoup, cela ne l’empêchait pas de faire deux toilettes par jour, de salir chaque soir une paire de gants blancs, de paraître à l’Opéra et d’aller ensuite dans le monde où, comme auteur des Mystères de Paris et de Mathilde, il était très fêté par les belles dames. Mais c’était un égoïste qui réservait son esprit pour ses livres. Il fallait le piquer au jeu pour lui arracher un mot de quelque valeur. Il ne se doutait pas alors qu’on ferait de lui, après la Révolution de 1848, un député socialiste. Il fut, comme on sait, député de Paris.
Pendant la campagne électorale, le comité conservateur fit tout pour le ridiculiser. On écrivait partout sur les murs cette plaisanterie d’un goût douteux : Eugène Sue des pieds. Il avait eu pour concurrent un nommé Leclère, dont la candidature fut soutenue avec un immense talent par le comte de Coëtlogon.
Une fois entré à la Chambre, Eugène Suë ne prit jamais la parole, et, juché à l’extrême gauche, il corrigeait sans cesse les épreuves de ses romans.
Quand il avait dîné au Café de Paris, Eugène Suë, resté sur les marches du perron, écoutait immobile ce qu’on racontait, et ne sortait de son immobilité que pour appeler une bouquetière et mettre une fleur à sa boutonnière ; après quoi, il partait avec Gérard de Nerval ou avec Frédéric Soulié ! Il va sans dire que cela se passait pendant la belle saison.
Roger de Beauvoir et Alfred de Musset étaient alors dans tout leur éclat. Avec sa belle chevelure noire et frisée, son habit bleu à boutons d’or, son gilet de poil de chèvre jaune, son pantalon gris perle, sa canne en corne de rhinocéros, Roger de Beauvoir donnait dans l’œil de toutes les femmes. Il était d’une gaieté et d’une bonne humeur que rien ne pouvait assombrir. Il y avait dans son esprit une pointe d’ironie qui piqua souvent ses amis intimés. M. Véron fut longtemps sa victime. On sait que le docteur portait d’énormes cravates destinées à cacher certaines cicatrices fâcheuses qu’il était impossible de faire passer pour des grains de beauté.
Roger de Beauvoir l’avait surnommé le prince de Galles, et lui écrivait : À monsieur Véron, dans sa cravate, à Paris. En ce temps-là M. Véron habitait la rue Taitbout. Au rez-de-chaussée il y avait un serrurier qui n’avait pas le droit d’agiter ses marteaux avant neuf heures du matin, afin de ne pas troubler le sommeil de ce sybarite qui attendait l’aurore pour se coucher.
Alfred de Musset, aussi très beau garçon, ne ressemblait pas du tout à Roger. Il avait des cheveux blond cendré que n’eût pas dédaignés une jolie femme. Il était élancé et ressemblait un peu à un brillant officier de hussards ; avec cela, des yeux bleu faïence, et myope à l’excès, ce qui donnait à son regard une fixité qui pouvait passer pour de l’impertinence. Il avait très grand air, causait peu et semblait toujours plongé dans une sorte de misanthropie dédaigneuse. Mais, quand on le connaissait, il était doux, affable, ne parlait jamais de lui, et ne contestait le talent de personne. Il avait horreur des gros sous, et quand il achetait quelque chose, des gants ou des cigares, il laissait toujours l’appoint sur le comptoir, ce qui lui valait les remontrances de son frère Paul, qui ne put jamais le corriger de cette manie.
On comprendra qu’on ne peut donner une idée de ce monde élégant et agité qu’à bâtons rompus. Puisque je parle des brillants cavaliers de ce temps-là, je dois mettre sur cette liste le major Fraser, une des originalités du boulevard. Il était étranger, selon les uns Russe et, selon Nestor Roqueplan, Espagnol. En tout cas, c’était un Parisien. Il portait toujours un pantalon gris clair à la cosaque, une redingote courte serrée à la taille, et de longues cravates de satin noir ou de foulard à pois, formant un nœud énorme sur la poitrine.
Il était aimé et estimé de tous. Un certain mystère semblait l’envelopper. Il était garçon et on ne lui connaissait aucun parent. Il occupait un entresol situé sur le boulevard, au coin de la rue Laffitte. Un jour, le major Fraser se crut obligé d’envoyer des témoins à Léon Gozlan. Ce dernier avait, dans une comédie, introduit un major pourvu de trois croix. On lui avait donné la première parce qu’il n’en avait pas, la seconde parce qu’il n’en avait qu’une, et la troisième parce qu’il en avait deux. On choisit des témoins qui réconcilièrent le major Fraser avec Léon Gozlan, qui déclara n’avoir jamais eu l’intention de faire allusion à ce galant homme.
Il faut citer encore Paul Daru, le comte Fernand de Montguyon, le comte de la Tour-du-Pin, spirituel autant qu’il était Breton, le comte Germain, le plus jeune de tous les pairs de France, tous habitués de ce qu’on appelait alors à l’Opéra la loge infernale. Ces messieurs, connaisseurs et difficiles, étaient la terreur du corps de ballet.
Il ne faut pas oublier Arthur Bertrand, fils du général, qui était allé à Sainte-Hélène avec le prince de Joinville pour ramener en France les cendres de l’empereur Napoléon Ier. Arthur Bertrand était encore plus élégant qu’il n’était beau garçon. Ce fut, sans contredit, le Parisien qui consomma le plus de gants blancs et qui acheta le plus de fleurs aux bouquetières. À Noël, alors qu’il neigeait, il envoyait galamment à ses amies des bottes de roses et des gerbes de lilas. Il était le frère cadet du comte Napoléon Bertrand.
C’est Napoléon Bertrand qui, au moment de monter à l’assaut de Constantine, mit des gants blancs qu’il avait apportés de Paris tout exprès. Le comte Napoléon Bertrand était, comme on sait, d’une bravoure chevaleresque.
C’est sur la frégate la Belle-Poule, qu’il ne fallait pas laisser sans coke, ainsi que le disait le Charivari du temps, que les cendres de Napoléon revinrent en France. L’aumônier de ce bâtiment était l’abbé Coquereau, qui resta très lié avec Arthur Bertrand. Celui-ci parvint à amener l’abbé dîner au Café de Paris, mais il ne put jamais le décider à le suivre dans ses équipées du soir. L’abbé Coquereau portait non une soutane, mais une redingote noire à une rangée de boutons, ce qui le faisait ressembler à un pasteur protestant. Un certain jour, après le dîner, l’abbé se promenait sur le boulevard avec Arthur et avec Alexandre Dumas. Ses compagnons l’amenèrent au théâtre des Variétés, espérant l’y faire entrer par surprise ; mais l’abbé résista, et les repoussa en leur criant : Vade retro, Satanas. Les mauvaises langues prétendaient que l’abbé s’en était allé visiter une pénitente très belle à laquelle il avait promis de ne sauver que son âme.
Mais on n’en finirait pas si on voulait même simplement esquisser les personnalités originales qui défilaient devant le Café de Paris. Après l’heure du dîner, les habitués de ce restaurant se mêlaient à ceux du café Hardi et du café Riche situés à côté l’un de l’autre, sur le boulevard, entre la rue Laffitte et la rue Le Peletier. On disait qu’il fallait être riche pour dîner au café Hardi, et hardi pour dîner au café Riche. L’un de ces restaurants a disparu, absorbé par l’autre.
Le café Hardi avait pour habitués toute la rédaction du journal le National, dont les bureaux de rédaction étaient situés rue Le Peletier. Vers sept heures, on voyait arriver Armand Marrast, le baron Dornès, tué aux journées de juin, Clément Thomas, Bastide, Gérard de Nerval, l’ingénieur Degousé, Recurt, Thibodeau, et quelquefois M. Louis Blanc.
Armand Marrast avait l’air d’un marquis et ressemblait à Barras. Bien qu’on ne fût pas en politique de la même opinion, on n’en fraternisait pas moins pour cela. Il est vrai que cela se passait dans la rue, et qu’une fois séparés, chacun conservait ses idées.
Louis Blanc, vers 1842, habitait la maison de Tortoni. Il était alors très jeune et ressemblait à un rhétoricien. Il travaillait à son Histoire de dix ans. Bien qu’opposé au gouvernement de Juillet, il n’en était pas moins très bien vu et accueilli par MM. Guizot et Thiers.
Le matin, vers neuf heures, il descendait de son appartement et venait prendre place à une table du café Tortoni, alors tenu par M. Girardin. C’est à lui qu’on servait la première tasse de café de la journée. Celui qui écrit ces lignes se faisait servir la seconde. Louis Blanc lisait le National, je parcourais le Journal des Débats, m’intéressant peu à la politique et rêvant d’obtenir un feuilleton des théâtres me donnant le droit d’entrer dans les coulisses. Je me rappelle que Louis Blanc admirait beaucoup Fourier. Il avait un culte pour ce grand génie, et me prédisait que la génération actuelle verrait la France en République, et la statue de Fourier dressée dans toutes les grandes villes.
Il y avait, à la même époque, une autre illustration littéraire qui était un habitué de Tortoni : c’était M. de Ballanche. Il habitait rue Laffitte. Il venait à pied à Tortoni et déjeunait avec du thé dans lequel il trempait des rôties couvertes de fromage de Brie.
L’auteur de la Palingénésie était tout de noir habillé et cravaté de blanc. Après son frugal repas, il montait dans un omnibus qui le conduisait rue de Sèvres, à l’Abbaye-au-Bois, où il passait la journée en compagnie de madame Récamier et de M. de Chateaubriand. Madame Récamier, le vicomte d’Arlincourt et lui disaient la messe en l’honneur de l’auteur du Génie du Christianisme, qui, étendu sur un canapé, acceptait avec froideur ces hommages.
On sait que Chateaubriand fut triste toute sa vie. On se demande pourquoi ? Il était né noble, avec des fleurs de lis dans ses armes, il fut ministre, ambassadeur ; il fut un des plus grands écrivains de son temps, adoré par les plus jolies femmes de l’Europe ; son roi le pensionna. Tout cela ne put dissiper les nuages amoncelés sur son front. Il est juste de dire que M. de Ballanche n’était pas fait pour l’égayer, pas plus que madame Récamier, qui n’était plus belle, hélas ! et en était arrivée à regretter son bras si dodu, sa jambe bien faite et le temps perdu.
Roger de Beauvoir a seul connu la cause de la tristesse de Chateaubriand. Selon lui, il pleura toujours son roi, et ne sut bénir que ce qui tombait. Lorsque Alexandre Dumas épousa mademoiselle Ida Férier, il eut pour témoins Chateaubriand et Roger de Beauvoir. À la cérémonie nuptiale, qui eut lieu dans la chapelle de la Chambre des pairs, il bénit la mariée qui avait des choses considérables à mettre dans son corset. « Voyez, dit-il à Roger, ma destinée ne change pas, et en ce moment encore, tout ce que je bénis tombe. »
Toujours, vers cette année 1845, il se passait bien des choses sur le boulevard des Italiens. On sait que Méry était très joueur et qu’il restait souvent la nuit dans un cercle pour jouer à la bouillotte. Il ne rentrait chez lui que vers quatre ou cinq heures du matin. En passant devant le Café de Paris, il lui arriva trois jours de suite d’y rencontrer Balzac, vêtu d’un pantalon à pieds et d’une redingote à revers de velours. Le troisième jour, il demanda à Balzac pourquoi il le trouvait toujours à cette place à une heure aussi matinale. Balzac fouilla dans sa poche et lui fit voir un almanach constatant que le soleil ne se levait qu’à quatre heures cinquante-cinq.
– Je suis traqué, dit Balzac, par les gardes du commerce, et forcé de me cacher pendant le jour ; mais à cette heure je suis libre, je me promène, on ne peut pas m’arrêter : le soleil n’est pas levé.
– Moi, répondit Méry, quand pareil désagrément m’arrive, je ne me cache pas, je vais en Allemagne.
Cela dit, ils se serrèrent la main et s’éloignèrent.
J’ai dit qu’en ce temps-là lord Seymour savait égayer le carnaval. C’est lui qui conduisait la descente de la Courtille, le mercredi des Cendres, après le bal de l’Opéra. Il avait pour compagnons, dans ces folles équipées, le comte d’Alton-Shée, pair de France de par l’hérédité ; puis Romieu, qui avait, comme on sait, infiniment d’esprit.
Ils partaient en voiture découverte et, une fois arrivés à la Courtille, ils s’installaient dans un cabaret et jetaient par les fenêtres, aux masques qui grouillaient dans la rue, des bonbons et de l’argent roulés dans de la pâte frite. Ces messieurs faisaient bien les choses, et se mêlaient sans façon aux pierrots, aux arlequins, aux débardeurs, aux paillasses, aux laitières crottées et aux marquises salies, vomis par tous les bastringues de Paris.
Vers dix heures du matin, lord Seymour-et les autres libertins, ses compagnons, brisés par leurs travaux, rentraient chez eux ; et, le soir, on les voyait reparaître en habit noir et en gants blancs au Café de Paris.
On sait que plus tard le comte d’Alton-Shée et Romieu jouèrent un rôle politique et réalisèrent cette prophétie du vieux Royer-Collard, qui avait dit : « Laissez faire ces jeunes bambocheurs, ils seront un jour l’espoir de la France. » Il en est beaucoup d’autres, que je ne nommerai pas, qui firent également partie de cette bande de jeunes bambocheurs.
Il y en a parmi eux qui sont devenus ministres et ambassadeurs. Il faut que jeunesse se passe, et si à présent nous sommes moins gais que nos pères, si nous sommes devenus poseurs, c’est parce que jeunesse ne s’est pas passée.
Les années pendant lesquelles se passait ce que je raconte se distinguaient surtout par la gaieté. On semblait être heureux de vivre, et on ne se montrait ni tendre, ni attentif pour les utilitaires et les réformateurs. Alexandre Dumas, Méry, Théophile Gautier publiaient des choses charmantes. Un feuilleton réussi était un évènement. C’est ainsi qu’on écrivait de province à la grave rédaction du Journal des Débats pour connaître d’avance le dénouement de Monte-Cristo.
Alexandre Dumas, installé à Saint-Germain dans son palais de Monte-Cristo, ne cessait de travailler que pour faire des mots, et venir, à titre de congé, flâner un peu sur le boulevard. Un matin, à Monte-Cristo, il vit deux matelots frapper à sa porte et lui demander l’aumône. Ils avaient fait naufrage. Dumas leur donna dix francs, en leur rappelant que les naufrages étaient les pourboires des matelots.
Lorsqu’il publiait la Reine Margot, dans la Presse, c’est-à-dire vers 1845, Dumas dînait souvent chez Émile de Girardin. Les honneurs du salon étaient faits par madame Delphine de Girardin, qui fut, comme on sait, une charmeuse. Un soir un convive se fit beaucoup attendre. On n’osait point se mettre à table, car ce convive était M. Viennet, pair de France et membre de l’Académie française. Enfin il arriva, et s’excusa auprès de madame de Girardin, en lui disant qu’il avait oublié l’heure en travaillant à la Franciade, poème épique, qui devait avoir près de trente mille vers. « Alors, dit Alexandre Dumas, il faudra » au moins quinze mille hommes pour le lire. »
Madame de Girardin publiait alors, dans la Presse, ses courriers de Paris, sous le pseudonyme du vicomte Charles de Launay. Elle y traitait tous les sujets avec une élégance, un esprit et un tact qui étaient cause qu’on comptait avec elle. Encore aujourd’hui ses courriers sont charmants. Il y en a sur le maréchal Soult, qui sont dans toutes les mémoires. Selon madame de Girardin, quand le maréchal Soult n’était pas au pouvoir, le National admettait qu’il avait gagné la bataille de Toulouse ; mais dès qu’il était ministre, il cessait d’avoir gagné cette bataille.
Ses descriptions du bal de l’Opéra fourmillent de mots exquis. Elle trouvait qu’à ces bals on était trop pressé et que les masques manquaient d’esprit. « Aussi, s’écriait-elle, on n’a jamais vu tant de chocs et si peu d’étincelles ! »
Les courriers de Paris de madame de Girardin faisaient un tort immense à ceux par trop naïfs qu’un homme d’esprit pourtant, Eugène Guinot, écrivait dans le Siècle. Nos chroniqueurs effrontés d’à présent doivent bien rire s’il leur arrive de jeter les yeux sur les berquinades inoffensives de Guinot. Avec lui, c’était toujours la même petite histoire scandaleuse, c’est-à-dire la petite baronne de X… en loge grillée avec le comte de B…, alors que le baron de X… se trouve lui-même dans la salle, dans une loge également grillée, avec la petite Tata, à laquelle le comte de B… veut du bien.
Pendant dix ou quinze ans Paris se contenta de cela, pour toute chronique scandaleuse.
On est bien plus exigeant par ce temps d’indiscrétions qui court, et les courriéristes doivent dépenser bien plus de talent.
Mais à cette époque, tout était facile. M. de Girardin était, comme on sait, député de Bourganeuf ; c’était son bourg pourri. Il y avait dans ce bourg cent vingt-neuf électeurs. Un de ses amis, un garçon charmant, M. F… de La…, amenait par séries ces bons électeurs à Paris. On déjeunait, on allait au spectacle, et, au jour de l’élection, on trouvait sur cent vingt-neuf bulletins le nom de M. Girardin. Il faut avouer que le suffrage universel donne à présent plus de fil à retordre aux candidats.
Parmi toutes les originalités de cette époque, il en est une sur laquelle il importe d’insister. Je veux parler de Nestor Roqueplan, qui fut proclamé le plus Parisien de tous les Parisiens. Auber seul pouvait lui contester ce titre. Mais ils n’étaient pas jaloux l’un de l’autre, et s’entendaient au contraire à merveille.
Après avoir dépensé beaucoup d’esprit dans les journaux, Roqueplan se fit directeur de théâtres. Il fut, comme on sait, successivement directeur des Variétés, de l’Opéra, de l’Opéra-Comique et du Châtelet. À cette époque, il était aux Variétés. Pour frapper un grand coup, il voulut réunir les artistes les plus aimés du public. Il prit Bouffé au Gymnase et Déjazet au Palais-Royal. Il mit le théâtre des Variétés à la mode et y attira comme habitués tous ses amis du boulevard et du Café de Paris. En ce temps-là, l’orchestre des Variétés était aussi élégant que celui de l’Opéra.
Roqueplan était, comme on sait, l’homme des paradoxes, mais avec lui le paradoxe n’était très souvent qu’une vérité exagérée. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire Parisine.
Ce livre, parsemé, je le reconnais, de fantaisies abracadabrantes, déborde de bon sens. Il avait quelques idées fixes, au succès et au triomphe desquelles il travailla toute sa vie. Il détestait la nature, et en art il exécrait tout ce qui n’était pas supérieur. Que de fois, au Café de Paris en compagnie d’Alphonse Royer, de Théophile Gautier et de Romieu, n’a-t-il pas plaisanté ceux qui s’en allaient à la campagne ou qui en revenaient minés par l’ennui ? Il soutenait qu’il faisait plus frais par la canicule, près du bassin du Palais-Royal ou dans le passage Choiseul, que dans toutes les forêts du monde, où, selon lui, il fallait se défendre des coups de soleil, des rhumes, des reptiles et des insectes. C’était une douce folie. Bien que parlant souvent sur ce sujet, il ne se répétait jamais, et savait toujours trouver quelque chose de nouveau.
Quant à ce qu’il appelait l’art inférieur, il lui fit, comme on sait, la guerre aux dépens de sa bourse. Lorsqu’il était directeur de l’Opéra-Comique, que de parti pris il conduisit fort mal, il jubilait d’entendre les ouvrages médiocres interprétés par les doublures auxquelles il les confiait. Il entrait furtivement à l’orchestre, et il devenait tout joyeux quand un ténor poussif et une chanteuse éreintée avaient bien massacré un duo. Il ne s’était fait directeur de cette scène que pour dégoûter ses compatriotes du genre de l’Opéra-Comique qui, selon lui, était en musique l’équivalent de ce qu’est, en fait de forces militaires, la garde nationale. Ce paradoxe lui coûta cher, ainsi qu’à ses amis.
Rien n’était amusant comme d’observer Nestor Roqueplan assis dans son fauteuil de directeur et recevant ceux qui avaient à lui parler. Un jour, on lui passa la carte d’un monsieur qu’il ne connaissait pas et qui s’était déjà présenté vingt fois. Désarmé par tant de patience, il dit à son huissier de faire entrer.
D’un ton un peu embarrassé, ce jeune homme venait lui demander ses entrées. Il croyait y avoir droit, parce que son grand-père avait fait jouer un opéra-comique en un acte en 1803. Roqueplan regarda le solliciteur, et le pria de lui fredonner un air de la partition de son grand-père. Cela lui fut impossible. « Eh bien, monsieur, dit Roqueplan, j’ignore encore plus que vous la musique de votre aïeul. Vous voyez que votre demande est excessive. » Mais, je m’arrête, ceci s’étant passé bien après l’époque dont je m’occupe.
En ce temps-là comme à présent, Paris se laissait surprendre par des aventuriers, et surtout par des aventurières. Il en est une qui vint un jour tourner les têtes de ces viveurs difficiles du boulevard. Je veux parler de Lola Montès. C’était une étrange personne. Elle avait vingt-deux ans lorsqu’en 1841 elle vint danser à Paris.





























