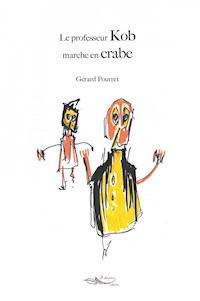Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 5 sens éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Louis, un vieil infirme dont le hobby est la préhistoire, se débat dans une société qui n’est pas faite pour lui. Son prochain objectif : nager le plus loin possible. Son père lui a laissé un cahier quand il était enfant avec un certain nombre de recommandations pour se réconcilier avec son corps. À l’occasion d’un voyage dans les Antilles, Louis et son épouse Madeleine retrouvent leur fille qu’ils n’ont pas vue depuis une dizaine d’années. Des tensions apparaissent entre le père et la fille. Sa petite-fille métisse parvient à donner un sens à sa vie, mais c’est dans la mer que le vieux Louis trouvera sa grotte enchantée et son dernier refuge.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gérard Pourret a écrit les scénarios d’une vingtaine d’albums pour la jeunesse dont certains ont été traduits à l’étranger. En particulier il est l’auteur de la collection "Graines d’ados" qui a reçu de nombreux Prix. Il vit à Toulon où il écrit et peint dans son atelier près du port. "Nager loin" est son deuxième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gérard Pourret
Nager loin
Roman
À ma mère
Garde-toi, tant que tu vivras,
De juger des gens sur la mine.
LA FONTAINE
Le cochet, le chat et le souriceau
PROLOGUE
« Pendant de nombreuses années, j’ai soutenu que je pouvais me rappeler des choses vues à l’époque de ma naissance. » Je suis tombé sur cette phrase par hasard en feuilletant un livre dans l’espace librairie d’Emmaüs, un récit autobiographique d’un certain Yukio Mishima. Avec Madeleine, on aime traîner au milieu des vieilleries d’Emmaüs qui nous rappellent notre époque. On feuillette au hasard, on prend le temps de dénicher des bizarreries. Cette phrase, tirée de Confessions d’un masque, est une bizarrerie littéraire qui pour moi a du sens : savoir si l’enfant qui sort ensanglanté et étourdi du ventre de sa mère est conscient de son état physique. S’il voit les choses autour de lui, s’il ressent la force victorieuse qui le fera se tenir debout ; ou si, au contraire, il sait déjà qu’il n’est pas un bébé magnifique, et que toute sa vie sera cent fois plus compliquée que celle de la plupart des humains. Rien n’est plus difficile en effet, lorsqu’on est différent, que de s’accepter tel qu’on est. Comment être libre de ses gestes, de son visage, de son corps nu, de son sexe, puisqu’il faudra bien les montrer un jour ?
Ma mère a noté sur son carnet de souvenirs que je n’étais pas « un bébé comme les autres ». C’est le moins qu’on puisse dire. J’ai rarement vu déambuler sur la plage ou ailleurs des spécimens dans mon genre. Nous autres handicapés, passons furtivement devant la glace au moment de se mettre au lit ou en sortant de la douche. Pour le reste, tout est question de volonté : on peut vivre dans un certain oubli de soi-même, comme un aveugle, à tâtons de notre propre corps, en espérant ne rien heurter qui nous ramène à la dure réalité de notre état. Je sais seulement que je ne dois pas me mettre torse nu devant tout le monde, je ne dois pas porter des habits trop moulants, surtout ne pas prendre l’avion pour éviter les palpations désobligeantes à la sortie du portique. Immanquablement, les contrôleurs croient découvrir une arme ; ils disent : « Qu’est-ce que vous portez là ! » Je suis bien obligé de répondre : « Mes os. » C’est différent d’un tétraplégique en fauteuil par exemple, d’un aveugle avec une canne ou d’une personne de petite taille. Ceux-là, par une sorte d’empathie, on les accepte volontiers, on les met en avant pour dire qu’ils sont comme nous, d’une autre forme de beauté, mais comme nous. Moi, je n’ai jamais été comme les autres, car la mauvaise surprise je la porte plus ou moins dissimulée sous mes vêtements ; je suis donc un voleur, un escroc du handicap dont on se méfie toujours.
J’aime ressentir sur ma peau la chaleur du soleil, danser avec les mouettes, goûter le sel de l’eau. Je ne me souviens pas des images vues à l’époque de ma naissance, je voudrais que celles entrevues au moment de ma mort soient de la même couleur que le rêve intérieur derrière mes paupières closes. À présent que j’écris, que mes vieilles mains tapent maladroitement sur les touches d’un ordinateur, je sais qu’il me reste une chose à accomplir, un dernier exploit qui me fera entrer une fois pour toutes dans le monde des humains.
Nager.
Nager loin.
I - GRANDIR
1
Ma mère a vécu toute sa jeunesse dans un village reculé des Deux-Sèvres, une cambrousse comme elle disait en rigolant. Au début du siècle dernier, on apprenait la vie en regardant les bêtes : le taureau monte sur le derrière de la vache quand elle est en chaleur, neuf mois plus tard, les veaux sortent les deux pattes et la tête en avant, puis, aussitôt léchés, ils se mettent debout pour téter. C’est la nature qui veut ça. La nature est toujours bienveillante, elle est la source des miracles et ce qui fonde l’âme humaine depuis la nuit des temps : la confiance en l’avenir. Le reste est une question de bon sens : au bal, sur le parquet du samedi, il ne faut pas danser avec l’Antoine qui porte sur lui toutes sortes de maladies vénériennes, ni avec les vieux qui pincent les fesses des filles. En ce qui me concerne, et malgré l’aide de la nature bienveillante, je n’ai pas réussi à me mettre debout tout seul, ni à téter correctement ma mère. Les premiers mois de ma vie ont été difficiles, je l’ai lu dans le carnet de souvenirs que ma mère a laissé.
Vers l’âge de sept ou huit ans, pendant que mon squelette était encore malléable, le médecin a dit que le mieux serait de me suspendre tous les jeudis après-midi. Mon père m’emmenait chez le kiné, je restais suspendu le plus longtemps possible aux barreaux d’un espalier, bras tirés en arrière, crucifié. J’étais le christ enfant, j’étais la bonté infinie du ciel déguisé en martyr. À quoi pouvais-je penser les bras en croix sur l’espalier, désarticulé, terriblement osseux, les yeux immenses et noirs ? J’existais petitement je suppose, à me demander si la souffrance que je ressentais dans mon corps était de l’ordre de la croissance naturelle, ou si c’était une punition inventée par les adultes pour je ne sais quel méfait : une sorte d’expiation pour toutes les larmes versées par les mères et les pères dont les bébés ne sont pas « nés comme les autres ». À la fin des séances, j’avais droit à une barre chocolatée. Pour le reste on ne pouvait pas faire grand-chose : en classe, la maîtresse passait de temps en temps sa main devant mes yeux, mais j’étais loin déjà, bien au-delà du carré de la fenêtre. C’est dans le ciel qui bouge que je cherchais l’inspiration, les oiseaux fugitifs ; ailleurs je ne voyais rien, ni sur le visage des adultes, ni dans mes livres d’école.
Mes parents habitaient Tours, nous passions toutes les vacances à la campagne, cette cambrousse d’où ma mère s’était échappée par miracle pour faire quelques études. Pendant des années, ça a été drôle pour ma sœur Fabienne et pour moi de courir dans les chemins, de voler des pommes dans les vergers et de se faire engueuler en patois. Ça ne se voyait pas beaucoup au milieu des animaux et des petits paysans crottés qui se baignaient avec nous dans les mares que j’étais mal foutu. Vers l’âge de quatorze ou quinze ans, mon grand-père décida de me faire faire le tour complet de la ferme et des propriétés alentour. Pour me sauver en somme. « Avec deux mains comme les miennes tu te débrouilles » me disait-il. Moi, je ne les trouvais pas très jolies ses mains, à l’une il manquait un pouce, ses ongles étaient noirs, épais comme de la tôle. Un jour, il me proposa de conduire sa Panhard, une PL 17 qui sentait fort le plastique et les pastilles à la menthe. Enfoncé dans la banquette avant, je voyais à peine la route, je manœuvrais le levier des vitesses en faisant craquer les pignons ; les gens se retournaient sur notre passage, ils ouvraient la bouche en nous regardant avec les yeux plissés pour bien se mettre dans la tête une chose à raconter le soir : le vieux Fernand et son petit-fils en pleine séance d’apprentissage. « Il a trouvé son commis » rigolaient-ils. Nous avons contourné une mare, puis nous sommes descendus jusqu’au Four à chaux, de là, remontés par Le Poirier, on est passé devant la ferme des Quinard où le père s’est pendu. Pendant ce temps, mon grand-père cherchait à me convaincre d’une sorte de liberté absolue : première, deuxième et puis à fond de troisième sur la ligne droite en sortie du village. Au début, c’était plutôt amusant de rouler sans permis, j’avais l’impression d’avoir absorbé une potion magique qui m’aurait fait grandir d’un coup.
Où se trouvait mon avenir ? Le trajet qu’avait fait ma mère de la cambrousse à la ville, je pouvais très bien le faire à l’envers. Peut-être réussirais-je à trouver ma place dans cette nature bienveillante, petit avorton en osmose avec la terre, le vent, la pluie, l’odeur des pommes pourries au commencement de l’automne ; peut-être y avait-il pour moi quelque chose qui ressemble à l’amour. Durant le temps que nous passions à la ferme, chaque année, la nature me titillait, je me branlais facilement avec rien : une femme au loin, déhanchée sur un vélo, ou la Setter noir et feu de mon grand-père, élégante et racée qui me léchait les doigts. C’était donc inspirant au début. En roulant j’avais toutes ces images en tête, et puis à force de tourner en rond, de voir toujours les mêmes paysans hébétés, à peine bougés sur le bord de la route, il m’est venu un doute, comme quelqu’un que l’on s’apprête à mettre gentiment chez les fous : au dernier moment il aperçoit la grille d’entrée, elle est haute, lourde, et puis disséminés dans le parc, ils sont là les fantômes à lever les bras au ciel, à baver leurs malheurs dans un drôle de patois.
C’est ça la liberté ! Ma vue se brouille, cramponné au volant de la Panhard j’aperçois une silhouette sur le bord de la route, un type mal fagoté, la braguette grande ouverte ; on dirait que c’est moi… Je n’ai jamais été au ciné avec les copains alors ? je n’ai jamais fait l’amour avec une vraie femme ? Mes mains lâchent le volant d’un coup, comme sous l’effet d’une décharge électrique ; la voiture fait une embardée et se retrouve à cheval sur le talus. Silence. Le moteur a calé. Mon grand-père me regarde, il a compris, il sait que ce gamin au visage blême, petit merdeux sans envergure n’est pas capable de conduire une Panhard et encore moins un tracteur Massey Fergusson. On ne peut décidément rien en faire : « i va bé te dire une chose, que t’mérite des cops de pais au çhu ! »
2
On ne revient pas en arrière sans prendre le risque de se poser de graves questions : Est-ce que j’ai pris les bonnes décisions dans ma vie ? À vingt et un ans, je redoublais pour la deuxième fois le bac et tout naturellement mes parents m’ont demandé si quelque chose m’intéressait ; oh ! pas grand-chose, mais quand même, une petite vocation, la mécanique par exemple (car j’aimais bricoler), ou la boulangerie (j’aimais la frangipane), distribuer des lettres en mobylette (?). J’avais mis depuis longtemps une croix sur les métiers physiques, mais je sentais qu’une petite chose cérébrale pouvait m’intéresser, je ne savais pas quoi exactement. J’ai demandé conseil à mes parents ; « Alors il faut que tu fasses du Droit, a répondu mon père, le Droit mène à tout. » Cette révélation soudaine eut le don de m’enflammer, car si le Droit mène à tout, n’importe quel être humain, même raté, même infirme, peut trouver sa place dans ce « tout » salvateur. Je suis donc allé le cœur battant me procurer un Code civil, un livre épais et rouge, pareil à un grimoire. Assis sur mon lit, je l’ai consulté en caressant les pelures, et puis en feuilletant les pages, une mécanique s’est déclenchée, comme si le petit neurone d’intelligence qui se trouvait dans mon crâne se réveillait d’un coup. Ça a démarré avec l’article 528 du Code civil à propos de la distinction des biens : « Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre. » Jusque-là, mon esprit fonctionnait à peu près normalement, et j’ai pensé tout d’abord que les autres biens étaient sans doute ce que l’on appelle dans le langage courant des immeubles ; mais les articles suivants m’enlevèrent cette déduction hâtive en révélant – d’une façon tout à fait surprenante – qu’il peut exister des meubles meublants qui ne sont ni meubles, ni immeubles, mais destinés à l’usage et à l’ornement des appartements. On donnait comme exemple les tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tableaux, porcelaines… J’étais stupéfait de lire ce genre de littérature. On avait imaginé en 1804 régler le sort des situations les plus tordues qui soient, l’infinie complexité des choses. En poursuivant ma lecture, je tombais sur un autre article, qui lui vous annonce tout de go qu’il existe des immeubles par destination, c’est-à-dire des objets qu’on ne peut enlever sans clef à douille ou tournevis, comme les lavabos ou les chiottes par exemple. Pour résumer, il existe donc des meubles, puis des meubles qui ne sont ni meubles ni immeubles, de même qu’il existe des immeubles, puis des immeubles qui ne sont ni immeubles ni meubles. Je commençais à être sérieusement intrigué par ces élucubrations, lorsqu’en lisant les petites notes en bas de page, je remarquai que la jurisprudence avait créé en forme d’apothéose une dernière catégorie, plus vicieuse encore : les meubles par anticipation. Je mis un certain temps à comprendre de quoi il s’agissait. L’expérience de la cambrousse me donna finalement la solution : si, par exemple, je vends les pommiers de mon grand-père et les pommes qui vont avec, ce sont des immeubles, on ne peut pas les déplacer, nous sommes d’accord, mais si je vends les pommiers à un paysan pour être abattus ensuite, les pommes et les pommiers deviennent des meubles par anticipation. En effet, bien qu’étant attachées provisoirement à l’arbre, les pommes sont destinées à faire du cidre tandis que le bois servira à faire du feu. On peut même imaginer que si je vends uniquement la récolte des pommes sur pied, les arbres restent des immeubles tandis que les pommes sont des meubles. J’étais heureux de découvrir que l’humanité recelait des mystères de cette nature ; il ne suffisait pas d’être bien foutu dans la vie, il fallait aussi savoir se plier aux circonvolutions du Droit. Une véritable scoliose intellectuelle ! J’étais devenu enthousiaste, j’avais l’impression que si j’entrais à fond dans cette matière, je serais en quelque sorte protégé d’une multitude de dispositions toutes plus tordues les unes que les autres. Que ce soit en Droit civil, en Droit administratif ou en Droit commercial, mon cerveau deviendrait si tortueux que personne ne trouverait à dire sur mon infirmité. Cul-de-jatte mille fois, c’était possible !
3
Madeleine a pas mal d’activités dans la semaine, essentiellement du bénévolat pour le Secours Populaire ou l’Armée du Salut. Elle aime les gens d’une façon générale, les femmes seules, les pauvres, les humiliés, elle n’aime pas les cow-boys qui boivent du whisky, crachent par terre, tuent des Indiens comme à la foire. J’ai emmené Madeleine voir Le Bon la Brute le Truand quand elle avait dix-huit ans ; à la fin de la séance elle a dit : « Encore une histoire de mecs. » « T’as raison » j’ai répondu. « Alors pourquoi on n’a pas été voir le film de Chantal Ackermann ? Il passe justement dans cette salle ! » Je n’ai pas osé lui dire que j’avais lu dans Télérama le synopsis du film (Je, tu, il, elle), un sujet qui aurait effectivement pu lui plaire, mais à moi pas du tout : « Une jeune femme seule dans une chambre déplace ses meubles, écrit des lettres et mange du sucre en poudre. Elle quitte sa chambre et rencontre un routier avec qui elle erre un moment. Plus tard, elle rencontre une jeune femme avec qui elle fait l’amour. »
Le film s’est terminé vers vingt-deux heures, ensuite nous sommes allés chez elle, un peu à la campagne, de l’autre côté du pont qui traverse la Loire. Ses parents étaient absents, nous en avons profité pour boire du mousseux prélevé dans la cave de son père en mangeant des rillons. À l’époque, je m’excitais très vite avec les choses du sexe. Ce soir-là, à force de l’embrasser, de la peloter amicalement, l’excitation a atteint une sorte de paroxysme. J’étais comme ces chats devenus fous au contact d’une certaine herbe : ils se frottent la tête contre les arbres, les murs, les jambes et se roulent par terre en miaulant. J’ai dégrafé mon ceinturon muni d’une boucle en acier avec le symbole Peace and love, et je me suis couché sur Madeleine en gesticulant.
C’était la première fois que je faisais l’amour, emberlificoté dans mes habits j’essayais d’arriver à mes fins tout en évitant de me montrer nu. Surtout pas ! Je m’accrochais à mes habits, mon pullover je ne voulais pas l’enlever, mon pantalon non plus ; je voulais que l’amour se consomme par une danse frénétique comme chez les oiseaux ou les lapins. Madeleine tirait sur mes manches, elle ne comprenait pas. La tête enfermée dans mon pull, je ne savais pas exactement par où la pénétrer ; parfois ça me semblait très hostile, douloureux ; parfois j’avais l’impression de m’enfoncer dans quelque chose de mou, agréable, mais faute de bien maîtriser la cadence, je ressortais et m’empalais à nouveau dans le dur (la boucle de mon ceinturon).
À la fin de la soirée, je n’avais pas joui, ma queue était rouge, turgescente, elle avait tellement gonflé que je n’arrivais pas à la rentrer intégralement dans mon slip. En descendant du lit, je marchai pieds nus sur une flûte, elle explosa littéralement. Il aurait fallu cinq ou six points de suture, seulement je n’existais déjà plus en tant qu’homme, en tant que personne humaine ; il y avait tellement de honte, de désespoir en moi que ça ne valait plus la peine de rien. Finalement, j’ai enveloppé mon pied avec deux chaussettes l’une sur l’autre. Quelques minutes plus tard, je claudiquais dans la nuit à travers le jardin pour retrouver ma mobylette. La nuit était fraîche, étoilée, je ne fuyais pas les parents de Madeleine, ni Madeleine elle-même, je m’en allais de l’amour. C’était trop compliqué.
4
Il s’est passé des années et des années et pas grand-chose autour. Parfois j’oubliais que j’étais mal foutu, je me laissais aller à être heureux. Quand on recevait chez nous, à Val-de-Fontenay, je me contentais d’ouvrir la bouteille de vin, c’était mon job : manier le tire-bouchon, respirer le bouchon, hocher la tête. Pour la conversation, Madeleine faisait le travail pour nous deux, toujours prévenante, aimable avec les invités. Ça me faisait comme une chappe de gentillesse derrière laquelle je me tenais bien tranquille.
Et puis il y avait ma mère. Je prenais le RER deux ou trois fois par semaine pour aller la voir dans une résidence médicalisée. Je l’écoutais raconter ses souvenirs, elle parlait d’une voix chevrotante avec de temps en temps des petits rires aigus pour nous réveiller tous les deux. C’était le souvenir de mon père décédé quinze ans plus tôt, c’était des nouvelles de ma sœur, des enfants de ma sœur, des enfants des enfants de ma sœur. Quand elle avait fini, je la relançais comme un jouet mécanique, et la voilà repartie à remuer les lèvres en faisant bouger son dentier avec la langue. J’avais le temps de bien l’observer, puisque c’était ma mère. Vous pensez ! Elle parlait longtemps, tout ce qu’elle disait ressemblait à des paroles que j’avais déjà entendues mais bien utiles pour la mémoire tout de même. J’étais content aussi de l’entendre péter, à quatre-vingt-neuf ans ça lui arrivait souvent, on faisait comme si on n’avait rien entendu, même l’odeur on ne s’en occupait pas. Ça nous faisait du bien à tous les deux.
C’est fini maintenant, ma mère est morte, et nous avons déménagé dans le Sud. Depuis plus de cinquante ans qu’on se connaît avec Madeleine, on a plus la force de s’inventer des souvenirs. Je reste assis dans mon fauteuil à lire des revues d’archéologie préhistorique pendant que Madeleine fait du bénévolat. Elle est heureuse de toute façon, des petits bonheurs surgissent en elle dans tous les endroits qu’elle fréquente, même dans notre petit appartement au deuxième étage d’un immeuble. De la fenêtre de la cuisine, elle voit une tourterelle nicher dans un palmier, elle regarde passer en scooter le livreur de cade ; son visage est serein, elle serre le col de sa robe de chambre et se tourne vers moi. « Tu m’as entendue ronfler cette nuit ? » demande-t-elle.
Il faut croire que la vieillesse nous emporte sans prévenir. On fait un pas de côté dans la vie et tout ce qu’on a connu disparaît d’un seul coup, les choses et les gens. C’est comme ça. Il ne faudrait jamais s’échapper de l’enfance, les copains qu’on a du premier coup et qui vous jurent fidélité : « À la vie à la mort. » Où sont-ils maintenant ? Hier, je me suis forcé à reprendre contact avec un copain que j’ai fréquenté lorsque j’avais quatorze ou quinze ans, c’est-à-dire avant même de connaître Madeleine. J’ai vu qu’il m’avait envoyé un petit mot sur ma messagerie Facebook : « Bonjour c’est Jean-Michel. Bon anniversaire Louis ! Si par hasard les alizés te conduisent en Dordogne… » Il y avait sa tête en couleur dans un petit rond au-dessus du message, un visage de vieil adolescent avec encore pas mal de cheveux sur le crâne. Dans la solitude où je me trouvais alors, j’ai fini par l’appeler au téléphone : « Salut Jean-Michel, c’est ton vieux pote Louis de soixante-dix ans, une paille ! » Il y eut un blanc à l’autre bout du fil, et puis la conversation a démarré : « Salut ! Il fait beau chez toi ? » « Ben oui, comme d’habitude. Et toi que deviens-tu en Dordogne ? » « On fait aller ». L’échange s’est poursuivi de cette manière, on n’a pas évoqué de souvenirs précis, on était plus vraiment copains en somme. D’ailleurs, il ne m’a pas clairement invité à venir chez lui, il a redit simplement à la fin de la conversation : « Si par hasard les Alizés te conduisent en Dordogne… » Il y a comme cela des vents loin des exaltations de la jeunesse, lents, incertains, sans véritable espoir de vous faire envoler. J’en ai parlé à Madeleine, je ne sais pas si on ira.
5
Je commence à me voûter sérieusement, les épaules partent en avant et les omoplates en arrière. Sans compter la colonne vertébrale tordue comme un hameçon, une pêche aux douleurs dans les reins. J’attends l’été pour des séances de natation qui me font beaucoup de bien. On ne peut pas dire que je nage à la perfection, mais j’aime plonger mon corps dans la mer. Une fois immergé, je sens les ligaments s’assouplir, les os se libérer de quelque chose de lourd ; je suis comme ces poissons qui filent dans les courants sans avoir besoin de trouver des appuis. J’avance simplement à la force des bras, mes mains glissent en profondeur et ramènent de grosses bulles en surface. L’homme a été une espèce de poisson avant d’être une espèce de singe. Les poissons-ballons et les poissons-coffres n’ont que deux petites nageoires de chaque côté, un genre de bras stabilisateurs ; leurs plaques osseuses se soulèvent, tandis que les nôtres ont fini par se souder et ne permettent que très faiblement de gonfler la