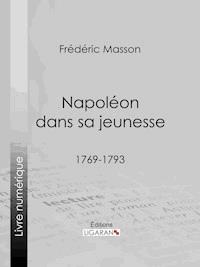
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait: "Napoléon est né à Ajaccio, le 15 août 1769, de Charles-Marie de Bonaparte et de Marie-Letizia Ramolino. Qu'étaient-ce que les Bonaparte ? Leur nom patronymique est sans doute Buonaparte, mais on trouve ce nom écrit avec ou sans u, indifféremment précédé ou non de la particule : tel, il est encore un des noms qui, en Corse, changent le moins de physionomie ainsi, dans la plupart, les désinences ne sont point fixes..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En 1895, j’ai publié, en collaboration avec M. Guido Biagi, conservateur de la Bibliothèque Médiceo-Laurentienne, les manuscrits que Napoléon avait confiés à son oncle le cardinal Fesch, que celui-ci avait remis à l’un de ses grand vicaires, l’abbé Lyonnet, que l’abbé Lyonnet avait vendus à Libri, Libri à Lord Ashburnham, et Lord Ashburnham au gouvernement italien.
Pour relier, expliquer et commenter ces manuscrits, je les avais encadrés de Notes sur la jeunesse de Napoléon que je détache pour former le présent volume. Les Manuscrits constituent désormais un volume séparé, qui, tel quel, fera à quelque édition que ce soit des œuvres de Napoléon une introduction nécessaire. Chacun pourra d’après eux former son jugement et établir sa conviction sans recourir à un travail qui m’est personnel et où mes opinions peuvent sembler discutables. Ces Notes d’ailleurs qui, depuis douze ans, ont été mises à contribution par tous les écrivains qui se sont occupés de la jeunesse de Napoléon, forment la première et l’essentielle assise des études que j’ai consacrées à Napoléon amant, époux, père, fils et frère. C’est ici le point de départ et rien n’est plus important que de le connaître.
Voici dans quelles conditions ces Notes avaient été recueillies et comme, en 1895, je les présentais au public :
Dans le fonds Libri, disais-je, à côté des manuscrits de Napoléon, se trouvent divers autres papiers : d’abord les pièces qu’il avait assemblées en vue d’écrire l’histoire de la Corse – on en trouvera plus loin la liste complète ; – puis, un opuscule, inédit ou présumé tel, de Joseph Bonaparte ; enfin un assez grand nombre de lettres et de documents ayant trait à cette période de la vie de Napoléon.
Sur bien des points, ces papiers contredisaient ou rectifiaient les légendes jusqu’ici admises ; mais, imprimés sans commentaire et sans lien, ils eussent été incompréhensibles pour quiconque n’a point du sujet une connaissance approfondie. Rattachées étroitement aux écrits mêmes de Napoléon qu’elles commentent et expliquent, ces pièces ne devaient-elles point servir à établir, le plus exactement qu’il se peut dans l’état actuel des connaissances, quel a été, pendant ces années, l’itinéraire de Napoléon, quelle son existence, quelles sociétés il a fréquentées, quelles amitiés il a nouées, quelle part il a prise aux évènements ? J’ai donc résolu de me servir de ces documents et de ceux que mes recherches m’avaient procurés, pour préciser par des Notes sur la jeunesse de Napoléon les époques auxquelles se rapportent les manuscrits et les circonstances dans lesquelles ils ont été rédigés. J’ai été amené par la logique à partir ces notes de la naissance même de Napoléon, et à ne les terminer qu’au moment où il paraît devant Toulon. C’est à cette date en effet que commence la publication de la Correspondance ; ce n’est un secret pour personne qu’un historien de talent prépare depuis longtemps sur le siège de Toulon une importante étude. Enfin, et c’est ici la meilleure raison, c’est à cette date que s’arrêtent les documents du fonds Libri ; que se clôt la période de préparation, d’éducation et d’instruction, la seule que j’aie voulu envisager et dont j’aie à rendre compte.
Ces Notes contredisent certaines assertions, démontrent apocryphes un certain nombre de lettres et d’essais qu’on a attribués à Napoléon, rétablissent certains faits mal connus ou mal interprétés. Elles ont un caractère purement documentaire, nullement littéraire. Elles n’abordent aucune polémique : elles n’en soutiennent aucune. Elles affirment des faits ; elles ne contiennent pas d’appréciations. Pour que le lecteur puisse les distinguer à première vue, elles sont numérotées en chiffres arabes, et portent au titre courant, sur le verso, l’indication : Notes sur la Jeunesse de Napoléon, sur le recto le numéro de la note et le sommaire de la page. Les Manuscrits de Napoléon, désignés ainsi au titre et au titre courant, sont numérotés en chiffres romains. Nulle confusion n’est possible entre les deux textes.
De ces Notes, j’indique la source, sauf lorsqu’il s’agit de documents qui m’appartiennent, de manuscrits dont les propriétaires ne veulent pas être nommés ou qui, devant faire l’objet de publications ultérieures, ne sauraient être désignés sans qu’il en résulte un préjudice évident. Je suis prêt d’ailleurs à fournir aux travailleurs consciencieux qui voudront bien s’adresser directement à moi, la preuve que je n’avance rien légèrement.
Pour compléter les indications que j’ai recueillies, j’ai fait appel à tous ceux qui pouvaient posséder des documents inédits. C’était en Corse qu’il fallait nécessairement fouiller d’abord et j’y ai rencontré le plus précieux concours. Des hommes pour qui j’étais un inconnu ont bien voulu, à ce nom de Napoléon, ouvrir pour moi leurs trésors familiaux et m’en offrir les plus précieuses richesses. Cela m’était d’autant plus utile que si, déjà, il est singulièrement difficile de suivre matériellement Napoléon dans ses séjours en France, combien plus de débrouiller l’écheveau des évènements qui se sont produits en Corse il y a cent ans et sur lesquels on ne saurait jusqu’ici attendre des imprimés presque aucune lumière !
Partagés entre leurs deux héros. Paoli et Bonaparte ; obligés par bienséance de louer celui-ci, mais, au dedans d’eux, préférant celui-là, qui est exclusivement Corse, à celui-ci qui est devenu Français ; ne pardonnant pas à Napoléon de n’avoir pas, au profit de la Corse, conquis et exploité la France, les historiens corses, dans la querelle survenue entre Paoli et Napoléon, se gardent de donner raison à l’un ou à l’autre ; ils flottent, atténuent les faits, dissimulent des pièges, se gardent de conclure et surtout de trop parler. Ces rivalités de familles, de villages, de pays en de ça et au-delà des monts, ils n’en rendent pas compte. Bien moins encore des formations de partis et des constitutions d’influence. Les faits les plus graves, s’ils en sont gênés, ils les passent sous silence ; ils prennent avec la chronologie de telles libertés que peu leur importe de retarder ou d’avancer de six mois ou d’un an tel évènement qui n’est pas en la place où ils le veulent. Ceux qui apportent quelque sincérité dans leurs recherches, et ne dissimulent point de parti pris les faits qui peuvent nuire à tel ou tel de leurs compatriotes illustres, abondent en amplifications, en récits légendaires ou romanesques, et manquent à ce point de sens critique qu’ils acceptent sans scrupule les anecdotes les plus contradictoires. Les documents qu’ils fournissent sont rares et l’on n’est jamais certain qu’ils soient exactement reproduits.
J’ai donc dû reprendre cette histoire et m’en instruire, pour en extraire ensuite ce qui touche Napoléon et les membres de la famille qui sont alors les plus mêlés à sa vie. Les imprimés m’ont fourni quelques points de repère, mais ne m’auraient point permis de me faire une conviction, si je n’avais reçu de M. Levie-Ramolino, conseiller à la cour de Bastia, de M. Levie, président du tribunal d’Ajaccio de M. Giubega, conseiller à la cour d’Aix, la communication de documents inédits précieux qui, je crois, m’ont permis d’approcher la vérité de plus près au moins qu’on ne l’avait fait jusqu’ici. Ce n’est certes pas un travail définitif que j’apporte. Ce travail ne pourrait être fait que par un Corse qui, aux documents manuscrits et imprimés, saurait joindre les traditions locales, les traditions de famille, retrouverait des témoignages contemporains, établirait les liaisons des hommes et les causes de ces liaisons, montrerait les ruptures et en donnerait les motifs, porterait, pour expliquer les êtres, ce que Napoléon appelait l’Esprit de la chose ; mais, à défaut de ces qualités qu’un continental ne saurait avoir, j’espère grâce aux pièces qui m’ont été communiquées, avoir établi les époques et fourni le lien essentiel de la vie de Napoléon.
Le lot le plus important est celui qui appartient à M. le conseiller Levie-Ramolino. On verra dans le § I de ce livre comment son grand-oncle, cousin germain de Madame Mère, avait reçu en don de l’Empereur la maison Bonaparte à Ajaccio, telle qu’elle était et se comportait. Or cette maison qui avait été saccagée en 1793, avait été, en l’an VI et l’An VII, reconstruite ou réparée par Mme Bonaparte qui l’avait habitée et y avait rassemblé ce que, au moment du pillage, ses amis avaient pu sauver de meubles et de papiers. À son départ pour la France en l’an VII, elle ne croyait nullement dire à la Corse un adieu définitif et elle laissa sa maison telle qu’elle était. À la donation, les objets qui s’y trouvaient suivirent le sort de l’immeuble. En 1815, au moment de la Terreur blanche, écrit M. Levie-Ramolino, mon grand-oncle, André Ramolino, qui, depuis l’acte de donation et d’échange du 2 germinal an XIII, habitait la maison Bonaparte, redoutant sans doute le sac de ladite maison, avait caché dans les combles sous un grand tas de charbon, tous les papiers provenant des membres de la famille. De 1815 au 29 décembre 1831, a-t-on jamais songé aux papiers ainsi cachés, je l’ignore : ce qu’il y a de certain, c’est que, après le mariage de mon père, célébré à Bastia le 4 juin 1832, ma mère qui jusqu’en 1844, a habité la maison Bonaparte, avant fait déblayer les combles, a trouvé un tas de papiers en grande partie détruits par l’humidité et par les rats, et c’est de ce tas qu’ont été retirés les seuls papiers qui fussent encore en assez bon état, c’est-à-dire les lettres actuellement en ma possession ainsi que celle que possède mon cousin Lucien Biadelli.
Ces lettres éclairent déjà singulièrement les époques inconnues de la vie de Napoléon et montrent son caractère, celui de sa mère et de ses frères, mais il eût fallu les compléter, au moyen du dépôt signalé par M. Blanqui, en 1830, et d’où sont tirées les seules pièces intimes authentiques qu’on connaisse jusqu’ici. Lors du sac de la maison Bonaparte, M. Braccini qui en était le familier et qui avait toute la confiance de Madame, avait mis à l’abri ce qu’il avait pu des papiers : correspondances de famille, travaux de Napoléon, de Joseph et de Lucien, etc. De cet ensemble, M. Blanqui, lors de sa mission en Corse, avait tiré trois lettres de Napoléon et quatre ou cinq fragments sans date et composés d’une ou deux phrases. Tous les autres papiers, évalués à près de cinq cents, étaient – sauf une pièce – demeurés inédits, et c’est de là, sans nul doute, que l’on pourra tirer seulement la vérité tout entière. Grâce aux démarches de mon collaborateur M. Biagi et à l’extrême obligeance de M. Orenga je parvins à retrouver le neveu et l’héritier de M. Braccini, M. Frasseto, qui voulut bien me promettre son secours : mais un examen de la précieuse cassette où les papiers Bonaparte avaient reposé si longtemps lui a prouvé que M. Braccini avait, peu de temps peut-être avant sa mort, disposé des lettres autographes et des documents les plus précieux. Cette source m’a donc presque entièrement échappé. Pourtant, durant le cours de l’impression de ce livre, les recherches auxquelles a bien voulu se livrer M. Frasseto, lui ont permis de retrouver trois pièces d’une importance capitale que l’on trouvera à l’Appendice. À l’Exposition organisée par la société la Sabretache, au profit de l’œuvre de la Société Maternelle, ont figuré deux autres pièces, provenant de la même source et appartenant à S.A.I. le prince Victor Napoléon, qui ajoutent encore quelques renseignements.
Ainsi écrivais-je en 1895. J’aurais pu – peut-être aurais-je dû – compléter ces Notes par les documents qui, depuis leur publication ont été mis au jour. Sur quelques points, elles en auraient été rectifiées, sur d’autres développées. Il m’a convenu pourtant d’en donner encore cette édition tirée sur les empreintes de la première et où pas un mot n’est changé. Ainsi pourra-t-on comprendre pourquoi je me suis plaint qu’on l’eût pillée, démarquée et contrefaite. Ainsi pourra-t-on juger si « le Napoléon inconnu fut un recueil de documents avec préface », comme l’a écrit un certain critique, et s’il ne renfermait de ma part aucun travail personnel. Ainsi pourra-t-on décider si j’eus tort ou non de prendre le parti de ne point citer mes sources, alors que, les ayant prodiguées, je les ai vu détourner sans qu’on prît la peine d’indiquer qui les avait captées d’abord. M. A. Chuquet, mon honorable confrère, ne s’est point mis dans ce cas et je saisis cette occasion de lui rendre hommage. Il y a plaisir à travailler parallèlement à lui et son irréprochable documentation est assez ample pour qu’il aime à reconnaître la part qu’il doit au labeur de ses émules.
Je ne me ferai pas faute dans l’avenir de recourir à son livre, dans la mesure où cette étude le comporte ; j’emploierai de même les quelques documents récemment publiés qui méritent confiance et qui présentent quelque intérêt ; au contraire de certains critiques, je sais lire. Je n’ai point cessé de glaner les pièces inédites qui ont pu sortir des archives privées ou publiques, mais la gerbe est encore bien mince et, sur les séjours de Napoléon en France, sur sa participation à la vie française, je doute fort qu’on puisse apporter des révélations caractéristiques.
Il n’en est pas de même des séjours en Corse et de la participation à la vie corse, mais là une récente expérience m’a appris que, sans le concours de certaines bonnes volontés qu’on est impuissant même à solliciter, puisqu’on ignore si les papiers existent et qui les possède, on ne saurait prétendre à quelque intelligence des évènements. Et je ne saurais guère espérer des coïncidences telles qu’elles se sont présentées pour me permettre de me corriger et d’apporter, dans la neuvième édition du tome premier de Napoléon et sa famille, un récit à peu près exact des rapports des Bonaparte avec la Corse de l’An V à l’An VII.
L’anecdote vaut d’être contée : En rédigeant ce tome Ier, j’avais été amené à indiquer, sur la foi de deux lettres trouvées dans des catalogues d’autographes, que, entre les Bonaparte (Joseph et Lucien) et le Directoire exécutif, une sorte de lutte s’était engagée en germinal an VII ; nul document dans les archives publiques, ne confirmait ni n’expliquait ces deux lettres. Un imprimé que ne possède, à ma connaissance, aucune bibliothèque parisienne et qui ne figure pas dans la bibliographie de la Corse publiée par le prince Roland Bonaparte, m’apporta quelques notions nouvelles. Dans le Compte rendu des opérations du Directoire du département du Liamone, l’on discernait, au milieu des phrases apologétiques, des actes engageant gravement la responsabilité des amis les plus dévoués des Bonapartes ; ce n’était là pourtant qu’un son de cloche. Une suite de hasards heureux, me procura successivement le registre de l’Administration départementale qui avait remplacé, à Ajaccio, celle formée par les Bonaparte, le copie-lettres du colonel commandant la Place d’Ajaccio, des brochures d’une rareté insigne publiées à Ajaccio, à Paris, et à Brignoles, enfin la correspondance entière de Joseph, de Lucien et de Fesch avec le principal de leurs amis du Liamone.
Ce ne fut plus désormais avec des hésitations ou des scrupules que je m’avançai à affirmer la lutte entre Lucien et le Directoire ; j’en avais les preuves, j’en tenais à peu près les causes, j’en suivais les péripéties : je pouvais affirmer. Non pas qu’il n’y eût plus rien à apprendre sur des détails et des à-côtés. Il y a toujours à apprendre : dans les affaires corses, les dessous sont tellement multipliés, les intrigues si nombreuses et si croisées, les fils si ténus et si fragiles que, encore à présent, je ne suis point fixé sur certaines alliances et certaines vendettas que je constate sans les expliquer, et dont, quelque jour peut-être, l’on trouvera la clef. Ainsi, pour ne parler que de l’an VII, les vicissitudes des liaisons entre les Aréna et Lucien ; mais ce n’est là qu’un détail.
À la pierre d’attente que j’avais placée sans grand espoir dans ma construction première, étaient venus se souder des matériaux révélés par le hasard des trouvailles chez les libraires, offerts avec une grâce touchante par des familles, proposés par des amateurs d’autographes ; il en était venu, presque au même moment, sur le même sujet, de cinq côtés différents – et à présent, il en arrive encore !
Ce n’est là pourtant qu’un fragment de l’histoire des Bonaparte en Corse ; que de papiers il faudrait pour éclaircir quelle était la situation réelle, financière, morale, municipale de la famille dans cette minuscule société ajaccienne sur qui l’on n’a que des vues confuses et contradictoires ; par quels moyens, quelles alliances, quelles compromissions elle est parvenue à sortir du commun, à prendre position au milieu des notables, à capter, dans les diverses élections, des suffrages sur qui elle ne paraissait guère pouvoir compter ; pour quelles raisons elle s’est détachée de la faction paoliste pour embrasser la française, toutes choses qui demeureront obscures tant qu’on n’aura pas discerné l’action personnelle de chacun des individus, Fesch et Joseph en première ligne, tant qu’on n’aura pas rejoint cette action à celle des Aréna, des Saliceti, des Pietri, des Pozzo di Borgo, des Chiappe, des Moltedo, des Costa, d’autres personnages chefs de pièves qui semblent avoir joué des rôles importants, de certains isolés, tels que Campi et Sapey, dont partout on trouve la main.
Sans doute, à partir de 1793, Napoléon est comme désintéressé de la Corse ; lorsque la Corse est reconquise, il l’abandonne volontiers à ses frères ; plus tard, il en fait comme une principauté pour Madame-Mère et pour Fesch ; mais les Corses n’en tiennent pas moins une part considérable dans sa vie, n’en agissent pas moins activement sur ses destinées, depuis Saliceti qui certainement n’est point étranger à son brusque avancement à Toulon, et Moltédo qui influe certainement sur la désignation faite de lui pour commander en vendémiaire, jusqu’à Pozzo di Borgo dont la haine le poursuit au milieu de ses victoires, et finit par triompher de sa fortune.
Sur les affaires de Toulon et sur l’arrestation à Nice, sur les pratiques à Gênes et sur la conduite de l’Armée d’Italie, les Corses influent : durant le séjour à l’île d’Elbe, ils prennent une importance majeure, et leur rôle à Sainte-Hélène explique seul bien des choses : sans les liaisons du début, sans les relations de famille et de clan, rien ne saurait se comprendre.
Les faits en eux-mêmes sont à présent presque tous établis ; les causes immédiates sont à peu près débrouillées ; les personnages, pour la plupart, ont fait l’objet de notices succinctes qui fournissent des dates et un résumé de leur carrière officielle ; tout cela est bon, mais ne fait entrer ni dans l’intimité des êtres, ni dans les mobiles réels de leurs actes. C’est là qu’est l’intérêt passionnant de l’histoire, c’est là ce qu’il importe de saisir pour fournir des hommes une image qui ait des chances pour être vraie. Je ne dis point que j’y parviendrai, mais je me fais, peut-être à tort, l’illusion d’espérer que, aux communications très précieuses qui m’avaient été faites jadis et qui m’avaient permis de construire ce volume, à celles qui, récemment, m’ont été gracieusement offertes et dont je profite, d’autres viendront se joindre que je sollicite ici, et grâce auxquelles, dans une prochaine édition, je corrigerai mes fautes et j’ajouterai des notions nouvelles à celles que j’ai recueillies.
F.M.
23 juin 1907.
Napoléon est né à Ajaccio, le 15 août 1769, de Charles-Marie de Bonaparte et de Marie-Letizia Ramolino.
Qu’étaient-ce que les Bonaparte ?
Leur nom patronymique est sans doute Buonaparte, mais on trouve ce nom écrit avec ou sans u, indifféremment précédé ou non de la particule : tel, il est encore un des noms qui, en Corse, changent le moins de physionomie ainsi, dans la plupart, les désinences ne sont point fixes ; on dit Ramolini ou Ramolino, Paravicini ou Paravicino. Ce dernier nom – celui d’une tante de Napoléon – se trouve écrit dans des actes publics de dix façons, au point d’y être entièrement défiguré.
Si Napoléon a préféré Bonaparte à Buonaparte, qu’importe ? Le reproche qu’on lui en ferait serait aussi justifié que celui de ne point avoir fait sonner le final de son nom.
On a longuement discuté sur l’origine des Bonaparte et sur la question de savoir si la famille, établie en Corse au XVIe siècle, était une branche des familles de même nom établies en diverses parties de l’Italie.
Plus que probablement l’origine est commune. Les Bonaparte de Florence portent identiquement les mêmes armoiries que les Bonaparte de Corse : De gueules à trois cotices d’argent accompagnées de deux étoiles à six rates de même. Les Bonaparte de Trévise n’ont point ajouté les étoiles, mais ont gardé : de gueules à deux cotices d’argent. Ce n’est point là une preuve, mais c’est un commencement de preuve. Il est d’ailleurs, sur ce point, un travail fait d’après les sources et qui paraît définitif.
L’auteur a établi sur pièces la généalogie des Bonaparte depuis 923 jusqu’en 1264. Il s’est référé, fort justement, pour la période suivante (1264-1567), à l’excellent mémoire d’Emmanuel Gerini (Memorie storiche della Lunigiana, p. 75 et suiv.) et pour la troisième période aux actes authentiques fournis par Charles Bonaparte au juge d’armes de France.
Ce qui était le plus nécessaire était de déterminer les origines ; car, sur ce point, les romanciers avaient donné carrière à leur imagination et abondaient en légendes. Les uns voulaient que les Bonaparte, descendant des Kalomeroi, se rattachassent aux empereurs d’Orient ; d’autres, prétendaient avoir découvert, à Majorque, que les Bonaparte se nommaient en réalité Bonpart et avaient pour ancêtre le Masque de fer ; un certain comte Vincenzo Ambrogio Gaddi di Aragona écrivait, en 1806, un gros livre pour démontrer qu’ils venaient directement des Césars Romains et se fondait pour le prouver sur le surnom de Parthus ou Parthicus donné à quelque empereur. Point de grande maison romaine à laquelle, selon l’usage italien, on n’eût cherché à rattacher les Bonaparte, le tout sans la moindre preuve. Ici, au contraire, l’on marche constamment d’après des documents d’une authenticité certaine et qui, recueillis par un savant dont la critique était aussi exercée que l’érudition, ne peuvent laisser place à aucun doute.
Le premier document où il soit fait mention de la famille des Cadolingi (ainsi nommée du comte Kadolo, troisième de la descendance) vise Conrad, fils de Tedice, et est en date de la huitième année du règne de Bérenger, c’est-à-dire de l’an 923. C’est un acte par lequel Conrad, fils de Tedice, pour son âme et pour les âmes de sa femme Ermengarde et de son fils, fait don à Dieu et à l’église des Saints Zénon-Ruffin-et-Félix, cathédrale de Pistoie, de son manoir de Vicofaro avec ses dépendances. Il prend en cet acte le titre de comte en la cité de Pistoie. Ce titre était-il héréditaire ou tenait-il à une délégation impériale, on ne sait ; mais, ce qui résulte de la suite des documents, c’est que, dans leurs domaines, mouvant de la cité de Pistoie, et qui, s’étendant dans la vallée de Nievole jusque sous les murs de Lucques, rejoignaient la vallée inférieure de l’Arno et s’avançaient de ce côté jusqu’à cinq milles de Florence, les Cadolingiens ne relevaient que de l’Empereur et non des ducs ou marquis de Toscane.
Ce qui n’est pas moins prouvé, c’est que le titre comtal, s’il fut d’abord concédé viagèrement, devint bientôt héréditaire. Kadolo, fils de Conrad, est qualifié comte, et son existence et celle de ses trois femmes est prouvée par deux actes de donation faits en 953 à l’église de Saint-Zénon, et par l’acte de fondation du monastère du Saint-Sauveur de Fucecchio dit de Borgo Nuovo. Lothaire, fils de Kadolo, fonde à son tour, en 994, le monastère du Saint-Sauveur de Settimo et continue, en 1006 et 1027, à enrichir le monastère de Borgo. On lui connaît deux enfants : une fille, Berthe, abbesse de Cavriglia du val d’Arno, qui a été béatifiée par le pape Benoit XIV et dont les Bénédictins célèbrent l’office chaque année le 24 mai, et un fils, Guillaume, surnommé, on ne sait pourquoi, le Bulgare, qui paraît dans des donations faites à la cathédrale de Lucques et aux deux monastères de Saint-Sauveur en 1034 et 1048. En 1058, 1061 et 1070, comme feudataire de l’Empire, Guillaume le Bulgare est un des grands qui assistent Godefroi de Lorraine, duc et marquis de Toscane, puis Béatrix sa femme dans divers plaids tenus à Saint-Pellegrin et à Florence. En 1068, il est un des témoins du jugement de Dieu entre les moines de Vallombreuse et l’évêque simoniaque de Florence, Pierre de Pavie ; il reçoit du spectacle auquel il a assisté une si vive impression qu’il prend lui-même l’habit et meurt en religion l’an 1073. Le fils de Guillaume Bulgare, Hugues, surnommé le Grand-comte, fonde en 1080 l’hôpital de Rosaio, en 1088 l’église de Saint-Jean-Baptiste de Fucecchio, en 1089, le monastère de Camaldules de Morrona. En 1090, il renonce à tout patronage sur le monastère de Settimo ; il bâtit et dote, en 1096, le monastère de Sainte-Marie de Montepiano, et, la même année, ayant perdu sa femme Cécile, il institue, sur le territoire de la paroisse de Saint-Julien à Settimo, un hôpital pour les pauvres pèlerins qui subsiste avec sa destination jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Des quatre fils du Grand-comte, un Bulgarinus, semble avoir pris part à la première croisade ; deux autres, Ranieri et Lothaire, meurent sans hoirs vers 1099 ; Hugues seul continue la postérité. On trouve de lui, entre les années 1097 et 1112, vingt et un actes de donations. On est en lieu de penser, il est vrai, que ces donations sont fictives et qu’elles ont pour objet de mettre les biens de la famille sous la sauvegarde de l’Église dont les possessions seules en ces temps de guerres civiles étaient généralement respectées. Hugues, qui, comme ses ancêtres, est fort attaché à l’Empire, entraine la ville de Volterra dans le parti des Pisans, Gibelins déclarés. Les Florentins, après avoir ravagé et pillé toutes ses possessions, le poursuivent jusqu’en son château de Montecascioli, son dernier refuge. Après une énergique défense, le château est pris et détruit, et les Florentins réunissent à leurs domaines une grande partie des biens des Cadolingiens.
Hugues ne survit pas à ces évènements qui prennent place en 1113. De ses fils, le cadet, Hugues, est un des chefs de l’armée qui soutient en Toscane le parti de l’Empire et il paraît comme tel dans un acte de 1122, à côté de Frédéric de Souabe, qui sera Frédéric Barberousse. Il est le père du cardinal Guido qui, sous les pontificats de Calixte II, d’Innocent II, de Lucius II, d’Eugène III, joue dans l’Église romaine un rôle prépondérant et est l’un des conseillers du Saint-Siège qui contribuent le plus au maintien de l’unité catholique.
Le fils aîné du vaincu de Montecascioli, le comte Guido, pour conserver le peu qui lui reste de ses biens, a été contraint, en 1141, de jurer fidélité à l’archevêque de Pise et à la commune et de se mettre sous leur protection. C’est la déchéance de la famille, l’abandon par elle de cette Immédiateté de l’Empire qui la faisait quasi souveraine. À titre de vassal des Pisans, Guido est compris dans le traité de paix conclu entre Lucques et Pise, sous la médiation de Welf, marquis de Toscane ; il meurt, bientôt après, laissant deux fils, Hugues et Ardouin. Hugues est un des chefs des Pisans dans leur guerre contre les Génois et les Lucquois réunis et contribue à la victoire de Motrone ; mais, après la défaite de Frédéric Barberousse à Legnano, le parti gibelin est abattu pour longtemps. En 1198, les cités de Toscane forment ensemble une grande ligue qui achève les dernières résistances des comtes ruraux et des vassaux de l’Empire. À mesure qu’ils les ont désarmés, les Florentins obligent leurs adversaires à venir s’établir dans leur ville où une surveillance étroite maintient sans crédit et sans influence les seigneurs dépossédés. C’est ainsi que Janfaldo, fils de Hugues, habite en 1235 la paroisse de San Niccolò de Florence. Il y fait encore une donation à l’Église, mais, dans cet acte qui montre combien à présent est restreinte sa fortune, s’il ne garde plus le titre de comte – car il n’en a plus ni l’autorité ni les privilèges – il revendique le souvenir de ses ancêtres et tient à constater sa filiation et sa race.
Janfaldo a un fils : Guillaume. Celui-ci, fidèle aux opinions que les siens ont toujours professées, opinions que consacrent en quelque sorte le surnom qu’il prend ou qu’on lui donne, le surnom de BUONAPARTE, n’hésite pas, en janvier 1261, lorsque les Gibelins ont un moment l’avantage à Florence, à entrer dans le conseil insurrectionnel de la commune. Avec ce conseil, il expulse les Guelfes, il ratifie la ligue conclue avec les Gibelins de Sienne ; mais, bientôt, les Guelfes retrouvent leurs succès accoutumés. Sans attendre l’exil qui le menace, Guillaume Bonaparte émigré à Sarzane. C’est un contumace que vise en 1268 le décret de la République par lequel Guillaume Bonaparte et ses fils sont déclarés rebelles et exclus à jamais du territoire florentin.
Que fut la vie des Bonaparte à Sarzane durant sept générations ? Une petite ville, un grand village, mais avec les goûts d’art et de culture, les instincts d’indépendance et de gouvernement, les rêves d’ambition, les intrigues populaires qui, en toute agglomération d’hommes qui se fait alors en Italie, germent du sol, et rendent profondément instructives les luttes entre quelques citoyens d’un bourg, pour des intérêts que le plus souvent on ignore ; tant l’habileté est grande chez les deux partis, tant leur ingéniosité est efficace, tant ils sont féconds en ressources, tant ils courent de belles aventures, tant les hommes abondent, avec des destinées inférieures à leur génie qu’ils emploient tout entier pourtant sur ces minuscules théâtres. Et, tour à tour, selon les besoins, ces citoyens administrent leur cité, se chargent d’ambassades qu’ils mènent en diplomates avisés près des républiques rivales, des empereurs ou des ducs, se coiffent de l’armet de guerre, ceignent l’épée et se ruent aux batailles, égaux sans cesse à leur fortune et, comme de naissance, aptes à tout entreprendre et à tout mener à fin. Pour savoir la politique, c’est à ces maîtres qu’il faut s’adresser et, pour le métier de la guerre, ils ont des habiletés, des ruses et des expédients qui les rendent incomparables.
À Sarzane, les Bonaparte comme les autres citoyens d’importance ont été membres du conseil ou syndics de la commune, prieurs et capitaines des Anciens, gouverneurs des forteresses qui relevaient de leur ville, ambassadeurs, tantôt près la république de Lucques, tantôt près des Visconti, ou même près des Empereurs ; ils ont fait la guerre et la paix et ont été mêlés à toute la vie civile, politique, religieuse, militaire de leur nouvelle patrie. Mais l’horizon y était borné et l’argent manquait. Dans la première moitié du XVIe siècle. François, septième descendant de Guillaume, passe en Corse et s’y établit.
Ses descendants prennent bientôt leur part à l’administration de la ville près de laquelle ils ont leurs biens. À chaque génération, on les voit siéger dans le conseil des Anciens et commander la milice, s’allier aux familles les plus distinguées et mener là une existence presque semblable à celle qu’ils ont eue à Sarzane. Toutefois, les intérêts sont moindres ; il y a encore cette continuelle, alerte qui tient les cerveaux éveillés et les corps dispos, mais on ne se frotte point à d’autres peuples et les querelles, pour être aussi vives, pour exiger autant de diplomatie et de courage, ne regardent plus des objets qu’on peut dire historiques : le nom de Florence et de Lucques, les mots d’empereur et de prince ne sonnent plus dans les ambassades à remplir. Bien qu’ils aient leur demeure à Ajaccio, c’est dans deux cantons assez éloignés de cette ville qu’ils ont leurs possessions, exercent leur patronage, acquièrent peu à peu, non ces droits féodaux qui, du serf, font le plus souvent, en France, l’ennemi du seigneur, mais cette autorité patriarcale qu’on retrouve presque semblable en Écosse où les chefs de clans ont de singuliers traits d’analogie avec les chefs de pièves. Bocognano est à six lieues et demie d’Ajaccio ; Bastelica presque à pareille distance. C’est à Ajaccio que les Bonaparte ont leur résidence, mais c’est à Bocognano et à Bastelica qu’ils ont leurs partisans.
C’est avec les gens de Bocognano et de Bastelica que marche Charles Bonaparte lorsqu’il prend part à la lutte pour l’indépendance. C’est à Bocognano et à Bastelica que Napoléon recrute pour son bataillon de volontaires ses meilleurs soldats et que, aux jours des proscriptions, il trouve des amis assez dévoués pour protéger sa vie au péril de la leur.
Autant qu’il est permis d’en juger, la fortune des Bonaparte est médiocre et a plutôt diminué qu’augmenté à chaque génération. Ils ne font point le commerce, ont quelques terres, des troupeaux, des vignes, une maison de ville, une habitation de campagne, vivent tant bien que mal des produits de leurs biens, mais vivent noblement – c’est-à-dire sans rien faire – et chichement.
Parfois, quelque prébende qu’obtient un cadet à la cathédrale d’Ajaccio vient aider un peu la famille, mais c’est là tout. Point d’esprit d’aventure, point d’idée d’aller se refaire sur le Continent. On vit là où l’on est né, content, semble-t-il, d’une existence modeste que remplissent les charges municipales et les soucis du lendemain. Mais, en Charles Bonaparte, le dixième descendant de François l’émigré de Sarzane, l’ambition apparaît et se fait jour.
Charles Bonaparte est né à Ajaccio le 27 mars 1746. Resté orphelin à quatorze ans, il se trouve sous la tutelle de son oncle Lucien, archidiacre de la cathédrale, homme de volonté et d’intelligence qui semble s’être donné pour tâche de relever la famille. Est-ce l’archidiacre qui, dès 1759, en vue de quelque succession future, a rétabli le lien avec les Bonaparte de Toscane et a obtenu d’eux, le 28 juin, une reconnaissance authentique de consanguinité, d’autant plus utile que, cette branche jouissant du patriciat en vertu de lettres récognitives délivrées par le grand-duc de Toscane le 28 mai 1757, les Bonaparte de Corse se trouvent par là même agrégés à la plus haute noblesse ? En tout cas, tout de suite après la mort de Joseph (le père de Charles, élu en 1760 ancien de la ville et décédé cette même année), c’est l’archidiacre qui prend résolument la direction de la fortune et de la famille. C’est lui, semble-t-il, qui engage le procès avec les Jésuites au sujet de l’héritage Odone, accaparé par eux quoiqu’une substitution perpétuelle l’assure aux Bonaparte au défaut des diverses branches mâles des Odone. C’est lui enfin, qui, vraisemblablement, envoie Charles à Corte pour y suivre les cours de cette Université que Paoli vient d’improviser et où des professeurs corses enseignent quantité de choses – hormis la médecine et la chirurgie qu’on pourrait tenir pour les plus nécessaires, mais, ne s’étant point trouvé de médecin ou de chirurgien corse, on se passe de ces sciences plutôt que de les faire enseigner par un continental. Par contre, on y a le choix entre la théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canon et le droit civil, la philosophie, les mathématiques, les humanités, la rhétorique et la procédure. Charles prend le droit – les deux droits, Utrumque jus, comme on disait.
Étant d’Ajaccio, d’une des villes maritimes dont Paoli ambitionne la conquête et dont, dès à présent, par toutes sortes de moyens il cherche à s’attirer les sympathies, il est tout naturel qu’il soit présenté au général. Il rédige en son honneur quelques vers singulièrement flatteurs : car il a la muse facile à la louange, et il est reçu au nombre des secrétaires du gouvernement. Dans un voyage qu’il fait à Ajaccio cette même année, il s’éprend de Mme Letizia Ramolino, nièce d’un chanoine de la cathédrale ami de son oncle. Outre qu’il aime cette jeune fille, belle alors à miracle, elle est un beau parti et d’une famille égale à la sienne.
La famille Ramolino, qu’on a dite bourgeoise et de petite origine, se rattache authentiquement et sans interruption à une des maisons les plus illustres d’Italie : celle des comtes de Collalto qui ont eu une domination quasi-souveraine en Lombardie avant le XVIe siècle. À la fin du XVe, le magnifique seigneur Gabriel Ramolino, gentilhomme florentin, fils du magnifique seigneur Abraham Ramolino, comte de Collalto, grand chevalier de l’ordre de Saint-Jean, est major aux gardes de Charles V, roi de Naples. Par son mariage avec Clori Centurione, fille du sénateur Fabrice Centurione, il acquiert à Gênes de puissants protecteurs et, le 2 février 1490, il obtient du doge, des gouverneurs et procurateurs de la Sérénissime République d’importantes concessions de terres à Ajaccio où il vient s’établir. Il n’a qu’un fils, Nicolas Ramolino, qualifié, en 1524, illustre colonel au service de la République, et dont les descendants occupent les plus hautes dignités dans leur ville adoptive. Morgante, fils de Nicolas, est délégué le 8 juillet 1542 au sénat de Gênes comme orateur par le conseil des Anciens d’Ajaccio ; Gio Girolino, fils aîné de Morgante, est magnifique colonel et, le 8 mars 1622, est élu capitano della citta ; son petit-fils, du même nom, est admis au conseil des Anciens par ordre de la Sérénissime République, malgré qu’il n’ait pas vingt-cinq ans accomplis. Il a trois fils : l’aîné meurt sans hoirs, le troisième est abbé. Du second, Jean-Augustin, lieutenant dans la compagnie corse du capitaine Rocca, et époux de Marie-Thérèse Ricci, proviennent quatre fils : Jean-Jérôme, marié à Angela-Maria Pietra-Santa ; dom François-Marie, prêtre, curé archiprêtre d’Ajaccio ; Bernardin qui, s’étant marié à Angela-Maria Ornano, est père d’André Ramolino ; et Paduo-Antonio, époux de Maria Pretronille, d’où Angela-Maria, mariée à M. Lévie, dont les descendant sont été autorisés à relever le nom de Ramolino.
C’est de l’aîné des fils de Jean-Augustin, de Jean-Jérôme, qu’est née à Ajaccio le 24 août 1750 Maria Letizia Ramolino. Sa mère, née Pietra-Santa, d’une famille noble originaire de Sartène, étant devenue veuve en 1755, se remaria en 1757 à François Fesch, capitaine dans la marine génoise, originaire de Bâle, qui, pour l’épouser, se lit catholique. Elle eut de son second mari, le 3 janvier 1763, un fils unique, Joseph Fesch, qui joua un rôle important dans la vie de Napoléon.
Ce second mariage de Mme Ramolino ne doit point étonner. Son premier mari avait aussi servi les Génois. Il avait été nommé par la Sérénissime République commandant des troupes à Ajaccio, puis, en 1750, inspecteur général des ponts et chaussées de l’île de Corse. Il avait dans ces emplois amassé une certaine fortune dont sa fille avait hérité.
Letizia Ramolino a quatorze ans au moment de son mariage ; son mari en a dix-huit. Le jeune ménage a un premier enfant, un fils, en 1765 ; une fille en 1767, tous deux morts en bas âge. Charles qui, dit-on, fait en 1766 un voyage à Rome, réside le plus ordinairement à Corte où, en dehors de ses fonctions auprès de Paoli, il est un des membres influents de la Consulte nationale. Sa femme qui l’y a accompagné, accouche le 7 janvier 1768 d’un fils : Joseph. À la suite du traité du 15 mai 1768 par lequel la république de Gênes cède à la France le royaume de Corse, la lutte s’engage entre les Français, déjà maîtres des villes maritimes, et les Corses. Charles y prend part et, durant cette campagne des plus vives, a plusieurs occasions de se signaler. C’est ainsi qu’on le trouve à l’affaire de Borgo, le 7 octobre 1768 servait d’aide de camp à Paoli. Ce combat de Borgo est une victoire pour les Corses qui tuent aux Français 1 600 hommes, leur font 700 prisonniers dont un colonel, leur blessent 600 hommes dont le comte de Marbeuf, commandant en second du corps expéditionnaire, et plusieurs officiers de distinction.
La campagne de 1768 se termine tout à leur avantage ; mais, dès le commencement de l’année suivante, aux renforts considérables qu’a reçus l’armée française, au système de guerre qu’a adopté le nouveau commandant en chef, le comte de Vaux, il est facile de voir que la soumission de la Corse n’est plus qu’une question de jours : le 9 mai, le combat de Ponte Novo porte un coup suprême à l’indépendance, moins par le nombre des miliciens qui y périssent que par les soupçons qu’éveillent les trahisons et par le découragement qu’inspire l’impéritie des chefs. Renonçant à la lutte, Paoli songe déjà à s’embarquer pour le continent ; il réalise ce projet le 13 juin, et emmène avec lui, sur deux navires anglais, trois cent quarante des patriotes les plus compromis.
Fuyant devant l’invasion française, les débris de l’armée corse battus à Ponte Novo, les membres du gouvernement, les femmes, les enfants, se sont réfugiés dans les solitudes du Monte-Rotondo.
Mme Bonaparte enceinte de son cinquième enfant est du nombre des fugitives. Déjà l’armée française est à Corte et nulle résistance n’est organisée. Le comte de Vaux, dit-on, prend l’initiative d’envoyer des parlementaires aux réfugiés qui députent à leur tour près de lui Charles Bonaparte et Nicolas-Louis Paravicini d’Ajaccio, Laurent et Damien Giubega de Calvi, Dominique Arrighi de Speloncato, J. Th. Arrighi et J. Th. Boerio de Corte et Thomas Cervoni de Soveria. Le gênerai en chef les reçoit au mieux, leur annonce le départ de Paoli, la soumission de l’île entière, loue leur courage et leur fidélité, leur promet la protection du Roi. Laurent Giubega répond au nom de tous avec une dignité singulière, et cet échange de paroles est pour inspirer aux vainqueurs du respect pour les vaincus, aux vaincus de la confiance en leurs vainqueurs.
Le comte de Vaux délivre à tous les réfugiés de Monte-Rotondo des passeports et des sauvegardes pour retourner dans leurs foyers. Charles, avec sa femme et ses enfants, revient à Ajaccio où, le 15 août 1769, Letizia met au monde son fils : Napoléon.
Cette date de la naissance de Napoléon a été contestée. On a dit que, dans un but de lucre, Charles Bonaparte aurait donné comme cadet celui de ses enfants qui était réellement l’aîné, et réciproquement. Il convient donc de rechercher, d’abord, quelle était la conviction de Napoléon lui-même au sujet de l’époque de sa naissance ; puis, quelles raisons on allègue au sujet d’une substitution d’actes de naissance.
Dans un document qu’il intitule Époques de ma vie et où il a réuni les dates qu’il lui importait le plus de se remémorer, Napoléon a tracé son itinéraire de 1769 à 1799 et fournit ainsi la base même de toute étude sérieuse sur cette période de son existence. Voici ce document :
ÉPOQUES DE MA VIE
Né en 1769 le 15 du mois d’août.
Parti pour la France le 15 décembre 1778.
Arrivé à Autun le 1er janvier 1779.
Parti pour Brienne le 12 mai 1779.
Parti pour l’École de Paris le 30 octobre 1784.
Parti pour le régiment de La Fère en qualité de lieutenant en second le 30 octobre 1785.
Parti de Valence pour semestre à Ajaccio 1786, 1er septembre.
Je suis donc arrivé dans ma patrie 7 ans 9 mois après mon départ, âgé de 17 ans 1 mois. J’ai été officier à l’âge de 16 ans 15 jours.
Arrivé le 15 septembre 1786, j’en suis parti le 12 septembre 1787 pour Paris d’où je suis reparti pour Corse, où je suis arrivé le 1er janvier 1788, d’où je suis parti le 1erjuin pour Auxonne.
Ainsi, par trois fois, Napoléon affirme qu’il est né le 15 août 1769. Il l’écrit d’abord en toutes lettres. Puis, il fait le calcul de l’âge qu’il avait lorsqu’il est revenu dans sa patrie : 17 ans 1 mois ; enfin, il dit son âge lorsqu’il a été nommé officier. Ici, un lecteur superficiel pourrait croire à une contradiction : Napoléon écrit : Parti pour le régiment de La Fère en qualité de lieutenant en second, le 30 octobre 1785 et plus bas : J’ai été officier à l’âge de 16 ans 15 jours. S’il avait été officier seulement le 30 octobre 1785, il aurait eu à ce moment seize ans deux mois et quinze jours et non seize ans et quinze jours ; mais, en fait, c’est le 1er septembre 1785 que, comme ses camarades, les cadets gentilshommes, il a été promu au grade, en attendant que deux mois après, il eût l’emploi de lieutenant en second à la compagnie des bombardiers d’Autun du régiment de La Fère du Corps royal de l’artillerie. Cette apparente contradiction est au contraire, une preuve auxiliaire de la véracité de Napoléon.
Il avait donc l’intime certitude qu’il était né le 15 août 1769. Autrement, il ne l’eût point affirmé par trois fois, en une pièce tout intime, toute personnelle, qu’il n’avait écrite que pour lui seul et qui après un siècle a été découverte dans un carton oublié. Voilà pour ce qui touche Napoléon.
Pour ce qui concerne l’acte qu’on attribue à son père, la démonstration sera plus facile encore. Voici le fait brutal.
On a affirmé, récemment encore, et l’on a prétendu prouver que Napoléon était né à Corte le 7 janvier 1768, que c’était son frère Joseph qui était né à Ajaccio le 15 août 1769 et que, pour permettre à Napoléon d’entrer, après l’âge requis, à l’école de Brienne, son père avait substitué le certificat de baptême du cadet au certificat de baptême de l’aîné. On se fonde pour le démontrer sur une série de dates inexactes fournies, soit par Joseph, soit par Napoléon lui-même lors de leurs mariages réciproques.
Pour admettre cette théorie, il faudrait que cette substitution eût été opérée dans la prime enfance des deux frères, avant qu’ils eussent conscience de leur âge, puisque Napoléon, ses frères et sœurs cadets ont toujours envisagé Joseph comme l’aîné de la famille ; puisque Joseph s’est toujours considéré comme tel et qu’il a très hautement et très formellement réclamé ses droits d’aînesse, puisque Napoléon a toujours regardé comme certaine la date de sa naissance et qu’il l’a ainsi constaté dans des notes aussi intimes. Qu’on eût ainsi interverti les dates de naissance au moment, où les enfants partaient pour le collège d’Autun, il n’est guère possible de l’admettre ; on n’eût point confié aux deux enfants un tel secret sans que, à un moment, ils le laissassent échapper et on vient de voir qu’ils n’en ont jamais eu le moindre soupçon. Donc, c’est presque à l’époque de leur naissance qu’il faut remonter, tout au moins à l’époque de leur entière inconscience.
Mais, dans quel but alors cette substitution ?
Jadis on disait : c’était pour que Napoléon put dire qu’il était né Français et pût participer aux avantages que lui donnait l’indigénat. Mais ces avantages étaient accordés à tous ceux qui, la conquête de la Corse accomplie, la soumission opérée, se trouvaient en âge et en droit d’en profiter. Les exemples et les preuves abondent. Il a donc fallu changer de système. On a dit : Le père de Napoléon a fait une série de faux pour rajeunir son fils Napoléon, vu que Napoléon avait dépassé l’âge d’entrée à l’École militaire et qu’il s’agissait de tromper le ministre de la Guerre. C’est bien là l’accusation telle qu’elle a été formulée. Or, dès 1778, le ministre de la Guerre était informé que l’intention de Charles Bonaparte était de faire entrer son fils aîné dans les ordres, et son cadet dans le service. « On a tenu note, écrivait-il, que le plus jeune des enfants de M. Buonaparte qui sont inscrits soit agréé de préférence pour les écoles militaires, l’aîné paraissant se destiner à l’état ecclésiastique » Donc, le ministre eût donné la place indifféremment à Joseph ou à Napoléon. Donc, il n’y avait nul besoin de le tromper, nulle utilité de faire des faux et nulle nécessité de s’en servir.
La question qui paraissait vidée depuis trente ans ayant été soulevée de nouveau, il a bien fallu discuter. Peut-être est-elle enterrée pour quelque temps.
Il est inutile de chercher à Ajaccio la maison et la chambre où naquit Napoléon. Nul ne doit ignorer que la maison Bonaparte a été saccagée et, dit-on, bridée, par les Paolistes en 1793, qu’elle a été reconstruite à la fin de l’an V et au commencement de l’an VI, que Napoléon n’a pu venir dans la maison nouvelle qu’une seule fois, à son retour d’Égypte lorsqu’il a relâché à Ajaccio, du 10 au 14 vendémiaire an VIII, et que, le 2 germinal an XIII, il a fait donation de cette maison qui ne pouvait lui rappeler aucun souvenir au cousin de sa mère, M. André Ramolino. Il a par le même acte donné audit M. Ramolino trois autres petites maisons dites : maison Badine, maison Gentile et maison Pietra-Santa à la condition que, par la démolition de la maison Pietra-Santa et de partie de la maison Gentile, une place fut établie devant la maison Bonaparte et pavée aux frais du donataire.
La maison à l’extérieur et à l’intérieur, les décorations, l’aspect même des lieux, tout est modifié profondément. Rien ne subsiste qui soit contemporain de la naissance de Napoléon.
21 juillet 177l
Presque aussitôt après la naissance de son fils Napoléon, Charles Bonaparte dut partir pour Pise où il avait dessein de se présenter au doctorat en droit. On peut présumer qu’il avait complété à Ajaccio ses études commencées à Corte. En tout cas il ne suivit point les cours de l’Université de Pise. On ne trouve nulle part son nom dans les livres des rassegne, certificats de fréquentation que tout élève régnicole était tenu de tirer de ses professeurs ; mais les étrangers n’étaient point obligés, obtenir le titre de docteur, à une telle assiduité : il suffisait qu’ils se présentassent au Chancelier et qu’ils obtinssent de lui la permission de soutenir leur thèse. Le 27 novembre, Charles Bonaparte (il Signor Carlo del fu Sr Buona-parte di Ajaccio in Corsica) se présente au chancelier Mazzuoli et lui demande son agrément : le 30 novembre, il soutient sa thèse, ayant pour président le docteur Antonio Vannucchi. Il est à remarquer qu’il est ainsi désigné sur le Libro di Dottorati : IL SIG. CARLO DEL Qm SIGNOR GIUSEPPE BONAPARTE, NOB. PATRIZIO FIORENTINO, SAMMINIATENSE, E DI AJACCIO. Sa noblesse, son patriciat florentin, son alliance avec les Bonaparte de San Miniato se trouvent donc ainsi constatés.
On est en droit de supposer qu’un parent que Charles avait à l’Université, le docteur Jean-Baptiste Bonaparte, professeur de médecine, ne lui fut point inutile en cette occasion, et que ce fut vraisemblablement grâce à lui qu’il obtint, ce même jour 30 novembre, de l’archevêque de Pise l’exercice du titre de noble et de patrice.
On peut penser que le séjour de Charles en Toscane se prolongea quelque peu et qu’il eut à cœur de renouer personnellement des relations avec ses parents de San Miniato. De retour en Corse, il eut à solliciter pour ses affaires et à rechercher ses titres. Ce ne fut que le 21 juillet 1771, que Napoléon fut baptisé dans la cathédrale d’Ajaccio par son grand-oncle, l’archidiacre Lucien Bonaparte assisté de l’économe de l’église Batista Diamante. Il fut baptisé le même jour que sa sœur Maria-Anna (la seconde qui ait reçu ce prénom), née le 14 juillet 1771 et morte en 1776. Ils eurent tous deux le même parrain, Lorenzo Giubega de Calvi, procureur du roi.
Les rapports des Giubega avec les Bonaparte étaient anciens et intimes, bien qu’il n’existât point entre les deux familles d’alliance ni de parenté. Durant la guerre de l’Indépendance, Charles Bonaparte et Laurent Giubega avaient été les fidèles lieutenants de Paoli. Ensemble, ils avaient traité de la soumission de leur patrie au roi de France et l’avaient fait avec une fierté qui n’était point pour donner aux vainqueurs une médiocre idée de leur caractère. Aussi, dès que la Consulte fut rétablie, Giubega et Bonaparte y jouèrent un rôle considérable.
En 1770, Giubega est l’un des trois députés près du Roi, et, depuis cette époque jusqu’en 1789, il occupe successivement l’emploi de procureur du roi à la Porta d’Ampugnani et à Ajaccio, puis celui bien plus considérable, de greffier en chef des États de Corse auquel il est nommé par commission du 6 février 1771. En 1789, il préside l’Assemblée de la noblesse et est élu suppléant du comte Buttafoco.
Charles Bonaparte et Lorenzo Giubega « son compère » avaient marché d’accord toute leur vie, s’entendaient sur toutes les affaires qu’ils avaient à traiter aux États, et luttaient de leur mieux contre les exactions et la tyrannie de l’administration française.
Aussi, après la mort de Charles, ses fils ne manquèrent pas de faire de Giubega le confident de leurs tentatives patriotiques. On ne peut douter que Napoléon n’ait reçu de lui des documents pour l’histoire de la Corse qu’il s’était donné mission de composer. Lorsque, à Pise, en 1787, Joseph écrit les Lettres de Pascal Paoli à ses compatriotes, il adresse son ouvrage à Giubega « ami de son père, parrain de Napoléon, généralement respecté pour ses connaissances, son patriotisme et son éloquence ». Enfin, Napoléon lui-même envoie à Lorenzo Giubega l’ouvrage inédit qu’on trouvera plus loin.
Sans doute pour les affaires de Corse, Giubega fit un voyage à Paris vers le milieu de 1792. Il assista aux massacres de septembre qui l’émurent profondément et revint dans son pays mortellement frappé. Néanmoins, il eut encore le temps de donner asile à Calvi, à la famille Bonaparte chassée d’Ajaccio par les partisans des Anglais. Il mourut peu de temps après, le 23 septembre 1793, ne laissant qu’une fille, Annette Giubega, pour qui il avait été question d’un mariage avec Joseph et qui fut estropiée par un éclat de bombe pendant le siège héroïque que la ville de Calvi soutint contre les Anglais et où se distingua d’une façon particulière son cousin François-Xavier Giubega, commandant la Garde Nationale.
Napoléon ne pouvait manquer de se souvenir de ces anciens amis. Dès 1800, il appela un Giubega (Vincent, frère de François-Xavier), aux fonctions de juge au tribunal d’appel d’Ajaccio. Quant à François-Xavier qu’il avait emmené avec lui en Italie, d’abord comme chef de bataillon, puis comme commissaire des Guerres, il le fit d’abord sous-préfet de Calvi, puis, en 1813, préfet de la Corse.
M. Giubega joua en 1814 et en 1815, car pendant les Cent-jours il reprit sa place, un rôle des plus honorables et épuisa sa fortune à lever et à solder une petite armée pour tenir tête aux Anglais. Au retour des Bourbons, il fut proscrit et sans d’heureux hasards il eût payé de sa vie son dévouement à la France.
La marraine de Napoléon, Gertrude Paravisino (ou Paravicini, ou Paravisini) était en son nom une Bonaparte. Elle était la propre sœur de Charles Bonaparte, et la tante de Napoléon. Elle avait comme adopté les enfants de son frère, était pour eux une seconde mère, montait à cheval avec Joseph, parcourait avec lui le faubourg et la campagne, l’initiait à la culture des terres.
Fille d’une Paravisino (Maria-Saveria, mariée à Joseph Bonaparte), elle avait épousé son cousin, Nicolo Paravisino et mourut probablement vers 1788. Napoléon n’oubliait pas de la mentionner dans les lettres : « Présentez mes respects à Zia Gertrude », écrit-il à son père en septembre 1784 ; « Présentez mes respects à Zia Gertrude », écrit-il à sa mère le 29 mars 1785. Les enfants de Charles héritèrent d’elle, mais les biens qui vinrent de sa succession furent réservés aux garçons et les filles y renoncèrent chacune au moment de son mariage.
La mort de Zia Gertrude n’interrompit pas les rapports de Napoléon avec les Paravicini. Le 2 germinal an XIII, l’Empereur ayant acheté du cardinal Fesch diverses terres sises en Corse, fit don à M. Nicolas Paravicini (Paravisino) : I° des terres situées au-delà de la rivière del Campo dell’Oro, faisant partie du domaine de la Confine ; 2° des portions de l’enclos de la Torre Vecchia, à côté de la Confine, à la charge par M. Paravicini de faire bâtir à ses frais un pavillon de la valeur de 20 000 francs sur l’élévation formée par de grosses pierres dans la portion de jardin qu’avait sa première épouse au-delà du couvent de Saint-François près Ajaccio. Nicolo Paravicini s’était marié en secondes noces à Marie-Rose Pô, et mourut le 2 mai 1813, laissant une fille, Maria-Antonia. L’Empereur à Sainte-Hélène se souvint de cette enfant. « J’ai, dit-il, dans le vingt-neuvième paragraphe des Instructions à mes exécuteurs testamentaires, j’ai une petite cousine à Ajaccio qui a, je crois, 300 000 francs en terres et s’appelle Pallavicini ; si elle n’était pas mariée et qu’elle convînt à Drouot, sa mère sachant que cela était mon désir, la lui donnerait sans difficulté. » Elle avait épousé depuis le 9 octobre 1817, Jean-André-Tiburce Sebastiani, alors colonel en demi-solde, plus tard lieutenant-général et pair de France. Elle est morte seulement en 1890.
Dans la maison d’Ajaccio, une seule servante. On imaginait que, dès la prime enfance de Napoléon, cette servante était une nommée Saveria. Ce ne fut qu’après 1788 que Saveria entra dans la maison. Elle resta toujours depuis au service de Mme Letizia, l’accompagna à Paris, où elle surveillait tout et donnait à la maison princière cet air parcimonieux que Napoléon reprochait à sa mère, la suivit à l’île d’Elbe, à Rome, partout.
Madame, après avoir essayé de nourrir son fils, avait dû y renoncer et gager une nourrice. Ce fut une nommée Camilla Carbone, femme d’un certain Augustin Ilari qui faisait le cabotage sur les côtes. Cette femme prit pour son nourrisson une sorte de culte. Elle ne souffrait pas qu’on le touchât, encore moins qu’on le grondât. Elle le préférait à son propre fils, Ignatio, qui embrassa le parti des Anglais, entra dans leur marine et quoique fort ignorant, était si bon marin et si brave soldat qu’il parvint à commander une flûte. Le frère de lait de Napoléon ne lui demanda jamais aucune faveur, pas même d’entrer au service de France.
Ce lien entre nourrice et nourrisson, si fort jadis, à présent si relâché, Napoléon ne le brisa jamais. À son retour d’Égypte, quand il débarque à Ajaccio, c’est Camilla Ilari qui le voit et l’embrasse d’abord. En lui remettant une bouteille de lait, elle lui dit : « Mon fils, je vous ai donné le lait de mon cœur, je n’ai plus à vous offrir que celui de ma chèvre. » Et le général, l’embrassant de nouveau, la remercie avec effusion de son humble présent.





























