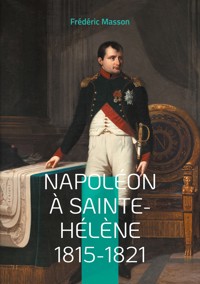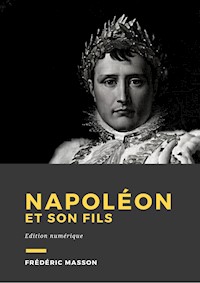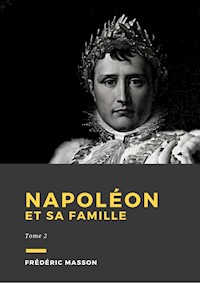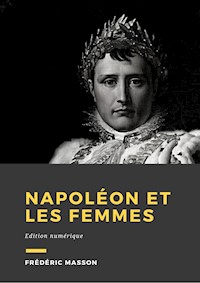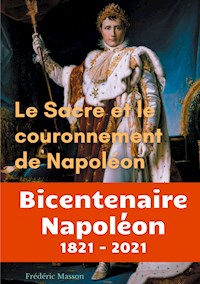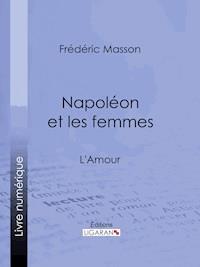2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’époque de la naissance du Roi de Rome à laquelle je suis parvenu dans Napoléon et sa famille m’a montré chez l’Empereur une transformation de sentiments dont il importait essentiellement de déterminer la cause et de suivre les effets. On ne pouvait penser qu’il s’agît d’une coïncidence fortuite ou d’une déviation passagère. La permanence du courant résulte d’une suite d’indications positives. La venue du Roi de Rome est bien la déterminante d’une série d’idées qui exercent sur la politique une action essentielle. Dès lors, cette action a dû être étudiée isolément, avec des procédés d’investigation minutieuse, car, faute de cet examen préalable, il serait impossible d’exposer, sous leur jour véritable, quels ont été les rapports de l’Empereur avec sa famille, de 1810 à 1821.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
FRÉDÉRIC MASSON
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
NAPOLEON
ET
SON FILS
© 2020 Librorium Editions
First Published in 1904
INTRODUCTION
Ce n’est point ici l’histoire du fils de Napoléon. Dans l’état présent des connaissances, je crois impossible d’écrire sérieusement une telle histoire. Que serait-elle sinon l’étude d’une âme, le récit des fluctuations de la pensée, des rêves avortés, des espérances détruites ? Nul acte qu’on rencontre, même nulle tentative d’action. Le drame se joue tout entier dans un cerveau et, de ce cerveau, qui a le secret ? On peut noircir des pages à côté, raconter ce que d’autres ont pensé à propos de cet enfant, ce que des partis auraient prétendu en faire, mais de lui-même, que sait-on et que saura-t-on jamais ? Grâce à la récente publication du Dr Wertheimer, on a quelques lumières sur l’éducation que l’empereur François lui imposa, mais, des résultats que produisit une telle éducation, on reste aussi mal instruit. D’ailleurs, même eût-on en mains le texte complet des journaux tenus par les gouverneurs et les précepteurs ; même y joignît-on la correspondance intégrale échangée entre l’Enfant, sa mère, ses parents autrichiens et les divers personnages des cours parmesane et viennoise ; même recueilît-on sur ses dernières années des témoignages plus probants et moins suspects que ceux de Montbel et de Prokesch ; parviendrait-on à démêler avec certitude le fond du caractère ? En présence des inimitiés qui l’entourent, l’Enfant s’est fait une habitude si forte de la concentration et du secret qu’il n’a pu manquer de taire les expressions spontanées de sa pensée véritable.
Aucune étude indépendante ne lui était permise ; aucune manifestation de son esprit n’échappait à l’inquisition et aux rapports de ses surveillants ; il le savait : donc, dans ses papiers, inutile de chercher des confidences, des tendances ou des rêves. L’énigme est faite pour tenter les écrivains qui cherchent un succès populaire, car nulle figure, par le mystère dont elle est couverte, n’est plus faite pour attirer l’attention ; par malheur, cette énigme est insoluble.
Cet attrait mis à part, l’étude en soi ne présente point une utilité réelle. Le fils de Napoléon ne vaut que par son père ; il n’attendrit que parce qu’il est le fils de l’Homme. Il n’a joué aucun rôle, il n’a exercé aucune action sur l’humanité ; il est une épave que les flots balottent quelque temps avant de l’engloutir, mais qui demeure toujours un lambeau du navire dont la tempête l’a arraché. C’est Napoléon que l’on cherche dans son fils ; c’est la liaison entre ces deux êtres qui importe à l’histoire. Donc, ce qu’il convient d’étudier, ce sont les conséquences que le sentiment de paternité a produites sur la mentalité, les projets et les actes de Napoléon et, à l’inverse, les effets, chez son fils, du sentiment filial.
Un autre problème se pose pourtant dont j’eusse souhaité chercher la solution : c’est celui de l’hérédité physique et mentale ; j’ai été arrêté par mon incompétence en une telle matière où je ne pouvais porter que des notions d’histoire et le secours que j’ai trouvé près de mon ami, le Dr Galippe, n’est point pour me donner des illusions sur le résultat que j’ai atteint. L’ouvrage que prépare le Dr Galippe sur les tares héréditaires dans la Maison d’Autriche répondra, à un certain point de vue, à la question de l’hérédité maternelle, mais il n’abordera point la question de l’hérédité paternelle. Pour la trancher, il n’eût point suffi de recueillir des notions sur les conditions de vie des ancêtres et des collatéraux de Napoléon, il eût fallut étendre l’enquête à ses deux fils naturels avoués, à ses neveux et petits neveux, et si, sur les familles princières ou illustres, de telles informations peuvent être obtenues, comment les espérer sur des familles particulières ? J’ai dû y renoncer : toutefois ; je signale l’intérêt que présenterait, scientifiquement traitée, une telle étude.
Ce livre s’est donc restreint aux termes du premier problème. Logiquement, il n’eût dû voir le jour qu’après les derniers volumes de la troisième série : la première étant consacrée au milieu atavique et à la formation intellectuelle ; la deuxième à l’influence du sexe ; la troisième à l’influence de la famille et celle-ci, qui est comme une conclusion, à l’influence de la descendance. Mais, à mesure que les questions se posent, j’en cherche les éléments de solution ; ainsi ai-je fait déjà, et c’est le meilleur procédé que j’aie rencontré pour m’avancer dans la connaissance de la vérité.
L’époque de la naissance du Roi de Rome à laquelle je suis parvenu dans Napoléon et sa famille m’a montré chez l’Empereur une transformation de sentiments dont il importait essentiellement de déterminer la cause et de suivre les effets. On ne pouvait penser qu’il s’agît d’une coïncidence fortuite ou d’une déviation passagère. La permanence du courant résulte d’une suite d’indications positives. La venue du Roi de Rome est bien la déterminante d’une série d’idées qui exercent sur la politique une action essentielle. Dès lors, cette action a dû être étudiée isolément, avec des procédés d’investigation minutieuse, car, faute de cet examen préalable, il serait impossible d’exposer, sous leur jour véritable, quels ont été les rapports de l’Empereur avec sa famille, de 1810 à 1821.
En soi-même d’ailleurs le problème présente un intérêt majeur. La naissance du Roi de Rome étant l’aboutissement des tentatives de Napoléon pour constituer l’hérédité monarchique, tout ce qui regarde la façon dont il a compris l’héritier doit être vu de près, aussi bien que la maison dont il l’entoure, les formes qu’il adopte pour l’élever, celles qu’il prépare pour l’instruire, que les palais qu’il lui dédie et ou les mesures qu’il adopte pour sa sûreté. La moindre manifestation de sentiments ou d’idées, le moindre projet, qu’il ait ou non été suivi d’exécution, est sans prix à cet égard. On y rencontre l’étiage des ambitions, en même temps qu’on y suit le développement des sentiments. Puis le drame se noue. L’Empereur, ayant acquis l’héritier de son sang, prétend assurer à cet héritier la succession de l’Empire. Il est prêt à offrir en échange sa puissance, sa vie, son martyre. L’Amour paternel se double de l’Amour dynastique, de la passion que l’ouvrier éprouve pour son œuvre ; le successeur qu’il espère se confond devant ses yeux avec le fils qu’il a tant souhaité ; tous deux avec l’Empire qui fut le but de son ambition, avec la France qui fournit le moyen de la réaliser, et, de là, résulte l’éclosion d’un sentiment qui passe en intensité toutes les habituelles expressions de l’âme humaine.
Que l’existence du Roi de Rome ait été de 1810 à 1812, une des raisons majeures de l’enivrement de Napoléon, par là une des causes de sa chute, dans les conditions au moins où celle-ci s’est produite, je ne le metspoint en discussion. Sa politique portait en soi des ferments incoercibles de destruction ; son système familial, tel qu’il en avait fait l’expérience dans la crise de 1809, ne pouvait manquer, sur une nouvelle épreuve, de déterminer une catastrophe ; mais, lorsque à ce système familial, qu’il n’avait eu ni la volonté, ni la possibilité d’abandonner complètement et dont il avait laissé subsister les parties les plus dangereuses, Napoléon joignit les vues résultant de sa paternité nouvelle, le péril s’accrut de la discordance des doctrines et la force de résistance s’abolit par la contrariété des intérêts.
Ce fait admis et la question politique écartée, il reste, au point de vue sentimental, une suite et un ensemble de manifestations qui attestent une forme de l’Amour paternel telle qu’on ne l’a rencontrée jamais si puissante chez aucun être humain. Chez Napoléon, la pensée, la sensation, le sentiment acquièrent, à chaque fois qu’ils s’exerçent, une amplitude qui passe à ce point la commune mesure qu’ils en deviennent l’expression sublimée et typique. En les étudiant successivement, c’est celui qu’on envisage momentanément qu’on croit occuper tout entier son esprit et son cœur. On ne peut croire qu’un homme éprouve avec une telle intensité toutes les passions ensemble ; qu’un cerveau suive à la fois tous ces projets ; qu’un système nerveux subisse en même temps toutes ces impressions. Cela est ainsi pourtant ; mais, à des époques, des dominantes surgissent qui jouent, même pour la politique, le rôle de directrices. La Paternité, sensation, sentiment et idée, a été, de celles-là, la plus active, la plus persistante, la plus féconde en résultats moraux. Si la plupart des historiens n’y ont point attaché une telle importance, c’est qu’ils trouvaient indigne de la majesté de l’Histoire, telle qu’ils la concevaient, de s’attarder à des détails de la vie privée et qu’à leur compte les hommes d’État échappent, par une grâce spéciale, aux passions qui mènent communément l’humanité. Mais le peuple, lui, ne s’y est pas trompé. Il a compris les joies, les orgueils, les rêves de cette paternité triomphante ; il a partagé les souffrances et les angoisses de cette paternité déchue ; il a vibré à des impressions qui lui étaient familières ; il a réalisé les désespoirs qu’une telle adversité devait inspirer. Chaque homme a senti en Napoléon un frère de misère et, s’il mesurait l’admiration au César victorieux, il n’a pu refuser sa pitié au prisonnier dont on a volé l’enfant. A la suite, les artistes et les poètes ont rendu au peuple l’émotion qu’ils en avaient reçue. Ils ont trouvé pour la présenter de nobles accents et d’admirables images. Peu à peu, la synthèse s’est établie ; la légende s’est formée, précédant l’histoire qui à présent la confirme. Elle a fait de la naissance du Roi de Rome le point culminant de la fortune de Napoléon ; elle a fait de l’existence du Roi de Rome, la préoccupation majeure de l’Empereur ; elle a fait de l’avenir de Napoléon II le rêve unique du Prisonnier, et sur tous ces points elle a raison.
La légende n’a besoin ni de faits prouvés ni de documents certains. Elle ne s’embarrasse pas du livre qui passe, elle qui demeure. Si par quelques côtés, l’histoire lui fournit des indices qui lui agréent, elle s’en empare, s’en rend maîtresse et les porte au sublime. Or, de l’enquête que j’ai menée avec la plus entière bonne foi, où je n’ai rien laissé dans l’ombre des passions moins généreuses et des ambitions moins hautes qui, surtout au début, ont jeté leur ombre sur les actes de l’Empereur, ressort en dernière analyse une histoire presque semblable à la légende. Calle-ci a pressenti celle-là, elle a noyé d’ombre les détails oiseux, elle a condensé les récits essentiels ; elle a deviné les causes, elle a réparti les responsabilités, elle a dégagé les conclusions nécessaires.
Ailleurs j’ai dû contredire une forme de légende qu’avaient faussée des intérêts politiques et personnels. Ici, la Légende a jailli spontanée et franche, elle n’a subi ni altération, ni mélange. Dès le premier jour, elle s’est formulée avec une netteté à laquelle les âges n’ont rien ajouté et, après un siècle révolu, elle se présente telle qu’elle sortit de la conscience du peuple. Je crois qu’elle est définitive et pas plus les haineuses et sottes déclamations que les histoires à documents apocryphes ne sauraient l’ébranler. J’y apporte, pour ma part, la confirmation d’une enquête qui fut sérieuse, indépendante et passionnée de vérité.
FRÉDÉRIC MASSON.
Janvier 1904.
NAPOLÉON
ET SON FILS
I
L’HÉRITIER ADOPTIF
(1801-1807)
Besoin qu’a l’homme de se survivre. – Ce besoin décuplé chez un fondateur d’empire. – Ce qu’est la dynastie par rapport à la famille. – La survie dynastique. – Napoléon, ne croyant pas avoir d’enfant, prétend établir sa dynastie par l’adoption d’un descendant. – Napoléon-Charles. – Raisons diverses à la tendresse de Napoléon pour le fils de Louis et d’Hortense. – Comme l’enfant y répond. – La nature et l’esprit de l’enfant. – L’éducation qu’il reçoit. – Institut des Princes de la Famille impériale établi par le Statut de Famille du 30 mars 1806. – Séjour de l’enfant à Mayence. – L’enfant tombe malade à la Haye. – Sa mort, le 5 mai 1807. – Sentiments de Napoléon. – L’hérédité adoptive ayant avorté, l’hérédité naturelle se présente juste à point.
Tout homme prétend se survivre. En chacun, contre la mort qu’il porte, proteste un rêve d’immortalité. L’instinct de reproduction, garantie de la perpétuation de l’espèce, ouvre l’espoir de la race se poursuivant, montant des degrés de fortune et d’honneur, ressuscitant, sous un nom pareil, les traits moraux et physiques, par là, assurant la vie à qui l’a donnée. C’est la forme la plus logique parce que la plus naïve. A travers cette chair, venue de soi, on voit sa vie se continuer, et à cette chaîne des êtres qui se perd si tôt dans les obscurs passés, chacun a l’illusion qu’il apporte un commencement, qu’il fonde une race, alors qu’il n’est qu’un maillon rattachant les êtres qui furent aux êtres qui seront, un dépositaire qui, par une fonction organique irraisonnée, transmet sans le vouloir le trésor de vie qu’il a reçu sans le demander De qui procéderont-ils ces inconnus nés de lui ? De quel lointain ancêtre reproduiront-ils les traits, le caractère et les vices ? De quelle tare physique seront-ils marqués ? Les générations à l’infini s’agitent pour revenir au jour, et l’homme, qui croit immortaliser les caractères essentiels de son individu, ne se trouve avoir renouvelé que les décevants aspects d’aïeux qu’il ignore. Un afflux de races est en lui, mélangées, douteuses, obscures ; un autre afflux de races aboutit à la femme que sa vanité de mâle croit uniquement destinée à recevoir et à porter son image ; des milliers et des milliers de faces mortes tressaillent dans leurs flancs ; mais, par un phénomène d’égoïsme et d’orgueil, l’homme est assuré qu’il a seul engendré, alors que son atavisme entier engendre par lui, et qu’il ne peut même savoir si c’est de sa propre race ou de la. race de sa femme que sortiront les descendants qu’il se promet.
Sur cette illusion reposent les ambitions les meilleures et les plus droites de l’humanité. A défaut de la survie par une postérité, elle cherche vainement des œuvres qui l’immortalisent, et qui, moins longtemps encore, la gardent de l’oubli : de cette commune folie, nul n’est exempt ; pas un acte pour qui l’on envisage la durée et dont on ne rêve sur soi le témoignage. On se persuade qu’en un poème ou un tableau, on aura mis assez de soi pour que, par là, quelque chose demeure de l’être qu’on a été ; on imagine qu’une congrégation qu’on institue se perpétuera mieux qu’une famille et continuera son fondateur, qu’une église attestera sa foi, une collection son goût, un hospice ou un prix de vertu sa bienfaisance. On cherche la fissure par où évader du tombeau un peu de ce qu’on a été, de ce qu’on a aimé, fait ou pensé, et c’est à poursuivre un tel rêve qu’on emploie les heures les plus souhaitables de la vie.
S’il est ainsi pour le commun des hommes, dès qu’ils sont hors du labeur quotidien par quoi ils assurent l’existence matérielle, qu’est-ce pour les conducteurs de nations, pour ceux qui, ayant constitué un système de gouverner, prétendent qu’il traverse les âges, emportant avec lui leur nom et leur gloire ? Pour ceux-là, se survivre est la raison essentielle. Ils bâtissent, non pour le temps présent, mais pour tous les temps. Ils ont trouvé la formule définitive où s’adapteront les générations, par qui elles seront modelées selon l’idéal qu’ils ont porté et qu’à la fin leur fortune leur a permis de réaliser. Et, de ceux-là qui ne se survivent que par leur idée maîtresse, si l’on passe à ceux qui ont groupé des peuples, assemblé des royaumes, formé un empire, n’est-ce pas que tout croule de leur œuvre, s’ils n’ont procréé une race à qui la transmettre ; si, à l’orgueil d’avoir conquis, ils n’ajoutent le prestige de prendre possession des âges par la fondation d’une dynastie ? En elle, à travers les siècles, ils vivront ; d’âge en âge, leur nom, imposé au souverain, attestera leur gloire ; leurs traits physiques, devenus l’attribut essentiel des dynastes, rappelleront sans cesse leur souvenir, et l’édifice qu’ils auront érigé, défiant les colères des souverains adverses, dominant les orages populaires, traversera les temps sous l’œil attentif des descendants, pieusement nourris de leur doctrine, sévèrement élevés dans leurs principes. Un jour viendra où, si solidement qu’il soit construit, si profondément que descendent ses fondements de granit, si intimement que ses assises soient liées par le ciment romain, l’édifice, temple et forteresse tout ensemble, sera délaissé pour quelque autre de style plus neuf et d’aménagement plus commode. L’invasion, la guerre civile, quelque tremblement du sol, quelque évolution de l’humanité en chassera les hôtes. Mais, au-dessus de la plaine morne, dominant les montagnes, les forêts et les villes, l’immense ruine dressera sur le ciel ses frontons mutilés. A la moindre brise agitant le manteau de lierre qui la couvrira, des statues d’airain, des métopes de marbre apparaîtront, racontant la légende de l’ancêtre ; quelque chose de divin tressaillera dans les salles désertes ; ce vide sera empli d’un nom que répétera l’écho des murs délabrés et, sur l’histoire, ce squelette de palais étendra à l’infini l’ombre de son fondateur.
Vision par qui le rêveur déifié s’aperçoit dans le recul des siècles présidant aux destinées de ses descendants : ceux-ci n’ont d’autre nom que le sien et y ajoutent seulement un chiffre ; ce nom grandit à mesure que les âges s’écoulent ; sa gloire s’accroît de toutes les gloires qu’on acquiert ; son génie préside à toutes les victoires qu’on gagne ; comme un légitime tribut, toute renommée remonte et s’attache à lui ; tout ce qui est fait de grand lui est compté ; sous son vocable devenu sacré, la postérité enregistre tous les travaux de la race, et, se refusant à croire qu’un homme en ait rempli le cycle prodigieux, elle veut qu’il ait été plus qu’un homme et lui érige des autels.
Telle est la vision qu’a Napoléon. Pour la réaliser, pour que le chiffre Deux, début de la numération qui multiplie sa gloire devant ses yeux, soit inscrit après son nom, il a travaillé sans relâche, il a agité dans tous les sens le problème de l’hérédité. Familial comme il est, il n’a pas su, malgré ses efforts et une lutte incessante, écarter ses frères de sa succession. Nominalement, légalement, il les y a admis, parce qu’il a été contraint, mais au moins a-t-il fait des réserves, car ils sont le présent, ils ne sont point l’avenir, et c’est dans l’avenir qu’il veut s’établir. A défaut d’une descendance naturelle qu’il a cessé d’espérer, il en veut une adoptive, mais qu’il ait formée et pétrie à son gré, en qui, s’il ne trouve point sa chair, il reconnaisse au moins les traits essentiels de sa race ; pour qui il éprouve cet instinct de paternité qui ne peut être commandé, qui demeure indéfinissable et qui, indépendant de la réalité des faits, établit de l’enfant tout petit à son père de convention ou de hasard, un magnétique courant de gaieté, de tendresse, d’inquiétude et d’orgueil.
Au milieu des projets qu’il a remués, Napoléon a pensé à désigner comme successeur son frère Louis qu’il a pour ainsi dire élevé ; presque tout de suite, il y a renoncé : si jeune que fût Louis, il était un contemporain, non un descendant ; mais, dès que Louis, marié à Hortense, a eu un fils, c’est à cet enfant, Napoléon-Charles, que Napoléon s’est attaché. Il a vu en lui l’héritier, il a éprouvé vers lui cette poussée de nature qui le lui a fait regarder comme un successeur et, alors que, en ses frères, se querellant déjà sur l’éventualité de sa mort, il n’est disposé à voir que des ennemis, à ce petit enfant qui ignore sa fortune, il se plairait à la transmettre toute.
Napoléon-Charles est le premier mâle qu’aient engendré les Bonaparte à la génération de Napoléon ; Joseph n’a qu’une fille ; Lucien deux ; les femmes ne comptent pas : ce n’est pas à Dermide Leclerc ou à Achille Murat que Napoléon peut penser. Napoléon-Charles est le premier né, et c’est là tout de suite une raison majeure de tendresse. Napoléon reconnait sa race et c’est à sa race qu’il se fie.
A cette sensation qu’il éprouve, – si profonde chez un Corse tel que lui, – faut-il chercher d’autres mobiles ? Dira-t-on, avec les émigrés rentrés, que Napoléon serait mal venu à n’éprouver pas des sentiments paternels pour un enfant dont il est le père ? Les dates, les faits, les témoignages, tout confond la calomnie et, par une étrange fortune, elle dessert même ceux qui l’imaginent. Ce bruit répandu et accrédité n’éveille point dans le peuple l’horreur et l’indignation attendues. La nation s’est si bien habituée à trouver en Bonaparte un être d’exception qu’elle lui passerait même une telle paternité. La Révolution a-t-elle aboli la notion des moralités conventionnelles ? Le peuple, dans l’indulgence avec laquelle il regarde le Consul, se plaît-il à l’élever au-dessus des lois communes ? Souhaite-t-il inconsciemment que quelque mystère enveloppe l’origine de la dynastie nouvelle ? Nul ne se soucie des propos des aristocrates, et Bonaparte, s’il se peut, en devient plus populaire.
Au fait, le sentiment qu’il éprouve est double, et, outre qu’il voit en Napoléon-Charles le premier né de sa race, il voit en lui le fils d’Hortense, quelque chose comme un petit-fils. Dès son mariage avec Joséphine, Napoléon s’est attaché aux enfants qu’elle avait eus, et qui, par leur âge, s’approchaient de lui presque plus que leur mère. Il s’est occupé d’eux, les a adoptés, a payé leur pension, leur a donné leurs premières joies. Dès l’Italie, il a appelé Eugène pour lui servir d’aide de camp ; au retour, il a pris Hortense rue Chante-reine ; en revenant d’Égypte, c’est sur les supplications des deux enfants qu’il a pardonné ; après Brumaire, Hortense a été si intimement mêlée à sa vie qu’elle est devenue par degrés la troisième personne de la République. Entre sa mère et le Consul, lors des querelles de dettes ou de femmes, elle intervenait, et, confidente de son beau-père, portait les paroles d’apaisement. Son précoce bon sens, sa douceur obstinée, une naturelle disposition à manœuvrer et à concilier que sa vie ; agitée depuis son berceau, a développée, la préparait à ces missions où, par une interversion des rôles, elle faisait entendre raison à cette mère qu’elle adorait sans se dissimuler ses faiblesses. Si le Consul la voulait gaie, vibrante et joyeuse, égrenant les fusées de son rire dans ces Tuileries, « tristes comme la grandeur », elle était encore le plaisir de ses yeux à Malmaison, lorsque, dans de gamines parties de barres, elle entraînait sur les pelouses la maisonnée entière, et, d’une allure de nymphe, passait, blanche vision, sous les couverts de marronniers, suivie par la meute haletante des aides de camp. Et les spectacles, et la musique, et la basquine de Rosine, et les chasses, et toute cette vie en constante ascension de fortune où elle était comme l’unique distraction du travail et la récompense des décadis ! Pourtant, père vigilant et, à l’occasion, sévère, il n’admettait point que les jeux tournassent en amourettes, fouillait les tiroirs et dénichait les billets. Il a cédé aux obsessions de Joséphine ; il a laissé faire le mariage avec Louis, et c’est un remords. Presque tout de suite, ce sont des scènes où il n’y a guère de remède, mais dont il ne pénètre pas le secret, et c’est l’abandon. Hortense rentre aux Tuileries, désabusée, l’âme flétrie plus que le corps, le cœur plein de larmes, et, de toute cette ignominie dont il ne sait point l’abîme, mais dont il voit les effets, Napoléon se sent responsable. Tout le temps de sa grossesse, Hortense le passe entre sa mère et son beau-père, une partie avec son beau-père seul, quand Joséphine prend les eaux à Plombières. Louis revient, contraint et forcé, pour les couches : L’enfant naît ; c’est un garçon, le premier de la famille : il ressemble étrangement à Napoléon : il a sa forme de crâne, sa coupe de visage, ses yeux, son bas de figure – seulement blond comme est la mère. Et à mesure qu’il se développe, que, grâce au bon lait de Mme Rochard, sa nourrice, il grandit, se forme, ouvre son intelligence, apprend à parler, chez l’oncle, une faiblesse de grand-père se révèle. Napoléon admire et se réjouit ; il s’ébahit aux gestes qui s’esquissent, il rit aux mots qui se balbutient ; il se distrait à voir remuer ce petit être aux heures où son esprit est le plus tendu et sa pensée la plus noire. Le jour où, à Vincennes, on fusille le duc d’Enghien, au dîner, à Malmaison, il fait mettre le petit sur la table, s’amuse aux plats qu’il touche, aux bouteilles qu’il renverse, et, ensuite, il s’assoit à terre près de lui pour jouer. Voyage-t-il ? Dans chaque lettre, un souvenir à l’enfant ; tous les détails de santé, de maladie, de vie pratique. C’est « M. Napoléon » ou « le petit Napoléon » ; il se plaît à répéter sur lui son propre nom, le nom qu’il lui a imposé, qu’à ce moment, dans le monde, eux seuls portent. Quand il a deux ans, il lui donne son portrait peint en miniature par Isabey, monté en un médaillon que l’enfant aura constamment à son cou. Quand on le sèvre, il envoie à Mme Rochard, la nourrice, un brevet de pension de 2,400 francs, et à lui, tout de suite, il règle un traitement annuel de 120,000 francs qu’il paiera jusqu’à l’avènement de Louis au trône de Hollande.
A cette tendresse qui l’enveloppe, comme un manteau duveté, d’une caresse chaude et douce, l’enfant répond avec une confiance pleine, une liberté entière, sans s’intimider aux titres qu’il ne sait pas, aux dignités qu’il ignore, pourtant avec une confuse sensation que celui qu’il aime est le plus grand, le plus fort, le plus beau des hommes. C’est Nonon ; Nonon Bibiche, quand il le mène donner du tabac aux gazelles, et qu’il le met à cheval sur l’une d’elles ; Nonon le soldat, quand il lui fait voir la parade, et le petit alors, cambrant son torse, agitant ses bras, crie aux grenadiers : Vive Nonon le soldat ! Nonon tout court, lorsque, dans la chambre à coucher, pendant la toilette, il l’appelle, lui fait ses farces, lui conte des bali vernes, – et parfois, s’interrompant, le regarde et prononce sur son avenir des paroles graves. L’enfant est courageux et dur au mal ; si Nonon lui tire les oreilles ou le pince, l’enlève par la tête pour le poser sur une table, il ne se plaint pas et lui sourit ; il est secret, et rien ne prévaut contre la promesse qu’il a faite de se taire ; il est brave : à Boulogne, où il est venu au camp retrouver l’Empereur avec sa mère, il est pris, dans une manœuvre, entre deux lignes d’infanterie qui font leurs feux, et il n’a pas peur. Il a du tact, il a de l’esprit, il a de la gentillesse ; il rend à chacun ce qu’il doit ; il n’est pas né prince. Sa mère le veut bien élevé, bien poli, n’admet point que, dans cette intimité dont elle ne le sort guère, on lui fasse sa cour, qu’on lui donne de l’Altesse ou du Monseigneur. Elle le laisse un bon petit enfant tout simple qui se développe en franchise, sans penser qu’il soit d’essence supérieure, qu’il ait des droits natifs et que le monde ait été créé pour lui. Elle ne le gâte ni en joujoux ni en bonbons, le frotte constamment à d’autres enfants qui le traitent à égalité ; elle l’habitue même à se sacrifier, à prendre son plaisir à en donner aux autres, dans les petits bals costumés, les représentations de marionnettes, d’ombres chinoises du sieur Séraphin et de lanterne magique. Même, à mesure qu’il grandit et que, par les circonstances, sa fortune s’accroît, tient-elle davantage la main à ce que, autour de lui, il ne trouve ni flatteurs ni complaisants, qu’on le gronde et le reprenne aux occasions, et que les cérémonies, telles que le Sacre, où il paraît, ne lui montent point la tête. Elle-même, selon les règles qu’elle s’est assez arbitrairement tracées sur l’éducation, sur le développement moral et matériel de l’enfance, impose avec une netteté ferme son programme, l’applique sans rémission, entend qu’il soit suivi point par point ; en cela, merveilleusement secondée par la gouvernante, Mme de Boubers, point gênée par Louis qu’occupent uniquement sa santé, ses voyages, ses amis, qui ne voit son fils qu’à longs intervalles et disserte alors sur des plans oiseux, mobiles et lointains.
Par tout cela, même cette sévérité voulue de la mère, éducatrice convaincue, – élève accomplie de Mme Campan, – l’enfant est rejeté en tendresse vers la grand’mère qui le gâte à l’heure en caresses, en présents, en chatteries, vers cet oncle-grand-père qui le secoue, le tarabuste, l’enlève, joue avec lui, le conquiert par sa force, par ce rayonnement qui émane de lui, par le prestige de son uniforme, des cortèges qui le suivent, des tambours qui battent aux champs quand il passe, des fusils présentés sur la ligne, à l’infini, d’un seul geste cadencé qui fait martialement sonner les capucines. C’est une sorte d’adoration, ni timide, ni respectueuse, mais confiante et joyeuse. « Ma chère tata et mon cher nonnonque, écrit-il quand il sait écrire, je vous souhaite une bonne année, je vous aime bien de tout mon cœur ; je suis bien fâché de ne pas vous voir parce que vous m’auriez donné des joujoux. » Et il signe Napoléon.
De l’instruire, on s’est occupé assez vaguement. La mère et la gouvernante lui ont montré à lire et à écrire. On lui apprend des fables de La Fontaine, mais peu, plutôt de Florian et de l’abbé Aubert. L’Empereur n’aime pas La Fontaine pour les enfants qui ne peuvent pas l’entendre. Il y trouve trop d’ironie, de scepticisme, d’immoralité même. De la bibliothèque de son cabinet particulier, il a donné à son neveu les fables de Florian, illustrées de cent estampes grossièrement enluminées, mais qui, comme les images d’Épinal, fixent les traits des histoires. Cela sert pour les leçons ; à la suite, on fait copier au petit des fables choisies de La Fontaine : la Poule aux Œufs d’or, le Loup et l’Agneau, le Gland et la Citrouille, le Lion et le Rat, le Pot de Terre et le Pot de Fer. L’écriture toute grosse abonde en fautes d’orthographe, mais, malgré le modèle suivi, elle marque l’intelligence ; elle a un caractère de volonté rare à cet âge ; dans les premières lignes de chaque devoir, l’attention est éveillée et La main ferme ; c’est pourtant trop de l’enfance pour qu’on y discerne les dispositions ataviques.
Cela est de 1806 ; le petit Napoléon va sur ses quatre ans et il faut songer à des instituteurs plus sérieux. C’est à l’héritier de son trône que l’Empereur a pensé d’abord lorsque, dans le Statut de Famille du 30 mars, il s’est réservé l’éducation des princes et des princesses de son sang. Il a peu à faire de Zénaïde et de Charlotte, les filles de Joseph, d’Achille, de Letitia, de Lucien et de Louise, les enfants de Murat, mais sur les fils de Louis, sur l’ainé surtout, il a étendu la main. Pour cela, étant donné le caractère soupçonneux du père, il a dû prendre, – ou avoir l’air de prendre, – tous les autres. « Rien de plus important, a-t-il dit dans son message au Sénat, que d’écarter d’eux de bonne heure les flatteurs qui tenteraient de les corrompre, les ambitieux qui, par des complaisances coupables, pourraient capter leur confiance, et préparer à la nation des souverains faibles sous le nom desquels ils se promettraient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l’éducation des princes et princesses de la Famille impériale doit donc appartenir à l’Empereur. »
En vertu de ce principe, « l’Empereur règle tout ce qui concerne l’éducation des princes et princesses de sa Maison ; il nomme et révoque à volonté ceux qui en sont chargés, et détermine le lieu où elle doit s’effectuer. Tous les princes, nés dans l’ordre de l’hérédité, seront élevés ensemble, et par les mêmes instituteurs et officiers, soit dans le palais qu’habite l’Empereur, soit dans un autre palais, dans le rayon de dix myriamètres de sa résidence habituelle. Leur cours d’éducation commencera à l’âge de sept ans et finira lorsqu’ils auront atteint leur seizième année. Les enfants de ceux qui se seront distingués par leurs services pourront être admis par l’Empereur à en partager les avantages. Le cas arrivant où un prince dans l’ordre de l’hérédité monterait sur un trône étranger, il sera tenu, lorsque ses enfants mâles auront atteint l’âge de sept ans, de les envoyer à ladite maison pour recevoir leur éducation. »
L’Empereur, dans les entretiens de la captivité, a développé les avantages qui eussent résulté pour les princes de sa Maison de l’éducation commune, mais si, en 1806, il s’occupe activement de la réalisation de ce projet, s’il ordonne à son bibliothécaire de préparer le catalogue d’une bibliothèque à l’usage des princes, s’il se fait soumettre par le grand maréchal des projets, des plans et des devis, s’il baptise le pavillon de Marsan pavillon des Enfants de France, s’il désigne le château de Meudon pour l’institut des princes, de 1807 à 1811, il laissera dormir le projet, bien que, en 1811, sept des enfants de sa famille aient atteint l’âge qu’il a fixé. C’est que l’intérêt majeur qu’il y a attaché, qui lui a fait instituer une sorte de conscription dans la Famille a disparu, dès qu’a disparu l’enfant qui devait être l’héritier du trône.
Pauvre petit Napoléon ! Son oncle s’est, s’il est possible, plus encore attaché à lui, depuis que, à la suite de ses parents, il est parti à la Haye. Il l’a voulu à Mayence pour tenir compagnie à la grand’mère qui est si heureuse de le gâter, de lui faire faire salon, de lui donner sa première montre. De chaque étape il écrit, et dans chaque lettre un souvenir, une caresse, un baiser pour le petit. S’il prend des quartiers d’hiver, il appellera près de lui, avec Joséphine, Hortense et ses fils, l’ainé du moins, car Louis a impérieusement réclamé le cadet. Il n’entend pas qu’on le triche ; il se défend si la mère revoit les lettres qu’écrit le petit. Il le veut tel qu’il est, avec la spontanéité de son caractère, avec la franchise entière d’une nature où, comme en un miroir, il se retrouve lui-même ; car, par un hasard de l’hérédité, cet enfant le reproduit bien plus fidèlement qu’il ne reproduit Louis, et si, par la suite, sous la néfaste influence de la dégénérescence paternelle, il doit s’arrêter dans son développement physique ou mental, pour l’instant, il semble échapper à ces tares, et brillant de santé, joyeux de vivre, plaisant en son humeur qui marque un tempérament équilibré, il donne l’impression pleine d’un être heureusement né, dont les organes sont sains, le sang pur, le cerveau intact, et dont l’existence sera longue.
Après ce long séjour à Mayence de près de quatre mois, du 12 octobre 1806 au 27 janvier 1807, Hortense, sur les ordres réitérés de Louis et, à la fin, sur l’exprès commandement de l’Empereur, a dû rentrer à la Haye. Sous le ciel gris, au milieu du brouillard qui baigne d’humidité le palais glacial, à peine meublé, elle a traîné la mélancolie des jours. Elle est suspecte, presque captive, ne peut recevoir qui lui plaît, ni sortir s’il lui convient. De plus, souffrante, constamment enrhumée et fiévreuse. A son fils, le climat ne convient pas davantage. Sur lui aussi, le roi étend l’inconstant despotisme de ses caprices. Il veut commencer son éducation, il entend changer ses méthodes de vie ; il préconise des régimes, et c’est encore une cause de querelles entre lui et Hortense.
L’enfant est pris d’un mal de gorge ; la mère, affolée d’abord, se rassure à une rémission ; il traîne, paraît se rétablir, retombe, et, cette fois, tout sots qu’ils sont, les médecins ne peuvent s’y tromper, c’est le croup, contre quoi l’on ne sait pas de remède. La maladie est nouvelle, au moins ne l’a-t-on point observée en Europe avant 1760. Le traitement est dirigé par le premier médecin du roi, Latour, qui est un spécialiste pour les paralysies des membres inférieurs ; mais on a appelé quiconque a une célébrité en Hollande, et Hortense, à grands cris, demande Corvisart. De fait, nul n’y peut rien. Après six jours, le 5 mai, à minuit, l’enfant expire. Il avait quatre ans et sept mois.
La nouvelle en vient frapper l’Empereur à Finckenstein, il n’en tire point des phrases ; il n’en déclame pas : cela n’est pas dans sa façon. Il a la pudeur de ses tristesses et il n’en fait point des confidences à tout venant. Mais ses paroles, ses lettres, ses actes prouvent que le coup lui fut rude. Toutefois, ce qui prime tout, c’est de pourvoir à l’avenir. Cet enfant était le pivot d’une combinaison : se croyant incapable d’avoir des enfants, s’attribuant la stérilité de Joséphine, Napoléon avait porté sur cette tête ses vues d’hérédité, mais Napoléon-Charles est aboli : « c’était son destin. » Avec lui, la combinaison s’écroule. Il faut sur-le-champ en imaginer une autre, car, ce qui importe, c’est d’assurer la durée à une œuvre qui, à chaque conquête, mérite mieux d’être éternelle. Une imagination latine avait pu être séduite par la pensée de renouveler l’adoption d’Octave, et il seyait à Napoléon d’imiter César. Cette paternité extra-humaine avait quelque chose d’antique. Mais, si un tel héritier convenait au Consul, l’Empereur ne s’en est contenté que parce qu’il croyait ne pouvoir mieux faire. Or, à ce pis aller de l’hérédité adoptive et collatérale, il se croit assuré maintenant de substituer à son gré l’hérédité naturelle et directe et, de son neveu qui meurt, il se console par son fils qui va naître.
II
L’HÉRITIER NATUREL
(1807-1810)
La naissance de Léon. – Napoléon acquiert la certitude qu’il peut être père. – Le système de l’adoption est condamné. – Napoléon divorcera. – Ménagements, transitions qu’il y porte. – Problèmes divers à résoudre. – Épousera-t-il ensuite une grande-duchesse de Russie ? – Avantages que présente en apparence le Mariage russe. – Hostilités que rencontre l’Empereur. – Dégoûts qu’il reçoit. – Le Mariage russe tel qu’il lui apparaît. – L’Autriche s’offre à lui. – Illustration d’une telle alliance. – Son caractère. – Le type autrichien signe de noblesse. – Ce qu’il est au vrai. – L’archiduchesse Marie-Louise, ayant presque uniquement du sang de Habsbourg et de Bourbon, est doublement une dégénérée, et ses descendants seront tuberculeux ou fous. – Le rêve dynastique. – Le Sénatus-consulte du 30 janvier 1810. – L’annexion de Rome et des États romains. – Le titre de Roi de Rome. – Le Sénatus-consulte du 17 février. – Eugène dépouillé de l’Italie. – Redoublement des constructions navales.
D’une passade sans conséquence avec une vague lectrice de sa sœur, Caroline Murat, Napoléon a eu un fils. Il n’en peut douter : cet enfant est de lui ; pour la première fois, le 13 décembre 1806, à l’aube de sa quarantième année, il acquiert cette conviction qu’il peut être père. Dès lors, tout est transformé dans ses desseins, tout revêt un aspect différent, et les idées auxquelles jusque-là il s’était attaché s’estompent et s’effacent. Il a pensé, dans le Grand-Empire tel qu’il le constituait, introduire largement le régime romain de l’adoption ; par elle, agréger à sa maison tous ceux qui, à un mérite personnel, joindraient un semblant de parenté ou d’alliance ; imposer par un nouveau baptême son nom impérial à tous les mâles dont il ferait des souverains, à toutes les filles qu’il établirait dans d’autres États, et, seul Auguste, étendre ainsi sur l’Europe des dynasties de Césars. A l’Empire même, il réservait celui de ces Césars qu’il estimait le plus près de son sang, mais l’enfant Napoléon est mort, et, presque en même temps, l’expérience du petit Léon s’est trouvée probante. Hérédité collatérale, hérédité adoptive, qu’est-ce près de l’hérédité naturelle ? C’est de lui-même, de lui seul, que sa race doit sortir, c’est à elle que l’Empire revient ; c’est pour elle qu’il travaille ; c’est par elle qu’il assurera à travers l’éternité des temps l’immortalité de son nom.
Dès ce moment, dès les premiers jours de 1807, tout est subordonné à l’idée maîtresse. Napoléon y porte des tempéraments ; il ménage des transitions ; il remplit ses engagements, mais, au fond de tous ses actes, l’idée persiste et se retrouve. Il mettra près de trois années à la réaliser, car les difficultés abondent, d’ordre intime comme d’ordre politique, et, peut-on dire, d’ordre social.
D’abord, rompre des liens qui, depuis dix ans, lui sont devenus chers, bannir de son lit celle qui, aux heures de sa naissante gloire, lui enseigna la volupté et se fit son institutrice d’amour ; qui, depuis, associée à sa fortune croissante, modéra à des jours ses ambitions, adoucit ses colères, ouvrit ses yeux sur le monde, sur la vie française, lui apprit les êtres et les choses, les façons et les paroles, et qui, par tout cela qu’il ignorait et qu’elle savait, lui parut supérieure ; chasser des enfants que depuis dix années il s’est habitué à regarder comme les siens, sur le dévouement desquels il compte, au cœur desquels il s’est confié, témoins et acteurs dans l’intimité de sa vie, cette vie qu’il faut à présent recommencer en brisant l’ancienne vie. Chaque fois qu’un homme déplace son existence ou qu’il en change l’ordre intime, quelque chose de lui meurt, et, dans sa mémoire assombrie, ce passé est un cadavre qu’il traîne.
En politique, que de problèmes à résoudre qui, durant cette guerre même, se sont imposés à son attention ! La Russie d’abord, puisqu’elle devient alliée. Sera-t-elle de bonne foi ? Tiendra-t-elle ce qu’il en attend ? Marchera-t-elle franchement dans la voie qu’il lui ouvre, et, dans ce partage du monde où il la convie, saisira-t-elle que son intérêt n’est point de poursuivre en Occident la politique où elle a été engagée par les Allemands qui l’oppriment, mais d’embrasser en Orient une politique nationale qui lui assure, avec un immense empire, un champ d’activité digne de sa force ? L’Espagne ensuite, puisqu’elle s’est rendue ennemie ; que, à l’heure où la France luttait avec l’ombre de Frédéric, elle a escompté sa défaite et lui a jeté le gant ; quel parti prendra-t-il avec ces misérables Bourbons et avec le Godoy qui les mène ? Jettera-t-il comme amorce à celui-ci quelque lambeau du Portugal ? Laissera-t-il à ceux-là leur royaume écorné, diminué des provinces qui lui conviennent ? L’Étrurie, le Portugal, les Algarves, l’Alentejo, autant de matières d’échange. Cela d’ailleurs est simple et ne peut entraîner : au pis aller, il prendra l’Espagne entière. Puis l’Italie, le Royaume d’abord, où il faut remplir les promesses faites à Eugène ; tout ce coin de Toscane et de Parme qu’il faut arranger ; Rome, où il est impossible de tolérer un pape indépendant et des cardinaux hostiles ; un établissement meilleur à fournir à Élisa ; la querelle avec Lucien à terminer, de façon que chacun de la Famille ait reçu sa part et soit associé au grand œuvre. En Allemagne, peu de chose ; un royaume à créer pour Jérôme, la Confédération du Rhin à étendre jusqu’aux frontières d’Autriche, la Saxe à renforcer d’un grand-duché de Varsovie ; la Prusse à annihiler, puisqu’on n’a pu la supprimer ; les Suédois à renvoyer chez eux ; les alliés fidèles à récompenser de quelques territoires ; cela se fera en courant. Une année pour toute cette besogne, n’est-ce pas largement compté ? Mais il se prend à l’engrenage de l’Espagne, et c’est Bailen, après quoi il ne peut lâcher ; c’est, à Erfurth, les hypocrites paroles, le terrain fuyant, la Russie qui se dérobe, l’alliance qui craque ; il faut courir en Espagne, où Joseph est en perdition, revenir d’une haleine à Paris, où se noue l’intrigue des ministres, se hâter vers l’Autriche, où la guerre éclate, sillonner l’Europe en éclairs, sans trouver les – minutes nécessaires pour amorcer la vie nouvelle. Après Wagram, à Schœnbrünn, il s’arrête un temps ; il se reprend, il mûrit et forme sa résolution ; mais alors se dresse cette difficulté d’ordre social qui, de près, semble plus ardue que toutes les autres.
Pour que, dans l’Europe telle qu’elle est constituée, l’Europe monarchique et aristocratique, l’édifice que Napoléon a élevé cesse d’être anormal et anarchique ; pour que son œuvre ne soit pas constamment menacée par les coalitions des souverains ; pour que, après lui, sa dynastie n’ait point, comme lui, à soutenir des guerres continuelles où elle pourra, devra périr, quel moyen ? Relier l’édifice impérial aux autres édifices de même structure, combiner l’œuvre napoléonienne à de pareilles œuvres royales, souder la dynastie aux dynasties existantes, – donc épouser une princesse qui apporte, avec le prestige d’une alliance illustre, l’appui d’une parenté puissante, la garantie que Napoléon est désormais agrégé à la famille des souverains. Mais quelle princesse ? A Tilsitt, l’Empereur a pu croire que la Russie s’offrait, mais, à Erfurth, elle s’esquive, et, en grande hâte, tout de suite après l’entrevue, elle marie à un principicule allemand la grande-duchesse dont le Corse eût pu demander la main. C’est peut-être un hasard, mais il donne à penser. Un homme tel que Napoléon ne s’expose pas à un refus, surtout ne reste pas sur un refus. C’est pourquoi, dès 1807, il aurait voulu, comme en-cas, tenir en réserve la fille aînée de Lucien. Sans doute, il n’eût point trouvé dans un tel mariage les sûretés qu’il cherchait ; c’eût été un autre aiguillage pour l’avenir ; au lieu du mariage dynastique, le mariage familial ; le système napoléonien poussé jusqu’à ses conséquences extrêmes ; la dynastie impériale rendue la plus vieille par le détrônement de toutes les familles souveraines encore régnantes, la constitution d’une Europe au profit exclusif des Bonaparte et de leurs alliés ; mais cette alternative n’est qu’un pis aller. On n’a pu procéder encore que par des insinuations qui pouvaient n’être pas comprises ; la situation trop nouvelle pouvait inquiéter ; le terrain n’était pas libre. Le divorce accompli, on n’aura plus de précautions à prendre. Les partis se présenteront d’eux-mêmes ; Russie ou Autriche, ce serait le mieux ; il y a encore la Saxe, la Bavière ou le Danemark : minces alliances, mais des Bourbons s’en sont contentés.
Dans le mariage qu’il fera, Napoléon envisage bien moins la femme, en tant que femme, que la. race dont il lui confiera le dépôt. « J’épouserai un ventre », a-t-il dit, et il veut que ce ventre soit illustre. Cette grande-duchesse de Russie, qu’on lui fait tellement attendre, mérite-t-elle qu’il en prenne à ce point souci ? En 1807, quand l’idée toute brillante s’en est présentée à son cerveau et qu’elle s’y est fixée, il ne concevait pas qu’une alliance avec l’Autriche fût possible. Marie-Antoinette était trop près ; les hommes de la Révolution qui, seuls ou presque, formaient son entourage, s’en fussent effrayés où révoltés. Sauf l’Espagne – mais qu’était-ce l’Espagne de Godoy et de Marie-Louise de Parme ? – nulle puissance ne s’était offerte, surtout dans ce caractère d’intimité, de confidence, d’ingénieuse flatterie qu’affectait Alexandre. Napoléon y avait été sensible, et, si expert qu’il fût « en finesse », il avait trouvé son maître. Le Corse, le Florentin, le Latin qu’il était, avec ses effusions, sa manière de se jeter à qui semblait se donner, sa confiance aux conquêtes qu’il croyait faire, n’était point de force avec « le Grec du Bas-Empire », dont la sincérité momentanée, qu’éveillait la curiosité et qu’excitait une sorte d’admiration craintive, était d’autant plus redoutable que, dans ses retours, elle ne manquerait point de tirer des armes des confidences qu’elle aurait provoquées. Si loin qu’allât Alexandre en son apparente confiance, il se gardait bien, soit par une naturelle retenue, soit par une juste appréhension des hommes qui l’entouraient, de livrer quoi que ce fût de ses secrets de politique, de famille ou de gouvernement. Il écoutait, et Napoléon, ayant parlé, croyait avoir convaincu. Les procédés étaient pour lui en donner l’illusion ; le silence paraissait un acquiescement, et ces caresses de langage où se plaît, à l’orientale, la courtoisie russe, lui semblaient des engagements. De fait, Alexandre n’avait rien donné, ou presque, que des phrases de politesse par qui il n’avait rien promis ni rien cédé. Il ne s’était engagé nettement sur aucune question, et, en ce qui touche le mariage, il avait laissé Napoléon faire toute la route.
Cette route, Napoléon l’a faite, si l’on peut dire, dans les deux sens. Il a vu d’abord les avantages d’une alliance avec une maison qui, comme la sienne, est nouvelle, qui n’est point encore dynastiquement établie selon les formes européennes, où nul intérêt politique, dès qu’on admet les lignes générales qu’il a tracées, ne va à l’encontre des siens, et qui, se tournant vers l’Orient, tandis que lui-même restera en Occident, lui prêtera et recevra de lui un appui, sans qu’il ait à craindre une rivalité. Il croit voir dans l’Empire russe un gouvernement analogue au sien, et, de la similitude des appellations, il conclut que les institutions sont semblables. Il croit à l’autocratie, il croit au sénat ; il croit à une construction, moins parfaite à coup sûr que celle de son empire, mais du même ordre, sur de pareilles assises, plus neuve seulement, et s’adaptant à un peuple moins avancé, telle, par rapport à la France, que l’embryon à l’homme fait. Il imagine qu’Alexandre est le maître comme il l’est, dans sa famille, à sa cour, dans ses conseils, dans ses États, et il ne voit pas que cette apparence d’absolutisme dissimule mal une oligarchie dont le chef impérial est constamment à la merci d’une conjuration de mécontents, parents, courtisans, ministres ou soldats.
Or, si une alliance avec la France ne va pas contre les intérêts bien entendus de l’Empire russe, elle va contre l’intérêt de particuliers dont le mécontentement fut toujours fatal aux empereurs ; elle va contre les principes, les ambitions, les passions que la bureaucratie allemande a inspirés à l’aristocratie moscovite et aux chefs de l’armée ; elle va enfin contre les préjugés et les haines de la famille impériale tout entière.
Car Napoléon s’est prodigieusement trompé lorsqu’il a cru trouver un orgueil moins hautain et un accueil plus facile dans la maison de Russie que dans telle maison souveraine dont l’héritage de puissance et de gloire se transmet, de mâle en mâle, à travers les siècles, depuis une origine fabuleuse. Qu’elle n’ait eu existence à peu près historiquement certaine qu’à dater du XVIe siècle ; qu’elle soit parvenue au pouvoir suprême par l’élection, le XVIIe siècle commencé ; qu’elle ait échoué par femme dans une branche cadette des Holstein-Goltorp ; qu’elle ne garde point, après Catherine II, une goutte de sang des Romanov ; que, dans cette maison, la dynastie cahotée passe du mari à la femme, du cousin à la cousine, revienne, retourne, des descendants de Pierre aux descendants d’Ivan, au travers d’assassinats, de dépositions, d’adultères, de suppositions d’enfants, c’est là une ancienne histoire, aussi mal connue, aussi profondément oubliée que l’histoire qui date d’hier. L’impératrice-mère, l’épouse de Paul Ier, a apporté en Russie la morgue des princes allemands dont elle est la fille, les préjugés d’une cour minuscule où l’occupation majeure est de s’instruire des généalogies et d’étudier les traités du blason, les formes d’une étiquette d’autant plus stricte qu’elle s’applique à moins de gens. De Montbéliard, où Catherine II la fit chercher en 1776 pour épouser son fils Paul, sur Pétersbourg où, à présent, elle demeure la première, elle a enté la formule de la dynastie à l’allemande, se perdant dans les âges et transmettant de mâle en mâle à l’infini le fief souverain : elle y croit peut-être ; en tout cas, elle fait semblant. De plus, la haine de la France nouvelle, l’horreur de ceux qui ont tué le Roi, le mépris de celui qui a pris sa place, et ce mépris, contre Napoléon, accru d’exécration après l’exécution du duc d’Enghien, le petit-fils de ce prince qui, avec une galante magnificence, a fait à la comtesse du Nord les honneurs de Chantilly. Ce qu’elle veut pour ses filles, ce n’est point un despote jacobin, si puissant qu’il soit, mais des princes, des princes vrais, qui aient du sang bleu aux veines et qui descendent de races de dynastes. Elle a marié son fils Alexandre à une princesse de Bade, son fils Constantin à une princesse de Saxe-Cobourg ; elle marie sa fille Alexandrine à l’archiduc Palatin, sa fille Hélène au prince héréditaire de Mecklembourg, sa fille Marie au prince héréditaire de Saxe-Weimar, sa fille Catherine au prince de Holstein-Oldenbourg. De ces maris, certains sont de tournure médiocre, de santé compromise, d’intelligence discutable, de fortune nulle ; il n’importe : ils sont Allemands et d’ancienne maison ; cela seul compte. Ce qui compte plus encore, c’est d’échapper au Corse, avec qui toute union est sacrilège. Dans sa propre famille, l’impératrice a vu livrer sa nièce, Catherine de Wurtemberg, à Jérôme Bonaparte. Elle a vu le propre frère de l’impératrice régnante épouser Stéphanie Beauharnais, et, dans une maison alliée, la reine de Bavière, sœur de la même impératrice, ne pouvoir empêcher l’union de sa belle-fille, la princesse Auguste, avec Eugène Beauharnais. De ces défaillances des princes allemands, son orgueil s’est rehaussé et s’est rendu plus intraitable. Toute la superbe de sa maison est en elle, accrue du pouvoir sans contrôle qu’elle exerce depuis la mort de Paul, sur la cour, sur ses filles, sur ses fils, sur l’empereur, sur certaines parties de l’administration, et, en fait, sur la politique tout entière.
Contre elle, Napoléon se heurte donc ; mais, à y regarder de plus près qu’il n’a fait jusqu’alors, doit-il tant regretter que, pour une alliance dynastique telle qu’il la souhaite à présent, la Russie lui échappe ? Il dira plus tard : « C’est la seule cour où les liens de famille dominent la politique » ; mais, en ce moment, l’histoire de son temps lui montre Pierre III assassiné de l’ordre de sa femme, et Paul Ier assassiné de l’aveu de son fils. Où qu’il porte ses regards, ce ne sont que meurtres et adultères, et le sang de Catherine la Grande est-il pour le rassurer ? Puis, ne faut-il pas que, au type dynastique que lui-même représente, la femme qu’il épousera ajoute l’alternative d’un type dynastique dûment établi, célébré par les poètes, illustré par les artistes, tel qu’on ne puisse le méconnaître et qu’il affirme l’alliance ? Or, de type dynastique, la famille de Russie serait jusqu’alors embarrassée d’en présenter un, et elle en a de bonnes raisons. Enfin, il veut que, dans la famille où il prendra sa femme, la réputation soit établie que « les filles soient des moules à enfants ». Or, s’il consulte, on lui dit que les sœurs de la grande-duchesse qu’il pourrait épouser sont médiocrement fécondes : l’aînée est morte sans hoirs, la seconde a deux enfants, la troisième un seul vivant, la quatrième n’en a point encore : c’est de quoi réfléchir.
Et, quand se présente une archiduchesse, quelles lignées, au contraire, chez les Lorrains comme chez les Habsbourg ! les quatorze enfants de Léopold de Lorraine, les seize de François Ier, les huit de Joseph II, les treize de François II ; et, chez les filles de Marie-Thérèse, les dix-sept enfants de Marie-Caroline de Naples, les quatre de Marie-Antoinette de France, les six de Marie-Amélie de Parme ! On ne compte pas les morts, et c’est un axiome en Europe que la fécondité des filles d’Autriche.
Par là, Napoléon trouve donc à se satisfaire et combien plus du côté de l’antiquité, de la noblesse et de l’illustration de la race ! Cette maison de Lorraine qui, par preuves et titres, remonte à Adalbert, comte de Metz, vivant en 1033, s’étale sur l’Europe et y joue, durant sept cents ans, un des grands rôles jusqu’au jour où, en 1736, elle est absorbée par la maison de Habsbourg. Ces Habsbourg, illustres depuis le Xe siècle, ont réalisé l’empire universel ; vainement remonterait-on les âges : nulle souveraineté comparable, nulle étendue pareille de possessions. Les mers s’ouvrent pour eux ; des continents nouveaux surgissent pour recevoir leur loi ; ce n’est point l’Europe seule qu’ils entraînent dans leur orbite, ce sont les deux Amériques, l’Afrique et l’Asie. Si leur puissance a décliné, si les Bourbons l’ont ébranlée, et si, dans la plus grande partie de leurs États, ils se sont même substitués à eux, c’est en se réclamant de leur sang et en se disant de leur race. La France, depuis trois siècles, a reçu d’eux presque toutes ses reines : Éléonore qu’épousa François Ier, Élisabeth qu’épousa Charles IX, Anne qu’épousa Louis XIII, Marie-Thérèse qu’épousa Louis XIV, Marie-Antoinette qu’épousa Louis XVI. C’est donc une tradition de la Maison de France que renouera Napoléon, et, à présent, n’est-ce pas que le prestige de sa gloire a aboli la Révolution, n’est-ce pas que les acclamations qui l’accueillent ont étouffé les invectives contre l’Autrichienne, n’est-ce pas que son autorité est assez fermement établie pour que, en se rattachant aux souvenirs du passé, en les évoquant devant les mémoires oublieuses, il n’ait rien à redouter des colères d’il y a quinze ans ? Telle est l’illusion et telle la vanité des choses.
Une archiduchesse n’est point une femme comme toutes les autres ; c’est un être qu’on ne saurait imiter ou contrefaire, qui, à travers le monde, porte des traits où l’on ne saurait méconnaître son origine. Quiconque tient à la maison d’Autriche en reçoit le type distinctif ; c’est la preuve de la naissance illustre et la marque de la race.
Ce type – ce stigmate, diront les physiologistes qui verront dans le prognatisme ainsi transmis une marque certaine de dégénérescence – consiste en un développement anormal des maxillaires et surtout du maxillaire inférieur, et, d’une façon concomitante ou secondaire, en un développement plus ou moins exagéré de la lèvre inférieure. Il est fixé dans la maison d’Autriche avec une telle persistance que très peu d’individus y échappent. Comme il est une tare, ceux qui ne présentent point l’anomalie faciale, paraissent, au moins la plupart, avoir subi d’autres anomalies moins facilement constatables, mais pires. Aussi loin qu’on remonte dans les documents graphiques, le stigmate saute aux yeux : il caractérise Charles-Quint et toute sa lignée espagnole, Maximilien et toute sa lignée autrichienne : donc, il est antérieur. Le voici attesté par les portraits des ducs de Bourgogne, par l’effigie de Marie, leur héritière, et aussi par la statue de bronze de Maximilien Ier. Peut-être l’union de Maximilien et de Marie de Bourgogne, prédisposés l’un et l’autre par une succession atavique qui paraît déjà longue, en-a-t-elle déterminé la fixation définitive dans la Maison d’Autriche ; peut-être les unions consanguines ont-elles contribué à l’y maintenir ; en tout cas, il est un titre de gloire, un motif d’orgueil pour qui le porte, et l’on n’est point d’Autriche si l’on n’a la grosse lèvre.
Dans le pennon généalogique de l’archiduchesse Marie-Louise, sur les trente-deux quartiers, six sont d’Autriche, quatre de France, quatre de Bavière, deux de Lorraine, deux de Neubourg, quatre de Brunswick-Hanovre et Wolfenbuttel, deux d’Œtingen, deux de Parme, deux de Bavière-Palatin, deux de Saxe et deux de Brandebourg-Bareith. L’archiduchesse tient le sang d’Autriche. d’Éléonore-Marie, épouse de Charles IV de Lorraine, et des empereurs Léopold Ier et Joseph Ier ; le sang de France de Philippe, premier duc d’Orléans, et du Grand dauphin, fils lui-même de Marie-Thérèse d’Autriche ; le sang de Bavière de Marie-Anne-Chrétienne-Victoire, qui épousa le Grand dauphin, et dont la grand’mère était Marie-Anne d’Autriche, de la Palatine, épouse de Philippe d’Orléans et de Dorothée-Sophie, épouse d’Odoard Farnèse II de Parme ; elle tient le sang de Lorraine de Charles IV, le sang de Neubourg d’Éléonore-Marie, épouse de Léopold 1er d’Autriche, le sang de Brunswick du duc Louis-Rodolphe, le sang d’Œttingen de Christine-Louise, épouse de Louis-Rodolphe de Brunswick, le sang de Saxe d’Auguste II, le sang de Brandebourg-Bareith de Christine-Everhardine, femme d’Auguste II, le sang de Brunswick-Hanovre de Wilhelmine-Amélie, épouse de Joseph Ier d’Autriche. Pour ses trente-deux quartiers, elle n’a, au cinquième degré, que seize ancêtres, car, dans sa ligne paternelle comme dans la maternelle, elle a une double ascendance commune. Ainsi se trouve-t-elle tenir son atavisme dans une proportion écrasante des maisons de Lorraine, d’Autriche et de Bourbon, puisque sur soixante-deux ancêtres depuis la cinquième ascendance elle en a neuf de Lorraine, onze d’Autriche, treize de Bourbon. En montant plus haut, la proportion du sang d’Autriche croîtrait encore.