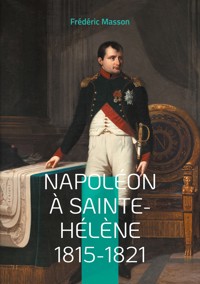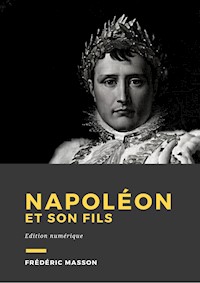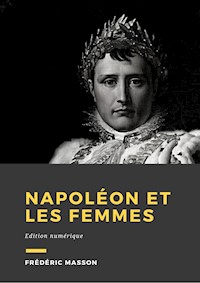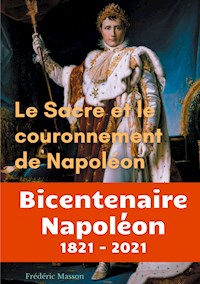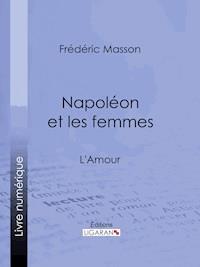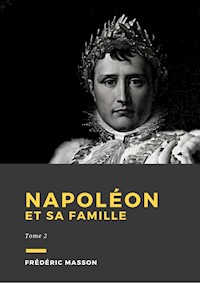
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
"Dans l’intimité familiale, on n’écrit pas tout ce qu’on dit ; on ne dit pas tout ce qu’on pense. — La pensée, la parole échappent ; de l’écrit, que reste-t-il au bout d’un siècle ? Sans doute, il existe des archives privées où doivent être conservés des témoignages singulièrement précieux ; mais, en solliciter seulement l’accès engage sinon à des mensonges, au moins à des omissions, et certainement à des jugements influencés ; je devais ici surtout, pour beaucoup de raisons, conserver une indépendance intacte et entière."
Ceci est le tome 2 sur 2 de cet ouvrage de référence.À PROPOS DE L'AUTEUR
Louis Claude Frédéric Masson, né à Paris le 8 mars 1847 et mort à Paris le 19 février 1923, est un historien français, spécialiste des études napoléoniennes et secrétaire perpétuel de l'Académie française. Issu d'une famille de hauts magistrats, sa sœur mariée à Édouard Lefebvre de Béhaine, Frédéric Masson se destinait à la diplomatie et devint bibliothécaire au ministère des Affaires étrangères.En 1886, il fonde la revue Les Lettres et les Arts, qui paraît du 1er janvier 1886 au 1er décembre 1889. À partir de 1894, Frédéric Masson se consacre principalement aux études napoléoniennes dont il devient, en son temps, le spécialiste incontesté, régnant sur une armée de secrétaires et de documentalistes dans son vaste appartement du 122 la rue La Boétie à Paris, puis dans son hôtel particulier de la rue de La Baume. Il est élu à l'Académie française le 18 juin 1903, en remplacement de Gaston Paris, et reçu le 28 janvier 1904 par Ferdinand Brunetière. Il en devint le secrétaire perpétuel le 20 mai 1919.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Napoléon et sa famille
Tome 2
Frédéric Masson
– 1897 –
NAPOLÉON ET SA FAMILLE
PAUL OLLENDORFF, ÉDITEUR 28 bis, RUE DE RICHELIEU
VIII. LES BONAPARTE EN L’AN X
BRUMAIRE AN IX. — NIVÔSE AN X (Novembre 1800. — Janvier 1802.)
La montée. — Madame Bonaparte, la mère. — Son genre dévié. — Ses placements. — L’hôtel de Fesch. — Rivalité avec Joséphine. — Disgrâce de Lucien. — Voyages aux eaux. —Les protégés corses. — Joseph. — Le droit d’aînesse. — Les ambitions. — Mortefontaine. — L’hôtel Marbeuf. — Lucien. — L’ambassade d’Espagne. — Buts divers. — La cour de Madrid. — Les présents. — Le traité de Badajoz. — Refus de ratification. — Démission de Lucien. — Polémique avec le Premier Consul. — Nouveau traité. — Retour à Paris. — Correspondances intimes. — L’hôtel de Brienne. —Elisa. — Fontanes. — Voyages. — Santé. — Le groupe Fontanes. — Paulette. — Saint-Domingue. — L’expédition. — Son urgence. —Enthousiasme. — Choix du chef. — Les retards. — Responsabilités. — Calomnies contre Paulette.— Caroline. — Murat et le corps d’armée de réserve. — Passage en Italie. — Correspondance avec Napoléon. — Armistice de Foligno. — Traité avec Duveyrier. — Rançon du Pape. — Visite à Rome. — Projet de voyage à Naples. — Demande de congé. — Le roi d'Etrurie. — La Cisalpine. — Retour à Paris. — La Motte Saint-Héraye, l’hôtel Thélusson, Neuilly. — Traitement réglé. — Jérôme. — Le collège de Juilly. — Études terminées. — Faiblesse du Premier Consul. — Première croisière. — Lettres à Gantheaume. — Embarquement pour Saint-Domingue. — Conclusions à tirer. — État d’esprit de Napoléon. — La famille. — Les mâles. — Les femelles. — Sentiments corses.
Pendant que se négocie et que s’accomplit, au milieu de ces péripéties étranges, le mariage de Louis avec Mme de Beauharnais, les membres de la famille ont poursuivi leur marche ascendante et il convient d’en marquer sommairement le progrès et d’en indiquer les étapes. Mme Bonaparte n’a point de rôle qui lui soit réservé ; grâce à ce fils qui l’a faite illustre, elle est riche et oisive. Sauf la richesse qui lui plaît, peut-être regretterait-elle des choses du passé, le pays natal, les parents, les amitiés de là-bas, la liberté de vivre à sa guise et d’agir à sa mode. Mais l’argent la console. Elle le disperse par l’Europe entière, afin, semble-t-il, de trouver une sorte de trésor où que sa destinée la porte et, par un sentiment qui n’est point si rare chez les épargneurs de son espèce, elle préfère perdre ses dépôts plutôt qu’avouer qu’elle les a faits. C’est par hasard que, en germinal an XI (mars 1803), Alquier, ministre à Naples, apprend que cinq ou six ans auparavant, Mme Letizia a fait déposer chez un nommé Forquet, banquier de la place, une somme de 11 806 ducats — (au change de 4 fr. 40, 51.940 fr. 40) et que ce banquier ayant été pillé, elle n’a pu rien tirer de sa créance. Elle n’a rien dit ; elle n’a élevé aucune réclamation près du Premier Consul : c’est Alquier qui de lui-même propose que les 50.000 francs, dus à Mme Bonaparte soient imputés sur les sommes payées par le roi de Naples aux Français victimes de pillages ou d’assassinats. Elle est ainsi : elle se montre peu, ne parle guère, chemine à bas bruit, opère des placements ici, là, en Corse, en Espagne, en Italie, peu en France où elle ne possède rien d’apparent — et cela par quantité de subalternes, généralement petits cousins, surtout par son frère, Fesch. Elle vit de préférence avec lui et en une telle intimité que lorsque Joseph vend l’hôtel de la rue d’Errancis où il lui offre l’hospitalité, c’est avec. Fesch qu’elle va habiter dans la superbe maison Hocquart, rue du Mont-Blanc, au coin de la rue Saint-Lazare — maison de financiers du temps passé, que Fesch, alors en plein courant de spéculations et de fournitures, a achetée dès le 25 ventôse an VIII (16 mars 1800). De l’hôtel, Mme Bonaparte meuble une partie à ses frais : les deux salons au rez-de-chaussée, puis les chambres qu’elle occupe, mais ce compte est fort sommaire puisqu’il s’élève en tout à 14.000 francs. Il ne lui plaît point de dépenser ; outre que la plupart des choses qu’elle pourrait acheter lui paraissent inutiles, elle pense déjà et constamment que les beaux jours peuvent ne point durer. Mais pour économe quelle est, elle n’en a pas moins d’orgueil et n’en tient pas moins à sa prééminence dans la famille : il lui déplaît de céder le pas à Joséphine et celle-ci qui s’en est aperçue, « s’efforce par d’adroites précautions d’éviter toutes les occasions » où, en présence du Premier Consul, de tels conflits risqueraient de se produire ; elle est pleine de ménagements et d’égards pour la mère de son mari et, quoiqu’elle sente fort bien la malveillance, elle parvient d’ordinaire, à force de tact et de bonne éducation à sauver les apparences et à maintenir, dans les relations de famille, une harmonie extérieure. Mais, pour cela, il ne faut pas qu’on s’avise de faire du mal aux enfants de Mme Letizia. Alors, toute l’âpreté, toute la violence corse, refoulées par la volonté d’être une dame à la française, monte en chaleur à la tête, déborde en paroles, ne pouvant se satisfaire en actes. Quand Lucien est disgracié, son chéri Lucien, l’enfant de son cœur, le persécuté, l’homme de génie, elle court aux Tuileries, et, s’adressant au Premier Consul, Joséphine présente, elle reproche à Fouché les bruits que la police répand contre Lucien, demande justice de ce misérable prêtre qui a battu son enfant. De Fouché, elle passe à Joséphine, disant les sociétés qu’elle fait avec lui, et les 30.000 francs, qu’elle reçoit par mois pour être sa complice. Joséphine, à son ordinaire, fond en larmes. Mme Bonaparte redouble ; Napoléon est obligé d’intervenir pour protéger sa femme et imposer silence à sa mère. En l’absence du cher enfant, elle se consacre à Lolotte, sa fille aînée, qu’il a mise en pension chez Mme Campan. Par chaque courrier elle écrit à Madrid des lettres brèves, volontairement insignifiantes à cause (le la poste, mais où l’on sent une puissance de passion contenue plus éloquente que les phrases. Elle vit fort isolée d’ailleurs, tous les siens ayant l’humeur voyageuse et courant les eaux pour des maladies souvent imaginaires. En germinal (avril 1801), son frère qui jusque-là lui a tenu fidèle compagnie est impérieusement appelé par ses affaires en Corse où il est devenu l’un des grands propriétaires terriens. Aussi, en messidor (juin), se décide-t-elle à accompagner, à Plombières, Joséphine avec qui elle est politiquement réconciliée et qui ménage en elle la mère de Louis. De Plombières, elle va à Vichy, faire une saison, revient à l’automne à Paris et s’y tient. Malmaison ne l’attire guère à cause des Beauharnais, et Mortefontaine l’intimide par la société qu’on y reçoit : elle n’y paraît donc guère qu’aux jours de famille et passe son temps à Paris où, bien que n’ayant point de prétentions à diriger la politique, elle ne manque point d’affaires par le nombre de protégés qu’elle s’ingénie à placer : cousins, petits parents et amis de Corse. Pour eux, elle sait fort bien écrire de style impératif aux divers ministres et, si l’on tarde à la satisfaire, elle tourne ses lettres de rappel d’un ton qui ne souffre ni n’admet la réplique. La Corse est sa chose ; les Corses sont ses gens ; on ne-fait rien pour eux ; on est ingrat. A quoi pense Napoléon de ne point appeler de là-bas le clan entier pour s’en entourer ? Mais, dès Toulon, il était ainsi : il rudoyait Costa, il n’admettait point qu’on lui parlât corse. Elle, au moins, est restée fidèle au passé et puisqu’on n’avance point ses Corses à son gré, elle prend en main leur cause. Qui vient de l’Ile sur le Continent et y cherche une place est assuré de trouver en Mme Lelizia une protectrice fort zélée— pourvu toutefois qu’il soit du bon parti ; car, à Paris, en l’hôtel Hocquart, elle est restée d’Ajaccio contre Bastia, elle tient toujours aux factions anciennes ; elle n’a rien oublié, rien pardonné, ni rien appris. On a suivi la montée de Joseph : elle a été singulièrement rapide. Dès les premiers jours où Bonaparte gouverne, Joseph est associé à toutes les grandes opérations de la paix : avec les États-Unis, avec l’Empereur, avec le Pape, avec l’Angleterre ; partout revient ce Joseph Bonaparte, conseiller d’Etat, et, outre la gloire qu’il en tire, les profits ne sont pas médiocres, car, en ce temps, on fait fortune à signer des traités. Mais Joseph ne semble point rechercher ces occasions ; chaque fois que le Premier Consul le désigne, c’est une contrainte qu’il paraît exercer, et c’est comme une faveur que Joseph accorde en acceptant. Il condescend, par unique bonté d’âme et pour tirer son cadet d’embarras, à se charger de besognes inférieures et qui ne sont point au pair de son mérite : car il est né pour la première place. Napoléon l’occupe, soit, Joseph consent à la lui laisser, parce que c’est en France ; mais il ne se considère pas moins, vis-à-vis de Napoléon, comme le supérieur, à titre d’aîné et de chef de famille. Napoléon a le fait ; mais lui, Joseph, a le droit et, des Bonaparte, quoi qu’il advienne, c’est lui le premier. Ce droit d’aînesse, Napoléon le supporte plus impatiemment à proportion qu’il monte, mais il le subit et le reconnaît. Par lui, le cadet, tout doit venir à Joseph, « le fils de la poule blanche ». C’est vis-à-vis de Joseph que sont les devoirs, c’est lui qui recueille les biens amassés et qui en fait la répartition, qui règle les intérêts et distribue les prébendes, tout vient naturellement en ses mains et c’est à lui qu’on s’adresse. D’ailleurs, à l’égard de Napoléon, Joseph ne se met point, lui, dans de mauvais cas, comme fait Lucien. Il n’a point de boutades, il souffre peu du besoin de s’épancher ; il paraît froid, il semble calme, il choisit ses confidents, les garde et se les attache. Ceux-ci savent seuls les secrètes ambitions qu’il dissimule et peuvent deviner jusqu’où il les porte. Tout le reste du monde, devant ses airs d’indifférence dégagée, demeure convaincu que c’est ici un homme modeste, sans nul désir de pouvoir, heureux d’une sorte d’obscurité et ne cherchant que les. délices de la campagne avec les agréments d’une société d’élite. Sans doute, la campagne qu’il faut à cet homme modeste n’est point médiocre ni banale. Chaque jour presque, elle s’arrondit : fermes, biens nationaux ou patrimoniaux, forets, prés, jachères, ce qui s’achète ou s’échange, tout ce qui l’entoure vient accroître le domaine. Et c’est une pareille folie d’embellissements ; or comme rien ne s’y prête mieux que le Grand et le Petit Parc, ce sont constamment des nouveautés pittoresques, temples, obélisques, souterrains, ponts, baraques, granges, tours, belvédères, montagnes même ; et comme il y a là, presque à demeure, Arnault, Casti, Andrieux, Boufflers et Fontanes, et qu’il ne manque point de rimailleurs à la suite, chaque fabrique, chaque fontaine, chaque rocher, reçoit son inscription latine, française ou italienne, toujours célébrant les délices de la campagne, les bienfaits de l’obscurité et les jouissances d’une âme pure, A Paris, l’homme modeste a trouvé trop médiocre aussi l’hôtel de la rue d’Errancis, vilain quartier, maison d’impure, fi ! D’ailleurs cela n’a coûté en l’an VI que 60.000 francs ; on y a dépensé, il est vrai, avant d’y entrer 28.000 francs, et à présent, cela revient à 150, mais qu’on en donne 120, c’est marché fait. Joseph n’a point attendu qu’il ait trouvé un amateur : à l’audience des criées du tribunal de la Seine, le 19 thermidor an IX (7 août 1801), il a acquis le magnifique hôtel construit en 1717 par Blouin, le valet de chambre de Louis XIV, sur un terrain, jadis en marais, acheté en commun avec la fille de Mignard, la comtesse de Feuquières, de M. Davy de la Faultrière, seigneur de la Gilquinière, maître ordinaire de la Chambre des Comptes. De Blouin, l’hôtel est passé à M. Davane de Saint-Amarand et, de lui aux époux Michel. Ces Michel, enrichis par la finance et décrassés par une charge de secrétaire du Roi, ont tant d’argent qu’ils marient l’une de leurs filles au duc de Lévis, cousin de la Sainte Vierge, et la seconde au marquis de Marbeuf, le neveu de l’ancien commandant en Corse. Celle-ci eut en succession l’hôtel à qui elle donna son nom de dame, mais son titre lui coûta cher : elle fut guillotinée en l’an II. C’étaient ses héritiers qui vendaient et le morceau était de prix, car l’hôtel ouvrant par une grande et belle cour sur le faubourg Saint-Honoré poussait son jardin jusqu’aux Champs-Elysées ; il était entre les plus réputés de Paris pour le luxe de son ameublement et l’agrément de son site, mais, pour qu’il plût à Joseph, ne suffisait-il pas qu’il fût l’hôtel Marbeuf ? Entrer ainsi dans la maison et dans les meubles de ces Marbeuf qui, à Joseph enfant, avaient représenté ce qu’il y avait de plus grand en France parce que c’était ce qui était le plus grand en Corse, n’était-ce point réaliser son élévation, se la rendre tangible, se prouver à lui-même qu’elle était achevée ? Au retour de ses voyages, quels récits Charles Bonaparte ne faisait-il point de ce palais et qui sait si Joseph lui-même, seize années auparavant, n’avait point passé en solliciteur le seuil qu’à présent il franchissait en maître ? Combien pourrait-on citer d’hommes qui aient jamais éprouvé une telle satisfaction d’amour-propre et de vanité, et ne semble-t-il pas que celle-ci a dû être plus sensible à Joseph que toutes celles qu’il avait reçues, et toutes celles même qu’il recevrait par la suite ?
Si la fortune de Joseph pouvait passer pour faite, celle de Lucien, au début de l’an IX restait à faire. Certes, il avait trouvé l’argent pour acheter sa maison de la rue Verte et sa campagne du Plessis, mais qu’était cela pour lui ? Or, en lui retirant le portefeuille de l’Intérieur, Napoléon avait eu sans doute pour objet principal de se séparer d’un collaborateur devenu dangereux ; mais, en même temps, et par manière de compensation, il avait prétendu ménager à son frère les moyens de s’enrichir et de conquérir en peu de temps toutes les satisfactions de l’opulence. De cette façon, Lucien assagi, adouci et calmé, redeviendrait quelque jour l’allié qu’il trouvait sans prix et sur lequel il faisait le plus de fonds pour les grandes entreprises. L’occasion offerte, Lucien était certes disposé à en profiter, mais dans une vue toute différente de celle qu’imaginait Napoléon. L’échec qu’il avait reçu en brumaire an IX, avait été le plus douloureux qu’il eût encore subi. Il était tombé du pouvoir alors qu’il s’y croyait à jamais établi et qu’il n’avait de doutes que sur les moyens qu’il emploierait pour en franchir le dernier échelon. Il en était tombé par la volonté de son frère, à l’anniversaire de cette journée— la Saint-Cloud, comme il disait — où lui seul avait sauvé la partie compromise, où lui seul avait rempli la besogne dont profitait surtout ce frère ingrat et envieux qui le chassait. Pour Lucien, tout ce qui avait suivi Brumaire, tout ce qui avait fait de cette journée du coup d’État l’ouverture d’une ère nouvelle — constitution antiparlementaire, institutions démocratiques, gouvernement, représentatif, administration centralisée, —tout cela, où il n’était entré à peu près pour rien, n’avait qu’une importance à peine appréciable. Le 18 brumaire était assez : c’était l’Alpha et l’Oméga. Tout avait été accompli par là, et, de là, le reste découlant n’était qu’un travail médiocre, où les inférieurs suffisaient. Puisqu’il avait fait le 18 brumaire, c’était lui l’auteur du reste et, loin de reconnaître qu’il eut commis des fautes et qu’il eût soulevé l’opinion, il attribuait sa disgrâce uniquement aux hostilités qu’il avait éveillées, à la jalousie du Consul, à l’inimitié de Joséphine. Quant à l’occasion, c’était par une ingratitude de plus qu’on avait choisi la publication du Parallèle. Quoi ! par une pensée de haute politique à laquelle applaudissait tout son entourage, et que sans doute Napoléon partageait lui-même, il avait voulu forcer l’opinion, déterminer, en créant en ce sens un courant national, à la fois l’hérédité et la stabilité du pouvoir consulaire, et c’était lui que, par une sorte de trahison, le Consul sacrifiait à Fouché et à Joséphine ! Puisque l’on rompait l’espèce de pacte qui lui avait attribué une part du gouvernement civil, n’était-il pas en droit d’agir pour son compte et de chercher ses garanties ? On lui avait enlevé le ministère, qui l’empêcherait d’affecter le Consulat ? Mais, pour politiquer, pour conspirer, pour vivre même hors de la sphère de son frère, il fallait qu’il se rendît indépendant, qu’il fit tout de suite une fortune et une grande fortune. Il ne comptait point son traitement : un misérable traitement de cent quarante mille francs, à peine de quoi nourrir ses gens. D’ailleurs, il faut du temps pour faire une fortune par l’économie et, devant témoins, d’une façon formelle, il a annoncé son retour à date fixe, l’année écoulée. Donc, quel moyen ? Durant que sa voiture roule de Paris à Orléans, à Beaugency, à Tours, à Bordeaux, croit-on qu’il y songe ? Fi ! il écrit des lettres humoristiques à sa sœur Elisa et il prodigue ses soins à la petite Egypte — plus communément appelée Lili, — aux deux ans de laquelle il a la singulière fantaisie de montrer les Espagnes. Il roule, sans s’inquiéter ni des difficultés qu’il rencontrera, ni des avantages qu’il tirera de sa place, tant il est convaincu de réussir en diplomatie comme il fit en administration. Néanmoins, il lit Wicquefort et y puise des maximes. Dès cette époque, on enseignait, il est vrai, aux Relations extérieures que « le livre de Wicquefort (L’Ambassadeur et ses fonctions) était très mal fait et qu’il était rempli de maximes hasardées et de principes douteux », mais Lucien n’en était point à cela près et le célèbre diplomate Vicford lui inspirait une admiration très sincère. Qu’aura-t-il à faire à son arrivée, et quelles questions devra-t-il traiter ? Il l’ignore entièrement puisqu’il est parti sans avoir eu le temps matériel d’ouvrir un carton ou de feuilleter un dossier ; mais, à tout, le Premier Consul et Talleyrand croient avoir pourvu en ne lui laissant qu’un rôle de pure ostentation. Dix-huit jours avant qu’il partit de Paris, alors qu’il n’était en rien question de son ambassade, Alquier a signé à Saint-Ildephonse, un traité par lequel, moyennant l’abandon de la Toscane au prince de Parme, époux d’une infante, la Louisiane a été rétrocédée à la France, Berthier est venu combiner sur place une action commune en vue du ravitaillement de l’Égypte et d’une expédition contre le Portugal. Il reste pour Lucien des signatures à échanger, des profits à recevoir, une action à exercer pour obtenir que les traités ne restent point lettre morte et que les promesses soient exactement tenues. Quant aux négociations, s’il s’en trouve, elles ne devront être menées que sur des instructions formelles venues de Paris et en référant au Premier Consul à toute occasion. Arrivé à Madrid le 15 frimaire (6 décembre 1800), après un arrêt prolongé à Bordeaux et une tentative de retour, sous prétexte que la peste était en Espagne, Lucien s’établit tout de suite non point en ambassadeur, mais « en gentilhomme de race princière » venu pour régler, de haut et sur un pied d’égalité avec les souverains, les relations entre les deux pays. Il affecte un air dégagé, écrit ses dépêches d’un style d’ironie qui lui paraît grand seigneur ; il prétend éblouir la cour et la ville de son luxe intime ; il a des maîtresses titrées, mais besogneuses. Sa légation qu’on l’a laissé composer uniquement de ses familiers, de ses courtisans et de ses gens d’affaires — Bacciochi, Félix Desportes, Sapey, Arnault, Thibaut — est comme une maison princière où l’on aurait mauvais ton. On s’y dispute ses faveurs, mais le bien de la chose est le moindre des soucis. Dans sa suite, Lucien a mené deux peintres : Le Thière et Sablet ; ce sont eux les plus occupés à chercher des raretés pour le maître. Laquais, équipages, hôtel, réceptions, tout est du dernier goût avec une nuance de simplicité dans les livrées qui est comme une concession aux idées républicaines et donne une note d’incognito. Ces façons réussissent ou semblent réussir : en tout cas, il en est certain : « Je suis comblé de faveurs, écrit-il, j’ai rompu la barrière de l’étiquette ; je suis reçu quand il me plaît et en particulier ; je cause affaires avec le Roi et la Reine ; le prince de la Paix, loin de s’en alarmer, s’en réjouit. » Et l’on signe, ou même l’on resigne avec lui tous les traités qu’il présente : le 9 pluviôse (29 janvier 1801), traité d’alliance pour envahir le Portugal, si le Portugal ne consent point à abandonner l’alliance anglaise ; le 24 pluviôse (13 février), convention au sujet de la direction à donner aux troupes de terre et de mer contre l’Angleterre et ses colonies ; le 30 ventôse (31 mars), traité — déjà passé avec Alquier cinq mois auparavant — pour Parme, la Toscane et la Louisiane : trois traités en deux mois sans compter les mêmes conventions ! Il était d’usage que, à la signature d’un traité, les plénipotentiaires reçussent en présent, des diamants, montés d’ordinaire en tabatière ou disposés autour d’une miniature du souverain. Ces présents, réglés par la réciprocité, et dont l’initiative appartenait selon les cas à l’une ou l’autre des puissances signataires, avaient, année moyenne, formé pour la France, de 1777 à 1789, en y comprenant les présents de congé, une dépense totale de 226.000 livres. Sous l’ancien régime, un présent diplomatique ne dépassait guère 30.000 livres, et le plus ordinairement se tenait très au-dessous. Sous le Consulat, on s’était fixé aux mêmes chiffres : 30.000 aux envoyés des grandes cours, 18 à 20.000 pour ceux des petites. A l’occasion du Concordat, par exemple, Consalvi eut une boîte de 15.000 francs et Spina une de 8.000. Ces traités avec l’Espagne n’étant point « des traités de paix ou d’alliance, » le Premier Consul refusa « de rien donner ». Or, pour ces traités, Lucien, de son propre aveu, eut, delà cour de Madrid, vingt tableaux de maîtres de la Galerie du Retiro, et deux cent mille écus de diamants montés ; et, au témoignage d’un de ses fils, comme présent de congé, le Roi lui envoya son portrait en pied, de grandeur naturelle, placé dans un cadre doré que protégeait un bourrelet de papier de soie. Et, dans le papier de soie, il y avait pour cinq millions de diamants ! -, Durant ce temps, il est vrai, rien, absolument rien n’avait été fait pour ravitailler l’armée d’Égypte, nul effort, nulle tentative même, et l’expédition de Portugal, après de grotesques victoires de Godoy, avait abouti à la comédie de Badajoz. Ce n’avait été que sous la contrainte du Premier Consul que Charles IV avait simulé une guerre contre son gendre, le Prince régent. On avait eu l’air de se battre, du moins on avait tiré des coups de fusil ; puis, sur l’annonce que les troupes françaises approchaient pour prendre part aux opérations, ce qui pouvait rompre les manœuvres concertées ou les rendre trop sérieuses, le Roi s’était empressé de se rendre avec la Reine à Badajoz où le prince de la Paix les avait rejoints et où Lucien le savait accompagnés. Tout de suite, et à point nommé, les Portugais s’étaient présentés pour traiter. On en avait donné l’honneur à Lucien qui avait présidé aux négociations et qui, sans nul pouvoir, contre les instructions et les ordres même du Premier Consul, avait, au nom de la France, mis son nom de Bonaparte au bas d’un traité « qui n’avait ni le style, ni la forme diplomatique », dont quantité d’articles étaient « inconcevables » et dont le projet définitif n’avait pas même été présenté au gouvernement français. Les Portugais, en enlevant la signature (17 prairial, fi juin), s’étaient flattés que le Premier Consul n’oserait, ni ne pourrait désavouer son frère, et que Lucien engagé par la reconnaissance à les soutenir, serait assez fort pour les protéger : ils se trompaient. Courrier par courrier, Napoléon refusa sa ratification et d’un ton qui ne laissait point d’espérance. Ce n’était point pourtant que le Premier Consul sût ou voulût savoir quel rôle avaient joué dans la négociation certains diamants bruts du Brésil, de plus grand prix encore que les diamants espagnols. A l’égard de Lucien, il attribuait uniquement son empressement à son ignorance des formes et comprenant quelle mortification porterait à son amour-propre le nouvel échec que la politique le contraignait de lui infliger, il employa tous les moyens pour la lui rendre moins sensible et pour adoucir un coup dont il ne se dissimulait point la pesanteur et que pourtant il ne pouvait lui éviter. Par Talleyrand et par Berthier, il lui fît écrire pour lui expliquer les raisons politiques et militaires qui le déterminaient ; lui-même, dans des lettres très explicites, dictées d’un ton de modération singulier, il prit soin de détailler expressément ses critiques. Même, il essaya de fouetter Lucien par une phrase à laquelle celui-ci ne fut point resté insensible en d’autres occasions : « Serait-il possible, lui disait-il, qu’avec votre esprit et votre connaissance du cœur humain, vous vous laissiez prendre à des cajoleries de cour et que vous n’ayez pas le moyen de faire entendre à l’Espagne ses véritables intérêts ? » Mais Lucien ne pouvait et surtout ne voulait rien comprendre : son piédestal s’écroulait, il n’était plus le jeune prince régissant en maître la politique de son pays, disposant ses armées et réglant ses alliances, mais un agent imprudent qu’un ministre reprenait et dont le Premier Consul désavouait la signature. Il tombait au néant, et qu’allaient dire les Espagnols et surtout les Portugais ? Ces magnifiques présents, reçus dès la signature du traité, était-il logique ou même prudent de les retenir, le traité étant rejeté ? Il n’y avait qu’un moyen de sortir d’embarras : partir, et partir tout de suite. Courrier par courrier, Lucien envoie sa démission d’ambassadeur et il le signifie en ces termes à Napoléon : « Vous m’indiquez dans votre lettre toutes les fautes que j’ai faites, selon vous, dans ma négociation. Je crois y avoir répondu d’avance. Je ne nie point qu’il me manque beaucoup de choses ; je sais depuis longtemps que je suis trop jeune pour les affaires et je veux me retirer en conséquence pour acquérir ce qui me manque... Je compte partir pour Madrid dans trois jours, et là j’attendrai mon successeur. » (9 messidor, 28 juin.) Mais, ce successeur, l’on peut tarder à le nommer. Pourquoi l’attendre ? « Je resterai à Madrid jusqu’au retour de ce courrier, mais pas davantage, écrit-il, quatre jours plus tard au Consul. Il y va de ma santé que je quitte ce climat, mais, ma santé fût-elle bonne, je ne connais qu’une puissance capable de me retenir en Espagne, c’est la mort. Je sais que si j’étais assez malheureux pour partir sans lettres de recréance, il faudrait m’attendre à un nouveau torrent de calomnies et de disgrâce, je m’y attends et je persiste. Je m’y attendais aussi en quittant Paris. J’avais calculé qu’on porterait l’effronterie jusqu’à me déchirer dans votre salon, jusqu’à m’accuser de viol, d’assassinat prémédité, d’inceste, etc., et cependant je suis parti... » Comment revenir sur de telles déclarations et ne point tenir de telles menaces ? Qui a fait entendre raison à Lucien ou plutôt quelles affaires le retiennent et de quel genre — affaires de cœur ou affaires d’argent ? Ce qui est certain, c’est qu’il ne part point, et il a bien raison : carie Premier Consul, qui, dès le refus de ratification, a fait engager à Paris, sous ses yeux, de nouvelles négociations avec le Portugal, réserve à Lucien pour guérir sa vanité, ménager sa considération aux yeux des étrangers et couvrir sa retraite, la signature du traité définitif : « Ce n’est que le traité de Badajoz rectifié avec suppression des articles inadmissibles et adjonction d’articles indispensables. » Lucien, qui est resté, reçoit donc le 18 thermidor (6 août) le projet officiel, et c’est à lui que l’on paraît s’en rapporter pour le faire aboutir ; mais, feignant de ne point voir que son intérêt seul est en jeu et gardant cette attitude d’offensé dont il croit prendre des avantages, à chaque poste, il ne manque pas de faire valoir que, « dans l’état de son esprit et de sa santé, chaque jour de séjour à Madrid est un grand sacrifice ». Les attaques contre son traité l’exaspèrent. « J’ai le plaisir, écrit-il au Premier Consul le 1er fructidor (19 août), de lire tous les courriers, dans vos journaux, des articles sur la paix du Portugal qui ne seraient pas autrement s’ils étaient dictés par les ennemis les plus acharnés de ma réputation. Au reste rien n’a plus le droit de m’étonner. » Un mois se passe encore au milieu de ces récriminations, de ces polémiques avec Napoléon et Talleyrand ; ne pouvant obtenir, malgré ces coups d’épingle réitérés, ces injures et même ces menaces, que le Premier Consul lui envoie ses lettres de rappel avant qu’il ait signé le traité, le 29 fructidor (16 septembre), il s’adresse à Joseph : « J’écris à mon frère, lui dit-il, qu’en finissant cette affaire, je veux absolument me retirer et que, depuis deux ans, j’ai senti qu’une retraite de quelques mois m’est indispensable... Si nous ne pouvons avoir la paix, je quitterai à regret une affaire non terminée, mais il y a des bornes aux devoirs comme aux droits el ces bornes sont atteintes. Je vous aime, après mes enfants, au-dessus de tout... Mais je crois que tous les liens qui m’attachent à vous ne pourraient pas m’empêcher d’être à Paris au mois d’octobre. Epargnez-moi cette sottise et rappelez-moi sans désagréments. Je ne mérite pas tous ceux que j’ai eus, mais je braverais comme eux le dernier, celui de quitter l’Espagne sans lettres de recréance. » Le 7 vendémiaire an X (29 septembre), treize jours après cette lettre à Joseph, Lucien peut enfin, grâce aux efforts de Gouvion Saint-Cyr, qui a fait toute la besogne, signer ce fameux traité ; mais encore faut-il que la paix soit proclamée à Paris, que les ratifications soient échangées à Madrid, reviennent à Paris et que, de Paris, on ait pu en accuser la réception. La paix est proclamée le 15 vendémiaire (7 octobre) ; mais il faut vingt jours au moins pour l’accusé de réception. C’est le dernier délai qu’a fixé Lucien : « Votre courrier, écrit-il à Talleyrand le 2 brumaire (24 octobre), m’a prouvé que le Premier Consul ne veut pas consentir à mon retour et j’ai perdu l’espoir de recevoir par le retour de mon dernier courrier mes lettres de récréance. J’ai pris mon parti en conséquence et, dans dix jours, je pars...
L’éclat que va produire un départ sans lettres de récréance retombera sur l’injustice d’un gouvernement que j’ai assez bien servi pour n’avoir pas dû m’attendre à sa défaveur... Vingt-quatre heures après le retour de Gaspard qui vous a porté les ratifications, je roule vers Paris. Cette nouvelle brouillerie entre mon frère et moi fera plaisir à bien du monde, mais la brouillerie de mon frère est un mal moindre que le dépérissement de ma santé et l’exil de ma patrie et de ma famille. » Et en effet, le 17 brumaire (9 novembre) — non pas dix, mais quinze jours après cette expédition — il quitte Madrid et de propos si délibéré que, d’avance, il l’a annoncé à Fontanes qui en a fait une nouvelle dans le Mercure du 15. De crainte d’être arrêté en route par un ordre du Consul, il court nuit et jour, sous un nom supposé — son secrétaire est le général Thiébaut et lui-même le secrétaire du général. — Le 23 brumaire (14 novembre), il est à Paris. Sauf le temps du voyage, c’est bien là le terme qu’il a fixé à ses amis, la veille de son départ, dans le salon de Mme Bonaparte. Encore ses amis ont-ils trouvé le temps long. A peine s’il était parti de Paris que par chaque courrier ils pressaient son retour, insistaient sur la nécessité de sa présence, sur les conseils qu’il pourrait donner pour hâter la marche progressive du Consul vers le rétablissement de la société ancienne. « Revenez au plus tôt en France, lui écrivait Fontanes, le 10 messidor (29 juin). Vos chênes et vos marronniers valent mieux, croyez moi, que les orangers d’Espagne et de Portugal. Finissez vite cette guerre et que la France vous revoie : elle n’eut jamais plus besoin de vous. » Et quelques jours après : « Votre bon démon ne doit-il pas vous ramener bientôt ? J’ai grand besoin de vous et, là-dessus, je ressemble à toute la France. Que de bons conseils, que de vérités courageuses à dire ! Quel appui vous pouvez donner dans le grand jour ! » Tout le groupe réactionnaire, catholique et surtout monarchiste, qui dès le ministère de l’Intérieur, a accaparé Lucien et auquel Lucien s’est livré, aspirait à son retour, et c’était pour cela peut-être, en dehors de quantité d’autres raisons d’ordres divers, que Napoléon longeait la courroie et n’eût point été fâché que Lucien prolongeât son séjour en Espagne. Mais qu’y eut-il fait de plus et n’avait-il point atteint son but ? N’en rapportait-il pas une immense fortune, cinquante millions a-t-on dit ! Et il ne s’en cache point, car laissant à Mme Bacciochi la maison de la rue Verte, dès le 1er frimaire (21 novembre) il loue, pour trois années, moyennant un loyer annuel de 12.000 francs en numéraire, le magnifique hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique, n°200, « consistant en une grande cour ayant son entrée par ladite rue, grand corps de bâtiment entre cour et jardin, basse-cour, écuries et remises, bâtiments en dépendant, grand jardin et autres dépendances ». Brienne après Marbeuf, n’est-ce point tout dire pour les Bonaparte, et que peut-il leur arriver par surcroît ? Mais le luxe des Brienne, si grand qu’il soit, ne suffit point à Lucien, il met. dans l’hôtel les ouvriers comme si déjà il était propriétaire, et, en même temps, au Plessis, il se prépare à tout reconstruire, achète tous les entours, bouleverse le château, les jardins, les communs, jette l’argent à belles mains pour que, dès le printemps, il puisse s’y installer avec sa cour. Celte cour, Elisa devra nécessairement la tenir,, car l’absence de Lucien, loin de rompre les liens qui étaient entre eux, semble les avoir renforcés. Nulle comme elle n’a souffert de son départ et c’est pour elle qu’a été la vraie disgrâce. Du même coup perdre un frère tel que Lucien et un mari tel que Bacciochi, c’était trop ! Heureusement, Fontanes lui était resté. Elle trouvait à sa société des agréments de tous genres, où la politique, le pédantisme et la littérature entraient pour quelque chose. Quant à Fontanes, il en avait tiré tout ce qu’il était, il en devait tirer tout ce qu’il serait et cela valait bien un peu de complaisance. Elisa n’était point belle, « d’une taille ordinaire, mince, maigre, point de gorge, les bras menus, la jambe et le pied jolis ; une figure bien faite, profil antique ; des cheveux noirs, des yeux noirs, la peau assez blanche, la bouche assez grande, de belles dents », voilà le physique. Nul charme de femme, mais « dans la physionomie, une extrême mobilité i dans la même seconde, elle crie, elle pleure et elle rit et console ceux qui l’entourent ». Cela seul peut sauver le masculin des traits et le laid des yeux à fleur de tête. Cela excuse l’amant, mais ne justifie pas l’amour. Après le départ de Lucien pour l’Espagne, Elisa a mené, rue Yerte, une vie fort retirée des Tuileries et à peine traversée par quelques séjours à Mortefontaine et au Plessis, surtout au moment des vacances de Lolotte. On ne la voit point à Malmaison, mais, au moins, Fontanes lui tient fidèle compagnie : « Je vis très retiré, écrit Fontanes à Lucien ; je ne sors que pour aller m’entretenir de vous avec celle qui vous aime le plus. N’allez pas croire que c’est une des mille Arianes que fait votre absence. C’est mieux que cela : c’est une âme et un esprit comme le vôtre. Mes livres, la rue Yerte et Madrid voilà où sont toutes mes pensées. Mme Bacciochi peut vous dire si je vous suis tendrement attaché. Elle a la bonté de me recevoir quelquefois. Elle aime à m’entendre parler de son frère. » Elisa poussait même ses bontés pour Fontanes au point d’accepter de tenir avec Lucien l’enfant « qu’il s’était avisé de faire » à sa femme. Il est vrai que Fontanes avait une si galante façon de solliciter ! « Si j’ai un fils, écrivait-il à Lucien, il aura votre génie ; si c’est une fille, elle aura les grâces de votre sœur. » Ce fut une fille et qui mourut tôt. Il en eut une autre et qui fut encore nommée Christine par Lucien et Elisa. (On sait que c’était de ce nom de Christine, qu’il avait donné à sa seconde fille, que Lucien appelait d’ordinaire sa femme, Catherine Boyer.)
A l’été, Elisa fort souffrante partit pour les eaux ; au passage à Paris, elle avait aperçu son mari, envoyé par Lucien de Madrid avec « le magnifique traité ». Son voyage fut si rapide que Bacciochi, retournant en Espagne et courant la même route que sa femme, ne put la rejoindre. Il s’en plaignait. — S’en plaignait-elle ? Elle vint à Barèges d’abord : le déplacement l’avait soulagée, mais les eaux lui firent grand mal. De là, à Carcassonne, pour consulter Barthez, fort en réputation dans le monde médical, et ayant à ses yeux ce prestige d’avoir soigné Charles Bonaparte dans sa dernière maladie : comme elle souffrait de l’estomac, elle pensait au cancer héréditaire. M. de Barante était alors préfet de l’Aude, mais, se trouvant lui-même indisposé, il chargea son fils de faire à la sœur du Premier Consul les honneurs de la ville. Elisa accepta d’autant meilleure grâce que voyageant sans aucune suite, elle était descendue dans une mauvaise auberge où, pour échapper aux punaises, elle couchait à terre sur un matelas. Déjà, à Barèges, elle s’était fort ennuyée, n’ayant rencontré personne de sa connaissance, et c’était presque une bonne fortune de tomber à Carcassonne sur un jeune homme d’agréable mine, qui fût au courant des nouvelles, de son monde, des pièces qu’on jouait et des livres à lire. En ces conditions, un tète à tète de deux jours ne parut point lui déplaire. Barthez lui avait donné une consultation copieuse ; mais. Montpellier étant presque sur la route, elle alla demander avis à la Faculté et à Fouquet en par lieu lier. Mais comment se reconnaître parmi tant d’ordonnances ? La pauvre chère dame, comme on l’appelait dans la société du Plessis, ne s’en trouva pas mieux et revint fort malade à Paris où elle crut enfin découvrir le remède qui lui convenait : « du lait de chèvre, seul, sans pain, sans eau, et six tasses seulement par jour ». Mais comme le reste, le lait de chèvre s’usa : et rien n’y put, ni son monde habituel, ni le trantran repris des voyages au Plessis, ni même le retour si désiré de Lucien. « Elle ne m’a pas encore paru si malade, écrit un de ses intimes. Elle a quelquefois été aussi souffrante, jamais aussi abattue, son œil est devenu fixe et sa physionomie, jusqu’à présent si mobile, n’éprouve plus qu’une longue habitude de douleur. Elle sortait autrefois de crise par un sourire, par un mot gai qui consolait tout le monde ; elle n’en sort aujourd’hui que pour plaindre ceux qui la voient de l’ennui qu’elle croit leur causer. On sent à ses discours, à ses regards, qu’elle n’a plus de confiance dans sa jeunesse, dans sa force, dans son courage. Elle n’a plus l’aimable prétention d’être au ton de tout le monde ; elle s’occupe du soin plus touchant encore de ne gêner celui de personne... Elle disait hier dans le salon : « Je m’en vais, j’empêche tout le monde de s’amuser, j’attriste tout le monde. » Et pourtant, toute moribonde qu’elle est, la pauvre chère dame ne sait rien refuser aux incessantes demandes de Fontanes qui se hâte de profiter qu’elle vit encore : c’est le temps où, sur les instances de Fontanes mis en branle par Chateaubriand, elle s’occupe à protéger Laborie qui vient d’être pris en flagrant délit d’espionnage dans le cabinet de Talleyrand. Et, pour le sauver, que de pas elle doit faire, que de démarches et combien de lettres ! Elle a gain de cause à la fin. « J’ai reçu la lettre de Mme Bacciochi, écrit Chateaubriand, elle est toujours adorable. » C’est le temps où elle détermine la fortune de Fontanes lui- même, où elle s’efforce pour tous ses collaborateurs, où elle obtient des subventions et recrute des abonnés pour le Mercure, où elle s’établit la protectrice du petit monde néo-catholique et se rend à chaque heure la garante des bonnes volontés des émigrés rentrés — s’entend de ceux qui sont amis de M. de Fontanes. Elisa est la seule de ses sœurs que Lucien retrouve à Paris ou qui y soit établie à demeure. Paulette, pour commencer par elle, vient en effet de partir pour le grand voyage qui va exercer une influence suprême sur sa destinée. Depuis qu’il occupe le pouvoir, le Premier Consul s’occupe des moyens de recouvrer Saint-Domingue, de rendre à la France sa colonie la plus importante et la plus riche. En trente ans — car, cédée à la France en 1697, au traité de Ryswick, le courant ne commence à s’y porter qu’après la banque de Law et l’affaire du Mississippi, et l’effort n’est décisif que dans les quinze années de paix qui suivent la terminaison de la guerre de Sept ans — la partie française de Saint-Domingue était arrivée à un tel point de prospérité que, en l’année 1789, déjà mauvaise et inférieure en produits aux précédentes, la France par 577 bâtiments y avait importé pour 122 millions de livres et en avait exporté en marchandises à destination unique de France pour 163 millions. Importations de marchandises profitant aux manufactures nationales, importations et exportations réunies alimentant le commerce maritime, revenu presque total de la colonie, évalué à 280 millions de livres, dépensé en France par les créoles habitant la métropole, voilà ce que des théories humanitaires avaient fait perdre à la nation, ce que le Premier Consul entendait chaque jour regretter par sa femme, par les parents, les amis de sa femme, tous créoles, tous propriétaires d’habitations, tous exaspérés par la sauvagerie des nègres, tous déclarant que rien n’était plus aisé que de reprendre possession de cette immense puissance d’argent — l'île aux huit cents sucreries, aux trois mille indigoteries, aux huit cents cotonneries, aux trois mille caféières, file bénie dont administrateurs et colons, voyageurs et historiens s’accordaient à vanter la salubrité. Aussi, dès le lendemain de Marengo, le projet est nettement arrêté dans l’esprit du Consul et il le marque en négociant avec l’Espagne la rétrocession de la Louisiane, destinée à fournir une base d’opération et un sanatorium s’il y a lieu et à assurer le ravitaillement en bois et en bestiaux. Aussitôt les préliminaires de paix signés avec l’Angleterre (11 vendémiaire an X — 3 octobre 1801) il met tout en action. Peut-il tolérer que, quoique dépendant encore nominalement de la métropole, Saint-Domingue ne soit plus d’aucun secours ni pour les anciens propriétaires, ni pour le commerce français, ni pour le trésor national ; qu’un nègre, un esclave, l’y parodie lui-même, le traite à égalité, proclame comme lui des constitutions, conclue des traités, se décerne de son chef une puissance dictatoriale et viagère ? Peut-il admettre, lui, gardien de l’honneur national, que la France, sans lutter, même sans protester, reconnaisse et proclame l’autonomie de son plus riche domaine ? Peut-il consacrer la spoliation des créoles, tarir cette source inépuisable et légitime de richesses, accepter comme un fait acquis la supériorité sur les blancs de ces nègres assassins et incendiaires ? L’Égypte conservée, Saint-Domingue était utile ; l’Égypte perdue, Saint-Domingue est indispensable ; y rentrer, ce n’est pas seulement exercer un droit incontestable, c’est remplir un devoir impérieux : c’est rendre son activité au commerce national, donner une impulsion énergique à l’industrie, rétablir la marine marchande ; c’est tirer de la pire misère une classe entière de citoyens intéressants, fournir à l’émigration un débouché nécessaire, assurer enfin à ceux qui seront employés pour reconquérir la colonie les éléments d’une richesse telle que les concessions de terre l’ont jadis procurée aux gouverneurs, aux intendants et, par eux, à quiconque s’est porté à coloniser. C’est bien ainsi qu’on le considéra dans l’armée : loin d’être regardé comme une disgrâce, ce fut une haute faveur de faire partie de l’expédition. « Il y eut, pour en être, une émulation extraordinaire, et le nombre des généraux et des officiers comparé à celui des soldats surpassa de beaucoup les proportions ordinaires. » On accorda cette grâce comme une sorte de compensation à beaucoup d’officiers qui n’avaient pu faire leur fortune en Italie ou en Égypte ou qui l’avaient défaite. Les sollicitations furent aussi vives de la part de l’élément civil que de la part de l’élément militaire, et, pour former les cadres administratifs de la colonie, aussi bien que pour constituer les cadres de l’armée, on n’eut qu’à choisir. Sans aspirer à des fonctions, quantité de gens demandaient encore à suivre l’expédition : créoles désirant rentrer dans leurs habitations, chercheurs d’aventures, commerçants de tous ordres, ouvriers de tous métiers : quiconque espérait se faire ou se refaire une fortune. Il y eut là un grand mouvement qu’il faut d’autant plus affirmer que le souvenir en a été plus vite perdu et que l’on se plut par la suite à découvrir d’autres mobiles à une décision que l’honneur commandait, que l’intérêt justifiait, que toutes les classes de la nation avaient désirée, et dont personne n’avait mis en doute le succès. Mais quel serait le chef ? Pour mener une telle entreprise, pour résoudre de son initiative les problèmes qui allaient forcément se poser et sur lesquels la distance ne permettrait point de demander et de recevoir à mesure des instructions ; pour remplir des intentions dont certaines ne pouvaient encore être exprimées en France et dont, même à Saint-Domingue, l’exécution dépendait des circonstances ; pour substituer l’autorité du capitaine général nommé par la métropole à la dictature de Toussaint à qui une fausse politique avait attribué des honneurs exceptionnels, le grade de général de division, la commission de général en chef, et jusqu’à la reconnaissance du pouvoir qu’il s’était attribué ; pour constituer, en face de l’Angleterre toujours hostile et des Etats-Unis déjà attentifs, tant avec l’ancienne partie française qu’avec la partie espagnole cédée par la paix de Bâle, une colonie florissante ; pour y réveiller l’agriculture et y rappeler le commerce, il fallait à Bonaparte un homme qui eût pénétré sa pensée et qui eût reçu la confidence de ses desseins les plus secrets ; qui lui fût attaché par des liens si étroits qu’il crût travailler pour lui-même en s’efforçant pour la France et que son ambition se confondît en quelque sorte avec celle du Consul ; qui joignît à une belle réputation militaire des talents d’administrateur et de diplomate, dont enfin l’esprit fût large, le cœur haut et les mains pures. Le nombre n’est jamais grand de tels hommes. Napoléon n’en trouva qu’un : Leclerc. Leclerc avait été son compagnon à Toulon aux premières heures de sa fortune ; il avait été, en Italie, entre ses affidés les plus intimes ; il s’était fait au 19 brumaire l’auxiliaire le plus utile de son coup d’Etat ; il n’était point de ceux qui cherchaient la richesse par tous les moyens et dont on dût appréhender les dilapidations et les extorsions ; enfin, il était l’époux de la sœur que Napoléon préférait et déjà un royaume n’eût point été trop pour elle. A Saint-Domingue, elle trouverait, avec les éléments assurés d’une fortune immense, toutes les satisfactions d’orgueil et de vanité ; elle y entraînerait sa cour, elle y donnerait des fêtes, elle y appellerait le luxe et le plaisir : car c’était bien plus à la colonisation qu’à la conquête que tous, et lui le premier, se plaisaient à penser, tous les anciens administrateurs coloniaux, tous les créoles s’accordant à dire que, pour faire rentrer les nègres dans l’obéissance, il suffirait de faire claquer un peu fort le fouet du commandeur. Depuis Brumaire, Leclerc, comme soldat, n’avait pas eu de chance. En lui confiant une division à l’armée du Rhin, le Premier Consul avait compté le sortir de pair et le mettre en ligne pour un commandement d’armée ; mais Leclerc n’avait pu se trouver qu’à une seule affaire, celle de Landshut, où ses dispositions avaient été bien prises et ou ses trois brigadiers avaient obtenu un joli succès, mais ce n’était point une bataille d’où sortît une illustration, c’était tout justement une attaque de poste. Durant la campagne, Leclerc ne put ensuite trouver sa belle, sa santé étant tout à fait atteinte et l’ayant forcé à se retirer sur les derrières de l’armée pour y faire des remèdes ; le Premier Consul avait été assez inquiet de lui pour que, à chaque courrier qu’il envoyait à Moreau, il demandât : « Leclerc se porte-t-il bien ? »... « Donnez-moi des nouvelles de Leclerc. » Revenu à Paris à l’armistice, il ne s’était point, à la reprise des hostilités, trouvé encore en état de faire une campagne active ; il avait dû être employé à Lyon avec sa division désignée pour faire partie de la nouvelle Armée d’observation en formation à Dijon. Après Hohenlinden et les préliminaires, le Premier Consul, rassuré, avait contremandé cette armée et chargé Leclerc d’organiser et de faire filer sur Bordeaux les brigades qui devaient composer le Corps d’observation de la Gironde (ventôse, an IX, mars 1801) ; au bout de trois mois, le 19 prairial (8 juin) il lui avait confié le commandement effectif de ce corps d’armée. Leclerc avait donc pu espérer qu’il allait enfin faire une campagne ; mais, d’une part, dès le 27 prairial (16 juin), il était prévenu que, pour des motifs politiques, aussitôt que les troupes hispanofrançaises se trouveraient réunies, Gouvion Saint-Cyr en prendrait le commandement en chef ; d’autre part, l’intervention si active de Lucien aux négociations de Badajoz avait précipité la paix avant même qu’il y eût eu rencontre avec les Portugais. Leclerc n’avait donc pu développer de talents militaires, mais il s’était montré organisateur et diplomate et il avait fait preuve d’une parfaite honnêteté. Incapable de se garnir les mains lui-même, comme tant d’autres avaient fait, il écrivait à Lucien : « Si tu trouves occasion de faire augmenter ma fortune à Madrid, je t’en aurai obligation. Le prince de Beauvau, en 1762, a été bien traité de la Cour. Elle ne me fera pas de peine en me traitant de même ; je suis aussi pauvre en sortant d’Espagne qu’en y entrant. » Et par le courrier suivant : « N’oublie pas, lui disait-il, que tu prends mes camées et que tu fais un cadeau à Paulette si tu fais la paix, non compris celui que tu me feras avoir et dont j’ai grand besoin. » Les généraux en chef qui, même en pays ami, attendaient qu’on leur donnât et ne prenaient point d’avance, étaient alors une rareté et l’on n’en aurait guère cité de tels. Sa conduite ne lui eût donc mérité que des éloges, s’il ne s’était avisé, durant une absence, de confier à l’un de ses sous-ordres le soin d’ouvrir les lettres qui lui étaient adressées, même par le Premier Consul : cela lui valut une algarade dont il put se souvenir, mais ne traça point d’ailleurs, car, lorsqu’il s’agit de désigner un chef à l’expédition projetée, Napoléon n’hésita point. Leclerc ayant eu vent de quelque chose et redoutant que le choix ne tombât sur lui, écrivait, dès le 20 thermidor (8 août), à Lucien : « Je crains l’embarquement, rassure-moi à cet égard, car je suis décidé à ne pas m’embarquer ; » mais d’autres avis l’avaient rassuré et lorsque, par une lettre du 16 vendémiaire an X (8 octobre), il fut appelé à Paris par le Consul, il croyait encore, en quittant son quartier général de Prao, près de Valladolid, qu’on allait lui donner le portefeuille de la Guerre. Néanmoins sa résistance fut courte : arrivé à Paris le 3 brumaire (23 octobre), il reçut et accepta le môme jour sa nomination de commandant en chef et de capitaine général de Saint-Domingue. Il avait ordre de partir le plus tôt possible et, pour un tel voyage, il fut leste en ses préparatifs, car le 28 brumaire (19 novembre) il était rendu à Brest. Pourtant, malgré les ordres réitérés du Premier Consul, ce ne fut qu’un mois après, le 23 frimaire (14 décembre), que la flotte aux ordres de Villaret-Joyeuse put mettre à la voile. Ce retard eut de terribles conséquences : il ne saurait être imputé à Leclerc ; doit-il, comme on l’a soutenu, être mis au compte de Paulette, laquelle accompagnait son mari à Saint-Domingue ? On a dit, répété, et l’anecdote passe à présent pour certaine, que Paulette aurait opposé une résistance désespérée aux ordres formels du Premier Consul lui enjoignant de partir avec Leclerc ; et cela parce qu’elle aurait alors été follement éprise de Lafon, de la Comédie-Française ; elle n’aurait point voulu le quitter, et, prolongeant à l’absurde son séjour à Paris, elle aurait compromis ainsi le succès de l’expédition. Or, voici les faits : Paulette a quitté Bordeaux à la fin de prairial (20 juin), lorsque Leclerc est entré en Espagne ; elle a passé la plus grande partie de l’été à Mortefontaine chez son frère Joseph et elle a fait aussi divers séjours à sa terre de Montgobert : il est possible que, dans ses voyages à Paris, elle soit venue au& Français, qu’elle ait pris plaisir à entendre Lafon ou tout autre, mais quoi ! est-ce un crime de se donner la comédie ? Quelqu’un pourtant a remarqué l’assiduité de Paulette, a certifié ses empressements ; — quelqu’un de la Comédie sûrement ? Certes, et c’est un témoin qui vaut créance, un témoin qui a été au courant de toute l’intrigue et qui, à l’annonce du départ de Paulette, s’est écrié : « Pauvre Lafon, il en mourra. » On nomme ce témoin : c’est Mme Duchesnois ; dès lors comment douter ? Cela passe des pamphlets dans les mémoires apocryphes et de ceux-ci dans l’histoire : or, ce témoin bien informé, ce témoin véridique, ce.témoin qui d’ailleurs n’a jamais témoigné, Mlle Duchesnois, n’appartenait alors ni à la troupe, ni à aucune autre : Mme Duchesnois a débuté aux Français le 15 thermidor an XI (3 août 1803) vingt et un mois après le départ de Paulette pour Saint-Domingue, sept mois après son retour en France. Ce n’est donc point pour Lafon que Paulette a retardé le départ de l’expédition ; mais nul doute pourtant que le retard ne soit de son fait. « Elle prit son temps, dit l’un des témoins prétendus, vint à Brest en litière portée à bras d’hommes. » — « Depuis quinze jours, dit un autre, l’escadre était prête à mettre à la voile ; l’ordre de départ avait été donné ; les vents étaient favorables et pourtant on restait dans le port. Une femme arrêtait tout le mouvement. » L’on insiste et l’on précise : c’est le lendemain de l’arrivée de Paulette que la flotte est partie. Or, ]\I me Leclerc a quitté Paris avec son fils le 22 brumaire (13 novembre) devançant son mari de quarante-huit heures, afin de pouvoir coucher en route. Le 26 (17 novembre), Leclerc, qui a couru jour et nuit, l’a rejointe un peu avant Rennes où ils se sont arrêtés ensemble chez Bernadotte. Le 28 (19 novembre), Leclerc qui a repris l’avance, est arrivé à Brest où les honneurs lui ont été rendus, en sa qualité de général en chef par l’armée et la marine, et le 29 (20 novembre), Paulette est arrivée à son tour. Elle a donc employé dix-neuf jours au plus à se préparer pour un tel voyage, et la flotte a mis à la voile dix-neuf jours après que Mme Leclerc était rendue à Brest. Cela parce que, à son arrivée, l’armement des vaisseaux était loin d’être terminé ; qu’à partir du 1er frimaire (22 novembre), le vent souffla en tempête d’ouest-nord-ouest presque sans interruption, amenant des désastres innombrables sur les côtes de France, de Hollande et d’Espagne ; que l’amiral enfin, jaloux de son indépendance et de son autorité, retarda d’autant plus que le général en chef le pressait davantage. Il ne se trouva prêt que le 20 frimaire (Il décembre) et, à ce moment, pour signaler sa galanterie à l’égard de la sœur du Consul, qui devait prendre passage à bord de l’Océan, son vaisseau amiral, il usa encore deux jours à lui offrir une fête. Mieux eût valu songer moins à des bals et embarquer un pilote pratique des côtes de Saint-Domingue, mais, à cela, Villaret ne pensa point. Il avait perdu vingt-trois jours à Brest ; il en perdit douze dans les parages de Belle-Isle, puis des Canaries, à attendre l’escadre de Rochefort ; et lorsque, après quarante-cinq jours de navigation, il arriva en vue du Cap Français, Toussaint, prévenu, avait fait enlever les balises et s’était mis en défense. Faute d’un pilote, Villaret se refusa à forcer l’entrée du port ; le Cap fut brûlé et les blancs furent massacrés. Quelle est ici la responsabilité de Paulette ? Elle avait pris galamment son parti d’un voyage dont, sans doute, elle ne prévoyait point tous les dangers, où même, sur la foi de ceux qui l’entouraient, elle imaginait des agréments, mais qui n’en présentait pas moins toutes sortes de risques. Elle s’était trouvée heureuse d’emporter comme viatique ce mot de son frère au bas des dernières instructions adressées à son mari : « N’oubliez pas de me donner des nouvelles de Mme Leclerc ; j’aime à penser qu’elle partagera aussi un peu la gloire de votre expédition, surtout si elle se met au-dessus des fatigues de la navigation et du climat. » Elle se reposait là-dessus, se tenant, elle aussi, pour un soldat, décidée à n’avoir pas peur, à ne point se passer de fantaisies— et c’était comme une coquetterie nouvelle, cet air de bravoure qu’elle donnait à son charmant visage, le contraste en était piquant et battrait irrésistible. Murat n’avait point été obligé d’aller si loin pour faire fortune. Après Marengo, où « il s’était conduit’ avec tant de bravoure et d’intelligence », que pour « lui donner une preuve toute particulière de la satisfaction du peuple Français, « les Consuls de la République lui avaient décerné un sabre d’honneur (4 messidor an VIII, 23 juin 1800), il était revenu à Paris où il comptait tirer bon parti de l’amitié que témoignait Joséphine à « son cher petit frère » et de l’intimité où était établie dans le palais consulaire « cette petite femme charmante qui se conduisait à merveille ». Caroline, en effet, logée à l’hôtel de Brionne, dans la cour même des Tuileries, ne quittait point alors Joséphine et Hortense. Elle était de toutes leurs parties de spectacle, de tous leurs voyages à Malmaison et s’accommodait au mieux de cette sorte de chaperonnât que Joséphine comme beaucoup de femmes de son caractère et de son âge, aimait à exercer sur les jeunes femmes. A l’arrivée de Murat, Caroline n’interrompit point ses assiduités, mais elle introduisit son mari en quatrième. D’ailleurs, fort petit garçon avec sa femme, ce soldat, et, au bal, avec son air martial, ses cheveux noirs, son physique de casseur, « tenant respectueusement les gants et l’éventail de cette petite personne mince et blanche qui dansait devant lui ». Au dehors, il se rattrapait. Sa propre grandeur l’affolait. Son alliance avec le Premier Consul lui montait au cerveau, il se tenait monté par là au-dessus de toute loi et de toute règle. Au retour d’une reconnaissance qu’il avait faite aux environs de Paris, en habits bourgeois, un préposé aux barrières eut l’insolence de lui demander le paiement d’usage : il l’éreinta à coups de cravache. « Il prétendait que son nom devait suffire et que qui