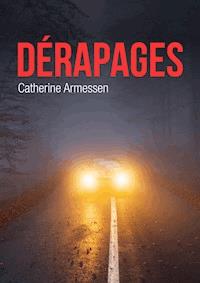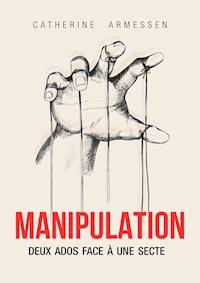Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les Passagères
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Jeune médecin, Alice s’installe en Sologne avec la ferme intention de retrouver son père, Maxime Derville, qui n’a jamais voulu la reconnaître.
La jeune femme est loin de s’imaginer que ces retrouvailles sont le début d’une longue quête de vérité.
Pourquoi a-t-elle l’impression d’être déjà venue chez Maxime ? Pourquoi sa mère, décédée depuis peu, lui a-t-elle caché que sa grand-mère a été assassinée ?
Fragilisée par le décès récent de sa mère, Alice a l’intuition que son équilibre dépend de la résolution de ces mystères.
Enquêter sur ce secret de famille va devenir chez elle une obsession.
La nature sauvage de la Sologne et l’incroyable personnalité de cette grand-mère énigmatique conspirent pour donner à ce polar régional son côté sombre et haletant.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Catherine Armessen est médecin et romancière. Après avoir écrit pour les petits (3-7 ans), elle a décidé de passer à la littérature adulte. L'auteur traite volontiers des sujets de société, comme l'alcoolisme ou les sectes.
Elle aime aussi les reconstitutions d'époque et le terroir. Son 3e roman
Manipulation a obtenu le prix Littré en 2008.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Noir obsession
© éditions les Passagères, 2023.
Tous droits réservés.
Catherine Armessen
Noir obsession
les passagères
I
Alice repoussa ses volets, satisfaite de commencer une vie nouvelle. La Sologne s’éveillait sous le soleil automnal, maisons à colombage, façades ornées de croix de Saint-André ou de losanges, arbres aux feuilles rouges ou jaunes.
S’efforçant d’oublier le cauchemar qui avait gâché sa nuit, elle se vautra sur son lit et prit au hasard un album dans sa pile de BD. Un vieux réflexe, comme enfiler un pull-over qu’on connaît par cœur au trou de mite près. L’album était hors d’âge, rassurant, sans surprise. Alice haïssait les surprises.
6 heures 30. Il était temps de prendre une douche. Elle actionna les robinets et prit le thermomètre de bain pour en mesurer la température. 38 °C. Parfait. Elle ôta son long tee-shirt et se posta sous la pomme de douche. L’eau ruisselait sur ses épaules nouées. C’était complètement idiot d’avoir mal partout quand on n’avait même pas trente ans. Alice avala un peu de l’eau purificatrice. Les pores de sa peau se dilataient sous la pression chaude, se délivraient de leur crasse. Cette douche était la première d’une longue série. Alice aimait passionnément se laver.
Vingt minutes plus tard, dans l’ordre chronologique habituel, elle fermait l’eau, enfilait une sortie de bain, frottait énergiquement sa chevelure rousse, attrapait l’éponge, nettoyait le bac à douche, lustrait les robinets, avant de se choisir un jean et un pull et de vérifier que ses chaussures étaient parfaitement propres. Puis elle attrapa sa sacoche, en vérifia le contenu, jeta un dernier coup d’œil à sa chambre, remarqua que l’oreiller était de guingois, fit demi-tour, le repositionna, prit du recul, jugea que tout était en ordre et descendit d’un pas léger prendre son petit déjeuner.
–Ah ! vous voici.
Louise Pujol se leva pour venir accueillir sa nouvelle pensionnaire : depuis son veuvage, elle tenait des chambres d’hôtes.
–Vous allez goûter à mon gâteau. Vous avez rendez-vous à quelle heure ?
–8h30. Votre sœur doit m’expliquer deux ou trois trucs avant le début des consultations, précisa Alice.
Louise soupira, déçue de ne pas pouvoir retenir son hôte pour bavarder.
–Je dois y aller.
Alice délaissa sa voiture pour marcher un peu avant son rendez-vous. Elle remonta les rues de la ville en longeant la Sauldre et accéléra le pas pour rejoindre la maison de santé. Des plaques de plexiglas indiquaient la présence de deux médecins, d’un infirmier, d’une psychologue et d’une kiné.
Alice poussa la porte. Planté devant un comptoir dont dépassait une tête frisée, un homme revendiquait le droit de parler au docteur Pujol.
–Elle ne consulte pas ce matin.
–J’exige de lui parler.
–Le docteur Estève est là, lui.
–Veux pas le voir, il me fait rien du tout.
Alice se retrouva en pays de connaissance, celui des râleurs, une espèce courante dans les cabinets médicaux. Elle prit le parti de rester en retrait et de suivre les échanges. Le ton montait, le gars ne lâchait pas le morceau ; de l’autre côté du comptoir, la fille résistait de son mieux à ses assauts. Les secrétaires médicales en prenaient toujours plein la tête. Un homme d’une quarantaine d’années sortit d’un bureau, nerveux, le crâne dégarni et le pantalon godaillant sur des chaussures aux semelles trop épaisses.
–Il y a un problème, Leila ?
–J’explique à monsieur que le docteur Pujol n’est pas là ce matin.
Le râleur poussa un cri qui tenait à la fois du cochon qu’on égorge et de l’âne en rut, une sorte de longue plainte qui commençait dans les graves pour finir dans des aigus qu’on n’aurait pas imaginés chez un type aussi grand. Il finit par tourner les talons. Leila exhala un long soupir : tous les dingues n’étaient pas enfermés.
–Vous désirez ? demanda-t-elle en découvrant Alice.
–J’ai rendez-vous avec le docteur Pujol. Je suis le nouveau médecin.
–Bienvenue, j’appelle Marlène.
Elle pianota sur les touches de son standard de ses ongles vernis de rouge vif.
–Elle vous attend dans son bureau. Vous allez contourner le bâtiment et vous trouverez sa salle d’attente. Pas question que je la fasse venir ici, avec l’olibrius qui vient de sortir.
Marlène Pujol affichait une belle soixantaine. Alice embrassa du regard le pantalon cigarette, les chaussures plates, le pull en cachemire, les yeux bruns et la bienveillance du regard.
–Bienvenue en Sologne, lança la sénior.
Leila avait prononcé les mêmes paroles. Marlène entraîna sa consœur dans son bureau dont elle referma la porte, on était toujours dérangé si on la laissait ouverte, ce cabinet devenait le château des courants d’air, les gens allaient et venaient comme s’ils étaient chez eux et vous mettaient le grappin dessus à la première occasion. Mieux valait se calfeutrer si l’on voulait souffler un peu. On se disait tu, hein, c’était plus commode.
–Elle t’a bien traitée, ma sœurette ?
–Je suis bien installée, cela me donne le temps de trouver un logement.
–Louise va être aux petits soins pour toi. Viens, je vais te faire visiter.
Elles firent le tour. A cette heure, la kiné était en visite et l’infirmier faisait sa tournée. Marlène proposa d’aller en « salle de perf » pour boire un café. La salle de repos était inattendue, avec son sofa recouvert de velours bleu, ses statuettes africaines qui voisinaient avec la machine à expresso sur un buffet paysan et ses étagères recouvertes de livres.
–Court ou long ?
Alice préféra un thé. Elles s’installèrent l’une à côté de l’autre. Marlène croisa ses longues jambes, souffla sur son arabica et se tut en observant sa consœur. Le silence qui s’établit avait des allures d’inquisition. Alice se raidit.
–Je te montre ton bureau ?
Elles reprirent leur visite. L’espace était grand et bien équipé. Pèse-bébé, négatoscope, échelle de vue, électrocardiogramme.
–Si tu vois quelque chose qui manque, n’hésite pas à me le dire. Je n’ai rien accroché aux murs, tu décoreras comme bon te semble.
Par la fenêtre, Alice aperçut un écureuil qui grimpait dans un chêne.
–Tu me parles des raisons qui t’ont poussée à quitter Paris pour un désert médical ? demanda Marlène à brûle pourpoint.
Marlène se tut de nouveau. Le silence suppose favoriser les aveux. Elle en fut pour ses frais.
2
Alice ne se remettait pas de la mort de sa mère. Elle restait coincée dans la chambre d’hôpital dans laquelle Thérèse Bonnel avait vécu ses derniers jours. Elle revoyait sans cesse le teint jaune, la peau tendue sur les pommettes, les orbites creuses, les bras amaigris, le ventre boursouflé qui saillait sous le drap.
Alice avala un comprimé de codéine car son cou lui faisait un mal de chien. La distance ne parvenait pas à l’éloigner des images qui rampaient dans sa cervelle, laides et gluantes, ruinant tous ses efforts pour s’en sortir.
Il y avait surtout l’instant maudit où Thérèse était sortie du coma qui avait précédé sa mort. Alice se souvenait du regard fou. Thérèse semblait possédée, terrifiée par quelque chose qui la dépassait. De son nez coulait un filet de sang. Alice avait croisé au cours de ses études des patients au seuil de la mort. Elle s’était forgé une cuirasse pour se préserver de ce sentiment d’impuissance devant l’extrême souffrance, la détresse qu’aucune médication n’est apte à soulager quand les gens ne sont pas prêts à quitter la vie. Cette nuit-là cependant, dans l’espace clos qui les retenait toutes les deux dans leurs ultimes échanges, elle n’avait pas reconnu sa mère dans la femme qui lui agrippait le bras. Thérèse qui ne rentrait jamais dans une église et se moquait des bigots, avait déliré autour de la punition divine dont elle était l’objet.
–Prends garde qu’elle ne t’atteigne. Reste loin de son pouvoir, avait dit la moribonde avant de retomber sur ses oreillers.
Alice cherchait en vain une explication à la signification de ces propos et faisait des cauchemars.
Elle regarda la paume de sa main dont avait disparu le cachet. La codéine permettait de supporter la douleur qui lui vrillait le cou et d’apaiser son malaise permanent. Elle calcula qu’elle avait encore droit à quatre comprimés aujourd’hui. Cette pensée la rasséréna.
Contre quelle menace Thérèse la mettait-elle en garde, cette fameuse nuit ? La question était obsédante. Alice ressentait encore les ongles de sa mère qui s’enfonçaient dans la chair du bras, la pression de ses doigts, la douleur infligée. « Prends garde qu’elle ne t’atteigne ». La voix était bien timbrée, le phrasé clair. Rien à voir avec un discours délirant, il s’agissait bel et bien d’un avertissement.
Alice ouvrit le tiroir de son bureau pour rédiger une ordonnance à son nom. Sa réserve de tranquillisants baissait. Pendant le week-end, elle aurait le temps de faire le plein de médicaments. La pharmacie qu’elle avait choisie se situait à trente kilomètres, une distance suffisante pour ne pas alimenter les ragots : L’imaginaire collectif prêtait à la profession une force de caractère et une santé héritées des dieux. Un médecin qui carburait aux cachets n’inspirait pas confiance.
Alice compta ses boîtes d’antalgiques. Mieux valait faire un stock. Elle se leva pour accueillir son prochain patient. Cela faisait déjà quinze jours qu’elle consultait dans la maison médicale.
Une jeune mère se leva, un cosy à la main contenant un placide bébé joufflu. Alice aimait ces consultations paisibles qui se centraient sur l’univers si particulier des bébés. À trois mois, ce petit Arthur ne connaissait de la vie que la frustration d’un biberon qui se faisait attendre puis la jouissance de le boire, niché dans la bienveillance de sa mère. Alice eut soudain envie de remonter le temps pour retrouver les bras de la sienne.
Le reste de la journée apporta son flux de microbes, d’allergies, de traitements à renouveler jusqu’à ce qu’Alice referme la porte sur son dernier patient. Elle rangea son bureau, vérifia que l’alignement des livres était parfait de même que la répartition des feutres à colorier dans le pot à crayons et le rang des flacons de désinfectant sur le chariot de soins.
Elle attrapa son manteau et son écharpe. De l’autre côté de la cloison, on entendait la voix d’Estève qui ne finirait pas avant vingt et une heures, la médecine l’avalait peu à peu mais ce type était incurable. À chacun sa névrose.
Dans la rue, un crachin froid et hostile la saisit à la gorge. Alice accéléra le pas pour rentrer dare-dare chez Louise. Quand elle atteignit la longère, le feu crépitait dans la cheminée.
–Ah ! te voilà, s’exclama Louise quand Alice poussa la porte, viens te réchauffer, il fait un froid de canard.
Alice accrocha son caban à la patère, s’approcha de l’âtre et s’assit en tailleur pour suivre la danse des flammes.
–Bois-moi ça, dit Louise en déposant sur la table basse un verre de vin chaud aux épices. Et avale aussi quelques gougères, sinon tu seras pompette. Quelle idée de faire de la marche à pied par ce temps !
–Ça me détend.
La pluie et le vent privaient Alice de ses joggings habituels. Elle s’astreignait à marcher, laissait souvent sa voiture sur le parking pour parcourir d’un pas vif les quatre kilomètres qui séparaient la maison de Louise du cabinet.
Louise laissa sa locataire se perdre dans la contemplation du feu et regagna sa cuisine. Alice aimait ces instants suspendus pendant lesquels la pensée flottait entre rêve et réalité en se perdant dans le jeu des flammes. Elle but à petites gorgées le vin bousculé par la saveur des épices. Chez Louise, Alice se sentait en sécurité.
–Je vais vous laisser, dit-elle quand la vieille femme réapparut.
–Reste donc, je fais table d’hôtes, ce soir. Toutes les chambres sont occupées, nous serons nombreux.
–J’ai commencé à faire les agences pour trouver une location.
–Prends ton temps. Que je loue la chambre à des gens de passage ou à toi, l’argent rentre toujours dans ma bourse.
Alice n’insista pas. Rester chez Louise lui convenait. Elle remonta dans sa chambre et en contempla le décor. Murs de pierre blanchis à la chaux, armoire rustique, bouquet de fleurs séchées trônant sur la commode. L’ensemble était aussi joli qu’impersonnel. De quoi s’émerveiller une nuit ou deux. Un endroit dont on repartait facilement pour rentrer chez soi.
Alice avait vécu dans un appartement moderne. Thérèse aimait les teintes froides. Elle avait repeint les pièces en gris clair et en blanc. Alice revit sa chambre d’adolescente, les murs qui disparaissaient sous les posters, le bazar, les canettes de Coca qui traînaient sur le sol. Elle repoussa ses souvenirs avec force et dîna d’un paquet de chips puis extirpa du tiroir l’adresse de celui qui l’avait amenée en Sologne.
Maxime Derville
3 Hameau des Étangs
3
La maison était isolée. Depuis la route, on la voyait à peine à cause du rideau d’arbres qui la masquait. Alice effleura de ses doigts le bois du portail qui brillait sous le soleil. Un ouvrage bien entretenu, dorloté par la lasure. C’était bizarre d’avoir laissé pousser des arbres aussi haut juste devant la façade exposée plein sud. Il n’y avait ni sonnette ni cloche. La boîte aux lettres rouillée envahie de prospectus suggérait que les nouvelles du monde n’étaient pas les bienvenues. À moins que le propriétaire soit absent.
Déçue, Alice passa son chemin et s’enfonça dans le hameau. On ne devinait la vie calfeutrée derrière la brique que grâce à la fumée qui s’échappait des cheminées. Il n’y avait dehors aucune âme qui vive. Un chat noir traversa la route.
Alice rebroussa chemin pour rôder de nouveau autour de la maison. Pour la contourner, elle s’engagea dans un chemin boueux mais là encore, la maison se déroba car le chemin débouchait sur un fatras de ronces emmêlées. Alice vit dans la barrière végétale le signe qu’elle ferait mieux de passer son chemin. Elle s’éloigna, le dos parcouru d’ondes glacées. La façade nord garderait son mystère.
Alice s’apprêtait à remonter en voiture quand elle vit un homme poussant une brouette chargée de bois qui avançait dans sa direction, un beauceron sur les talons. En apercevant l’étrangère, le chien se mit à grogner. Alice se raidit.
–Silence, Kalach !
L’homme qui venait de donner l’ordre était grand. Il avançait très droit, sans se presser. Sa démarche était assurée. Quand il s’approcha, Alice ne vit plus que son regard, étrangement bleu, perçant à travers des paupières bousculées par la vie. Des rides profondes sillonnaient ses joues.
− Vous cherchez quelqu’un ?
–Connaissez-vous Maxime Derville ? On m’a dit qu’il habitait cette maison.
–Qu’est-ce que vous lui voulez ?
Les cheveux étaient un peu longs, rejetés en arrière, d’un gris de cendre. Le nez droit, le port de tête altier, suggéraient de rester à bonne distance. Alice n’avait pourtant pas l’intention d’en rester là.
–C’est personnel, répondit-elle froidement.
–Dans ce cas, laissez un mot dans sa boîte aux lettres.
–Pour qu’il se perde au milieu des prospectus ?
–C’est un risque à prendre.
À demi-rassurée, Alice observait le chien qui lui flairait les mollets.
–Détendez-vous.
–Rappelez-le s’il vous plaît, il me fait peur.
–Pourquoi cherchez-vous Maxime Derville ? Personne ne vient jamais le voir.
Le chien venait de se coucher aux pieds d’Alice. Du sang se mêlait à sa bave, coulant d’une plaie de la langue. Alice ne pouvait détacher les yeux de la tache vermillon qui ensanglantait sa botte. Le beauceron haletait, immobile dans une fausse indifférence, le regard rivé sur son maître. L’homme ne cherchait pas à le rappeler. Il observait simplement la scène. Alice s’efforçait de garder son calme. Son cœur martelait ses côtes pour sortir de ce merdier. Le vent soufflait, il faisait froid
–Au pied, Kalach, entendit-elle.
Elle prit une goulée d’air. L’homme se rapprocha.
–Vous êtes médecin ? demanda-t-il en découvrant le caducée derrière le pare-brise.
–Je suis généraliste à Romorantin. Mon nom est Alice Bonnel.
Les yeux turquoise s’étrécirent.
–Quel est votre lien avec Maxime Derville ?
–Je n’en parlerai qu’avec lui.
–Laissez-moi vos coordonnées. Je les lui remettrai personnellement.
Alice extirpa de son portefeuille une carte de visite professionnelle. Elle inscrivit au dos son numéro de portable personnel.
–Dites-lui que j’ai très envie de faire sa connaissance, dit-elle en se glissant derrière le volant.
Ses mains tremblèrent quand elle remit le contact. Elle prit son temps pour s’éloigner. Avant d’amorcer le virage, elle jeta un coup d’œil dans son rétroviseur. Maxime Derville restait debout au milieu de la route avec son chien assis à côté de lui. Les yeux embués, la rage au cœur, Alice regarda disparaître de son champ visuel celui qui n’avait pas daigné reconnaître qu’il était son père.
Elle roula longtemps sans but, obsédée par l’image de l’homme aux yeux pareils aux siens que sa mère évoquait parfois, dans une version plus jeune, avec son allure de baroudeur, toujours vêtu d’un jean, un Nikon pendu au cou. Thérèse Bonnel l’avait follement aimé. Elle avait supporté ses absences prolongées quand il partait en reportage aux quatre coins du monde, connu la peur qu’il laisse sa peau dans un coin perdu du Liban, ses retours toujours difficiles parce que la guerre marque un homme et trace une frontière nette entre ceux qui la vivent et ceux qui la regardent à la télé.
Il avait découvert le ventre rond de Thérèse au retour d’une mission particulièrement longue. L’homme qui pouvait regarder sans sourciller des cadavres mutilés et des femmes pleurant leur enfant mort ; celui qui avait glissé sur des flaques de sang, supporté l’odeur immonde des tripes sortant de ventres explosés, avait été incapable d’affronter sa paternité. Thérèse avait accouché seule et ravalé ses larmes pour offrir à sa petite Alice un visage souriant. Quand plus tard l’enfant avait posé des questions, elle lui avait répondu en prenant soin d’agrémenter la vérité trop rugueuse de mots apaisants. Alice avait grandi avec l’image d’un père brillant autant par ses exploits de grand reporter que par son absence. Elle n’aurait su dire à partir de quand sa mère lui avait menti en lui cachant qu’elle avait retrouvé la trace de Maxime Derville.
Alice remua la tête pour chasser la tension qui croissait à la base de sa nuque. Derville n’avait pas réagi quand elle avait décliné son identité. Dégonflé ! Alice pila à cause d’un chevreuil qui venait de traverser devant son capot. La poussée d’adrénaline qui l’envahit aggrava sa colère. Derville était un pleutre qui fuyait ses responsabilités. Elle s’enfonça dans son siège et reprit sa route.
Elle rentra, prit soin d’ouvrir la porte sans attirer l’attention de Louise, gravit l’escalier comme une petite vieille à cause de son dos qui la martyrisait, referma la porte, goba quelques cachets puis se roula sous sa couette avec l’intention de dormir. Comme elle n’y parvenait pas, elle tripla la dose de tranquillisants. Bon prince, le médicament l’emporta dans un sommeil sans rêve.
4
Maxime resta figé dans sa posture bien après que la Clio eut disparu de son champ visuel. Son passé le rattrapait. Il shoota dans une pierre. Aucune des femmes qui s’étaient succédées dans sa vie n’était parvenue à lui faire oublier Thérèse. En la quittant il avait cru larguer définitivement les amarres mais il s’était trompé. La visite d’Alice le perturbait.
Il rentra chez lui et se fit un café italien serré à mort. Accoudé à la table de la cuisine, il se laissa envahir par les souvenirs.
Paris 1981. Les rues chantent Sardou et Berger. Il fait beau. Il se balade le long des quais, les bras chargés des livres qu’ils vient d’acheter à un bouquiniste.
Une femme l’interpelle. Elle est jolie : fluette, les traits fins, une peau de porcelaine.
–Monsieur ?
Il se retourne.
–J’allais acheter « Le silence de la mer » mais vous m’avez devancé. Pourriez-vous me le revendre ? j’avais projeté de le lire ce soir.
Tout avait commencé là, par un coup de foudre sous le soleil. Ils ne s’étaient plus quittés.
Derville lava sa tasse et partit au bûcher. Fendre du bois l’aiderait à évacuer le merdier du passé. Les images s’imposaient, la robe jaune pâle que Thérèse portait ce jour-là, son parfum orangé, les boucles blondes qui auréolaient son visage.
–Il va falloir marchander. Autant le faire autour d’un café, qu’en pensez-vous ?
La bûche s’ouvrit en deux comme une coquille de noix. Le côté sombre de Thérèse avait terni leur relation. Il n’avait pas supporté l’annonce de sa grossesse et s’était tiré à l’autre bout du monde. Peu reluisant mais indispensable.
Maxime positionna un rondin sur le billot et abattit sa hache. Quelques années plus tard, Célia était apparue dans son ciel avec ses deux marmots qu’il avait élevés comme les siens jusqu’au jour où il était rentré d’un reportage complètement vidé. La guerre au Liban faisait rage. Il partait en mission régulièrement et revenait avec de la boue et du sang plein la tête. Cela le rendait taciturne et désagréable. Célia lui avait annoncé qu’elle partait en Australie.
–Tu pues la mort, je n’en peux plus, avait-elle décrété en guise d’explication.
Elle n’avait plus donné de ses nouvelles. Il avait carrément pleuré, autant la mère que les deux gosses puis avait tourné le dos à tout espoir de fonder une famille.
Derville en était à sa dixième bûche. La sueur qui dégoulinait de son front gagna ses yeux, brouillant un instant sa vue.
La vie est ainsi faite. Un instant on est dans la photo puis le cliché change et les gens vous rayent de leur existence.
Alice Bonnel en serait pour ses frais. Il ne la recontacterait pas.
5
Marlène Pujol divisait en deux parties bien distinctes les gens qu’elle rencontrait. Il y avait les sinistres, les jamais contents qui ne voyaient que la partie du verre à moitié vide en affirmant que tout était mieux avant. Avant quoi, d’ailleurs ? Nul ne le savait exactement sauf ceux qui se vantaient d’avoir connu meilleure époque, avec de nobles valeurs. Les mêmes agressaient la caissière de leur supermarché, affirmaient leur supériorité à l’aide de subtils jurons, traitaient les plus jeunes d’ignares et d’incapables.
À côté de cette espèce irrécupérable, il y avait tous les autres, les trébucheurs qui s’écorchaient les genoux sur les pierres de la vie mais savaient se relever en remarquant que le ciel était bleu, les fragiles qui demandaient de l’aide, les pudiques qui répugnaient à le faire, les maladroits qui se hérissaient de piquants pour se protéger des coups. Marlène avait foi en eux, tous et sans exception. Louise traitait sa cadette d’exaltée.
Mais était-ce vraiment excessif de deviner en Alice une estropiée de plus ? Pour fêter les deux premiers mois de son arrivée à la maison de santé, Marlène avait organisé une sortie au resto en compagnie de sa sœur et des êtres qui constituaient, depuis le décès de son mari, sa « drôle de famille ».
Tristan, l’infirmier du cabinet, arriva le premier, vêtu comme à l’accoutumée d’un jean et d’un tee-shirt, le visage agrémenté d’une barbe sculptée à la tondeuse. Pas mal d’Iseult grattaient à sa porte. Louise arriva sur ses talons, soufflant comme une brebis prête à mettre bas, pestant après les conditions de stationnement, bientôt on devrait se garer hors de la ville, il lui faudrait une carte d’invalidité avec sa hanche qui la handicapait.
Juchée sur des talons-échasses, Leila apparut au détour de la place, moulée dans un pantalon blanc et un bustier rouge à pois suffisamment décolleté pour faire damner la plus pieuse des âmes. Elle raffolait de fringues, de maquillage et des parfums orangés dont elle s’inondait.
–Je suis en retard ? demanda-t-elle en feignant d’ignorer les regards masculins qui convergeaient dans sa direction.
Elle prit place à côté de Tristan, en face de Louise. C’est dans cette posture qu’Alice la trouva quand elle arriva, au moment où Marlène commandait l’apéritif, un jus d’ananas pour Leila, une bière pour l’infirmier.
–Et une bouteille de Sancerre, ajouta-t-elle.
Il manquait Gaëlle, la kiné et Tiphaine, la psychologue. Pascal Estève, le second médecin du cabinet, restait en retrait, épaules rentrées et regard fuyant. Un drôle de gars qui bossait trop. Marlène secoua la queue de cheval rousse d’Alice.
–On va trinquer à notre petite équipe et à toi en particulier. Ça leur fait bizarre, aux patients, d’être soignés par une jeunette, hein Tristan ?
Tristan haussa les épaules et regarda dans le vague, ou plutôt ailleurs que dans le décolleté de sa voisine Leila. Marlène décida qu’il était temps de passer la commande.
–J’espère que tu as faim, Alice. Ici, il y a ce qu’il faut dans l’assiette. Pour commencer, je te propose une terrine de faisan.
–Je suis végétarienne, rappela Alice.
Louise se lamenta, c’était pitié, cette marotte actuelle. Ils se turent pour se concentrer sur la carte. Alice n’avait pas très faim.
–Une omelette aux champignons, ça te dirait ? proposa Marlène.
Soudain il y eut un mouvement, des cris. Un homme traversa la place au pas de course et vint se planter devant leur table. Jules, le petit-fils muet d’Albertine, venait de tomber et saignait comme un bœuf.
–On y va, décréta Marlène en repoussant sa chaise.
Alice la suivit. Un attroupement envahissait le trottoir, le gosse était sujet aux convulsions ; ce môme, il lui arrivait toujours malheur, sa pauvre grand-mère Albertine avait du fil à retordre avec lui, précisa Marlène en se penchant, Alice fit de même.
–Écartez-vous si vous voulez qu’il respire, dit-elle, quelqu’un peut me trouver une couverture ?
Les badauds se dispersèrent pour aller chercher compresses et désinfectant. Certains filmaient, Alice leur lança en pure perte un regard meurtrier. L’enfant avait sept ou huit ans, un beau gamin avec un visage d’ange. Il semblait indifférent au sang qui coulait le long de sa tempe et jusqu’à sa bouche. Il passa la langue sur ses lèvres rougies. Marlène lui caressa la joue. Elle aurait agi de même pour apprivoiser un chaton. Et alors, mon Jules, tu as encore fait des tiennes ? L’enfant fixait sur elle ses yeux bleus mouillés de larmes. Il pleurait en silence. Il tourna la tête vers une femme âgée qui se hâtait dans leur direction. Marlène la rassura.
–C’est bon, Albertine, le petit n’a rien, juste une plaie du cuir chevelu. Je l’emmène au cabinet pour lui poser des points.
–On a prévenu les pompiers, Docteur.
Marlène dévisagea l’homme qui lui parlait tout en filmant la scène.
–C’est inutile, Jules ne supporte pas les hôpitaux, répondit-elle sèchement.
Elle conseilla au type de retourner à sa vidéo. Jules disparaissait presque dans les bras d’Albertine qui le serrait à l’étouffer. Les curieux rebroussaient chemin, traînant sous leurs pas un peu du sang qui colorait l’asphalte.
–Les secours arrivent, entendit-on.
–Et zut, commenta Marlène.
La sirène qui retentissait retint les curieux sur le trottoir. Jules se débattait dans les bras d’Albertine qui tentait en vain de le calmer. Marlène fit la grimace, le gosse allait finir par convulser pour de bon. Elle se dirigea vers le camion qui se garait.
–Eteignez votre gyrophare, vous effrayez le gamin.
–Laissez-nous faire notre travail.
Pas de chance, l’équipe était nouvelle et ne connaissait pas les phobies de Jules. Un jeune pompier s’approcha d’Albertine. L’enfant se mit à pleurer bruyamment. Sous l’effet de la peur, son corps se tordait comme un serpent fou. La voix était aiguë, sauvage.
Alice en eut froid dans le dos et se boucha les oreilles. Brusquement, tout bascula. Elle se retrouva violemment projetée dans le cauchemar éveillé qui la tourmentait régulièrement. La rue se transforma en un milieu hostile, sinistre et répugnant. Il n’y avait plus de voitures, plus de fragrance sucrée provenant de la boulangerie, plus de musique qui s’échappait de la fenêtre d’en face, plus de Marlène et même plus de Jules. Il n’y avait qu’une ombre qui surgissait dans la nuit, un visage ensanglanté, une odeur écœurante qui empuantissait l’air, mélange de sueur et d’antiseptiques. Et une femme aux allures de cadavre qui l’attrapait par le bras. Alice en eut la nausée.
Par réflexe, elle se recroquevilla sur elle-même avant de se laisser glisser au sol contre le mur. Les bras croisés sur la poitrine, les genoux remontés sur le torse, le cœur au bord des lèvres, elle attendait la fin de l’assaut. Ça s’arrêtait toujours, il suffisait d’attendre. De ne plus penser à rien. De ne plus ressentir quoique ce soit. D’être comme morte.
–Alice, ça va ?
Sur le trottoir, il y avait de nouveau Jules qui refusait de suivre les pompiers et Marlène qui la secouait, tentait de l’entraîner. Marlène dont le parfum chassait l’odeur du sang. Marlène avec son visage bienveillant et son front barré d’une ride soucieuse.
–Tu m’expliques ce qui se passe ?
Il aurait fallu trouver les mots.
6
Dans les jours qui suivirent, Alice se lava encore plus souvent et s’épuisa dans de longues courses à pied qui martyrisaient son dos avant de la plonger dans un état voisin de l’euphorie.
Elle revenait apaisée de ces marathons et se mettait à penser à Jules. Quelque chose dans la détresse de ce gamin faisait écho en elle. Ses cris avaient été les siens, ceux qu’elle parvenait à étouffer quand l’angoisse s’emparait d’elle. Elle ignorait pourquoi elle avait toujours peur.
Après s’être fait poliment rembarrer, Marlène avait cessé de poser des questions. Mieux valait parler des patients. C’est ce qu’elles faisaient tous les soirs après les consultations en buvant un verre. Comme lorsqu’elle était interne, Alice rendait compte des malades qu’elle avait vus dans la journée, de leurs pathologies, des décisions qu’elle avait prises.
–J’ai vu le petit Jules, cet après-midi, dit Alice.
–C’est moi qui ai demandé à Leila de l’inscrire à ta consultation, j’ai besoin d’un regard neuf sur ce gamin.
–Il est venu avec sa grand-mère, on n’a pas reparlé de l’autre soir. Il avait une otite.
Un gosse vraiment bizarre, shooté par la fièvre, les yeux cernés, la morve au nez, se laissant examiner passivement, le regard dans le vague.
–Il est mutique depuis la mort de ses parents, expliqua Marlène. Ils ont dérapé sur une plaque de verglas l’hiver dernier. Ils ont quitté la route et sont venus s’écraser en contrebas. Leur voiture a pris feu. Jules était parti avec eux mais on ne l’a pas retrouvé dans l’habitacle. Il a disparu plusieurs heures avant d’être retrouvé sur les lieux de l’accident avec des ecchymoses mais indemne… et muet.
Albertine, sa grand-mère maternelle, avait ravalé son chagrin pour s’occuper de lui. Une armée de psy avait fondu sur l’enfant, paroles mesurées aux lèvres et crayons de couleur dans les mains, en pure perte : Jules ne s’était pas laissé amadouer.
–Comment s’est-il comporté avec toi ? demanda Marlène.
–Il est resté amorphe.
Pourtant, il y avait eu ce regard, celui d’un enfant qui avait vu la mort en face et y avait cru à fond. Il était perdu, Jules, et tout étonné d’être vivant alors que ses parents avaient traversé l’ultime frontière. Elle garda pour elle cette perception des choses.
–Tu es jeune. Je pensais qu’il se détendrait avec toi.
En vérité, ils s’étaient jaugés. Alice avait vu les ténèbres dans le regard du gosse. Elle avait cheminé à ses côtés.
Alice détourna Marlène du cas de Jules pour aborder le cas des autres patients. Elles parlèrent du père Bouvier qui s’était joyeusement payé la tête d’Alice en jurant qu’il suivait son régime à la lettre et de cette Virginie Lambert qui multipliait les arrêts de travail.
–On n’est pas Dieu et les patients sont indisciplinés. Pas la peine de perdre la foi pour autant, décréta Marlène, sinon des gamins comme Jules n’auront plus de médecin pour les sortir de leur guêpier.
–Je perçois chez cet enfant une souffrance abominable.
–Qui remonte à longtemps, précisa Marlène.
Sa famille a mauvaise réputation dans le coin. Les gens regardaient ses parents de travers. Le gosse a inévitablement perçu le rejet.
Elles furent interrompues par Gaëlle qui venait de faire sortir son dernier patient. Elle venait réclamer une ordonnance de rééducation.
–Les histoires de famille ont plané comme des vautours au-dessus du berceau de Jules, poursuivit Marlène. Une aïeule tondue à la libération, des grands-parents paternels disparus dans une avalanche et surtout un grand-père maternel violent. Albertine peut dire merci à la cirrhose qui l’a tué.
Les parents de Jules avaient choisi de rester dans la région pour s’occuper de la grand-mère.
–Tant qu’il n’est pas allé à l’école, Jules a été heureux. Ensuite, la loi des gosses l’a crucifié. On n’est pas loin du Berry, la succession des catastrophes prenait des allures de sortilège. Ses copains se sont chargés de lui faire vivre l’enfer parce qu’on disait de sa famille qu’elle était maudite.
–À la place des parents, j’aurais retiré mon
gamin de l’école, remarqua Alice.
–C’est ce qu’ils ont fini par faire. Jules a été scolarisé chez lui. Sa mère et Albertine se chargeaient de son éducation. L’enfant n’avait pas de copains. Son univers se résumait aux adultes qui l’aimaient. Quand l’accident est arrivé, tout s’est effondré.
Il suffit de si peu pour qu’une vie bascule. Alice en eut froid dans le dos.
Il était près de 20h quand elles terminèrent. Pascal Estève venait de fermer la porte sur son dernier patient.
–Tu termines de bonne heure, aujourd’hui, lui lança Marlène.
–Ne te moque pas, ce n’est pas ma faute si on est dans un désert médical.
Celui-ci avait bon dos, Estève répugnait à rentrer chez lui retrouver une femme qu’il n’aimait plus depuis des lustres et quatre enfants à qui il n’avait pas grand-chose à dire parce qu’il n’avait pas pris le temps de les voir grandir. L’homme était de taille moyenne, avec un physique banal, celui de monsieur tout le monde que l’on croise dans la rue sans même relever les yeux, front dégarni, épaules étroites, dos discrètement voûté, teint d’endive, gourmette en or.