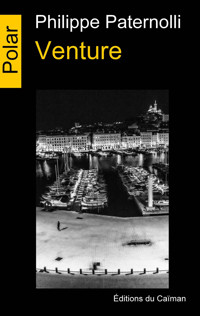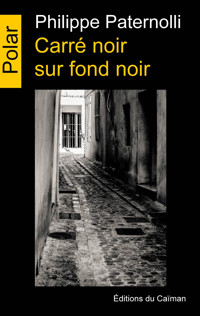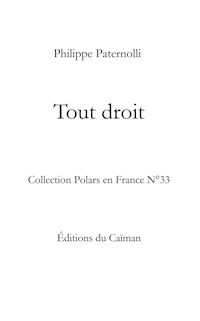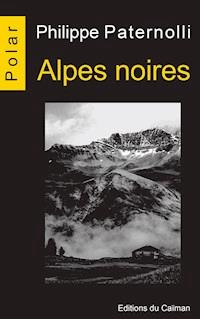Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Le 11 février 2002, trois personnes meurent. Les victimes n’ont aucun lien entre elles. Leurs assassins non plus. Mais les routes de ces derniers, ainsi que celles de ceux qui les poursuivent, finiront par se croiser. Le lecteur suivra ainsi, par chapitres formant une boucle : Fouad Tazenahte, journaliste enquêtant sur la piste d’une inquiétante affaire de contamination au virus VIH qui le conduira à pourchasser le Dr Ruben, figure de l’extrême-droite locale ; Vincent Erno, jeune lieutenant de police sous les ordres de son mentor, le capitaine « rouge » Martin Rogé, enquêtant sur Sandra Stéfanelli, possiblement coupable de trois crimes ; Dominique Saint Calais, patron du Cube, officine des services secrets ayant substitué à la chanteuse Hélène Parker son sosie (presque) parfait afin de confondre Paul Moisan, l’amant d’Hélène, fonctionnaire au Quai d’Orsay, impliqué dans un trafic de drogue international ; Les passagers du cargo Singapore, parmi lesquels Claire Lucenec, la compagne de Frédéric Erno, le frère du lieutenant de police Vincent Erno, embarquée pour un tour du monde de trois mois et qui découvrira que le cargo, à chaque escale, ne débarque et n’embarque pas qu’une cargaison innocente. Et comprendra que ses compagnons de voyage ne sont pas à bord par hasard ; Enfin, Frédéric Erno, guitariste de blues, en panne d’inspiration, réfugié dans une ancienne ferme transformée en studio d’enregistrement au pied du pic de "Nore", en contact quotidien avec Claire sur son cargo jusqu’à ce que le Singapore ne réponde plus...
À PROPOS DE L'AUTEUR
Désormais installé en Provence, Philippe Paternolli partage son temps entre l'écriture, un travail de correcteur d'un genre particulier - dit "traque-boulette" - et la photographie de la montagne Sainte-Victoire et des passereaux au lever du jour.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Une première version de ce roman a été publiée en 2001 aux Éditions de la Bastide sous le titre « Mélodies malsaines ».
Bien que paraissant dans la présente édition un an après « Venture » – dernier épisode mettant en scène Vincent Erno – « Nore » est en réalité le premier jalon de la série
1
Le 11 février 2002, les Français apprirent la candidature officielle du président à sa propre succession. Le même jour, Omar Bouarfa, Hélène Parker et Julien Péchavar décédèrent.
Omar Bouarfa mourut à l’hôpital de Nîmes, des suites du HIV.
Autour du lit, les instruments désappareillés par le personnel hospitalier. Les sondes, perfusions et cathéters, inutiles, pendaient à leur potence. La présence de la mort gagna jusqu’au moindre objet de la chambre. Le froid et le silence se rendirent maîtres des lieux.
Regroupée autour du rectangle de drap blanc que le corps sans vie d’Omar soulevait et froissait à peine, sa famille demeurait silencieuse et immobile, depuis de longs mois résignée et pourtant incrédule face à la réalité. Aïcha, la mère, et Nadia, la sœur, se blottirent l’une contre l’autre puis se détournèrent pour masquer leurs larmes à celui qui ne les voyait pourtant plus. Près de la table de nuit, debout, grand et sec comme un arbre en pleine hamada, son frère Hocine tenta de réconforter Nathalie, l’épouse d’Omar aux chairs également meurtries par le virus. De la cour parvinrent des cris et des rires. Les enfants savaient qu’en ces lieux et instants les jeux leur étaient défendus, mais ils ne pouvaient malgré eux se contraindre au silence. Hocine croisa le regard de sa mère. Elle pardonnait à ses petits-enfants, l’insouciante pureté de leur innocence. Néanmoins, par respect pour la mémoire de son frère, Hocine sortit, l’index posé droit sur sa bouche, les yeux embués de larmes ; et sans qu’il prononce le moindre mot, les jeux cessèrent.
Hélène Parker succomba d’un sectionnement de la carotide. La lumière allogène éclairait son corps nu baignant dans son sang qui formait une tache rouge sombre sur les draps blancs. Un peignoir, blanc lui aussi, avec de fines rayures jaunes et orange, se trouvait au pied du lit. Quelques éclaboussures sanglantes en souillaient le coton-éponge. Un numéro du magazine Elle se trouvait roulé à terre, contre le mur. Bientôt le corps serait escamoté, la chambre nettoyée ; les draps, le peignoir, remplacés par des propres ; le magazine sagement posé sur la table de nuit. La mort serait chassée de l’endroit, sans que la vie s’y réinstalle.
S’il avait été découvert, l’assassinat d’Hélène Parker aurait eu un certain retentissement. La victime était une chanteuse dont la renommée avait dépassé le stade de la confidentialité. Mais le décès d’Hélène Parker devait demeurer – et était demeuré – inconnu de tous et en premier lieu de son amant, Paul Moisan, fonctionnaire au Quai d’Orsay.
Le corps de Julien Péchavar révéla lui aussi sans ambiguïté les traces d’un égorgement soigné. Pur hasard que cette similitude avec l’assassinat d’Hélène Parker. Il mourut chez lui, dans son appartement parisien, appartement de célibataire, collectionneur de conquêtes féminines. La chambre en était l’exemple le plus frappant. Un luxe factice le disputait au mauvais goût. Quelques sérigraphies pornographiques et vaguement orientales encadraient sur les murs une reproduction de l’Origine du Monde. Des cendriers aux formes obscènes altéraient la beauté rustique d’une commode au plateau de travertin. La moquette en laine synthétique et les tentures de velours feutraient une atmosphère qui, se réclamant sans doute d’un érotisme raffiné, dégoulinait d’un stupre frelaté. Seul le lit en orme blond échappait à l’examen critique, îlot d’authenticité agréablement paré de draps de sobre coton blanc. Le sang commençait à sécher par larges plaques. La puanteur s’installait déjà. La mort s’en donnait à cœur joie.
La vie dissolue de Julien Péchavar plaida auprès de son voisinage de la rue de Ponthieu pour un meurtre perpétré par un ou une désaxé(e) sexuel (le). De fait, le sexe de Julien Péchavar avait été aussi nettement tranché dans la longueur que son cou dans la largeur.
2
Avant d’arriver à Saint-Amans-Soult, Frédéric Erno quitta la D602 et prit la D53 en épingle pour atteindre Les Raynauds. La nuit était tombée. Le mercure des thermomètres ne devait pas dépasser le zéro de beaucoup. Un oiseau de nuit s’envola lourdement quand il éclaira plein phare pour s’enfoncer dans les ténèbres de la Montagne Noire. Il alluma la radio, la supporta 5 minutes, puis massacra la touche d’arrêt du tuner, coupant le sifflet au Président au moment précis où celui-ci exhortait ses « chers compatriotes » à lui accorder une nouvelle fois leur confiance. Il présenta une cassette DAT au lecteur de son autoradio pour écouter une fois encore les démos qui devaient lui servir de base à l’enregistrement de son nouvel album. « Si toutefois l’inspiration me revient » songea-t-il, à l’écoute des lignes mélodiques enregistrées ces six derniers mois. Un signe ne le trompait pas : la musique qu’il entendait – ses propres compositions – laissait ses doigts enroulés autour du volant, sans aucune envie de battre le tempo. Il grimaça de dépit. En six mois, il n’avait su qu’accumuler des sirops de synthés, englués dans le caramel mou d’une orchestration putassière mais branchée. Il éjecta la cassette et la balança sur le siège passager. Un court instant, il eut la tentation d’abaisser la vitre et de la jeter en pâture au néant.
Passé Les Raynauds la route s’éleva, les virages formant des épingles que la puissance du 4x4 parvint non sans mal à digérer. Frédéric s’engagea à l’assaut du Taïllado Loungo, par la route approximative et mal entretenue qui s’enfonçait entre chênes rouvres et sapins. Il roula encore un quart d’heure puis bifurqua en épingle vers Labadou et le Plo des Prades. Le véhicule tout-terrain ahanait. Depuis la sortie de la D612, il était passé de la cote 272 à la cote 913. De la neige recouvrait les bas-côtés de la route, balisée par les fûts sombres des conifères. Il suait comme s’il participait à l’effort de son moteur, ses cheveux noirs et bouclés plaqués à sa nuque et son front. Régulièrement, il chassait de ses doigts quelques mèches tombant sur son nez. Enfin, il contourna Peyre Moutou pour déboucher au milieu d’une étroite clairière, au centre de laquelle une lourde bâtisse en forme de L, au toit de lauze, représentait son ultime espoir d’accoucher d’un CD digne de lui. Et digne de Claire.
3
Claire Lucenec jeta un œil par le sabord de sa cabine. Le cargo avait quitté Le Havre depuis une heure et l’horizon engloutissait les côtes normandes dans des brumes incertaines. Le froid de ce début d’année, les embruns glacés, et maintenant une pluie battante, avaient contraint le capitaine du Singapore Contship à rejoindre Claire sur la passerelle du pont supérieur pour l’inviter à regagner sa cabine. Claire avait obéi avec le sourire. Ici, sur ce porte-conteneurs de 15 460 tonnes sorti des chantiers navals finlandais 30 ans plus tôt, monstre des mers capable d’avaler l’Atlantique Nord en moins de 12 jours, la jeune femme ne s’était pas sentie de taille à contester la moindre parcelle d’autorité au capitaine, « seul maître à bord sinon Dieu » avait-elle pensé.
Elle tira l’une de ses deux grandes valises près du lit, l’ouvrit et commença à ranger ses affaires. La première valise contenait essentiellement des vêtements. Une garde-robe complète, du maillot de bain une-pièce jusqu’à la doudoune hivernale. On n’entamait pas un voyage de trois mois autour du monde en jeans-tee-shirt-baskets. La seconde valise recelait son matériel de travail : un portable multimédia, une boite de disquettes 3,5’, une micro-parabole, deux dizaines de livres dont quelques romans, un lecteur de cassettes DAT connectable au portable, plus une collection impressionnante de blocs-notes et une trousse garnie de feutres. Claire s’aménagea un coin-travail dans sa vaste cabine, une véritable chambre de luxe avec WC-douche privée, vidéo, bar et frigo, une couchette en 110 ferme à souhait, le tout assez éloigné de la salle des moteurs pour que le tumulte de la mer soit omniprésent. Claire ne regrettait pas sa cabine individuelle, même si le surcoût lui avait paru conséquent.
Tout en agrémentant sa nouvelle tanière de touches personnelles, la jeune femme songea à l’homme qui l’aimait et dont elle s’éloignait avec ce tour du monde. Ils avaient convenu de rester en contact par le biais de leurs ordinateurs respectifs, connectés par liaison satellite. Claire brancha entre eux les différents appareils de communication et testa leur bon fonctionnement. Elle reçut le signal de connexion avec le récepteur de veille de Frédéric mais renonça à lui adresser aussitôt un message. Cacher ses faiblesses, principe éculé…
Elle éteignit son portable et consulta sa montre. Le dîner serait bientôt servi. Elle n’avait pas exactement compris l’horaire indiqué par l’officier en second lors de l’embarquement. Un Polonais ou un Balte, très certainement, qui parlait un anglais teinté d’accent slave. Quoi qu’il en soit, Claire se souvenait des recommandations de la Niederelbe Schiffahrsgesellschaft Bremen, la NSB, compagnie maritime à laquelle appartenait le Singapore. Un livret opulent accompagnait le billet de réservation. Au chapitre repas, il y était stipulé « tenue correcte ». Elle avait embarqué une robe longue, puisque la compagnie recommandait la tenue de soirée pour tout voyage entraînant le passage de l’Équateur. Pour le premier soir, elle se contenta de troquer son jean pour un pantalon écossais moulant, un pull en cachemire noir et des baskets. Elle maintint en place ses mèches blondes à l’aide d’un bandeau et décida de se maquiller très légèrement. Ne pas dévoiler trop vite ses forces, autre vieux principe…
Elle pesta en silence contre le décorateur d’intérieur qui avait fait installer les miroirs sans envisager une seule seconde l’embarquement à bord du Singapore d’une femme de cent quarante-huit centimètres (de bas, ironisait Frédéric). Elle râlait encore, lorsqu’un garçon de cabine vint l’avertir de l’imminence du dîner. Elle chanta un joyeux merci, en anglais et à travers la porte. Les pas du garçon s’éloignèrent et Claire l’entendit répéter son invitation aux autres passagers. La jeune femme s’accorda quelques minutes avant de rejoindre la salle à manger, située sur le pont supérieur. Quelques minutes qu’elle occupa à se regarder en pied dans les portes-miroirs dissimulant les étagères de rangement.
1m48, 41 kilos. Parfois, Claire en avait assez de son image de poupée fragile, de femme-enfant. Cheveux naturellement châtain clair, aux reflets chauds tirant sur le roux. D’une rousse, elle possédait la peau si blanche et si délicate, si apte à rougir. Claire avait tout du bibelot fragile et précieux que les hommes se doivent d’enfermer dans un écrin de luxe. Elle avait tout du bibelot, sauf un cerveau capable de sur-régime impressionnant et un caractère de baroudeur revenu de toutes les rizières minées. Force lui était de reconnaître ne pas offrir toutes les rondes saveurs des canons de la féminité épanouie. Sa poitrine réduite à deux pointes, posées sur une esquisse de renflement lui assurait un buste attendrissant ; ses fesses de garçonnet laissaient planer un doute sur les motivations de ses amants. Claire jugeait son corps avec sévérité et le traitait durement.
Elle posa une fesse sur le bord du lit, parcourant quelques feuillets d’un calepin, ses dernières notes du roman qu’elle prétendait écrire tout au long des 100 jours que le cargo mettrait pour accomplir son périple. Puis, elle se récita l’itinéraire du Singapore : Le Havre – New-York – Norfolk (Virginie-USA) – Savannah (Géorgie-USA) – Cristobal (Canal de Panama) – Papeete – Auckland (Nouvelle-Zélande) – Melbourne – Sydney – Hong Kong – Singapour – Canal de Suez – Port Saïd – Felixstowe et Hambourg. Claire débarquerait à Felixstowe, sur la côte est de l’Angleterre, près d’Ipswich, à une centaine de kilomètres de Londres.
Ayant perçu des pas dans le couloir, elle quitta sa cabine et rejoignit les autres passagers et les officiers autour de la vaste table, dressée selon les usages d’un restaurant de haute tenue. Après un salut mutuel, le capitaine les invita à passer à table. Il s’exprimait en anglais méditerranéen, c’est-à-dire avec force roulements de r et zézaiements langoureux. « Un Italien » se dit Claire. La vérité était plus romantique encore : le capitaine était maltais.
Elle prit le temps de dévisager chacun de ses compagnons de voyage. Outre les deux officiers, elle partageait la table avec cinq autres passagers.
Le capitaine initia un rapide tour de table afin que chacun se présente.
Ainsi Claire apprit-elle l’identité de ses voisins de cabines : Eric Van Pele et Jan Sommer. Le premier, professeur de musique, le second son élève prodige. Van Pele expliqua qu’avec son poulain, ils avaient pris l’habitude de s’éloigner de l’agitation terrestre lorsque Jan devait franchir un cap important pour sa carrière. Début mars, Jan Sommer représenterait la Belgique au septième concours d’orgue de Maastricht. Leur voyage à bord du Singapore prendrait fin dans 10 jours, à New-York, d’où ils regagneraient l’Europe à bord d’un autre cargo. Les deux musiciens emmenaient dans leurs bagages une somme considérable de partitions. Jan voulait s’en imprégner d’une lecture attentive et silencieuse. Il aimait exercer ainsi son cerveau à jouer avant ses mains. Il pensait maîtriser mieux son jeu par cette méthode. Grand garçon timide d’une vingtaine d’années, au visage poupin, Jan Sommer s’exprimait dans un anglais scolaire, hésitant. À quelques reprises, il sollicita son mentor pour que ce dernier l’aide à traduire au plus juste sa pensée. Claire les trouva attendrissants.
Assis à leur droite, Ulrich Vegelt s’empressa de révéler qu’il était à la fois jeune retraité et jeune divorcé. Claire décoda sans difficultés les vingt mille invitations secondes que recelait le regard de cet ancien professeur de géographie des environs de Freiburg-im-Breisgau. Lui aussi s’exprima en anglais, de manière très correcte. C’était la première fois qu’il voyageait en cargo, qu’il prenait la mer pour une aussi longue traversée. « Pas aussi longue que ma vie, passée aux côtés de ma terrible épouse » ajouta-t-il en levant son verre de porto. Il y trempa les lèvres tout en invitant, d’un geste de la main, le passager suivant à se présenter.
Hosni Koseir s’éclaircit la voix avant de décliner son identité. Riche dilettante égyptien, il avoua passer le plus clair de son temps en mer. Son père possédait des parts dans de nombreuses compagnies maritimes, dont la NSB. À ces mots, le capitaine sourit. Claire en déduisit que les deux hommes se connaissaient. À presque 40 ans, Koseir annonça à ses compagnons son mariage prochain. « Pour cet été, en principe ». Dans un soupir malicieux, il déclara qu’il s’agissait là sans doute de son ultime tour du monde par voie maritime, la future madame Koseir éprouvant une sainte horreur pour la mer et ne jurant que par l’avion, « si rapide, si pratique, si moderne ». Claire aurait parié que cette fiancée représentait un douillet matelas de dollars enrobé dans une plastique de top-model. Le genre de dinde idéale pour renflouer les caisses de papa Koseir. Confirmant l’intuition de Claire que l’Égyptien et le capitaine se connaissaient, ce dernier exprima ses regrets de ne plus compter à l’avenir Hosni Koseir parmi les passagers du Singapore. Il lui présenta dans la foulée ses félicitations pour son futur mariage et Koseir le remercia en italien.
Le voisin de Claire était peintre, américain, célibataire et âgé de 67 ans. Originaire de Portland dans le Delaware, Donald McMurray rentrait chez lui, après une escapade de six mois entre Afrique du Nord et Europe du Sud. Il déclara avec modestie avoir voulu, sans bien y parvenir, comprendre la lumière méditerranéenne. Il l’avait scrutée de port en port ou en pleine mer, grâce aux multiples liaisons maritimes reliant les deux continents. Il tenta de faire partager son émotion face à certaines couleurs qu’il n’avait jamais perçues ailleurs aussi intensément. Il fut à deux doigts d’essuyer une larme au souvenir de Bizerte.
— Et Malte ? interrompit le capitaine. Vous avez aimé Malte ?
McMurray répondit n’avoir jamais été en vue des côtes maltaises. Le capitaine sembla vexé et donna la parole à Claire, interrompant McMurray qui s’apprêtait à reprendre l’exposé de ses recherches sur la lumière.
Claire s’efforça d’être brève. 31 ans, divorcée, journaliste. Elle s’éloignait des salles de rédaction pour écrire. Elle avait publié deux romans qui s’étaient vendus respectivement à 114 et 281 exemplaires. Anonymat total, jusque chez les critiques littéraires. Elle était à bord pour la rédaction de son troisième roman et s’excusa par anticipation de devoir rester le plus possible dans sa cabine afin d’avancer dans son travail. Le vieux peintre américain l’assura de sa totale compréhension. Le capitaine, rancunier, empêcha McMurray de reprendre la parole plus longtemps en invitant chacun de ses convives à commencer le dîner.
Après les entrées, il les complimenta pour leur résistance face au mal de mer. Pure malice. Claire discerna aussitôt une suée inaccoutumée chez Van Pele, signe annonciateur d’un malaise prochain. Elle-même se surprit à réprimer quelques bâillements, ce qui ne présageait rien de bon. Les regards qu’échangèrent entre eux les officiers, la voyant masquer ses bâillements, ne furent pas pour la rassurer. Elle qui s’était extasiée sur la vue panoramique qu’offrait la salle à manger, se mit à regretter ce perpétuel balancement de l’horizon auquel ses yeux ne pouvaient échapper.
Van Pele ouvrit le bal. Se levant d’un bond, il s’évacua dans un feulement, hélas contagieux. Des six passagers, cinq quittèrent la table et jouèrent des coudes pour gagner leurs cabinets de toilette. Seul Koseir resta en compagnie des officiers, qui contemplèrent la débâcle vomitive d’un œil moqueur.
Claire distribua quelques coups de pieds pour éviter de se faire écraser contre la paroi d’une coursive par un Ulrich Vegelt, aux prises avec un excédent de vin blanc, et gagner enfin sa cabine. Après s’être soulagée, elle s’étendit sur sa couchette. Ses yeux se portèrent sur l’écran mat de son portable. Elle se promit de contacter Frédéric dès le lendemain.
4
— Vous êtes sûr de ce que vous dites ?
Hocine Bouarfa ne répondit rien. Son regard suffisait. Fouad Tazenahte n’insista pas. Son interlocuteur disait la vérité, ne pouvait que dire la vérité. Cet homme exsudait la loyauté.
Tazenahte était journaliste au Canard enchaîné. Il effleura d’un index soigné la touche stop de son magnéto, puis se leva avec lenteur. La poignée de main qu’il échangea avec le frère d’Omar Bouarfa, mort des suites du sida, fut brève mais intense : les deux hommes voulaient exprimer leur reconnaissance réciproque. Fouad remercia Hocine de sa confiance. Hocine reporta entre les mains de Fouad son espoir de voir la mort de son frère vengée. Tazenahte quitta l’appartement, du sixième étage d’un immeuble aux façades défraîchies, situé à l’intersection de la route d’Uzès et de la nationale 113 qui contournait Nîmes par le sud. Une fois l’habitacle de sa Ford réintégré, le journaliste se repassa la bande qu’il venait d’enregistrer.
Depuis un an, il recensait tous les décès liés au HIV survenus dans le périmètre Nîmes-Orange-Arles. L’origine de son enquête remontait à la parution d’un article du Monde daté du 25 janvier 2001, relatant le déroulement à Orange d’une manifestation de victimes du sida. Cette singulière marche de protestation regroupait, pour l’essentiel, la communauté beur d’une ville dirigée par le Front National depuis 95.
Fouad s’était senti concerné. Né à Lunel en 1972 de parents marocains, natifs de Fès, il avait été ému par les manifestants d’Orange. C’était comme s’ils étaient tous nés par-delà la Méditerranée, et lui avec, et que leurs semelles transportaient encore le sable et les cailloux pointus des déserts et montagnes de l’Atlas. Jamais comme ce jour-là, Fouad ne s’était considéré comme autant étranger à la terre grasse de l’Occident. Mais les manifestants n’avaient pas défilé pour offrir leur malheur à la compassion du pays. Leurs banderoles, leurs slogans, portaient une accusation terrifiante : « On nous assassine ». En conclusion, l’article du Monde faisait état d’une rumeur circulant dans cette région, entre Languedoc et Provence. L’extrême droite, par l’intermédiaire de ses nombreux groupuscules actifs, aurait élaboré des réseaux en milieu médical afin de propager le virus HIV au sein d’une population choisie. Hormis le Canard Enchaîné, aucun média n’avait tenté de faire rebondir les révélations du Monde. Chacun s’était accommodé de l’oubli des manifestants d’Orange. Pas Fouad Tazenahte, qui avait décidé d’enquêter.
Depuis douze mois, il sillonnait les départements du Gard, de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, allant de familles en deuil en contaminés en voie d’exclusion. Depuis douze mois, Fouad avait appris la prudence. Sa première visite concernant l’enquête, il l’avait réservée au journaliste du Monde ayant sorti l’info. Il était mal tombé. Deux infirmiers du SAMU évacuaient son corps lorsque Fouad parvenait devant son immeuble de la rue Louis-Braille. Une jeune femme suivait les brancardiers, une main devant la bouche, comme pour s’empêcher de hurler.
Tazenahte avait rongé son frein deux semaines durant avant de téléphoner au domicile du journaliste. La jeune femme avait accepté un rendez-vous pour le surlendemain. Elle portait un tee-shirt en Lycra noir et une longue jupe fendue. Elle possédait de splendides cheveux noirs, bouclés, assez longs. Selon Fouad, elle devait approcher la trentaine. Elle avait ouvert la porte après s’être assurée de l’identité du journaliste.
— Simple prudence, s’était-elle excusée.
— Je vous comprends, avait-il répondu en pénétrant dans un petit appartement meublé sans goût. La police n’a placé personne en surveillance ?
— Pourquoi l’aurait-elle fait ?
— Après la mort brutale de votre mari…
La femme avait précisé qu’elle n’était ni l’épouse, ni la petite amie de Loïc Le Reun, mais sa sœur.
— Et puis Loïc est mort accidentellement. La police est formelle. Tout à l’heure, je ne vous ai pas ouvert de suite parce que maintenant que je suis seule dans cet appartement, il m’arrive d’avoir peur. Mais rien d’autre…
Sophie Le Reun avait invité Fouad à s’asseoir. Il avait étendu son mètre quatre-vingt-neuf dans un fauteuil proche de la dislocation. Elle lui avait proposé du thé.
— Vous pouvez me parler de l’accident ?
C’était un accident banal. Loïc prenait son bain tout en rédigeant un article sur son portable. Sans doute pour économiser les batteries, le jeune homme avait branché l’ordinateur sur le secteur. L’appareil avait glissé dans l’eau, le journaliste avait pris une décharge de 220 volts. Il s’était assommé contre le rebord de faïence rose de la baignoire lorsque, le compteur ayant disjoncté, il était retombé inerte au fond du bain. Là, il s’était noyé.
Fouad s’était dit que c’était une fin digne de Claude François, le chanteur des années 70. Simplement, on en parlerait moins et il y avait peu de chance pour que, dans quinze ans, un producteur investisse le moindre euro dans l’édition posthume d’un article inédit de Loïc Le Reun.
Sophie Le Reun avait soufflé sur sa tasse. Fouad regardait tout autour de lui.
— Nous partagions l’appartement, Loïc et moi. Il collaborait de temps en temps au Monde (Fouad ne l’ignorait pas)… Moi, je suis danseuse…
Fouad n’avait pas eu la curiosité de lui en demander plus. Sophie Le Reun était pourtant assez jolie, mais la seule chose importante aux yeux du journaliste, c’était l’éventuel dossier que son frère aurait pu constituer et garder chez lui. Il avait demandé si un tel dossier existait.
— Je n’ai rien trouvé.
— Son ordinateur ?
— Il n’en possédait qu’un. Il était hors d’usage, après l’accident… Alors je l’ai jeté…
Tazenahte regrettait d’avoir attendu avant de contacter la jeune femme. Il avait regardé une fois encore tout autour de lui et décidé de prendre congé. Sophie Le Reun l’allumait depuis quelques minutes, croisait-décroisait ses jambes qui n’en finissaient plus d’aller se perdre sous sa jupe. Fouad avait cru qu’il ne pourrait jamais quitter l’appartement. La jeune femme s’accrochait d’une main langoureuse à son avant-bras et le retenait dès qu’il amorçait un pas vers la cage d’ascenseur. Il s’en était tiré avec la promesse d’aller voir danser la jeune fille un soir. Elle lui avait fourré la carte du club où elle se produisait dans la poche de son veston, puis sa langue au fond de la gorge.
Ainsi avaient commencé douze mois d’enquête, pour aboutir aux révélations stupéfiantes d’Hocine Bouarfa sur la maladie de son frère.
Par ailleurs, Fouad s’était bien gardé de pointer le bout de son nez au club où se produisait Sophie Le Reun.
5
Hélène Parker rentrait de Paris. La jeune chanteuse se sentait lasse. La journée d’enregistrement l’avait épuisée. Toujours et toujours améliorer sa voix. Parfois, malgré son jeune âge et son début de carrière prometteur, Hélène éprouvait la tentation de tout envoyer balader : métier, argent, notoriété, tout ce qui la rendait à la fois si différente des autres femmes de son âge et si conforme à la vie qu’elle s’était rêvée pendant son adolescence. Elle n’était cependant pas encore si célèbre pour être reconnue au milieu des voyageurs franchissant la sortie de la gare SNCF de Meaux. Bien sûr, affublée de sa perruque bleue, telle qu’elle apparaissait à la télévision, quelque adolescent l’aurait identifiée. Mais ce soir, naturelle, simple jeune femme aux cheveux châtain foncé, aux yeux sombres, à la silhouette anodine, vêtue d’un jean et d’un manteau de pure laine dont elle avait relevé le col, Hélène Parker savourait cet anonymat.
Son Audi