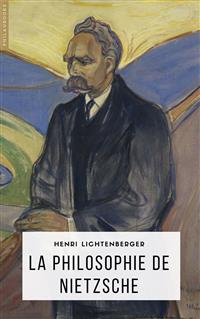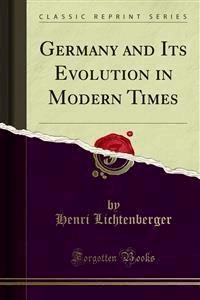1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
George Frédéric Philippe de Hardenberg, — ou pour le désigner par le pseudonyme sous lequel il est connu dans l’histoire littéraire, Novalis — naquit le 2 mai 1772 à Wiederstedt, dans le comté de Mansfeld, sur le bien patrimonial de son père, le baron Henri Ulric Erasme de Hardenberg.
Son enfance s’écoula dans un milieu sans lumière et sans joie.
Le château familial des Hardenberg était un vieux couvent du xiiie siècle, aux fortes murailles dominées par une tour massive, aux fenêtres cintrées entourées de vigne vierge, avec de grandes pièces hautes de plafond et de longs corridors sonores. Tout autour, un vaste parc, sévère et sans fleurs, ombragé d’arbres séculaires parmi lesquels dort un étang noir. C’est dans cette sombre et hautaine demeure, dans un rez-de-chaussée humide et sans jour, que se passent les premières années de Novalis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Novalis
Henri Lichtenberger
© 2024 Librorium Editions
ISBN : 9782385746148
CHAPITRE I
LA JEUNESSE DE NOVALIS
I
George Frédéric Philippe de Hardenberg, — ou pour le désigner par le pseudonyme sous lequel il est connu dans l’histoire littéraire, Novalis — naquit le 2 mai 1772 à Wiederstedt, dans le comté de Mansfeld, sur le bien patrimonial de son père, le baron Henri Ulric Erasme de Hardenberg.
Son enfance s’écoula dans un milieu sans lumière et sans joie.
Le château familial des Hardenberg était un vieux couvent du xiiie siècle, aux fortes murailles dominées par une tour massive, aux fenêtres cintrées entourées de vigne vierge, avec de grandes pièces hautes de plafond et de longs corridors sonores. Tout autour, un vaste parc, sévère et sans fleurs, ombragé d’arbres séculaires parmi lesquels dort un étang noir. C’est dans cette sombre et hautaine demeure, dans un rez-de-chaussée humide et sans jour, que se passent les premières années de Novalis.
Et l’athmosphère morale dans laquelle il grandit est également imprégnée d’austérité et de tristesse. Son père, Erasme, gentilhomme de haute culture et de caractère fortement trempé, s’était converti au piétisme le plus sévère après une jeunesse orageuse et une existence assez accidentée. La mort de sa première femme qu’il aimait passionnément, emportée après quelques mois de bonheur, au cours d’une épidémie de petite vérole, lui était apparue comme un avertissement du ciel. L’instinct de piété, héréditaire dans sa famille s’était brusquement éveillé en lui. Résolu à expier par une existence consacrée à Dieu les désordres de sa vie passée, il avait rompu avec le monde pour se vouer à la dévotion et au travail. Avec les années, il était devenu un solitaire misanthrope et autoritaire, tourmenté de scrupules religieux, hanté par une tristesse qu’il n’avait jamais réussi à secouer, cherchant l’oubli dans un labeur acharné, dur pour les autres et plus encore pour lui-même, distant envers tout le monde, sans tendresse même pour ses proches. La mère de Novalis était une timide et frêle créature, une cousine pauvre que Erasme de Hardenberg avait épousée en secondes noces. Humblement dévouée à son redoutable mari, épuisée par la naissance consécutive de onze enfants, il semble qu’elle ait glissé à travers la vie comme une ombre mélancolique, aimante et douce, mais sans joie ni gaîté, délicate et trop impressionnable, souvent malade, hantée parfois par des idées noires. Ainsi la jeunesse de notre futur poète s’écoula monotone et solitaire — car le vieux Hardenberg ne tolérait personne auprès de lui ni autour des siens, — entre ce père qui lui inspirait plus de respect que d’affections et contre lequel sa nature indépendante commençait à se révolter, cette mère résignée, lasse, effacée et ses frères qui étaient ses seuls camarades de jeux et qu’il aimait tendrement.
Au point de vue physique nul doute que Novalis n’ait hérité de ses parents et spécialement de sa mère un élément morbide. Toute cette génération de Hardenberg présente en effet des symptômes pathologiques irrécusables. Sur les dix frères et sœurs qu’avait Novalis, un seul survit à ses parents. Tous les autres meurent prématurément, les uns tout jeunes, les autres avant la trentaine. Plusieurs succombent aux atteintes de la tuberculose. Chez d’autres se manifestent des troubles nerveux, une tendance à l’hypocondrie, voire même à une sorte d’hystérie. Que des prédispositions héréditaires maladives aient existé aussi chez Novalis, cela n’est point douteux. Je n’ai pas l’intention de faire de lui un « anormal », de rééditer à son propos le thème rebattu de la parenté du génie et de la folie, d’expliquer son mysticisme comme un produit de la dégénérescence nerveuse et de jeter d’avance le discrédit sur ses idées en présentant le penseur comme un détraqué. Rien ne nous autorise à prétendre que le mécanisme psychique de Novalis ait été faussé d’une manière appréciable par des troubles morbides ayant leur source dans sa nature physique. Tout ce que je veux constater ici, c’est le fait indéniable qu’il porte, comme ses frères et sœurs, le poids d’une hérédité inquiétante, que son organisme renferme des germes de dissolution qui l’ont conduit de bonne heure à la mort. Ces conditions physiques ont eu évidemment une répercussion sur sa pensée. Mais dans l’état actuel de nos connaissances, c’est à peine si nous pouvons entrevoir dans quel sens s’est exercé leur action. Je ne chercherai donc pas à définir la personnalité ni à expliquer la pensée de Novalis par des considérations pathologiques. J’abandonne de parti pris cet ordre de recherches aux spécialistes qui possèdent en ces matières délicates des connaissances et une expérience pratique qui me font défaut. Et, après avoir signalé, comme il était indispensable, le fait qu’il y a eu probablement chez Novalis un élément morbide héréditaire, j’essaierai d’interpréter sa vie et son œuvre comme je le ferais pour une personne entièrement « normale », en insistant le moins possible sur les perturbations que la nature physique de Novalis a pu produire dans son évolution psychique.
Sur le développement intérieur de Hardenberg pendant ses années d’enfance, nous sommes assez peu renseignés. Une tradition de famille veut qu’il ait passé ses premières années, jusqu’à l’âge de neuf ans, dans une sorte d’engourdissement intellectuel ; puis que, à la suite d’une crise physique, — une dysenterie compliquée d’atonie stomacale — il ait fait preuve brusquement et sans transition d’une extraordinaire vivacité d’esprit. L’examen des devoirs d’écolier de Novalis et le témoignage d’un de ses premiers maîtres semblent plutôt indiquer que son intelligence fut précoce et son esprit éveillé et original. Nul doute, d’autre part, que le sens religieux ne se soit développé de bonne heure chez lui, sous l’influence de l’éducation pieuse reçue d’abord à la maison paternelle, puis à la colonie morave de Neunietendorf où il commence son instruction en vue de se préparer au ministère évangélique. Notons aussi chez lui le développement précoce de la vie affective — à sept ans déjà « l’amour effleure son cœur d’une légère caresse », — la préoccupation de l’invisible qui se révèle dans ses jeux d’enfant ainsi que la faculté de se créer, à côté de l’existence réelle, une vie de rêve féerique et merveilleuse et nous aurons réuni les traits les plus frappants de la psychologie du jeune Hardenberg. C’est un enfant à l’imagination ardente, au cœur tendre, d’une sensibilité vibrante, d’une intelligence très compréhensive, un rêveur qui, dans le milieu austère et grave où il s’est développé, s’est un peu replié sur lui-même et n’a pu encore s’épanouir librement.
Son horizon cependant s’étend peu à peu. Un oncle paternel, le commandeur de Hardenberg, le « Grand-Croix », comme on l’appelait dans l’intimité, le tire d’abord de son isolement. Il avait cru discerner en son neveu des promesses de talent, et comme il n’avait pas d’enfants lui-même, il l’avait invité, à venir dans sa magnifique demeure de Lucklum, en Brunswick, pour le préparer à faire une carrière brillante. Mais ce grand seigneur d’ancien régime, très entiché de noblesse, étroit d’esprit et de cœur sec, assez borné malgré ses prétentions à l’infaillibilité, était au fond trop médiocre pour pouvoir exercer une influence durable sur une nature comme celle de Novalis. Celui-ci d’ailleurs ne resta pas longtemps dans ce milieu mondain et fort libre d’allures, qui pouvait être dangereux pour un adolescent à l’imagination ardente. On l’envoya terminer ses études secondaires au gymnase d’Eisleben où, sous la direction du recteur Jani, il s’enthousiasma pour l’antiquité classique et en particu¬ lier pour Horace, dont il traduisit de nombreux fragments en hexamètres allemands.
Vers l’automne de 1790, enfin, il se rend à l’université d’Iéna où il doit faire ses études de droit. Mais il y trouve comme professeurs Reinhold, le vulgarisateur de Kant et surtout Schiller qui excite à ce moment l’enthousiasme le plus profond parmi la jeunesse universitaire. Et aussitôt ses projets de travail régulier s’en vont à vau-l’eau. Schiller incarne désormais à ses yeux, l’idéal de beauté poétique et de beauté morale, de liberté et de pureté qui flottait devant son imagination de jeune homme. « Son regard, écrivait-il plus tard, me prosterna dans la poussière et puis me redressa de nouveau ». Il lui inspire dès le premier moment une confiance absolue et sans limite. Il le tient pour son maître et son guide, et déclare que si jamais il produit une œuvre de valeur c’est à l’inspiration de Schiller qu’il le devra. Et au lieu de piocher son droit, le voilà qui s’adonne à la poésie, compose une petite élégie qui paraît sous ses initiales dans le Mercure allemand, et esquisse même un drame intitulé Kunz de Stauffungen. Son père s’inquiète de le voir ainsi se dissiper ; il s’ouvre de ses préoccupations à un ami d’Iéna. Prévenu par celui-ci, Schiller s’empresse de réparer le mal qu’il a commis sans le vouloir. Il fait venir le jeune étudiant, lui remontre la nécessité de se préparer à une carrière régulière et lui fait sentir l’intérêt supérieur de ces sciences austères, dont le premier aspect l’avait rebuté. Aisément convaincu par la parole entraînante du maître aimé, Novalis s’incline. Il quitte non sans regrets mais sans révolte l’université d’Iéna, où il avait goûté pour la première fois les douceurs de la liberté complète et se rend à Leipzig où il doit, en compagnie de son frère Erasme, étudier les mathématiques, le droit et la philosophie.
II
À Iéna Novalis avait pris contact avec le classicisme allemand et l’idéalisme kantien. À Leipzig il se trouve en présence du romantisme naissant : il rencontre Frédéric Schlegel et se lie avec lui d’une étroite amitié.
Ce furent, on le sait, des personnalités singulièrement complexes, mobiles et déconcertantes que ces premiers romantiques allemands. Lorsque, au cours des dix dernières années du siècle finissant, on les vit surgir à l’horizon littéraire, ils apparurent tout à la fois comme des révolutionnaires effrénés, des décadents blasés, des apôtres enthousiastes.
Des révolutionnaires : car ils affichaient le radicalisme le plus subversif en philosophie comme en politique, glorifiant hautement la Révolution française, dénigrant avec passion la sagesse terre à terre de « l’ère des lumières », la prudente médiocrité des idées rationalistes sur l’art, la morale, la religion, prêchant la révolte contre la tyrannie de la froide raison au nom des droits supérieurs de l’imagination et du cœur, accablant de leurs railleries et de leurs sarcasmes les philistins effarouchés ou les défenseurs de l’ordre établi.
Des décadents : car ces contempteurs de la société et de la culture du temps sont en même temps des blasés rongés par le spleen, sceptiques jusqu’au complet nihilisme moral, déprimés par l’abus de l’analyse dissolvante d’eux-mêmes et de l’ironie corrosive, destitués de toute énergie pour l’action virile ; ce sont des acteurs qui jonglent avec les mots et les sentiments, qui se composent des attitudes théâtrales, qui sont devenus incapables, finalement, de discerner au juste où finit chez eux la sincérité et où commence le cabotinage.
Des apôtres pourtant : car ces comédiens annoncent avec une assurance imperturbable et une superbe grandiloquence, un renouveau de la culture européenne, ils se posent en réformateurs de la littérature, de la philosophie, de la science, des mœurs publiques, de la religion elle-même ! Ils rêvent une vaste synthèse où viendront se fondre tous les intérêts sociaux et moraux, religieux et artistiques de l’humanité et se tiennent pour les prophètes chargés d’annoncer aux hommes cet évangile nouveau.
Frédéric Schlegel, lorsqu’il débarque à Leipzig, en 1791, âgé de dix-neuf ans comme Novalis, résume en sa personne tous les traits du romantique tel que nous venons de le dépeindre. Destiné par sa famille d’abord aux affaires, puis, aux études juridiques, il ressent une aversion décidée pour les unes comme pour les autres et débute ainsi dans la vie par une crise pénible d’incertitudes et de stériles agitations. Le commencement de son séjour à Leipzig marque précisément le point culminant de ses désordres et de sa détresse matérielle et morale. Incapable de s’imposer à lui-même une discipline stricte, il vit au hasard, dispersant ses efforts et gaspillant son temps, se partageant entre l’étude et la société s’appliquant volontairement à devenir un homme du monde accompli et accumulant entre temps d’immenses lectures qui embrassaient tout à la fois l’histoire et le droit, la politique et la poésie ancienne, la littérature et la philosophie contemporaines. C’est un dilettante intellectuel perpétuellement occupé à s’analyser lui-même, plein de mépris pour le « vil troupeau », gonflé de « l’aspiration vers l’infini », ballotté entre l’enthousiasme et le dégoût, persuadé qu’il est « unique » au monde, que nul ne le comprend, qu’il n’est pas fait pour être aimé, assoiffé néanmoins d’amour et d’amitié en dépit (ou peut-être à cause) de son égoïsme profond et de sa sécheresse de cœur, accablé du sentiment de son isolement, hanté par des idées problablement sincères de suicide, affichant d’ailleurs un athéisme provoquant et décrétant comme Stirner ou Nietzsche, que l’homme supérieur doit être son propre Dieu. Son héros favori c’est à ce moment Hamlet en qui il voit une âme sœur de la sienne : Hamlet meurt victime de sa raison infinie ; si elle était moindre, il agirait en héros ; son essence intime est « un effroyable néant, le mépris du monde et de soi-même », sa destinée, la tragédie du désespoir héroïque. Et la vie extérieure du jeune Schlegel est aussi désordonnée que sa vie intérieure. Il se lie d’amitié avec Hardenberg ou encore avec un certain comte de Schweinitz dont il a fait la connaissance dans le monde où l’on s’amuse. Mais il met une telle passion dans ces amitiés orageuses qu’il ne tarde pas à se brouiller avec ceux qui en sont l’objet, ce qui provoque chez lui de véritables accès de désespoir. En amour il est plus malheureux encore. Il s’éprend d’une coquette à la fois provoquante et froide, se conduit vis-à-vis d’elle avec une insigne maladresse, témoignant tantôt d’une timidité déplacée, tantôt affectant au contraire une assurance plus déplacée encore ; et il réussit à faire ainsi d’une aventure qui pour un autre eût été une expérience peut-être intéressante, une espèce de drame d’amour bizarre, ridicule et pourtant douloureux. Dans sa vie comme dans ses idées il se montre encore tout à fait incapable de bon sens, de logique, de mesure.
Qu’est-ce qui pouvait attirer Hardenberg vers cet anarchiste de lettres décadent et un peu bohème et quel avantage a-t-il retiré d’une semblable amitié ?
Constatons d’abord que rien ne nous permet de supposer que Novalis ait été même temporairement gagné par le nihilisme intellectuel et moral de son ami. Il ne semble pas qu’il ait traversé une crise religieuse, ni que la foi chrétienne qu’il tenait de l’enseignement familial et de son éducation piétiste ait jamais vacillé en lui. Il a pu lui arriver de protester contre l’austérité un peu morose de la religiosité paternelle. Mais il n’a jamais été gagné ni par le scepticisme, ni par l’esprit de révolte. Dans ses premiers essais poétiques, qui datent de cette époque, on trouve çà et là des accents nettement chrétiens et d’une évidente sincérité. Relisez plutôt la pièce intitulée Contentement, où Novalis exhorte l’homme à « ne pas maudire cette vie du pèlerin terrestre ». Sans doute, conclut le poète, il y a des heures douloureuses dans la vie où le spectacle de la nature et du printemps, où l’amitié et la philosophie ne sauraient vous préserver contre l’assaut de la mélancolie : « C’est pourquoi réfugie-toi, ô homme, auprès du Livre de la très divine religion, près du Livre très saint ; là seulement cherche la consolation qui t’avait fui. De là coulera à flots en ton cœur la paix bénie, l’intime félicité et, sur ton rude sentier, te sourira le divin contentement ». Plus concluants encore sont les passages nombreux qui attestent l’effort passionné du jeune homme vers un idéal moral supérieur, où il confesse humblement les défauts qu’il se reconnaît et aspire ardemment à se rapprocher de la perfection qu’il entrevoit. « Sans force, je me vois condamné par le sort à la jouissance indigne d’un homme ; je frémis lâchement devant le danger. La destinée m’a donné une éducation efféminée. Je suis non pas son favori mais son esclave ». Et il conclut : « Prends-moi donc, ô Parque, ce que des milliers d’êtres implorent, ces dons que ta bonté m’a si généreusement départis ; donne-moi les soucis, la misère, les tourments ; mais en échange donne de l’énergie à mon esprit. » Ce ne sont point là les accents d’une âme blessée par le doute. L’adolescent qui écrivit ces vers n’a pas vu se dresser devant son imagination la vision inquiétante de la « mort de Dieu ». C’est un croyant qui a foi en Dieu, qui sait où est le bien et le mal, et qui, conscient de sa faiblesse et de ses imperfections, voudrait se rapprocher de l’idéal qui flotte devant son imagination.
La religiosité très sincère du jeune Hardenberg n’a d’ailleurs rien d’ascétique ni de chagrin. Il aime la vie, il veut en jouir largement et c’est sans remords, en bonne conscience, qu’il aspire au plein épanouissement de sa personnalité. L’enfant rêveur et replié sur lui-même est devenu un élégant cavalier qui se flatte de « jouer un rôle brillant sur la scène du monde », qui mène gaiement la vie pittoresque d’étudiant allemand, qui se bat en duel, qui a le sang chaud et le cœur inflammable, fréquente volontiers le monde où l’on s’amuse et s’éprend à Leipzig, d’une certaine Julie qui figure plus tard dans la société berlinoise sous le nom de Mme Jourdans. Beau et richement doué, appartenant à la plus haute aristocratie, il est fait pour plaire et pour réussir dans le monde. Il s’y présente comme un dilettante épris de philosophie et d’art, enthousiaste de Platon et de Hemsterhuys, causeur étincelant dès qu’il se trouve en face d’un partenaire digne de lui. Il professe un optimisme convaincu et déclare « qu’il n’y a point de mal dans l’univers », qu’on se rapproche d’un nouvel âge d’or. Bref, il apparaît à son ami Schlegel comme l’incarnation même de la jeunesse et de la joie de vivre. « Le destin, écrit celui-ci à son frère, a mis dans mes mains un adolescent dont on peut tout espérer… C’est un tout jeune homme encore, de belle mine et de bonnes manières, au visage distingué, aux yeux noirs. Sa physionomie prend une expression magnifique quand il parle avec chaleur — avec quelle chaleur indescriptible ! — d’une belle chose ; il parle trois fois plus et trois fois plus vite que le commun des mortels. Il a l’intelligence la plus vive et la plus ouverte. Jamais le joyeuse fraîcheur de la jeunesse ne m’est apparue si éclatante. Il y a en lui une pudeur de sentiments qui vient de l’âme, non de l’inexpérience. Il est très gai et malléable et prend pour l’instant toutes les empreintes qu’on lui communique. »
Le défaut que, en toute simplicité, il constate chez lui et que ses camarades relèvent également, c’est une certaine mobilité d’impressions, une instabilité qui l’entraîne à toute sorte de désordres, dont il souffre et dont il ne parvient pas à se corriger. Schlegel observe chez son ami « une mobilité sans frein qu’une femme même perdrait sa peine à vouloir fixer » ; il le trouve « brusque jusqu’à la sauvagerie, animé d’une joie toujours remuante et inquiète » ; il lui déclare sans ménagements. « Je vous trouve tantôt adorable, tantôt méprisable », ou encore, « Vous voyez le monde en double : une fois comme un bon jeune homme de quinze ans et ensuite comme un mauvais sujet de trente. » Et de fait : il y avait dans sa vie un décousu dont il se rendait compte lui-même et qu’il ne pouvait approuver. Il était capricieux dans sa vie sentimentale, flambait comme un feu de paille et s’éteignait tout aussitôt après. Son frère Erasme l’avait surnommé « Fritz le papillon » et déclarait qu’il ne se chargerait pas d’écouter les doléances de toutes les belles que ce don Juan avait courtisées. Novalis était arrivé à Leipzig avec les plus sages résolutions de travail. « Il faut chercher à acquérir plus de fermeté, de décision, de logique, de constance et j’y arriverai le plus aisément par l’étude sérieuse du droit. Je me ferai une loi stricte d’observer un jeûne absolu en ce qui concerne les belles lettres et de m’abstenir de tout ce qui pourrait m’éloigner de mon but ». Or il lui fallait bien reconnaître qu’il n’avait pas trouvé l’énergie de s’imposer cette discipline ferme, que, tout comme à Iéna, il s’était laissé distraire, et qu’au lieu de suivre des cours il avait composé des vers, causé philosophie ou simplement fait la fête avec son ami Schlegel. Et il constatait cette faillite avec de sincères remords, maudissant les « divagations désordonnées de son imagination », se reprochant « ses heures d’irréflexion », et ses « errements », déplorant cet « égoïsme » qui se développe si aisément chez des natures comme la sienne et dont il espère se défaire à la suite d’un rigoureux examen de conscience.
Ne nous dissimulons pas, d’ailleurs, que si ce vagabondage sentimental, philosophique et littérairé n’entrait pas dans le programme que s’était trace Hardenberg et si, surtout, il devait apparaître à son père comme la plus funeste et dangereuse aberration, il a eu, pour la formation de la personnalité de notre poète, une importance capitale. Si Novalis compte dans l’histoire de la littérature et de la pensée allemande, ce n’est pas seulement parce qu’il a été un mystique chrétien d’une exquise ingénuité, mais aussi parce qu’il apparaît en même temps comme l’un des représentants typiques de cette génération idéaliste et romantique qui se développait à ce moment en Allemagne. Or, c’est bien à Leipzig et au contact de Frédéric Schlegel, qu’il a pris conscience de cette culture romantique, qu’il s’est assimilé dans ses grandes lignes la conception du monde qui germait dans les esprits les plus avancés de la jeunesse d’alors. C’est ce besoin profond d’entrer en communion avec l’âme de son temps qui l’a certainement entraîné vers Schlegel en dépit des différences profondes qui les séparaient. Il a peut-être toujours gardé vis-à-vis de l’homme une défiance en somme être justifiée : « Sois sur tes gardes dans tes rapports avec Schlegel », écrivait-il dans son Journal intime. Mais il se rendait bien compte du profit qu’il pouvait tirer d’une liaison intellectuelle avec lui. Il avait sû deviner en Schlegel un génie capable de jouer vis-à-vis de lui le rôle d’initiateur à la vie de l’esprit, le prêtre d’Éleusis, qui lui ouvrirait le sanctuaire de la culture contemporaine. « Par toi, lui écrivait-il un peu plus tard, j’ai appris à connaître le ciel et les enfers, par toi, j’ai goûté aux fruits de l’arbre de la science. » Initié déjà par Reinhold et Schiller à l’idéalisme kantien, il apprend de Schlegel à mieux comprendre le Gœthe de l’époque classique et l’idéal de la culture hellénique. Il s’enthousiasme avec lui pour la Révolution française et cela avec d’autant plus d’ardeur, que son père et son oncle fulminaient avec toute l’indignation de bons et loyaux conservateurs contre les forfaits des sans-culottes et contre les idées nouvelles. Il pénètre à sa suite dans les arcanes de la philosophie de Fichte. Il suit dans les cahiers philosophiques de son ami qu’il se fait prêter, la genèse progressive de la pensée romantique.
À Leipzig, d’ailleurs, sa personnalité littéraire ne s’est pas encore formée. Sans doute Frédéric Schlegel, après lecture de ses premiers essais poétiques, lui prédit aussitôt un brillant avenir. « J’ai parcouru ses œuvres, écrit-il à son frère Guillaume. Aucune maturité dans la langue et la versification ; de constantes digressions ; une excessive longueur ; une surabondance d’images simplement ébauchées. Mais tous ces défauts ne m’empêchent pas de flairer en lui les qualités qui font le grand poète lyrique, une sensibilité originale et belle et une aptitude à percevoir toutes les nuances du sentiment. » Mais il semble bien que ce jugement ait été dicté à notre critique plutôt par l’impression vivante qu’il avait reçue de la personnalité de Hardenberg que par l’examen réfléchi de ses poésies mêmes. Ces premiers essais, qui figurent aujourd’hui tout au long dans les éditions critiques récemment parues, sont en effet d’une insignifiance presque constante. Ce sont des petites pièces sur le vin et l’amour, des gentillesses anacréontiques, d’aimables parodies de l’antique, des poésies de circonstances, où l’on retrouve l’influence de toutes les lectures du jeune homme, Klopstock et les poètes du Hainbund de Gœttingue, Wieland et les anacréontiques, Bürger surtout, pour qui Novalis témoigne d’une particulière prédilection. Ou bien c’est une esquisse de drame, Kunz de Stauffungen, qui n’est pas autre chose qu’une pâle et médiocre imitation de Gœtz de Berlichingen. À peine si, çà et là, dans quelques pièces d’inspiration religieuse (Contentement ou Plaintesd’un jeune homme) on entend quelques accents un peu plus personnels. Novalis n’est encore qu’un dilettante aimable et un peu prolixe. Le poète n’est pas né en lui : il ne se développera que lorsqu’il aura reçu le baptême de la souffrance.
Le séjour de Leipzig, cependant, aboutit pour Hardenberg, comme celui d’Iéna, à une crise intérieure et à des explications désagréables avec sa famille. Une brouille avec Schlegel, passagère d’ailleurs, mais qui sur le moment faillit amener un duel, l’état de trouble où le plonge sa passion vite éteinte mais très ardente pour Julie, les soucis que lui donnent une affaire de dettes restée mystérieuse, où il se conduisit, au dire de Schlegel, « comme un enfant » et où l’honneur de sa famille risqua, paraît-il, un instant de se trouver compromis, toutes ces circonstances réunies suscitent chez lui une véritable détresse morale. Il songe à lâcher toutes les études et à se faire soldat. Il se découvre brusquement une vocation militaire qui s’impose à son imagination, vers le début de 1793, avec l’intensité d’une idée fixe. Il lui semble que le service des armes sera pour lui la meilleure discipline morale. Obligé de « se plier aux règles rigides d’un système », astreint à l’accomplissement strict de devoirs bien définis et à des besognes en grande partie machinales, il acquerra peu à peu, affirme-t-il, cette fermeté de caractère qui lui fait défaut. Son père, impressionné d’abord par la solennité de son langage, se montre tout prêt à acquiescer à son désir. Il se rend alors à Eisleben pour s’entendre définitivement avec les siens. Mais lorsqu’il se trouve en présence de la réalité prosaïque, son grand projet lui apparaît beaucoup moins séduisant. Il apprend que la situation financière de son père n’est rien moins que brillante, qu’il ne peut être question pour lui d’entrer dans quelque régiment de cavalerie élégant, que son avancement serait lent, son existence matérielle étriquée et médiocre. Et son enthousiasme pour la carrière militaire s’éteint aussi vite qu’il s’était enflammé. Il s’aperçoit qu’il arrivera tout aussi aisément à se créer une situation indépendante en continuant ses études. Et dans ces conditions il se décide à changer encore une fois d’université : de Leipzig il émigre à Wittemberg.
III
Dans la petite cité saxonne, un peu assoupie, mais où flottaient les souvenirs d’un passé glorieux, Hardenberg trouve enfin une atmosphère favorable au recueillement et au travail. Il se met donc à l’ouvrage pour rattraper le temps perdu. Et cela de bon cœur. Il n’a point de regrets, semble-t-il, de l’existence bruyante et agitée qu’il menait à Leipzig. Pas un instant il ne songe à se faire homme de lettres, à devenir un professionnel de la plume. Il ne sera et ne veut être écrivain qu’à ses heures de loisir, pour satisfaire l’instinct de nature qui le porte vers la poésie et la philosophie. Il sent au contraire très vivement, la nécessité de choisir une carrière, quoiqu’il pût lui en coûter. Il s’y résout non pas seulement par déférence pour les conseils de son père, mais parce qu’il perçoit clairement tout le profit qu’il peut tirer, pour son perfectionnement intérieur, d’une activité pratique bien réglée. En dépit de « sa nature foncièrement anti-juridique, sans vocation ni instinct pour le droit », il se prépare donc en conscience au métier d’administrateur. Il termine avec ardeur l’étude de la législation saxonne fort négligée jusqu’alors. Arrivé à Wittemberg au printemps de 1793, il passe avec succès ses examens dès le mois de juin de l’année suivante et se sent heureux d’avoir derrière lui, à vingt-deux ans tout « le fatras d’école. »
Son rêve d’avenir se précise maintenant. Pour fixer la mobilité de sa nature d’imaginatif et donner de la consistance à son caractère, il avait songé un instant à embrasser l’état militaire. Il pressent maintenant que c’est dans l’accomplissement régulier des devoirs domestiques qu’il trouvera cette paix de l’âme tant cherchée. Il est convaincu, écrit-il à sa mère, que le goût pour le bonheur du foyer, qui est si vivace en lui, ne peut manquer d’avoir sur sa destinée l’action la plus bienfaisante. Il sent qu’il est fait pour la vie de famille, qu’elle lui convient « comme l’air de montagne ». Il servira de père à ses frères et sœurs au cas où son père viendrait à mourir. Il compte donc se marier de bonne heure et vante à son frère Erasme, les charmes de « l’état de philistin ». Il déclare même tout franchement qu’il veut faire un mariage riche, pour pouvoir d’autant mieux savourer toutes les magnificences de ce bel univers. Il est d’ailleurs certain que, en organisant ainsi sa vie, il n’est pas infidèle à ses aspirations de jadis. Peu de semaines après avoir passé ses examens, il écrit à Schlegel, le confident de ses ambitions littéraires de Leipzig : « J’attends tranquillement l’appel de la destinée, car ma vie est d’ores et déjà fixée. Je n’ai qu’un but, que je pourrai atteindre partout où s’ouvrira pour moi un champ d’activité. Mais je ne me suis pas, comme un vulgaire bourgeois, fixé des limites trop étroites. Si je conserve la santé, j’atteindrai le maximum de développement dont je suis capable… Sache que je suis et reste assurément digne de toi. Qui sait si malgré tout, nous ne suivrons pas la même voie — oublie un instant mes vingt-deux ans et laisse moi ce rêve — peut être comme Dion et Platon. »
Pas à pas il avance sur la voie qu’il s’est choisie. Il veut entrer, comme son père, dans les salines saxonnes. Et en attendant qu’il se trouve un poste vacant dans l’administration supérieure, en Saxe ou en Prusse, il va, au mois d’octobre 1794, faire un stage chez le bailli Just, à Tennstedt, pour s’initier à la pratique des affaires courantes. Et il s’acquitte avec entrain et succès des tâches assez modestes qu’on lui confie. Plus heureux et plus sage qu’un Wackenroder ou un Hœlderlin, il n’éprouve aucune difficulté à concilier la réalité et l’idéal, la prose de la vie avec ses aspirations supérieures. Ses goûts littéraires et spéculatifs ne l’empêchent pas d’être un fonctionnaire modèle. Son mentor, l’excellent Just, est émerveillé de la facilité avec laquelle il se met au courant de ses occupations nouvelles et de la conscience avec laquelle il accomplit sa besogne. Il aborde, sans se laisser rebuter, les études techniques les plus arides. Le chimiste Wiegleb qui lui enseigne la technologie des salines, est stupéfait de la promptitude avec laquelle, en dix à douze jours, il s’assimile cette matière peu attrayante. Et il montre la même application à acquérir le maniement courant du style administratif, recommençant deux et trois fois le même travail pour lui donner une forme entièrement satisfaisante, couvrant des pages entières de synonymes ou de termes techniques, afin d’acquérir la souplesse et la précision dans l’expression qui conviennent au langage des affaires.
La vie semble ainsi s’ouvrir pour lui sous les auspices les plus favorables. En possession des dons les plus rares d’intelligence, d’imagination, de mémoire, de cœur, embrassant dans une chaude sympathie les hommes et la nature, sensible à toutes les beautés et toutes les harmonies de l’univers, apte à goûter les joies saines de l’existence, il semble promis aux plus heureuses destinées. Ce n’est pas un de ces génies superficiels et présomptueux qui se heurtent douloureusement aux bornes nécessaires de l’humanité. De bonne heure il a compris la nécessité de la discipline, de l’effort patient, du dévouement à une tâche limitée. Au sortir de l’université où il s’est affirmé l’égal des plus brillants représentants du romantisme naissant, il s’est plié sans effort aux exigences de la vie pratique et semble en bonne voie pour devenir un homme utile en même temps qu’un esprit supérieur.
C’est à ce moment que l’amour entre dans sa vie, et avec l’amour la souffrance.