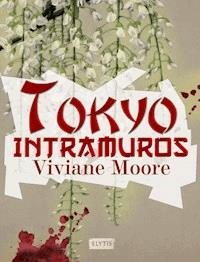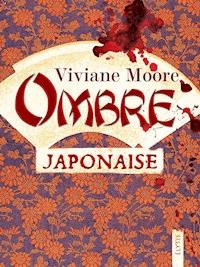
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elytis Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un voyage au cœur d'une Tokyo en pleine mutation
« Je ressens un mélange d’excitation et d’anxiété que je maîtrise mal. La venue de cette femme me trouble… Elle pourrait être vieille et laide. Soan ne m’a rien dit sur elle. Anonymat oblige. Et malgré tout, je ne peux m’empêcher d’imaginer ses courbes rehaussées de couleurs. J’avale ma salive, avec difficulté. Je l’attends comme jamais, peut-être, je n’ai attendu une femme. »
Dans ce nouvel opus japonais, Viviane Moore nous plonge avec violence et sensualité dans le brouillard d’un univers oppressant et urbain à l’excès.
Une silhouette tatouée tel un yakuza, fuyant son passé, sème la mort et la terreur à Tokyo. Ombre japonaise, cachée derrière le paravent d’un maître tatoueur ou dans le dédale des rues, cette femme n’en finit pas de réclamer justice.
Un polar rouge sang, noir comme l’encre d’un tatouage, lumineux comme une estampe
EXTRAIT
L’homme marche vite. C’est un Occidental et, pourtant, il paraît à son aise dans ce singulier quartier d’Ueno, un lieu hors du temps comme il n’en existe presque plus à Tokyo. Pauvres maisons de bois serrées les unes contre les autres en étroites ruelles. Linge séchant à des cordes tendues dans les venelles.
Grand, les épaules larges, une tignasse de cheveux blonds en bataille encadrant un visage aux traits rudes, l’homme est habillé d’une veste et d’un pantalon de lin, une lourde sacoche de cuir à l’épaule. Il a cette démarche souple, presque élastique, des sportifs ou des danseurs. Son regard vert balaye sans cesse ce qui l’entoure. Sans inquiétude, juste par habitude, une habitude de l’œil et du corps aussi.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Viviane Moore, née le 3 juillet 1960 à Hong Kong, est une journaliste et romancière française, spécialisée dans les romans policiers historiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A la vie, au souffle de vie, envers et contre tout…
PROLOGUE
Paris, Quartier latin, mai 1993.
JE CROIS que je suis resté un moment sans comprendre, sans réaliser vraiment ce qui se passait, ce que je faisais ainsi, agenouillé sous la table.
Le monde avait explosé. Des cadavres jonchaient le sol, les cloisons étaient éventrées, les miroirs brisés. Le corps de mon frère avait glissé à terre, le dos transpercé d’éclats de verre. Sans vie.
Pendant un instant, je crus que moi aussi… Tout ce sang, le regard fixe de Marc. C’était peut-être ça la mort ? Aucun son. L’impression d’être immergé au fond d’une piscine emplie de fumées et de flammes. Sans un bruit.
Une quinte de toux me déchira la poitrine, une douleur aiguë les tympans.
Le feu rongeait les tables, les chaises, les boiseries et les tentures du restaurant. Bientôt, il serait sur moi.
Tout près, le corps d’un homme qui remue faiblement. Une de ses jambes forme un angle impossible. Sa bouche s’ouvre, mais je n’entends toujours rien. Il retombe et, en cet instant précis, je sais qu’il est mort et que je suis vivant.
Suis-je le seul ? Je tourne lentement la tête.
La lumière du jour paraît lointaine, si lointaine, l’impression d’être au bout d’un tunnel, alors que quelques mètres à peine me séparent de la rue.
A contre-jour, deux silhouettes bougent là-bas. Irréelles.
La femme, une blonde, porte une robe claire serrée à la taille. La lumière du jour traverse le tissu, soulignant les courbes de son corps, ses cheveux défaits flottent sur ses épaules et, autour d’elle, joyeusement, un enfant fait la ronde. L’impression d’irréalité s’accentue encore. Et toujours cette absence de bruit.
Les flammes toutes proches. La chaleur insupportable, l’air manque.
Sortir.
Je marche, enfin je crois que je marche, mais je m’aperçois que je suis toujours agenouillé. Je me sens lourd, si lourd. Il faut que j’aide ces deux-là. Ensuite, je reviendrai chercher mon frère.
Mon regard se tourne à nouveau vers la porte, l’enfant sautille, il a attrapé la main de la jeune femme et la force à danser avec lui.
Elle se laisse faire, ses bras et ses jambes remuant comme ceux d’un pantin.
Malgré le feu, les morts, ou peut-être à cause de cela, ils sont beaux. Je pense à la photo que je pourrais faire et que je ne ferai pas.
Nausée.
Mon regard revient vers Marc. Tout a été si vite. L’instant d’avant, nous parlions moi du reportage, lui du portrait. Enfants de photographes, nous avions choisi cette voie avec enthousiasme tant la passion de nos parents était communicative et puis, il y avait eu leur mort à tous deux…
Non, je ne ferai rien.
Pourtant ma sacoche est là, intacte. Malgré tout ce qui vient de se passer, je l’attrape et me lève.
Je marche jusqu’au gamin, saisissant sa main que je serre fortement dans la mienne.
Est-ce le contact de ma paume ? Il s’immobilise aussitôt, me regarde et se cramponne à moi avec son autre bras comme s’il allait me grimper sur les épaules. Petit singe fragile et affolé.
Quelques sons me parviennent enfin. Un sourd grondement qui vient des cuisines.
Peut-être tout n’est-il pas fini ? Une autre explosion se prépare. Le gaz. Plus aucune conscience du temps.
La femme ouvre la bouche pour crier. Je la soulève sans effort, la jetant en travers de mon dos. Elle ne se débat pas et s’accroche à ma chemise. Elle est lourde. Lourde de toute cette terreur qui contracte son corps contre le mien. Ses ongles s’enfoncent dans ma peau.
Je cours.
Le seuil est là, devant moi.
Dehors, c’est l’éblouissement du soleil de midi. Le vert des platanes. Le bleu du ciel. Les gyrophares. Les ambulances hurlantes, les flics… La foule derrière les barrières de sécurité, des visages et des corps statufiés par l’angoisse et la curiosité.
Des craquements dans mon dos.
Je me jette en avant. Désespérément. Des pompiers courent vers nous, ils m’arrachent l’enfant et la femme qui hurle d’une voix perçante. Ils nous entraînent, nous soulevant, me portant presque.
Ils crient tous, mais je ne comprends pas ce qu’ils disent. Je n’ai d’yeux que pour la foule qui recule en désordre. Panique, hurlements.
Une foule qui m’en rappelle d’autres. Mais ce n’est plus le Liban ou la Palestine, c’est la France et Paris.
Envie de rouler au sol, de me protéger la tête. Des images se bousculent, explosions, balles perdues, corps ensanglantés, enfants en pleurs, charniers… J’en ai tant vu. Trop vu.
Les portes de l’ambulance sont grandes ouvertes. Les pompiers nous y font monter si vite que je me retrouve à côté de la femme, debout, l’enfant contre moi sans bien savoir comment.
Là-bas, un souffle projette ce qui reste de la façade du restaurant vers l’avant.
Des jets de verres brisés, des flammes. Les lances d’incendie arrosent le brasier, éclaboussant les trottoirs.
Une infirmière nous fait asseoir. Elle nous enveloppe de couvertures, nous parle, mais je ne l’écoute pas. Trop vite, trop de mots. Je préférais le silence d’avant, cette impression d’immersion, je viens de réaliser que j’entends à nouveau presque normalement.
Comprenant que personne, pas plus l’enfant que la femme ou moi, ne l’écoute, elle se tait d’un coup, se contentant de nous ausculter.
Un creux à l’estomac, une sensation de vide. Mes jambes vacillent. Je m’assieds sur la civière le long de la paroi.
– Vous avez mal, monsieur ? demande l’infirmière qui m’a vu grimacer.
Incapable de formuler une réponse, j’enserre mon crâne dans mes mains et ferme les yeux.
Comment lui expliquer que ce n’est qu’une douleur immense que rien ni personne ne pourra jamais guérir ? Que ni elle ni ses médicaments n’y pourront rien. Que je n’en peux plus d’être le survivant. Toujours.
– Votre femme, votre fils ? fait-elle en désignant les autres.
Je fais signe que non. J’ai envie de lui parler de mon frère, de l’homme qu’il était, de l’enfant qu’il a été. Ma gorge se noue davantage, envie de hurler.
Tremblant de tous ses membres, la jeune femme se blottit contre moi, le garçonnet s’est assis à mes pieds, se tenant à mon pantalon en marmonnant des mots sans suite.
Nous restons ainsi sans bouger alors que s’écoule un temps différent de tous les autres.
Lourd, si lourd. Dehors, tout est fini. Je ferme les yeux un instant.
Quand je les rouvre, un homme, habillé d’un pardessus froissé, est monté dans l’ambulance.
Il nous regarde et montre sa carte à l’infirmière qui proteste, il la repousse fermement et s’adresse à moi.
– Police, puis-je vous parler monsieur ? Vous m’entendez ? Il m’entend ? dit-il à l’infirmière sans se retourner.
– Oui, mais il est sous le choc, vous ne pouvez vraiment pas attendre qu’ils soient tous à l’hôpital ?
Le flic ne lui répond même pas, et répète sa question en détachant les syllabes comme si j’étais un gamin :
– Vous m’en-ten-dez ? me demande-t-il à nouveau.
Les mots refusent encore de sortir. Je me racle la gorge et prononce un “oui” d’une voix que je ne reconnais pas.
– Je suis l’inspecteur Dumont. Y avait-il d’autres survivants que vous à l’intérieur ?
– Non.
– Avez-vous vu ce qui s’est passé ?
– Non.
– D’où venait l’explosion ?
– Des cuisines, deux déflagrations…
– Vous êtes sûr ?
– Oui.
– Combien étiez-vous là-dedans ?
Un flot de paroles soudain qui me monte à la bouche.
– Je ne sais pas. Une quinzaine peut-être, clients, serveurs, patron, personnel en cuisine.
Il me dévisage, puis regarde la sacoche posée à mes pieds.
– Photographe ?
– Oui.
Il s’interrompt brusquement, et salue avec respect celui qui vient de monter dans l’ambulance. Un homme à la peau aussi grise que son costume, au visage osseux, au nez busqué, le cheveu rare et l’iris d’un bleu si pâle qu’on le dirait blanc.
Il entraîne le policier dehors, à l’écart près d’une voiture banalisée. Ils discutent à voix basse, nous jetant de temps à autre des regards de biais.
Je m’en désintéresse. D’ailleurs, en cet instant, rien ne me soucie vraiment que la mort de mon frère, cette femme, cette inconnue qui tremble de tous ses membres à mes côtés, et cet enfant cramponné à moi.
Mes yeux errent à nouveau sur les pompiers qui se démènent, sur la foule, un groupe de touristes japonais, puis les regards curieux, excités, d’Américains qui nous prennent en photo, nous les rescapés. Un flic les bouscule. Ils reculent en protestant. Je n’en vois pas plus.
L’infirmière a refermé les portes, l’ambulance démarre.
– Monsieur, essayez de raisonner cette jeune femme afin qu’elle s’allonge sur la civière. Je voudrais l’examiner.
Sirène hurlante. Gyrophares. J’imagine la une des journaux. “Quinze morts dans l’explosion d’un restaurant au Quartier latin.” Mon cerveau tourne à vide.
Dehors les rues de Paris défilent. La Seine brille. Les gens flânent aux terrasses en savourant leur café, comme d’habitude.
La jeune femme a fini par se laisser convaincre. Elle s’est enroulée dans les couvertures. Ses traits se détendent peu à peu. Ses dents ont cessé de claquer. L’enfant s’est endormi sur les genoux de l’infirmière.
Je repense au cadavre sous la table, au regard fixe de ce frère que j’ai dû abandonner dont il ne restera rien que je puisse mettre en terre. Ses cendres balayées par l’eau des lances d’incendie.
Une vilaine douleur m’empêche soudain de respirer. Je sais que la barrière de son corps m’a sauvé la vie. Il était entre moi et l’explosion. Marc, mon aîné, le plus sage de nous deux.
Celui qui m’a toujours protégé de tout. Celui que rien n’abattait jamais, qui éclatait de rire et me faisait sauter sur ses épaules quand j’étais en colère ou que j’avais peur.
Des milliers de points lumineux dansent devant mes yeux.
Soudain, tout s’obscurcit d’un coup. J’essaye de me rattraper, mais le plancher monte vers moi. Très vite, trop vite. J’entends l’infirmière crier.
Noir.
“En première rencontre, Aussi distante qu’un Bouddha En biais dans son coin”
YANAGIDARU,Tonneau de saule, 1765.
Dix ans plus tard, Tokyo, Japon.
L’HOMME MARCHE VITE. C’est un Occidental et, pourtant, il paraît à son aise dans ce singulier quartier d’Ueno, un lieu hors du temps comme il n’en existe presque plus à Tokyo. Pauvres maisons de bois serrées les unes contre les autres en étroites ruelles. Linge séchant à des cordes tendues dans les venelles.
Grand, les épaules larges, une tignasse de cheveux blonds en bataille encadrant un visage aux traits rudes, l’homme est habillé d’une veste et d’un pantalon de lin, une lourde sacoche de cuir à l’épaule. Il a cette démarche souple, presque élastique, des sportifs ou des danseurs. Son regard vert balaye sans cesse ce qui l’entoure. Sans inquiétude, juste par habitude, une habitude de l’œil et du corps aussi. Il aurait pu être peintre, il n’est que photographe.
Il se dirige sans hésiter vers l’une des maisonnettes. Celle dont la porte est barrée d’un noren de lin jaune, une portière de tissu fendue par le milieu qui oscille dans le vent matinal.
Une pierre plate est posée près du seuil. Dessus est tracé au pinceau l’idéogramme d’un nom. D’une large jarre de terre cuite sort le tronc grêle d’un érable aux feuilles dentelées d’un rouge profond.
Là, dans cette maison simple, travaille l’un des plus grands maîtres tatoueurs du Japon.
Soan, le nom d’une lignée pratiquant l’art complexe de l’horimono, le “corps gravé”. Un art dont les origines remontent au IIIe siècle et qui connut son apogée au XVIIIe siècle. D’abord signe d’opprobre et marque de criminels, le tatouage servit longtemps à calligraphier dans la chair serment ou incantation, avant de devenir ornemental.
L’homme écarte le rideau et entre, ôtant ses chaussures et enfilant l’une des paires de chaussons disposées au pied de l’escalier. Arrivé au premier, il frappe doucement au vantail. Un ordre bref en japonais, il entre et referme doucement derrière lui.
Une lumière orangée, chargée de myriades de poussières, filtre entre les lattes de bambou, traçant un chemin clair sur le bois du plancher.
Une salle vide, ou presque. Sur des nattes, des pots de couleurs, des pinceaux, des stylets rangés dans des présentoirs inclinés. Dans un angle, un autel shinto d’où s’élève la fumée légère d’un bâtonnet d’encens, une odeur à laquelle se mêle celle du shochu, l’alcool de riz.
Le photographe s’est placé en retrait, son appareil, un vieux Leica, masquant son regard.
Un Japonais entièrement nu vient de rentrer dans la pièce, il s’est allongé sur un linge près de la fenêtre. Un tatouage inachevé orne ses épaules. Soan a juste une brève inclinaison de la tête vers lui. Pas un mot n’a été échangé.
Silencieux, le photographe change de place.
Assis en tailleur, vêtu d’un pagne de coton blanc, le corps recouvert de tatouages, le maître reste immobile. Le front plissé et le regard fixe, il se concentre.
Le photographe a tourné son appareil vers le buste maigre de Soan qui se courbe lentement vers son client.
Le déclic du Leica, si léger pourtant, me gêne.
Je recule et m’allonge à même le plancher. Mon œil ne quitte pas le viseur. Je cherche un détail de la peau à cadrer. Des bleus, des rouges, l’impression de pénétrer à l’intérieur d’une peinture. Un corps devenu toile. Une toile dont le maître utilise les courbes, la couleur de peau, la minceur d’un membre, la saillie d’un muscle.
Le maître a choisi le premier stylet, l’a humecté de noir de Chine à l’aide d’un large pinceau qu’il garde coincé entre les doigts de sa main gauche.
Il chevauche le corps de l’autre. La peau tressaille. Le visage est tourné vers le mur, mais je sens la tension des muscles quand la pointe s’enfonce dans la chair. Douleur contenue, maîtrisée. Nouveau déclic.
Un quart d’heure passe, je vais d’un angle de la pièce à un autre, tournant autour des deux hommes.
Encore et encore. Des centaines d’incisions très rapides. Du sang coule que le maître ôte d’un revers de linge avant de vaporiser de l’alcool de riz sur les plaies.
Pas une plainte, juste ces gouttes de sueur qui ruissellent le long du cou.
Les gestes du maître sont précis, son mouvement du poignet très vif. Il s’arrête un instant, humecte un nouveau stylet, à la pointe plus large que les précédents.
Je me redresse et m’approche. Jusque-là, j’ai travaillé au 135, et au 50, mon optique préférée, celle qui vous oblige à bouger. Je suis au-dessus d’eux. Je cadre le dos du tatoueur avec celui de son client, et déclenche à nouveau.
Un dragon, la gueule ouverte, qui descend des omoplates jusqu’au bas des reins du maître, une carpe rouge émergeant de l’eau, sur les épaules du jeune Japonais.
Une heure est passée. La séance est finie. Le maître s’est redressé, a échangé un mot avec l’homme à la carpe, lui a tendu une serviette de lin propre afin qu’il essuie la sueur qui dégouline de son front. L’homme est blême, des cernes noirs soulignent la brillance de ses yeux. Il salue le maître très bas et, enfilant ses chaussons, passe dans la pièce à côté.
Un vestiaire où pendent des yukatas, des kimonos de coton. Des piles de serviettes parfumées sur une petite table. Une pousse de bambou dans un vase. De longs bancs de bois.
Il referme doucement derrière lui.
Ici, je n’existe pour personne. Ces deux-là sont ailleurs. Dans une dimension qui m’est inconnue. Je pose un instant mon appareil sur ma sacoche, changeant à nouveau d’optique.
A l’autre bout de la pièce, le maître nettoie soigneusement ses stylets à l’alcool et les aligne dans la boîte marquée au nom de l’homme à la carpe.
Il a posé le pinceau chargé d’encre noire, devant lui, dans une coupelle de porcelaine.
Enfin, il se tourne, attrape la lourde théière de fonte sur son brasero, et verse un reste de thé vert dans une minuscule tasse céladon. Il ne semble toujours pas me voir. Il boit lentement.
Soan m’a prévenu que la personne suivante serait une femme. Ma première femme tatouée. Bien sûr, il faudra lui demander son autorisation pour les photos, mais jusqu’à présent je n’ai pas eu de problème, le plus difficile ayant été d’obtenir l’accord du maître tatoueur, lui-même. C’est le troisième maître chez qui j’effectue un reportage, un des plus renommés aussi.
Je glisse ma bobine dans une poche de mon sac, nettoie la lentille d’un coup de pinceau. Vérifie l’accrochage du film dans le boîtier, la lumière ambiante. Le Leica est chargé. Tout est prêt. En attendant, je n’ose troubler le silence ni m’adresser à Soan. Il est dans son monde intérieur et je ne m’y sens pas convié.
Je sors mon appareil numérique, un petit Sony. Une machine que je n’aime guère, mais qui me sert de bloc-notes quand je reste longtemps sur un sujet ou dans un même lieu.
J’ai souvent l’impression que mes yeux ne me suffisent plus et que je ne puis me passer de ces prothèses, de ces cadres, de ces lentilles de verre dans lesquelles j’enferme chaque jour davantage mon regard… L’appareil vissé à l’œil, je me promène dans la pièce, je l’explore en lentes circonvolutions. En mode rapide, il devient caméra, et enregistre les sons.
Le maître a reposé sa tasse, il respire bruyamment. Je tourne mon objectif vers l’autel shinto où l’encens achève de se consumer puis, à nouveau, vers la porte entrebâillée du vestiaire.
La porte de la rue a claqué, l’homme est parti.
Quelques minutes passent, lentes, infiniment lentes. Je pense à la femme tatouée qui va arriver. La porte d’en bas. Un bruit de pas dans l’escalier, un grincement léger tout proche, je sais qu’il s’agit du banc où s’assoient les clients pour se déshabiller.
C’est alors que je réalise à quel point je suis dans un état singulier. Mes mains sont moites, ma bouche sèche. Je ressens un mélange d’excitation et d’anxiété que je maîtrise mal. La venue de cette femme me trouble d’une façon que je ne m’explique pas.
Elle pourrait être vieille et laide. Soan ne m’a rien dit sur elle. Anonymat oblige. Et, malgré tout, je ne peux m’empêcher d’imaginer ses courbes rehaussées de couleurs.
J’avale ma salive avec difficulté. Je l’attends comme jamais, peut-être, je n’ai attendu une femme. Un sentiment étrange.
J’aimerais pouvoir conserver la totalité de cet instant : pas seulement les images et les sons, le frottement léger dans la pièce à côté, le bruit de ses pas, mais aussi les odeurs d’encens et d’alcool. Cette impression d’ivresse qui me tient soudain.
Je la vois presque, chair translucide, ôtant ses vêtements un à un. Très lentement… les posant sur le banc.
Le bois grince. La porte s’entrouvre.
Elle va apparaître. Oubliant ma promesse de ne rien faire sans autorisation, je braque le Sony vers la porte.
Elle apparaît dans l’entrebâillement. Habillée des chevilles aux poignets d’un tatouage infiniment plus complexe que celui que j’avais imaginé. Un kimono posé sur les épaules.
Je n’ai pas le temps d’en voir plus. Elle a bondi, essayant de m’arracher l’appareil des mains. Ses yeux flamboient de colère. J’essaye de lui expliquer en anglais ce que je fais ici, mais elle n’entend pas.
Je proteste :
– Je prenais juste des mesures de lumière et des sons. De toute façon, je ne ferai rien sans votre accord, je le promets. Vous me comprenez ? Je ne ferai rien sans votre…
Je me suis tu. Elle ne me m’écoute pas. Elle s’est tournée vers le maître, lui parlant d’une voix rauque, en petites phrases courtes et hachées. Elle va si vite que ma connaissance imparfaite du japonais ne me permet pas de saisir ce qu’elle dit.
La porte du vestiaire claque. Nous sommes à nouveau seuls dans la pièce. Je l’imagine qui se rhabille. Le bois de l’escalier craque, puis plus rien. Quelques secondes à peine ont suffi.
Le maître a reposé sa tasse un peu plus fort qu’il n’eût fallu.
Je sens toute la gravité de mon geste à la façon dont il s’adresse à moi en anglais, d’une voix contenue, plus sourde qu’à l’accoutumée.
– Cette femme veut ces photos. Elle vous attend en bas. Donnez-lui satisfaction ou nous ne nous reverrons pas.
Il n’ajoute rien. J’ai le sentiment d’avoir commis l’irréparable tant vis-à-vis d’elle, que de lui.
– J’ai compris. Pardonnez-moi, maître.
Je ramasse mes affaires et sors, non sans m’être incliné.
Il n’y a personne dans la rue, en tout cas personne qui lui ressemble, mais en fait, je ne sais pas à quoi elle ressemble vraiment, si ce n’est à une femme en colère. Elle est partie. Je ne sais même pas son nom.
Je reste un moment là, indécis. Puis me décide à m’en aller, moi aussi, me demandant comment me présenter à nouveau devant Soan. Il a déjà été si difficile de lui faire accepter l’idée même de ce reportage réalisé par un Occidental. De ce livre qui paraîtra en Europe.
Sans le consul de France, je n’y serais jamais parvenu.
Je repense à cela et maudis ma maladresse. Cette folie qui m’a poussé à voler ces images. Car je les ai volées. Et l’émotion est toujours là. Intense. Je l’ai trouvée… non pas belle, mais mieux que ça, différente de tout ce à quoi je m’attendais.
Je secoue la tête, lève les yeux vers le ciel d’un bleu sans défaut. Il faut que j’aille chez Yoshi, maintenant.
Je m’éloigne lentement, raffermissant ma prise sur la lanière du sac à mon épaule.
Sur les fils tendus, le vent soulève le linge. De longues tiges chargées de fleurs jaunes se courbent dans un pot, un canari en cage lance un trille aigu.
Dans son atelier, un artisan fabrique des cloisons de papier. Nos regards se croisent un instant.
Je longe le temple de Shitaya, et abandonne ce petit quartier de bois, retrouvant l’autre Japon ; celui des rues bruyantes, des voitures, des immeubles de verre, d’acier et de béton.
J’ai laissé ma moto, tout près, dans le parking d’un grand magasin.
Je quitte le souterrain et file vers Shinjuku par la voie express n° 1. Une fine pluie mouille soudain le plexiglas de mon casque. Je zigzague entre les taxis, les voitures, les camions, faisant rugir le moteur pour prendre la voie rapide surplombant des immeubles et d’anciens canaux.
Je ralentis pour me faufiler entre les véhicules arrêtés. M’immobilise un instant, aperçois le visage fardé d’une geisha à travers une vitre, sourire vite masqué par une main fine, visage harassé et gants blancs d’un chauffeur de taxi. Bientôt, je serai à Shinjuku, le quartier des plaisirs et du jeu de Tokyo.
Yoshi habite en lisière du Shinjuku Gyœn, le parc de Shinjuku. Un ancien jardin impérial empli de cerisiers en fleurs, aux parterres dessinés par un jardinier de Versailles au début du XXe siècle.
Un immeuble aux loyers plus onéreux que ceux des Champs-Elysées ou de l’avenue Montaigne à Paris. Une vaste pièce bourrée d’écrans informatiques, de disques durs, d’onduleurs, de scanners, d’imprimantes, de matériel de toutes sortes, mais aussi de rouleaux de papier, de sacs de plâtre, de pots de peinture, de pinceaux, de toiles… Des placards partout. Dans un recoin, le laser qu’utilise Yoshi pour réaliser des hologrammes… Ces insolites images en trois dimensions dans l’art desquelles il est passé maître.
Après m’avoir ouvert, mon ami retourna se pencher sur la maquette de ville qu’il construisait. En plâtre, six mètres de long, par quatre de large.
Les montagnes, la rivière Ohta, la mer, les îles, les temples, les maisons aux toits de tuiles vernissées, les cabanes de bois, les nagaya de travail… Arbres, pots de fleurs, rien ne manquait à cet étonnant paysage. Hiroshima avant Little Boy, la bombe qui la réduisit à néant le 6 août 1945.
J’ai rencontré Yoshi, il y a maintenant trois ans, à Londres. Il exposait ses œuvres dans un collectif japonais. Son travail m’a tout de suite fasciné. Sa vision du Japon était un patchwork de photos, de sculptures, de gravures, de peintures et d’hologrammes. L’homme touchait à tout. Aucun mode d’expression ne semblait lui être étranger. Son œuvre était tragique, mais infiniment esthétique. Il ne traitait que de son pays, en une espèce de danse entre le passé, le présent et le futur, mêlant les symboles traditionnels, religieux, mythiques, graphiques, à ceux de la modernité.
Mon regard s’attarde sur lui. Il n’a que trente-quatre ans, mais en paraît dix de moins, tant ses traits sont lisses et dépourvus de rides.
C’est un ancien otaku, un de ces enfants repliés sur eux-mêmes, refusant tout contact avec le monde, y compris avec leur propre famille. Un otaku dont les œuvres s’arrachent et qui, maintenant, voyage d’un bout à l’autre de la planète, oubliant peut-être, quoique j’en doute en voyant ses créations, son ancien refus des autres et de la société.
Je n’ai jamais su pourquoi ni comment nous nous sommes liés d’une si réelle et profonde amitié. Même quand des milliers de kilomètres nous séparent, jamais nous ne cessons de correspondre par e-mail, par téléphone, par lettres. Je lui envoie mon travail, nous discutons du sien.
Il m’entraîne sur des chemins que je n’emprunterais sans doute pas sans lui. J’espère que je sais lui rendre le même service. Il m’a appris, ou essayé de m’apprendre le japonais, il m’a fait apprécier les infinis parfums du saké et la chute des pétales de cerisiers dans les jardins de Ueno. Quelques-uns de mes sujets récents, dont celui sur le tatouage, viennent de lui et de nos discussions nocturnes les plus animées.
– Corman-san, konnichi wa, bonjour, dit-il sans relever la tête, ses doigts minces effleurant les méandres d’une rivière de plâtre teinté de vert.
Il aime m’appeler par mon nom de famille. Sa façon à lui de conserver de la distance entre nous.
– Bonjour Yoshi, mon ami ! fis-je en m’approchant de la grande maquette posée sur tréteaux.
Un travail fantastique, cette maquette d’avant la bombe. Je sais que depuis longtemps, voire depuis toujours, Hiroshima et Nagasaki hantent sa vie. Je me demande si sa famille n’est pas originaire de cette région du Japon, s’il n’est pas lui-même un descendant d’hibakusha, les irradiés, les survivants de la bombe. Jamais, il ne s’est confié là-dessus et jamais je n’ai osé lui poser la question.
Je regarde la maquette et le seul bâtiment que je connaisse par des clichés devenus tristement célèbres, celui qui a résisté à l’explosion. Un dôme “atomique”, c’est son surnom, qui s’élève aujourd’hui au centre du parc de la Paix.
Il a punaisé aux murs des centaines de documents d’archives, des photos aériennes du point d’impact, des films détenus par le musée commémoratif et le Mémorial Hall, des milliers d’heures de travail.
Je n’ai pas osé, non plus, lui demander ce qu’il ferait ensuite de cette maquette. S’il allait la détruire, simuler l’explosion, créer au-dessus d’elle un kinoko gumo, un nuage en forme de champignon…
– Tu as fait bonne chasse ? me demanda-t-il.
– Oui et non. J’étais chez le maître Soan.
Il sentit au ton de ma voix que quelque chose n’allait pas. Il se tourna vers moi, m’observant de son singulier regard étiré.
– Et alors ?
Je ne répondis pas tout de suite. Je branchai le câble du Sony sur l’ordinateur qu’il me prêtait et chargeai les images de la matinée : l’atelier, les stores de bambou, l’autel d’où s’élevait la fumée de l’encens, les coupelles de couleurs, Soan et sa tasse de thé…
– Alors rien, tu vas voir.
Il n’insista pas, se contentant de fixer l’écran où défilait le petit film. Je pointai le curseur sur la séquence où Soan lève sa tasse. Plein champ sur la porte du vestiaire.
– Voilà mon problème, dis-je, en lui montrant ce qui se dessinait maintenant.
La porte s’ouvrait. On voyait apparaître la silhouette de la femme.
– Je l’ai filmée sans autorisation. Cela s’est mal passé, très mal passé, et Soan refuse de me revoir tant que je n’aurai pas réglé ça. Seulement, elle a disparu et je ne sais même pas son nom.
Sur l’image suivante, la femme occupait tout l’espace. Yoshi arrêta l’image et l’agrandit au maximum.
Je remarquai l’extrême minceur de la Japonaise, la finesse de sa taille, l’étroitesse de ses hanches, sa musculature longue et déliée.
Le cœur me cogne à nouveau. A cause des rais d’ombre et de lumière qui jouent sur sa peau, le motif du tatouage est difficile à discerner. Il l’habille presque entièrement, à l’exception d’une étroite bande de peau qui part de la base de son cou, passe entre ses seins et s’arrête au sexe qu’elle couvre de ses mains croisées en m’apercevant. Les aréoles de ses seins sont cernées par des pétales de pivoine rouge.
Yoshi zooma vers la tête de la femme nue figée sur le seuil de la pièce. Envie, moi aussi, de manipuler l’image, de l’explorer.
Le visage fardé de blanc prend maintenant tout l’écran. Traits androgynes, pommettes hautes, mâchoire un peu carrée, petite bouche aux lèvres violines.
Vision de ses cheveux coupés très courts sur la nuque et les tempes, de cette grande mèche masquant mal un regard fixe, cerné de noir. Un puits dans lequel je m’enfonce, sans pouvoir, sans vouloir me retenir.
Elle m’obsède et, en même temps, j’éprouve une sensation de “déjà-vu”, de familiarité. Se pourrait-il que je l’aie rencontrée ailleurs ? Autrement ?
Mon trouble est-il si visible ? Mon ami me jeta un bref coup d’œil et passa à l’image suivante.
Là, elle est en colère, le visage tordu. Ensuite, alors qu’elle essaye d’attraper l’appareil, j’ai pris malgré moi des vues du plafond, puis plus rien.
– Elle n’est pas belle, lâcha Yoshi en se tournant vers moi, mais je comprends ce qui t’attire. Elle a quelque chose d’incandescent comme quelqu’un qui aurait survécu aux flammes. Une survivante. Que vas-tu faire, Erwan ?