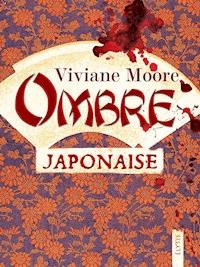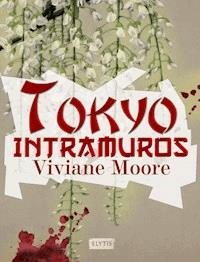
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elytis Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quand la passion conduit au meurtre…
« Les flics doivent me chercher partout. Partout, sauf ici. Ils ne pourront pas imaginer que moi, l'étranger, le gaijin, je me suis dissimulé dans la gare Shinjuku de Tokyo. Il y a là des centaines de cartons alignés le long des souterrains, des cartons habités par des humains qui rangent leurs chaussures à l'entrée. Le mien, c'est un carton Sony. Ça fait deux nuits que j'y dors, fuyant ce qui a fait de moi un architecte et... un assassin. »
C'est en virtuose du polar que Viviane Moore nous entraîne une nouvelle fois au Japon, dans l'univers trouble d'un architecte que phobie et passion amoureuse mèneront à l'irréparable...
Un polar noir dans la tradition du genre
EXTRAIT
Avec le recul, j’ai l’impression que tout a commencé cette nuit-là, il y a bientôt six mois… Il y avait le bourdonnement de cette mouche contre la lanterne de papier d’un bar du Kabuki-cho, le quartier “sans nuit” de Tokyo, le quartier des plaisirs. C’était un petit bruit sec, agaçant, ponctué de chocs sourds. Elle s’obstinait à chercher une issue qui n’existait pas… comme moi. J’aurais peut-être pu continuer longtemps ainsi… Mais là, j’ai pris conscience que je n’en pouvais plus.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Viviane Moore, née le 3 juillet 1960 à Hong Kong, est une journaliste et romancière française, spécialisée dans les romans policiers historiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Un voyage, fût-il de mille lieues, débute sous votre chaussure.”
LAO-TSEU
A Paul
PROLOGUE
LES FLICS doivent me chercher partout. Partout, sauf ici. Ils ne pourront imaginer que moi, l’étranger, le gaijin, je me suis dissimulé dans la gare Shinjuku de Tokyo.
Il y a là des centaines de cartons alignés le long des souterrains, des cartons habités par des humains qui rangent leurs chaussures devant l’entrée.
Le mien, c’est un carton d’emballage Sony, un grand carton brun constellé de codes-barres et d’étiquettes. Ça fait deux nuits que j’y dors, fuyant ce qui a fait de moi un architecte et… un assassin.
Ce soir, pourtant, est un soir différent des autres : c’est celui de mes trente ans. J’ai craqué une allumette et j’ai regardé la flamme qui dansait dans la pénombre, attendant qu’elle me lèche les doigts avant de la souffler. De toute ma vie, je ne me souviens pas avoir jamais fêté mon anniversaire. Je le fais sans doute parce que tout est fini. Mes mains sont devenues celles d’un vieillard et je ne peux empêcher mon corps de trembler.
Aujourd’hui, alors que l’obscurité du carton me dissimule aux regards des autres, j’ai décidé d’arrêter de fuir. Cela devrait m’angoisser et c’est une délivrance. On va me condamner, m’enfermer pour meurtres. Je ne me souviens même pas de les avoir tués ; mais qui d’autre que moi aurait pu le faire ?
Je me suis allongé, serrant mon blouson autour de moi et me recroquevillant pour échapper à l’air froid qui passe par les interstices de mon abri. Un rayon de lumière électrique éclaire les journaux que j’ai étalés sur le sol ; il flotte dans l’air une légère odeur d’encre, une odeur d’imprimerie.
Je sais qu’il fait nuit depuis longtemps. Le vieil homme à côté doit déjà dormir : j’entends sa respiration oppressée à travers la cloison.
Des retardataires courent vers les quais. Les haut-parleurs hurlent des mots que je ne comprends pas. Avec un bruit de métal, les derniers trains quittent Tokyo pour les lointaines banlieues. Les néons vont s’éteindre.
Demain sera le dernier jour.
“Quand on ne peut décider entre vivre ou mourir, alors mieux vaut mourir.”
DIT DU SAMURAÏ KIRANO SUKE SHIDA.
EXTRAIT DU HAGAKURÉ.
AVEC LE RECUL, j’ai l’impression que tout a commencé cette nuit-là, il y a bientôt six mois…
Il y avait le bourdonnement de cette mouche contre la lanterne de papier d’un bar du Kabuki-cho, le quartier “sans nuit” de Tokyo, le quartier des plaisirs. C’était un petit bruit sec, agaçant, ponctué de chocs sourds. Elle s’obstinait à chercher une issue qui n’existait pas… comme moi. J’aurais peut-être pu continuer longtemps ainsi… Mais là, j’ai pris conscience que je n’en pouvais plus.
Je devais faire une drôle de tête car Guy a reposé son verre et m’a fixé avec insistance, essayant d’attirer mon attention. J’ai baissé le nez sur le sakasuki, la petite tasse de saké tiède que je serrais entre mes doigts.
J’avais beau le connaître depuis des années, c’était devenu un étranger. Je supportais de moins en moins bien son laisser-aller, sa chemise auréolée de sueur, ses bonbons qu’il mâchait à longueur de journée et ses beuveries. De toute façon, je ne supportais plus personne.
Hirinobu, notre collègue japonais, son long visage maigre orné d’une fine moustache, penché sur son verre, ne parut s’apercevoir de rien. Il buvait vite, saluant d’un “Kampai” – à votre santé ! –, chaque nouveau verre, souriant à quelque chose qu’il était seul à voir.
– Théo, ça ne va pas ? me demanda Guy.
Je répondis d’un signe de tête agacé que si, ça allait. Comment lui expliquer qu’à cause d’un insecte la vie m’était soudain devenue insupportable ?
J’avalai mon saké d’un trait. Je n’avais pas trouvé l’ivresse, mais une chose que d’habitude j’arrivais à éviter : me regarder en face.
L’espace se resserrait autour de moi, sa pression sur ma peau devenait insupportable. Même l’air se raréfiait comme dans un cercueil.
La salle était petite et sombre, c’était un nomiya, un bar pour habitués où tout était écrit en japonais. Il y avait tellement de gens là-dedans et si peu d’air que les parois de bois jaune dégoulinaient de transpiration. Une odeur de sciure montait du sol, avec des relents d’alcool et de bière. Au plafond, éclairé par un néon blafard souillé de chiures de mouche, grinçait un ventilateur aux pales tordues.
Je sentais l’angoisse me gagner. Ça arrivait toujours comme ça : une crispation de l’estomac, un manque d’air, l’envie de fuir. La bête qui logeait en moi se réveillait. Plus rien d’autre alors ne comptait. Le bourdonnement de l’insecte était de plus en plus fort, couvrant même les cris et les rires des clients qui se pressaient autour du comptoir. Je n’entendais plus que lui.
Et puis ce fut le silence, une traînée sur le mur, une tache brune sur ma paume.
Je me retrouvai dehors sans savoir comment, respirant à fond l’air humide, me frottant nerveusement les mains avec mon mouchoir froissé.
La venelle était sombre, juste éclairée de loin en loin par les lampions de papier rouge des bars et les néons des salles de pachinko et de mah-jong. A l’arrière-plan, toutes proches, se découpaient les silhouettes noires des hautes tours de bureaux dont ne brillaient plus que les feux de signalisation.
Hirinobu et Guy me rejoignirent bientôt.
– Trop de saké, fis-je pour couper court à toute question.
– Pour moi aussi, ajouta Guy. Je crois qu’il est temps qu’on rentre.
– Je vous raccompagne, proposa Hirinobu en s’inclinant avec politesse.
– Non, mon ami, merci, protestai-je. J’ai là un plan qui nous permettra de regagner notre appartement sans problème.
– Vous êtes sûr ?
– Oui, Hiri-san, merci.
Le Japonais n’insista pas.
Il allait nous laisser quand un sourd grondement résonna autour de nous. Je n’avais jamais ressenti ça. L’impression que l’air était saturé de bruit et que, tout en même temps, il venait des profondeurs de mes entrailles. Hirinobu se figea aussitôt, la main levée, nous faisant signe de ne pas bouger. Pas un son n’était sorti de ses lèvres, mais nous avions déjà compris : c’était un jishin, un tremblement de terre. Ils étaient si fréquents au Japon qu’il paraissait impossible d’y séjourner sans en faire l’expérience.
On ne peut pas dire que j’ai eu peur, je n’en ai pas eu le temps. Le grondement s’est intensifié, suivi d’un roulement très proche de celui des tambours de guerre, un son de basse qui vous prenait aux tripes tandis qu’une trépidation faisait vibrer le sol et craquer le bois des charpentes.
Hiri restait sans bouger avec l’air concentré d’un homme qui attend quelque chose. Nous étions plantés là, au milieu de la ruelle, pendant que des gens sortaient des bars et des salles de jeux en se bousculant. A quelques pas de nous, une pile de caisses bascula et une enseigne électrique se brisa dans une myriade d’étincelles… Le temps s’étira.
J’imaginais déjà les façades de verre des tours de Tokyo volant en éclats, le sol se fendant comme une figue trop mûre, les ravins engloutissant des grappes humaines, l’inutile stridence des sirènes d’alarme, le fracas des maisons effondrées…
Et puis soudain plus rien. Cela n’avait duré qu’une seconde. Le roulement s’était tu, et je réalisai que je n’avais entendu personne crier.
Hiri nous laissa là pour rentrer dans l’un des nombreux bars. Il en ressortit presque aussitôt, annonçant d’un air joyeux :
– C’est fini ! Ils disent à la NHK que c’était une secousse mineure. Un peu de vaisselle et de verre cassés, rien de bien sérieux. Il n’y a plus de danger. Que disions-nous ? Ah oui, vous vouliez rentrer seuls.
Après les salutations d’usage, il s’éloigna d’un pas rendu hésitant par la bière. Il avait à peine tourné l’angle d’une ruelle que Guy se tournait vers moi.
– Voilà pour ton baptême du feu. Ici, à Tokyo, il y a près de 1.500 secousses par an. T’en verras d’autres.
Comme je ne répondais pas, tout à l’analyse de mes sensations, il reprit :
– Qu’est-ce qui t’arrive, Théo ? Tout à l’heure, t’étais blanc comme un linge, et ne me dis pas à moi que c’est l’alcool : il n’y en a pas deux comme toi pour y résister.
Je n’avais pas du tout envie de parler, encore moins de me confier. Je répliquai assez sèchement :
– Rien. Que veux-tu qu’il m’arrive ?
Guy leva les mains en marmonnant quelque chose, mais déjà, je regardais ailleurs.
Les lumières se reflétaient dans les flaques à mes pieds. Les gens retournaient vers les bars. Une odeur de terre humide et de thé vert saturait l’air. Des gars ivres morts, que la secousse n’avait même pas réveillés, étaient restés affalés par terre. Un Japonais vêtu d’une veste violette et cravaté de rouge, rabatteur d’un tripot clandestin, reprit sa place à l’entrée du bouge. Une porte claqua, libérant un instant le bruit de billes de métal du pachinko, la roulette japonaise qui se remettait en branle. La vie reprenait.
Deux toutes jeunes filles vêtues de l’uniforme des collégiennes sortirent d’un porche et disparurent dans l’ombre d’un passage.
Un groupe s’engouffra bruyamment dans un bar, après nous avoir proposé de les accompagner. Pour eux, la nuit allait bientôt s’achever. S’ils n’attrapaient pas les derniers trains les ramenant chez eux, ils dormiraient à l’hôtel avant de retourner au bureau le lendemain matin.
J’aimais bien ce quartier, il ne ressemblait à aucun autre. On y passait sans transition de venelles étroites, cernées de maisons de bois éclairées par des lanternes de papier, à de larges avenues bordées de buildings et de boîtes de nuit aux néons multicolores. Un marchand ambulant de soba poussait péniblement sa carriole-fourneaux. Sa journée finie, l’homme rentrait, laissant derrière lui un sillage vinaigré et sucré.
Pour le Français que j’étais, le Kabuki-cho évoquait le Montmartre d’autrefois ou Pigalle, planté au pied de Manhattan.
J’avais envie de marcher et d’être seul. Guy restait là, attendant que je me décide, se dandinant d’un pied sur l’autre comme s’il ne savait quoi faire de sa grande carcasse.
– Peut-être pourrais-tu prendre un taxi ? lui suggérai-je. Je vais faire un tour avant de rentrer.
Il hésita, sortit un bonbon à la menthe de sa poche, jeta le papier par terre et se mit à le sucer sans mot dire. Il devait sentir qu’il n’était pas le bienvenu et je n’avais aucune envie de le détromper. Enfin, il grommela :
– Tu oublies que nous devons partir de bonne heure demain matin, pour ces deux jours de travail à Arita.
Je ne répondis pas, imaginant avec malaise les heures de train express et les multiples changements avant d’arriver dans cette lointaine province au sud-ouest de l’archipel. Je n’aimais pas les transports en commun. Je devais m’abrutir de calmants pour les supporter et il me fallait ensuite bien du temps pour recouvrer ma lucidité.
BIEN MALGRÉ LUI, car il aurait sans doute préféré marcher une partie de la nuit, Théo avait accepté de rentrer avec moi. Nous n’étions pas très loin de notre appartement, un grand deux pièces dans un immeuble de Shinjuku. C’est là que notre client japonais nous logeait tous les deux, au cœur de Tokyo, dans l’un des quartiers les plus chers de la capitale.
Bien que l’immeuble soit récent, l’appartement avait gardé l’aspect des intérieurs traditionnels japonais. Le sol était recouvert de nattes de paille de riz tressée et des shoji de bois et de papier coulissaient entre les pièces et le long des baies vitrées. Pour le reste, il y avait tout le confort : la salle de bains et la cuisine n’avaient rien à envier à celles des appartements parisiens. Du balcon, on apercevait même un vaste parc, ancien jardin impérial planté de milliers de cerisiers, le Shinjuku Gyoen.
Cela faisait quinze jours maintenant que nous avions quitté la France et que nous vivions à Tokyo. Quinze jours pendant lesquels j’avais plus appris sur Théo qu’en quelques années.
Je ne savais pas pourquoi, mais l’homme me fascinait, j’étais jaloux de ses succès, bien sûr, mais fier aussi qu’il me croie son ami. De toute façon, je n’avais jamais su ce qu’était l’amitié. Théo avait besoin de moi, un peu, un tout petit peu, et moi surtout de lui : c’était la plus solide définition de l’amitié que j’étais capable d’inventer.
Les lumières de la ville luisaient à travers les shoji de papier qui masquaient les baies vitrées. Théo les repoussa machinalement, laissant un rayon de lune glisser sur les tatami qui recouvraient le sol. Hormis des coussins et une table basse, la pièce principale était vide. Dans le tokonoma, l’alcôve réservée aux ikebana et aux objets d’art, trônait son saxo. C’était son lieu, il y vivait à la japonaise et comme eux, il rangeait le peu qu’il avait dans les placards.
Théo n’aimait pas la lumière électrique, encore moins les néons et parfois, s’il m’arrivait de rentrer tard, je le trouvais dans la pénombre, le foyer de sa pipe luisant dans le noir. Quant à ses nuits, il les passait sur le balcon. Au matin, je le voyais assis là, en train de boire son thé, le regard dérivant sur les toits de la ville. C’était d’ailleurs le seul moment où il était à peu près détendu.
A notre arrivée à Tokyo, quand nous avions appris que nous devions partager le même appartement, Théo m’avait expliqué qu’il aimait dormir ainsi, supportant mal la chaleur. Je n’avais rien dit. Je le savais original, qu’il dorme dehors m’importait peu.
Quant à moi, j’occupais une pièce minuscule où j’entassais pêle-mêle mon ordinateur, une télé que je ne regardais jamais, ma réserve de vin français, des tas de gadgets électroniques et du linge sale. Contrairement à Théo, je ne rangeais jamais rien et j’avais rajouté quantité de coussins sur mon futon. En fait, je supportais mal la literie japonaise et je rêvais d’un bon vieux lit à l’européenne. Ici, j’avais toujours l’impression de dormir sur une plage de galets.
Ce soir-là, Théo arborait son visage des mauvais jours, et l’expression hallucinée que j’avais vue dans ses yeux quand il avait écrasé la mouche m’avait intrigué. Je me contentai de le saluer, sans attendre de réponse, et me dirigeai vers ma chambre. Je savais qu’il me réveillerait le lendemain matin. Il dormait peu, guère plus de cinq ou six heures par nuit, lisant et dessinant pendant qu’effondré sur mon futon, je ronflais.
J’avais trop bu et un goût âcre, mélange d’alcool, de tabac et de bile me remontait dans la gorge. Je jetai mes vêtements dans un coin, m’assis sur le tabouret de bois pour me savonner et me doucher, avant de soulever le couvercle de la baignoire et de me plonger dans l’eau tiède où je pataugeai un moment.
Il faisait humide et lourd et à peine sorti du bac, je me remis à transpirer. Je ne connaissais qu’un remède à ça. Je récupérai ma fiasque de whisky dans la poche de mon veston et bus une dernière rasade. Une fois allongé, je me tournai en tous sens, cherchant en vain le sommeil.
Je ne sais pas pourquoi, mais cette nuit-là, je me souvins de ma rencontre avec Théo à Paris, presque dix ans plus tôt.
Son vrai nom est Maxence Théoran. Je l’avais connu boulevard Raspail. On fréquentait la même école d’architecture, moi comme prof, lui comme élève. Quelques années plus tard, on s’est retrouvés dans une agence, rue Michelis, à Neuilly.
C’était un garçon solitaire et brillant, préférant l’urbanisme à l’architecture. Je ne sais pas pourquoi, mais la maison-objet l’ennuyait. Pour s’exprimer, il lui fallait des villes. Il dessinait d’étonnantes perspectives, réinventait l’espace, étirait ses structures vers le ciel, les couchait à flanc de montagnes. A l’époque déjà, il me fascinait. Je ne lui connaissais pas d’amis ; en fait, il ne s’intéressait qu’aux femmes. Il savait leur plaire.
Grand et mince, presque maigre, le visage mat et les cheveux prématurément blanchis, il y avait en lui quelque chose de racé et de distant qui les attirait, comme la flamme les papillons de nuit. Son visage eût été banal, s’il n’avait eu ce regard un peu fou, ce regard de visionnaire et d’artiste et ce nez busqué qui le singularisait. Je m’étais aperçu, grâce aux conversations animées de mes étudiantes, qu’il ne sortait jamais très longtemps avec ses conquêtes et que pas une seule ne savait où il habitait. Cela faisait jaser et bientôt, pour couper court, il cessa toute relation avec elles. En fait, je n’aurais jamais cru qu’il ferait attention à moi, et pourtant…
Un soir, alors que je regagnais mon studio, je trouvai un homme qui gisait de tout son long sur le pavé. Je m’en souviens comme si c’était hier, c’était rue Emile-Richard, cette sinistre allée bordée de platanes, coincée entre les hauts murs du cimetière Montparnasse. Je me suis précipité. C’était lui.
Il avait le visage en sang, des côtes cassées et respirait avec peine. Il ne voulait pas de médecin. Je l’ai aidé à se relever et l’ai emmené chez moi pour le soigner.
Je me souviens que cette nuit-là, il ne m’a pas donné d’explications et je ne lui en ai demandé aucune. A vrai dire, je m’en foutais. Quoi qu’il ait pu faire pour se prendre une telle raclée, c’était son affaire, pas la mienne.
Quelques jours plus tard, il m’a proposé de venir boire un verre chez lui et j’ai compris qu’il me faisait une faveur.
Il habitait un vieux studio sur les quais et n’avait pour toute compagnie qu’un chat, un pur gouttière nommé Théorème qui, en hiver, partageait son frigo et ses tas de journaux. La pièce était petite mais lumineuse, avec un balcon qui donnait sur la Seine. Il a mis un peu de musique, on a bu un vieux Talisker, sans rien dire. Son whisky était bon et j’aimais bien l’odeur de son tabac.
C’est ainsi que notre amitié a débuté, enfin ce que moi j’ai appelé amitié : un peu plus que de l’indifférence, un peu moins que de la sympathie.
Les années ont passé. Quand je me suis aperçu que mes élèves étaient meilleurs que moi, j’ai arrêté l’enseignement.
C’est drôle, je n’ai jamais été très bon mais contrairement aux autres, le temps, au lieu de m’apporter de la valeur, m’en retirait. Dans ces cas-là, mieux vaut sortir du jeu. C’est ce que j’avais fait, trouvant des missions à l’étranger et notamment au Japon, où j’étais resté cinq ans et où j’avais appris la langue.
J’avais perdu Théo de vue et puis nous nous sommes retrouvés par hasard dans la même agence. Je n’étais pas devenu meilleur, mais le travail ne manquait pas à cette époque et ma qualité d’interprète japonais servait souvent. Avec Théo, nous n’avions guère le temps de nous voir, d’autant qu’à ce moment-là, je parlais mariage à l’une de mes conquêtes. Elle n’était pas vraiment belle, celle-là, on pouvait même dire qu’elle était moche, mais elle avait du fric. Moi, j’avais pris du ventre, perdu des cheveux et je claquais tout ce que je gagnais. Et puis comme les autres, la garce m’a plaqué quelques jours avant la cérémonie, ayant dû sentir que je n’étais pas un bon plan. J’ai accepté de partir au Japon, j’aimais bien ce pays et rien ne m’attachait plus à Paris.
En fait, rien ne m’attachait plus à rien sauf l’alcool, la bouffe, les putes et… Théo. Il était devenu mon chef de projet. Encore un élève qui avait dépassé son maître mais curieusement, lui, je ne lui en voulais pas… pas encore. Dix jours plus tard, nous volions vers Tokyo.
Je détestais ces longs voyages, sanglé à un siège trop étroit. La seule compensation, c’étaient les innombrables collations et les whiskies servis par les hôtesses. Théo avait dormi pendant les seize heures de vol et je l’avais réveillé un peu avant la descente sur l’archipel.
Je me rappelle notre arrivée au-dessus de l’aéroport de Narita. Théo avait avalé des comprimés de caféine pour se remettre d’aplomb et, penché vers le hublot, il fixait la terre qui montait vers nous à toute vitesse. La nuit tombait, le ciel était d’un orange électrique et nous avons survolé les lumières de Tokyo, des milliers de lumières plantées entre la mer et le mont Fuji dont on discernait encore la silhouette enneigée au loin.
Il a murmuré :
– Je n’aurais jamais dû venir ici…
Puis il s’est tourné vers moi.
– Tu te souviens de cette légende ? Izanami, la déesse qui donna naissance au Japon, est morte brûlée par le feu qu’elle avait mis au monde… Je crois, moi aussi, qu’on peut mourir de ce qu’on a fait naître ou de ce qui est né malgré nous…
Il n’ajouta rien et je ne lui demandais pas d’explication ; il ne m’en aurait pas donné. Je ne savais pas à quel point ces phrases étaient prophétiques, ni combien mon destin était lié au sien… Comme si déjà, en cet instant, tout était joué.
Nous avons atterri, retrouvant l’un de nos collègues japonais, un vieil ami à moi, Hirinobu Tôgan, au milieu de la cohue des couloirs de Narita. Mes idées se brouillaient et je finis par m’endormir.
IL N’ÉTAIT PAS six heures quand Théo réveilla Guy. Dehors résonnaient le grondement des voitures et l’appel aigu des trains : Tokyo se levait tôt.
Guy repoussa le drap dans lequel il s’était enroulé et s’étira en bâillant, fixant son ami d’un air morose. Il avait la bouche pâteuse, mal à la tête et le sentiment que ses quarante-six ans en valaient deux cents.
– Allez, dépêche-toi, fit Théo en se détournant. Je t’ai laissé du café à la cuisine.
Incapable d’articuler un mot, Guy hocha la tête et, d’un pas hésitant, gagna la salle de bains.
Quand il revint, quelques minutes plus tard, une vilaine coupure entaillait son menton mais il était habillé et son sac de voyage était prêt. Hirinobu, qui venait d’arriver, s’inclina devant lui et les deux hommes se mirent à discuter en japonais, le gros Français s’interrompant pour rire et taper sur l’épaule de son ami.
Quelques instants plus tard, à bord d’un taxi Toyota jaune, ils s’engageaient dans le flot de la circulation.
– J’avoue, Théo-san, fit Hirinobu dans un français parfait, que je m’étonne toujours de votre facilité à vous déplacer dans une ville où même les habitants et les chauffeurs de taxi ont besoin de plans pour se retrouver.
Un bref sourire éclaira le visage du jeune architecte.
– Facilité est un bien grand mot. C’est vrai qu’avec vos numéros qui ne se suivent pas et vos rues sans nom, se perdre à Tokyo est un jeu d’enfant. Mais vous oubliez notre métier commun ; à force de tracer des plans… Et puis à Tokyo, comme en Amazonie, il vaut mieux regarder le ciel, la forme des arbres et… sa boussole.
Hirinobu acquiesça avec un petit sourire.
– Lao-Tseu a dit : “Quand on voit peu, cela devient clair.”
Théo hocha la tête, amusé malgré lui par les sentences dont Hiri parsemait ses phrases. Le taxi venait de s’encastrer dans la voie rapide. Très vite, le compteur chuta de dix à deux kilomètres/heure.
Le jeune Français ne disait plus rien, observant les maisons qu’ils surplombaient. De là où ils se trouvaient, à près de quatre étages de haut, leurs regards plongeaient chez les gens. Des femmes sortaient leurs futons pour les aérer. Des salarymen travaillaient déjà, assis devant leurs écrans.
Sur le toit d’un immeuble, au milieu d’une forêt d’antennes, un homme, torse nu, se redressait, pivotant lentement sur lui-même avec cette grâce si particulière aux danses millénaires. Le long des balcons gisaient pêle-mêle des climatiseurs, des vélos, des réfrigérateurs et des machines à laver. Des haut-parleurs diffusaient de la musique et des messages publicitaires tandis qu’en contrebas retentissaient des sirènes de police. Dans les voitures voisines, les gens étaient immobiles et silencieux.
Théo se tourna vers Hirinobu.
– Parlez-nous un peu de cette séance de travail à Arita.
Le Japonais hocha la tête.
– Notre agence aimerait que nous présentions le projet du téléport à de nouveaux financeurs.
– Nous manquons donc encore de fonds ? repartit Théo vivement. Je croyais que cet aspect était réglé.
Le visage d’Hirinobu se ferma. Ce n’était apparemment pas un sujet sur lequel il voulait s’étendre.
– Je ne peux vous en dire plus, Théo-san, fit-il en inclinant brièvement la tête. Mais les anciens, qui sont hommes de sagesse, disent : “Les crabes creusent des trous à leur taille.”
Théo allait répondre mais le Japonais poursuivit.
– J’aimerais vous présenter quelqu’un avec qui notre agence compte s’associer et dont, peut-être, vous avez entendu parler, M. Shesua.
– Konebie Shesua, l’architecte qui veut développer les maisons en carton ?
– Oui, celui-là même. C’est un homme de grand talent et dévoué aux causes humanitaires.
– Sans doute, sans doute, mais c’est étonnant de voir à quel point on commence à parler de la grande pauvreté en termes de marché, fit abruptement Théo.
– Tu sais bien que c’est la seule façon de l’inclure dans notre économie, coupa Guy, se mêlant à la conversation.
– Ce qui me gêne, c’est justement que l’on veuille y inclure les pauvres plutôt que de simplement leur tendre la main. Mais si le marché de la pauvreté peut générer des profits, alors…
Hirinobu ne répartit rien, mais ses yeux mi-clos restèrent fixés sur le jeune homme, sans qu’il soit possible de savoir s’ils exprimaient inimitié ou sympathie.
– Au fait, mon ami, pourquoi aller si loin pour rencontrer ces messieurs ? reprit Guy. Ils auraient pu venir dans nos bureaux de Tokyo.
Le Japonais se tourna vers lui.
– Le principal financeur, M. Kamada, possède une maison de famille à Arita. Il a accepté de nous rencontrer au Kanko, un des hôtels de la ville. C’est un homme très pris.
– Et M. Shesua sera là, lui aussi ?