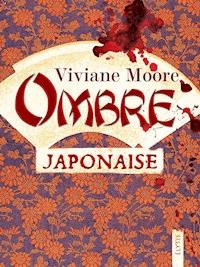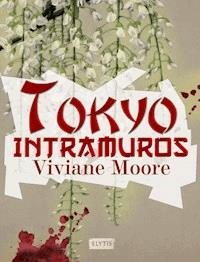Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elytis Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le premier volet d’une série de polars urbains
Viviane Moore nous immerge ici dans un polar urbain sauce
Wasabi
L’inspecteur Tanaka, les
Otaku, un corps jeté dans la
Sumida - la rivière qui traverse Tokyo – une série de meurtres rituels, une tête retrouvée sur l’ancien champ d’exécution des
shogun…
Ce Japon-là n’a guère l’épure des jardins zen ni la lenteur des danses
buto.
Tokyo des ténèbres se dégustera plutôt tel un saké brûlant dans l’ambiance sous néons de bars Tokyoïdes ultra-modernes…
Un polar original avec comme toile de fond un Japon ultramoderne et encore baigné des coutumes les plus anciennes
EXTRAIT
Il était peintre… et mendiant. Il peignait l’eau. Où qu’il soit, il avait toujours peint l’eau, cet élément instable, fuyant. C’est lui qui, le premier, remarqua le cadavre. Il le scruta avec attention, non parce qu’il était surpris ou effrayé, mais parce que son métier de peintre lui avait appris à regarder. Le corps était celui d’un homme trapu, bras et jambes écartés, vêtements gonflés d’air, flottants autour de lui.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Viviane Moore, née le 3 juillet 1960 à Hong Kong, est une journaliste et romancière française, spécialisée dans les romans policiers historiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un voyage, fût-il de mille lieues, débute sous votre chaussure.
LAO-TSEU
“La nuit tombe et, avec elle, mes pas m’entraînent vers le monde des ténèbres.”
MATSUBARA IWAGORO (1866-1935)
IL ÉTAIT PEINTRE... et mendiant. Il peignait l’eau. Où qu’il soit, il avait toujours peint l’eau, cet élément instable, fuyant.
C’est lui qui, le premier, remarqua le cadavre. Il le scruta avec attention, non parce qu’il était surpris ou effrayé, mais parce que son métier de peintre lui avait appris à regarder. Le corps était celui d’un homme trapu, bras et jambes écartés, vêtements gonflés d’air, flottants autour de lui.
Des cris aigus lui firent lever la tête. Des mouettes tournoyaient dans le ciel au-dessus du pont. Elles étaient trois ou quatre, elles seraient bientôt des dizaines à escorter le mort jusqu’à la mer. Un bateau passa, fendant la rivière de son étrave.
Le peintre prit son carnet de croquis et, d’un trait, dessina la forme entrevue, à peine une ombre dans la mouvance de l’eau.
L’homme n’avait pas de tête.
Il était décapité, comme les condamnés de jadis, ceux qui traversaient le pont des Larmes avant d’être exécutés sur la terre de Kotsukappara, dans le quartier maudit de Sanya. Quelques siècles plus tard, celui-là glissait sous les ponts de Tokyo avant de s’enfoncer dans les eaux salées du port marchand.
Autrefois, songea le peintre, on exposait les têtes le long de la grande route Oshu-kaido qui conduisait vers le nord. Il se demanda si l’assassin ferait de même. Un frisson remonta de ses reins jusqu’à sa nuque. Il essuya son pinceau et l’enroula dans un carré de tissu, puis il glissa son carnet dans sa poche, remit son chapeau de paille et fit demi-tour, de ce pas lent, un peu hésitant, qui était devenu le sien.
Juste une feuille de papier blanc, pliée en quatre, glissée dans une enveloppe Via Air Mail. Il l’avait sortie lentement, précautionneusement. La fine écriture se brouillait sous ses yeux. Il passa la main sur son visage, l’écran éteint lui renvoyait l’image d’un garçon maigre dans un tee-shirt trop grand.
Ses jambes tremblaient sous lui et il dut s’asseoir, articulant à haute voix, avec difficulté.
“Tu auras douze ans demain, lui écrivait sa mère, j’aimerais t’offrir un cadeau. Si seulement tu acceptais d’ouvrir...”
Son regard se perdit dans le vague, la lettre tomba à ses pieds au milieu d’un amas de papiers gras et de canettes de soda vides. Il essaya de se rappeler les traits de sa mère, la façon dont elle s’habillait, sa voix. En vain, il n’y arrivait pas. Elle était floue, étrangère.
La seule chose qu’il gardait en mémoire, c’était le bruit de son pas. Depuis l’accident, elle claudiquait.
Il tourna lentement la tête, regardant autour de lui. Le néon au-dessus de son bureau diffusait une clarté verte sur le futon où il se roulait en boule pour somnoler. Les stores étaient baissés, et il avait collé des pages de manga sur les fenêtres afin qu’aucune lumière naturelle ne filtre. Le seul éclairage qu’il tolérait était celui des écrans vidéo. La plupart du temps, il maintenait ses machines allumées. Le ronronnement du disque dur et les minuscules diodes qui scintillaient dans la pénombre étaient ses repères.
Porté par le vent, le murmure étouffé de Tokyo arrivait jusqu’au quinzième étage. Aucune notion du jour ou de l’heure. Il pouvait être midi ou minuit. Lundi ou dimanche. Hier ou demain.
“Il allait avoir douze ans !” disait-elle. Il calcula sur ses doigts. Depuis quelque temps, il n’arrivait plus à rassembler ses pensées, encore moins à compter.
Douze moins neuf, cela faisait donc trois ans qu’il avait poussé le verrou de sa chambre, refusant de retourner en cours ou de parler aux siens. Trois ans qu’il ne communiquait plus que par ces morceaux de papier glissés sous la porte.
Il ne sortirait pas. Jamais il n’accepterait de retourner dans le monde qu’il avait quitté. Il n’était pas le sien, ne l’avait jamais été.
Son père avait fabriqué une sorte de sas dans lequel sa famille déposait chaque jour de la nourriture, des vêtements propres, parfois, mais, plus rarement, des jouets ou des CD. Il avait son propre cabinet de toilette et ses W-C. Il ne se lavait plus mais buvait souvent, les mains en coupe, l’eau qui jaillissait de la douche.
Il passait ses journées et ses nuits, les doigts fébrilement serrés autour de son joystick ou de son trackball, à jouer seul.
Par e-mail ou par fax, certains d’entre eux dialoguaient, échangeant des jeux ou des tuyaux pour passer au niveau supérieur. D’autres collectionnaient des images de Lolita, des poupées, des robots ; lui préférait les jeux et la solitude, ils étaient tous des otaku. C’est comme ça que les autres les appelaient, un drôle de nom qui signifiait “vous” ou “votre maison” et qui maintenant les désignait, eux, les enfermés.
Il bâilla et retourna se coucher, s’enveloppant étroitement dans sa couette et se recroquevillant sur lui-même. Dans l’appartement, à un mètre à peine, séparé de lui par une cloison, sa mère allait et venait, préparant les o-bento, les boîtes repas de son père et de sa sœur.
Porté par le vent, le sifflement d’un train sur la ligne Yamanote. Il maugréa et se retourna contre le mur. Il faudrait qu’il remette du papier le long des fenêtres pour atténuer le bruit du monde. Il s’endormit brusquement, alors que son père frappait un coup timide sur le sas et lui souhaitait le bonjour avant de partir au travail.
Même pour Tokyo, il n’y avait rien d’habituel dans cette ruelle du quartier de Shimbashi. Elle était tellement étroite qu’il était difficile de s’y croiser, et les maisons de bois étaient si petites qu’elles en devenaient invraisemblables.
Le peintre mendiant habitait l’une d’elles. Ainsi, il n’était pas très loin du port marchand et de la Sumida. Quand le vent portait, il entendait les sirènes des cargos qui appareillaient.
Il vivait au rez-de-chaussée et avait disposé un futon au premier étage qu’il gagnait à genoux tant le plafond était bas.
Cette après-midi-là, alors qu’il poussait la porte, une singulière angoisse le saisit. Etait-ce la vue de ce cadavre décapité qui lui en rappelait un autre ? Il accrocha son chapeau de paille et sa sacoche à un clou, à droite de la porte, fit chauffer l’eau pour son thé et s’assit à même une natte sur le sol de terre battue.
De l’unique fenêtre barrée par un store de lamelles de bambou filtrait un mince rayon de lumière. Dans une minuscule cage chantait un grillon. Il faisait chaud et humide. Des particules de poussière dansaient dans le soleil. Partout, sur le sol et les murs autour de lui, des esquisses et des peintures représentant l’eau dans tous ses états, écumante, courante, dormante, ondoyante, suintante, glacée, bouillonnante...
Il resta un long moment à regarder son univers sans le voir. Ses yeux étaient secs et pourtant, comme chaque fois qu’il y pensait, il eut envie de hurler. Le bruit de la cassolette sur le brasero le rappela à lui.
Le bien-être et l’oubli n’arrivèrent pas avec la première gorgée de thé vert ni même avec la dernière. Depuis combien de temps n’avait-il pas vu Shizuo et Masayuki ? Avant, ils pêchaient ensemble et puis ils n’étaient plus venus, et il se retrouvait seul avec lui-même. Il détestait ça.
Dix jours, quinze peut-être, ou un mois qu’il n’avait pas rencontré ses deux amis.
Le peintre ne lisait pas les journaux, n’écoutait pas la radio et, bien sûr, n’avait pas de télévision. Il se levait et se couchait avec le soleil, errait sur les ponts de Tokyo, du Yanagibashi, le pont des Saules, au Kachidokibashi. Mais son préféré restait le Nihonbashi, le pont du Japon, surmonté du tumulte des quatre voies routières. Un pont masqué, défiguré, comme lui.
Il mendiait et vendait parfois une toile pour s’acheter du thé, du riz ou du tabac, une toile, jamais davantage. Il n’aimait pas s’en séparer. Elles faisaient partie de lui, comme un autoportrait.
Les galeries lui en réclamaient des dizaines, faisaient grimper les prix, lui proposaient d’exposer dans le monde entier, il aurait pu devenir riche.
Avant, peut-être...
Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu’il ne s’y attendait pas. Un sanglot lui déchira la gorge.
Il se força à penser aux iris, le long des berges de la Sumida, aux susuki, ces roseaux aux fines aigrettes argentées, aux liserons bleus des poètes qu’il esquissait en signature de tous ses tableaux.
Son regard se fixa sur l’une des peintures, posée sur un chevalet, au centre de la pièce.
Des aplats de vert, du noir, une palette de gris chaud et froid, les piliers d’un pont plongeant dans les eaux argentées d’une rivière. C’était le Nihonbashi, ancien point zéro de l’Archipel, ce point d’où partaient jadis les routes impériales. Les arches en fonte étaient ornées de licornes et de chiens coréens, symbolisant l’Est et l’Ouest.
Installés à une table de la cafétéria du World Magazine House, les deux hommes, un Européen et un Japonais, buvaient leur thé en silence. Ils étaient aussi différents qu’il était possible et, pourtant, on sentait qu’une singulière fraternité les liait.
Autour d’eux, dans la grande salle, des journalistes en train de discuter, mais aussi des gens venus feuilleter les derniers numéros de la presse internationale en avalant un hotto, un hot coffee.
L’Européen, un homme d’une trentaine d’années, aux larges épaules, examinait son compagnon d’un air soucieux. Ce dernier semblait avoir oublié sa présence et contemplait sa tasse vide avec morosité.
— Depuis combien de temps nous connaissons-nous, Ishi ? demanda-t-il brusquement.
A l’énoncé de la question, le Japonais releva la tête. Il avait une quarantaine d’années, et ses cheveux, soigneusement lissés, encadraient un visage rond, presque lunaire. De petites fossettes marquaient le coin de ses yeux noirs, soulignant la tristesse de son regard. Comme la plupart de ses confrères journalistes, il portait un strict costume noir, une chemise blanche et une cravate dont il desserra le nœud, en répondant lentement :
– Quinze ans, Sean, quinze ans.
Le Français hocha la tête en signe d’approbation. Il fixait son ami, cherchant un moyen de le tirer de sa mélancolie.
– On a fréquenté les mêmes ambassades, les mêmes bureaux de presse, interviewé des militaires, des artistes, des patrons, des terroristes. On a bu des Spitfire, des Guinness, des Carolus, des Kronenbourg, et maintenant, si tu veux bien, on pourrait aller déguster une Sapporo, plutôt que de rester dans ce lieu, à peu près aussi chaleureux qu’une morgue.
A cette tirade, le Japonais sembla se détendre un peu.
– Et les bagarres ! poursuivit l’Européen sentant que l’humeur sombre de son ami se dissipait. Rappelle-toi ce type à Londres, qui t’avait traité de noms d’oiseaux. J’ai adoré la façon dont tu lui as appris à voler !
– Et la fois où tu m’as sauvé la vie, Sean, ajouta le Japonais de sa voix calme.
– Sans cette bande de fous, nous n’aurions jamais fait connaissance, Ishi, et cela m’aurait sacrément manqué. Grâce à toi, je parle japonais, je pratique le karaté et le tir à l’arc, et surtout, surtout, j’ai goûté plus de cinquante sortes de sakés. Mais tu peux me dire ce qui te tracasse, Ishi, une enquête pour l’Asahi Shimbun ?
Le Japonais n’essaya pas de se dérober, ces deux-là se connaissaient trop.
– Oui. On est plusieurs dessus, nos patrons ont l’air de penser que c’est important.
– Toi aussi, visiblement. N’est-ce pas ce corps sans tête, retrouvé il y a deux jours, dans les eaux du port marchand ? Tu as déjà fait plusieurs papiers, et la presse japonaise ne parle plus que de ça.
– Tu as deviné. L’homme était tatoué et il s’était fait yubitsume, il lui manquait la première phalange de l’auriculaire...
Ishi s’arrêta, hésitant à poursuivre.
– J’ai eu, moi aussi, mes renseignements, fit le Français. A cause du tatouage, et de la façon dont il a été exécuté, tout le monde pense que c’est un règlement de comptes entre yakusa. Pourquoi t’en soucier ainsi ? On dirait que tu en fais une affaire personnelle.
A cette dernière phrase, une lueur s’alluma dans les yeux du Japonais.
– Tu ne sais pas tout, Sean. On vient de retrouver sa tête sur un parking d’autobus, à côté de la gare de Minami-senju.
– Continue.
– C’est bien le cadavre d’un yakusa, mais, surtout, c’était celui d’un vieil ami. Tu as donc raison, j’en fais une affaire personnelle. Deuxièmement, ce parking est édifié sur l’emplacement du Asakusa hatitsuke jo, le lieu des crucifixions d’Asakusa, un des deux terrains d’exécution de Tokyo, au XVIIe siècle, au temps des shogun Tokugawa. Et troisièmement, mais la presse étrangère n’en a pas été informée, ce cadavre-là n’est pas le premier.
– Explique-toi.
– Il y a déjà eu deux morts identiques.
– Tu veux dire des gens décapités et les têtes posées sur ce même parking ? Mais pourquoi les autorités et les journaux ont-ils gardé le silence ?
La voix du Japonais n’était plus qu’un murmure quand il répondit, mal à l’aise :
– C’étaient des burakumin.
Un nom que le Français avait déjà entendu, mais que les Japonais ne prononçaient qu’à contrecoeur. Il vida ce qui restait de sa tasse et se leva.
– Est-ce que tu as besoin de repasser à ton journal ?
– Non.
– Alors, ma proposition tient toujours, je t’offre une bière.
Ishi se leva et emboîta le pas à son ami. La différence entre la fraîcheur du hall et la moiteur chaude de la rue saisit Sean. L’artère était encombrée de véhicules, les trottoirs d’une foule dense, c’était l’heure de la sortie des bureaux.
Ils marchèrent un moment en silence. Une fois sur la grande artère Harumi dori, le Français se tourna vers son compagnon :
– Si nous rejoignions à pied notre brasserie sur la Sumida ?
Ishi hocha la tête sans répondre. Il était à nouveau lointain, préoccupé. Au-dessus de leurs têtes, un néon vantait les cigarettes Mild Seven. Partout des banderoles couvertes de kanji, les idéogrammes japonais, des portiques lumineux, des écrans géants, une profusion de couleurs et de sons, les bornes jaunes des téléphones.
– C’est une drôle d’histoire que celle de mon amitié avec Yamada, observa soudain Ishi. Le tatouage qu’il portait sur la poitrine était l’emblème de la Tosei-kai coréenne, une des bandes contrôlant les boîtes de nuit de Ginza. Il était devenu l’un des leurs dans sa dixième année, mais il avait abandonné tout ça, à la mort du Tigre de Ginza, son maître, pour devenir conteur et biographe.
– Conteur et biographe des yakusa, répéta Sean, songeur. Mais oui, je crois que je l’ai rencontré. Ce ne serait pas Yamada Tamura ?
– C’est lui. Il a écrit de nombreux livres, des chansons, à la gloire de ses anciens maîtres et des yakusa, en général. Il était respecté, comme un barde de chez vous, une sorte de poète. Tu le connaissais ?
– Je l’ai interviewé l’année dernière, lors d’un de ses séminaires à l’Asakusa View Hotel. L’assistance était très chic, et j’étais le seul journaliste européen à avoir été convié. Pourquoi ses anciens patrons l’auraient-ils exécuté ?
– Il n’est pas sûr que ce soit eux. Ce que je sais, par contre, c’est que j’ai une dette envers Yamada et qu’il est parti avant que je ne la lui règle. Adolescent, j’habitais comme lui dans le quartier de Sanya, Tokyo no fukidamari, le dépotoir de Tokyo, comme on l’appelle encore. Yamada m’avait pris sous sa protection, et c’est grâce à lui et à l’argent qu’il m’a avancé que j’ai pu faire des études et devenir journaliste. Sans cet homme, je ne serais rien d’autre qu’un docker ou un malfrat.
Un groupe d’étudiants japonais, vêtus du strict costume noir à boutons dorés emprunté à l’ancien uniforme du lycée Stanislas de Paris, les dépassa. Les deux amis traversaient le pont Kachidokibashi. Sous les lourds piliers glissait la rivière qui avait entraîné le corps de Yamada vers la mer.
Ishi s’arrêta, s’accoudant à la rambarde. En dessous d’eux, chargé de touristes, passait un suijo basu, un aquabus. Sur leur droite, ils apercevaient les immenses hangars du marché aux poissons et, plus loin encore, la silhouette des cargos, le long des quais.
La nuit s’annonçait chaude, humide, et la vibration familière d’un tremblement de terre fit frémir l’air.
Deux ans que je travaillais au Japon, comme correspondant de presse, quinze que je connaissais Ishi et je ne savais toujours pas comment fonctionnaient les Japonais. Ishi, surtout, m’échappait. Je réalisai brutalement que je ne savais rien de son passé et que son présent m’était étranger.
Non qu’il se soit jamais vraiment confié à moi, alors que nous travaillions en Europe, mais au moins, avant, je comprenais ses réactions, ses rires, son envie de boire ou de se défouler. En arrivant à Tokyo, j’avais trouvé un homme différent, prématurément vieilli. Je restais persuadé qu’il avait subi quelque épreuve dont il me parlerait plus tard... Ou jamais. Peut-être cette enquête, s’il acceptait mon aide, contribuerait-elle à nous rapprocher.
La terrasse de la brasserie Harumi était pleine d’une foule essentiellement masculine. Des salarymen japonais en train de boire, première étape d’une soirée où ils “feraient l’échelle”, ricochant de bar en bar jusqu’à l’ivresse.
Le serveur nous trouva une table près des rambardes de bois. De cet endroit, nous surplombions la Sumida. Assis dans des fauteuils en teck, protégés par des parasols, je me sentis loin de Tokyo, et de cette sombre histoire de corps décapités.
Une feuille de papier était apparue entre les doigts d’Ishi. Il la lissa, puis la courba en deux. Origami, un mot qui venait de ori-kami, papier plié. Je l’avais toujours vu faire ça. Il créait des oiseaux, des fleurs, des papillons et je m’étais aperçu, au fil des années, que ces créatures de papier n’étaient pas qu’un passe-temps, elles avaient un sens, un sens que j’arrivais rarement à déchiffrer.
Etaient-ce les parasols ou les lattes brunes du plancher ? Je me souvins des promenades sur les planches à Deauville, en Normandie. Le sable où je traçais le nom de cette mère disparue trop tôt de ma vie. Maureen, ma mère d’Irlande, aux yeux verts et aux cheveux flamboyants, ma mère qui s’était enfuie alors que je n’avais que huit ans, m’abandonnant à ce père que je n’avais jamais su aimer.
Le bruit des bouteilles que le serveur déposa devant nous me ramena à la réalité. Je me penchai vers Ishi.
– Que peux-tu me dire sur les burakumin ?
Ishi soupira, c’était pour lui un sujet difficile, un tabou. J’avais appris, il y a peu, que ce mot signifiait le “peuple des hameaux” ou quelque chose d’approchant, mais surtout que ces hommes et ces femmes étaient encore, pour les Japonais du XXIe siècle, des sortes d’intouchables.
– Tu sais que ce terme désigne les “gens des hameaux spéciaux” ?
– Oui, mais je n’ai jamais trouvé personne pour m’expliquer ce que cela signifiait exactement, ni quelle était leur origine.
– Shiranai, je n’en sais rien.
C’était une façon très japonaise de dire que tout cela ne le concernait pas. J’insistai quand même.
– Combien sont-ils ?
– Trois millions. Ce sont les descendants des parias de l’ancien gouvernement shogunal. Je ne sais pas grand-chose d’autre.
– Trois millions ! Je croyais que c’était une minorité, comme les Aïnous.
– Non, les Aïnous ne sont que quinze mille, mais si tu veux en savoir plus, un homme s’est spécialisé sur l’histoire du Japon et sur les burakumin, c’est un Français comme toi, et il vit à Tokyo depuis six mois. Il se nomme Nanvil, Théodore Nanvil, je te donnerai ses coordonnées.
– Nanvil... Oui, je me souviens, le consul m’avait averti de son arrivée, et je n’ai pu me rendre au déjeuner qu’il donnait en son honneur. Tu disais donc que ces deux burakumin ont été décapités comme ton ami Yamada. Mais ce n’étaient pas des yakusa ?
– Des burakumin, pas des yakusa, fit Ishi en déposant devant lui deux papillons de papier blanc.
– L’un ne peut pas être l’autre ? insistais-je, avant de m’apercevoir qu’il ne pouvait ou ne voulait pas me répondre. Bon, Ishi, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour que je te le demande directement, as-tu besoin de mon aide pour cette affaire ?
– Je pense qu’elle me serait précieuse.
– Je l’espère. Tu disais que ce parking s’appelait jadis le “lieu des crucifixions” ?
– Oui, c’était l’un des châtiments sous les Tokugawa, avec la décapitation et l’immersion dans l’eau bouillante. Les shogun avaient le sens du supplice. Les têtes étaient exposées à la porte des terrains d’exécution, et les voyageurs entrant dans Tokyo par le nord ou le sud avaient là matière à réfléchir.
– Si tu veux mon avis, nous aussi ! Serais-tu d’accord que nous partagions l’enquête en deux ? Tu te charges de Yamada, pendant que je suis la piste des burakumin ?
Ishi inclina légèrement le buste.
– Je te remercie, j’accepte.
– Tu n’as pas à me remercier, Ishi, c’est moi qui te remercie d’accepter mon aide. Je voudrais te poser une dernière question. Je connais le nom de Sanya, pour l’avoir entendu prononcer. Je sais que des associations caritatives y travaillent et pourtant, je ne l’ai vu sur aucune carte de Tokyo.
– Ici, au Japon, on change souvent les noms des lieux. Celui de Sanya a disparu des plans de Tokyo en 1966. Il a été fragmenté en plusieurs blocs dont Minami-senju, dans le quartier d’Arakawa. Là où on a retrouvé la tête de Yamada et des deux autres.
– Un parking d’autobus, à côté de la gare...
– Oui, un terrain sur lequel aucun promoteur n’a voulu construire !
Sur l’écran, le robot lançait des traits de feu. Les doigts crispés, Koji imprimait des mouvements saccadés au joystick. Les projectiles détruisaient les aéronefs ennemis qui explosaient en grands aplats rouges.
Un bruit léger, derrière lui, un fax venait de tomber sur le sol.
Un dessin représentant un samouraï, les mains tachées de sang, se faisant seppuku, quelques mots tracés d’une main hâtive, en hiragana.
“Reviens ! Y.”
Koji ramassa la feuille et la posa avec les autres dans une boîte en carton, près de son fiston. Il y en avait des centaines. Toutes de Studio. Studio, dont il ne se rappelait même plus le visage. Il avait même oublié le sien, car le seul miroir qu’il possédait encore était celui de l’écran vidéo.
“Les volubilis donnaient de jour en jour des fleurs plus petites et, à l’heure où les lumières flamboyantes du soleil couchant envahissaient l’étroite demeure, le chant obsédant des cigales s’exacerbait, avec une sorte de hâte fébrile.”
NAGAI KAFÛ, LA SUMIDA,
traduction de Pierre Faure, Gallimard-Unesco.
UNE SEMAINE était déjà passée depuis notre discussion sur la terrasse de la brasserie Harumi. Je n’avais pas revu Ishi, et aucun autre cadavre n’était venu s’ajouter à la liste.
Toutefois, je n’étais pas resté inactif. J’avais essayé de rencontrer mon compatriote, spécialiste de l’histoire japonaise. Je lui avais écrit pour demander un entretien et, entre-temps, j’avais lu un de ses ouvrages.
Les autres pistes concernant les burakumin menaient à des impasses. Les déclarations gouvernementales sur leur nombre, sur les ghettos où ils vivaient, les renseignements sur la BKD, la ligue de libération des Buraku, ne manquaient pas, mais je sentais que la vérité était ailleurs.
Davantage dans la réponse que me faisaient la plupart des Japonais interrogés : shiranai, “je n’en sais rien”.
Enfin, ce matin-là, alors que j’allais sortir, le téléphone sonna, et une voix féminine me prévint, en français, que monsieur Théodore Nanvil m’attendait à son domicile, à 11 heures précise.
J’avais à peine raccroché qu’un fax tomba, me livrant un plan détaillé. Nanvil habitait près des jardins d’Asakusa, un endroit que je connaissais bien. Un regard au réveil posé à côté de mon ordinateur, j’avais encore deux heures devant moi, je pouvais attraper un aquabus à l’embarcadère d’Hamarikyu et descendre à Asakusa.
C’est une fois sur le bateau, alors qu’il s’éloignait de la rive, que je songeais que la Sumida participait, tout comme le terrain d’exécution de Minami-senju, au sentiment d’étrangeté qui me possédait quand je réfléchissais à cette affaire.
La proue fendait les eaux troubles et il faisait déjà très chaud. Laissant le marché aux poissons sur notre gauche, nous passions sous le Kachidokibashi.
J’eus le temps d’apercevoir la silhouette d’un Japonais, en kimono gris. Un grand chapeau de paille sur la tête, un chevalet léger posé devant lui, appuyé à la rambarde. Il semblait dessiner l’eau, bien plus que le paysage qui l’entourait.
Le tablier du pont occulta la vue. Le bateau s’éloignait. Dans moins d’une demi-heure, j’aurais rejoint ma destination. Des mouettes tournoyaient dans le ciel bleu.
Le livre que j’avais proposé à un éditeur parisien m’obsédait presque autant que la mort de Yamada et des burakumin. Il était pour moi la conclusion d’une longue enquête menée sur les otaku, ces milliers de jeunes Japonais retranchés du monde.
J’avais encore, là aussi, bien des recherches à effectuer et des interviews à mener. L’autre jour, au World Magazine House, je voulais en parler à Ishi, mais l’affaire des décapités avait accaparé toute la place.
La traversée s’acheva sans que je m’en rende compte. Un haut-parleur annonça l’arrivée. Alors que je m’avançais vers la sortie, une jeune Japonaise, vêtue d’un kimono traditionnel, sa taille fine serrée par une obi, se leva. Elle était accompagnée d’un homme âgé, en kimono lui aussi, qui s’appuya lourdement sur son bras. Je les laissai passer, écoutant avec plaisir le bruit des socques de bois sur le métal du pont.
Après avoir traversé le parc de la Sumida et passé la Kaminarimon Gate, la Porte du Tonnerre, et les sculptures des dieux du Vent et de la Foudre, à l’entrée de la galerie couverte de la Nakamise dori, je m’enfonçai dans un fouillis de ruelles.
Difficile d’imaginer l’homme que j’allais rencontrer. Pourtant, je m’étais renseigné sur lui, notamment par le biais de mes collègues français. Nanvil était à la fois une autorité reconnue sur l’histoire japonaise — il parlait et écrivait couramment cinq langues asiatiques, avait rédigé de nombreux livres et articles — et un parfait inconnu. Aucun portrait de lui, aucune biographie nulle part, Théodore-François Nanvil détestait visiblement mêler le privé au public.
Une petite maison, perdue au milieu de boutiques, si étroite que, sans le plan obligeamment fourni par mon compatriote, je serais passé devant sans la voir. Une lanterne de papier au-dessus de la porte, un arbre à kaki dans un grand pot de terre. Une clochette dont je tirai la chaînette dorée.
Un son aigre s’en éleva.
Il avait eu à peine le temps de résonner qu’une Japonaise m’ouvrit.
Son aspect était si singulier que j’en restai un moment sans voix. Vêtue à l’européenne, d’un impeccable tailleur de lin clair, il émanait d’elle un sentiment d’irréalité, accentué par son épaisse chevelure décolorée, nouée en chignon, plus blanche que celle d’un vieillard. Elle était d’une extrême minceur et étonnamment grande pour une Asiatique, presque aussi grande que moi.
– Vous êtes Monsieur Jean Senac ? demanda-t-elle d’une voix rauque, dans un français irréprochable.