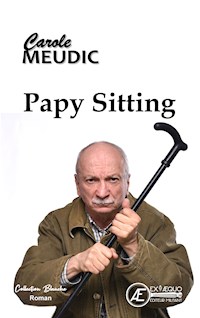
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un roman bouleversant qui décrit les relations entre différentes générations.
Prenez un papy-boomer qui coule des jours heureux aux Caraïbes depuis près de vingt ans. Prenez un vieux garçon de presque cinquante ans qui galère depuis la même date. Mélangez. Car l’Etat est en faillite, ne peut plus payer les retraites et oblige les enfants à prendre en charge leurs parents. Or, lorsque les liens entre père et fils sont distendus, l’ambiance peut devenir explosive ! Des pages drôles qui nous touchent et explorent les fractures parfois douloureuses entre les générations.
Suivez les aventures d'un papy-boomer et de son fils dans une ambiance drôle et touchante à la fois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carole Meudic
Papy-sitting
Roman
ISBN : 979-10-388-0139-4
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt légal : mai 2021
©couverture Ex Æquo
© 2021 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo
1
— Et merde !
Il se tenait là, immobile au milieu du vestibule, le courrier tremblant dans la main droite, l’enveloppe qu’il venait de déchirer dans la gauche. Comme transi. Il n’avait même pas pris le temps d’enlever sa veste.
En bas, dans le hall de son immeuble, il avait, comme chaque soir, trié la masse de prospectus qui encombrait sa boîte aux lettres malgré l’autocollant « Stop Publicités » qu’il avait pris soin d’y apposer. C’est là qu’il l’avait découverte, cette enveloppe oblongue. Cachée entre une promotion pour le jarret de veau hard discount et la liste interminable des pizzas disponibles en livraison à prix imbattable. Son cœur s’était mis à battre tellement fort qu’il l’avait senti jusqu’au fond de sa gorge. Il avait été submergé d’une vague acide. Pas d’erreur, elle lui était bien adressée. C’étaient bien son nom et son adresse qui apparaissaient par la petite fenêtre de papier transparent. L’en-tête ne faisait pas de doute non plus. C’était l’expéditeur tant redouté.
Ça devait bien finir par arriver. Il le savait. Il avait vu petit à petit ses proches touchés. Un à un. Comme dans un jeu de bataille navale géant, il avait vu les coups dans l’eau tomber autour de lui. Des amis avaient même disparu. Aucune nouvelle. Aucune trace. Du jour au lendemain. Évaporés.
Au début, il avait guetté le facteur, craignant le pire, frémissant chaque fois qu’il le voyait fouiller dans sa besace.
Et puis le temps avait passé. Comme rien n’arrivait, il avait fini par croire qu’il était passé entre les mailles du filet. Qui sait ? Peut-être avait-il eu de la chance pour une fois ? Peut-être n’était-il pas dans les listings ? Une mauvaise adresse ? Un patronyme mal orthographié ? Peut-être que ses parents étaient devenus riches, va savoir ? Ou peut-être qu’ils avaient passé l’arme à gauche sans qu’on prenne la peine de l’informer ?
Qu’est-ce que c’est con l’espoir !
Finis les coups dans l’eau, la bombe venait de lui tomber sur la tête. Touché, coulé !
Deux coups de pied rapides, il envoya ses Converses dans un coin du couloir. A la hâte, il accrocha sa veste en jean dans le placard de l’entrée et s’effondra sur le canapé, la lettre toujours à la main.
Il se mit à la relire, avec attention cette fois.
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales… En vertu de la loi Solidarité Générations votée en date du…
Solidarité Générations, mon cul oui ! De quelle espèce de cervelle avait bien pu germer cette appellation lumineuse ? Encore une idée de génie d’un énarque en mal de reconnaissance. Tout droit jaillie d’une séance de brainstorming au Ministère. Il s’imaginait très bien la scène. Une meute de jeunes conseillers fraîchement sortis de l’école. Autour d’une table Louis XVI encombrée de dossiers et de petites bouteilles d’eau minérale. Ils avaient enlevé leurs vestes et leurs cravates. Certains même étaient en bras de chemise. Masturbation intellectuelle de groupe. Chacun y allant de son concept, de son jargon. Une vraie battle de novlangue. C’était à celui qui sortirait le concept le plus tordu. Il était tard. Cela faisait des heures qu’ils essayaient de trouver un nom à cette foutue loi. Le Ministre lui-même avait formellement refusé qu’on y accole le sien. C’est dire s’il était fier de son projet ! Il fallait faire passer la pilule en douceur. Il fallait un joli nom qui cloue le bec aux électeurs. Éviter que la colère ne gronde dans les rues avant les primaires. Que les sondages ne chutent. Pour peu que ces crétins de lycéens ne décident de manifester, histoire de sécher les cours avant le bac et l’on serait contraints au rétropédalage. Non, il fallait un plan com au cordeau. On ne pouvait se permettre que la loi soit retoquée. Ou que des meutes de gilets jaunes envahissent encore les rues. Certes, elle protégeait la génération du baby-boom, les plus nombreux. Et il y avait plus d’électeurs en déambulateurs dans les isoloirs que de jeunes boutonneux. D’ailleurs, cela faisait belle lurette que les jeunes avaient cessé de croire en la politique. Mathématiquement, c’était donc gagné, mais si l’on pouvait avoir le consensus, ce serait l’apothéose. Alléluia ! Jouez hautbois, résonnez musettes ! C’était la réélection assurée.
Soudain, l’un d’eux avait dû s’exclamer :
— Pourquoi ne pas titiller le devoir moral des jeunes envers leurs aînés ? Que pensez-vous de « Solidarité Générations » ?
Que n’y avaient-ils pensé plus tôt ? Les vieux, c’est comme les enfants ou les petits chats, on ne peut pas en dire du mal sans s’attirer l’opprobre général. On ne peut pas les laisser tomber, ce serait odieux. Même les aïeux minables, méchants, qui sentent le pipi et qui vous ont pourri toute votre existence. C’est comme noyer des chatons ou laisser un clébard attaché à un platane de la nationale 7. C’est inavouable. On doit la vie à ses parents, pas vrai ? Rien de tel pour forcer le respect. Un juste retour des choses en somme. Brillant ! Inattaquable ! Le Ministre avait été ravi, le jeune énarque avait sans doute reçu une belle prime, le projet avait été adopté, le plan com élaboré au millimètre, les éléments de langage diffusés, largement relayés dans les médias, le peuple avait tout gobé. Champagne messieurs dames, ce fut un triomphe !
Et le résultat, il l’avait entre les mains. Il ne put échapper un soupir. Parce qu’elle avait été solidaire la génération d’avant ? Parce qu’on leur devait quelque chose peut-être ? Quelle bonne blague ! Il avait un goût aigre dans la bouche.
Il poursuivit sa lecture.
Eu égard à votre situation fiscale… bla, bla, bla… votre résidence principale…
Principale, c’était beaucoup dire dans la mesure où il n’en avait qu’une ! Son petit trois-pièces, deuxième sans ascenseur, dans une ruelle sombre du centre de Bordeaux qui sentait l’urine. Son petit trois-pièces pour lequel il s’était endetté sur trente ans. Son petit trois-pièces qu’il avait eu l’intelligence d’acheter dès qu’il avait signé son CDI, avant que les prix ne flambent dans la capitale girondine. Aujourd’hui, après l’arrivée massive de Parisiens grisés par leur pouvoir d’achat et les sirènes immobilières, il lui serait tout bonnement impossible d’espérer vivre dans sa ruelle sombre qui sentait l’urine.
… dont la surface et le nombre de pièces rentrent dans le cadre de l’article 24/b fixé par la loi sus-citée… bla, bla, bla…vous devrez désormais vous acquitter de l’impôt Solidarité-Générations
Il déglutit en regardant le montant inscrit dans le cadre. Ils avaient dû faire une erreur, ce n’était pas possible. Le fonctionnaire qui avait saisi la somme avait dû s’endormir sur la touche du zéro. Déjà que sans faire d’excès, sans presque jamais prendre de vacances, il avait du mal à joindre les deux bouts. Il n’avait pas de voiture, il traînait les mêmes vêtements bon marché toute l’année. Il ne pouvait guère s’écarter. Son seul caprice était l’achat compulsif de polars qui tapissaient les murs de tout son appartement. Il fit un rapide calcul. Impossible pour lui de s’acquitter de cet impôt. Une fois déduites les traites de son prêt, ses charges fixes, il ne resterait plus rien.
… ou bien prendre en charge votre/vos ascendant/s…
Suivait le nom de son père.
Henri Lalouse.
Drôle d’impression de lire ces deux mots.
Tellement longtemps.
Tellement longtemps qu’il n’avait pas entendu ou lu ce prénom associé à son patronyme. Tellement longtemps qu’il n’avait plus de nouvelles. Tellement longtemps qu’il avait enseveli la figure paternelle sous des tonnes d’oubli.
… un agent référent vous contactera dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du présent courrier afin de fixer avec vous les modalités d’installation de votre ascendant.
Il avait donc deux semaines pour se décider. Payer l’exorbitant impôt dont le montant prohibitif était une invitation à choisir le plan B… ou opter pour le plan B.
Il envoya la lettre d’un geste rageur sur la table basse et resta ainsi, voûté, prostré sur le bord du canapé, anéanti. Une onde de désespoir le submergea. Ses yeux s’embuèrent. La lumière du plafonnier se mit à trembloter. Non. Non, il ne fallait pas. C’était ridicule. Un homme, ça ne pleure pas. Surtout à plus de quarante balais. Et puis, ça ne résout rien. Il sentit pourtant une larme se frayer un chemin lentement, très lentement, le long de sa joue droite jusqu’à s’évanouir dans sa barbe. Et puis une autre, plus rapide. Puis encore d’autres, irrépressibles. Son visage fut vite baigné de pleurs. Il porta ses mains sur ses paupières comme pour les murer. Rien n’y faisait. Un flot continu ne cessait de s’écouler. De violents sanglots soulevaient ses épaules. Ses joues brûlaient.
Des images, pêle-mêle, s’entrechoquaient dans son esprit. Un kaléidoscope. Un tourbillon de fragments de sa vie. Le petit appartement de ses parents au-dessus de la boutique paternelle. Sa chambre avec le grand poster des Verts au-dessus de son lit et le regard de tueur d’Osvaldo Piazza, son préféré, qui veillait sur ses nuits. Sa mère et ses loulous de Poméranie. Obsédée par les concours canins de « ses chéris ». Qui avait fini par emporter sa mise en plis platine et ses clébards sous d’autres cieux, pour suivre un éleveur de teckels. Son père à la caisse de sa petite épicerie de quartier, les lunettes perchées sur le haut de son crâne luisant, le nez plongé dans les colonnes des pronostics du tiercé. Lorgnant sur les gros seins de sa pouffiasse rousse qu’il ne cachait même plus après le départ de sa chère et légitime épouse. Son message le jour où il lui avait annoncé qu’il avait vendu l’épicerie, qu’il partait avec Natacha s’installer aux Caraïbes, qu’il devait se presser s’il voulait récupérer ses affaires avant qu’elles ne partent à la décharge. Son enfance réduite à deux malheureux cartons. Et puis les années de galère. Les petits boulots pour financer ses études. La colocation avec toujours plus de monde dans des appartements toujours plus étroits. L’abandon de la fac et de ses rêves. Son boulot de serveur au Mushroom Café. Sa petite vie merdique. Mais il l’aimait bien, sa petite vie merdique. Au moins il était tout seul. Personne pour perturber sa bienfaisante solitude.
Les sanglots s’étaient espacés. Ça l’avait soulagé, mine de rien. Le film de sa vie en accéléré, comme avant de mourir. Comme un gros sac d’eau qui se serait crevé dans son cœur. Un abcès aquatique. Ses joues mouillées piquaient comme s’il avait pleuré des larmes d’acide. Quelques minutes avaient suffi à tuméfier ses yeux d’adolescent attardé. Il renifla. Il lui fallait un mouchoir et un verre. Il se leva. Sur la table de bar du coin cuisine, il arracha une feuille de Sopalin et se moucha bruyamment. Un crissement qu’il n’avait pas remarqué jusqu’alors se fit plus pressant. Comme si quelqu’un grattait la vitre. Avec toutes ses émotions, il l’avait oublié ! Il se précipita à la fenêtre. À peine eut-il entrouvert un battant, qu’un félin tigré sauta en douceur sur le carrelage. Il s’essuya d’un revers de la main les dernières traces de larmes aux coins des paupières, comme s’il avait honte que son chat le voie dans cet état.
— Salut, Momo ! La forme ?
Cela faisait belle lurette qu’il s’adressait à son chat à voix haute. Il ne voyait pas en quoi cela pouvait paraître ridicule. On parle bien à des nouveaux nés alors qu’ils ont la capacité à vous répondre d’un rôti de veau. Et tout le monde trouve cela normal. D’ailleurs, il était persuadé que Momo le comprenait à sa façon. Ne sachant pas parler le chat, il s’exprimait en français. C’était plus commode pour tout le monde. De toute façon, Momo n’était pas un diseux. Il ne miaulait jamais. Même quand il avait faim. Il levait la tête et le regardait. Cela suffisait.
Le matou se frotta le long de ses mollets, sa façon à lui de dire bonjour. Il lui gratta le dessus du crâne, ce que Momo semblait apprécier au plus haut point, les oreilles plates et les yeux mi-clos. Il lui versa quelques croquettes dans la gamelle, au pied du frigo. Le chat se précipita, les dernières croquettes rebondirent sur son crâne.
Quant à lui, il avait besoin de quelque chose de fort pour réfléchir. Si au moins il avait sous la main la petite eau-de-vie de prune de sa grand-mère auvergnate ! Les flammes le long de l’œsophage suivies presque aussitôt d’une explosion style champignon atomique au milieu du crâne, ça vous réveille un mort. Faute de petite prune, il entreprit de se servir un whisky. Les glaçons, comme toujours, n’avaient pas l’intention de sortir de leur petit habitacle carré. Il eut beau tordre le bac dans un sens puis dans l’autre, rien n’y fit. Puis, au moment même où il allait abandonner, l’un d’eux jaillit d’un trait jusque sous la table. Et tous se mirent à tomber d’un coup d’un seul dans son verre. Momo redressa son oreille gauche lorsqu’il entendit son maître, à quatre pattes sous la table, maugréer « journée de merde ! » Il jeta la poignée superflue de glaçons récalcitrants dans l’évier et noya les quelques heureux élus sous une bonne rasade de pur malt.
Il fallait qu’il parle à quelqu’un. Qu’il s’épanche. Qu’il partage l’énorme tuile qui venait de lui tomber dessus. Il jeta un œil sur le cadran digital du micro-ondes : 3 heures 09. Mauvaise heure pour les confidences. Soit vous tirez votre interlocuteur de son premier sommeil et il y a fort à parier qu’il vous rugisse que vous êtes un grand malade d’appeler à des heures pareilles et que la prochaine fois qu’il vous croise il vous met une droite. Soit il a décroché machinalement, n’est pas complètement sorti de ses rêves et vous vous rendrez compte à la première question restée sans réponse et à sa respiration paisible qu’il est en train de baver sur son portable en continuant sa nuit. Soit votre interlocuteur s’époumone pour couvrir la musique tonitruante en fond sonore et vous calculez à son élocution qu’il en est au moins à son sixième mojito.
C’était mort pour cette nuit. Il faudrait attendre le lendemain pour rameuter tous les potes. La réunion de crise allait devoir attendre.
Il s’avança vers la fenêtre de la cuisine en quête d’un bol d’air frais et planta ses coudes dans la jardinière qui ornait la petite balustrade en fer forgé. Au début de son installation, il avait repiqué quelques pieds de menthe, de thym et de persil, tout heureux de parsemer ses spaghettis de sa petite production personnelle. Jusqu’au jour où il s’était rendu compte que la voisine du dessus secouait régulièrement ses draps par la fenêtre. Il avait retrouvé au milieu des feuilles odorantes des poils dont la courbure et la longueur ne laissaient aucun doute sur leur provenance. Il avait cessé d’arroser la jardinière. Désormais la terre était aussi craquelée que dans le désert d’Atacama et seuls quelques moignons secs laissaient imaginer la présence passée de végétaux. Elle ne servait plus guère que d’accoudoir les soirs de blues et de pont d’atterrissage pour Momo lorsqu’il décidait d’explorer les toits du quartier.
L’air n’était même pas frais. L’humidité de la Garonne toute proche conférait un caractère presque tropical à la touffeur ambiante. Encore un été qui se présentait début avril. Les commentateurs n’allaient pas manquer d’accuser le réchauffement climatique. La faute à la pollution ! Cela donnerait une bonne occasion au gouvernement de surtaxer le carburant ou d’interdire les véhicules en ville.
Il remua le verre. Les glaçons tintèrent de joie. La gorgée de whisky coula le long de sa gorge, libérant ses effluves de tourbe et de bois. Les yeux clos, il essaya de rassembler ses idées, de reconstituer son esprit disséminé en une multitude de minuscules fragments.
Alors comme ça, voilà que cette foutue loi avait fini par lui tomber dessus. Son père n’avait pas passé l’arme à gauche, n’était pas devenu riche non plus. Son patronyme n’avait pas été mal orthographié. Il était bien sur les listings, avec la bonne adresse. Bref il n’avait pas de bol.
Comme d’hab.
Il se passa la main sur le front. Comment en était-on arrivé là ? La crise d’abord. Et puis la soi-disant reprise. Le gouvernement d’alors, galvanisé par les bons résultats de ses voisins européens, qui fait pleuvoir les cadeaux électoraux. Les profs, les médecins, les jeunes, les cheminots, les PME, tout le monde avait eu sa petite miette de charité pré-électorale. Comme si la croissance était contagieuse. Comme si les mauvais élèves pouvaient avoir les félicitations du jury juste parce qu’ils sont assis à côté du premier de la classe. Si au moins ils avaient copié sur leurs voisins, ces ânes… Bien au contraire, tournée générale avant les élections ! Allez, c’est le président qui régale !
À coup de dette. Tous accros à la dette. La dope de l’état. De la dette plein le pif, l’état ! Et puis un beau matin, la machine s’était emballée. Les investisseurs n’étaient plus très sûrs d’en vouloir, de la dette française. Et s’il fallait être remboursé ? Ils eurent peur de ne pas retrouver leurs billes. Le dealer nous laissait tomber pour un client qui payait mieux. Il n’avait fallu que quelques points de plus sur les taux d’intérêt de la dette publique pour que tout l’édifice vacille et s’écroule. Tout le monde nous lâchait. Les caisses de l’état étaient vides. Gueule de bois générale. Tronche de circonstance à la télé. Mesdames messieurs, l’heure est grave. Le président qui nous explique, des trémolos dans la voix, que nous sommes au pied du mur, qu’il va y avoir du sang et des larmes. Que ce n’est pas de sa faute, cela fait trente ans qu’on déconne, tout le monde le sait. Qu’il va falloir prendre des mesures difficiles. L’état n’était plus en mesure de payer à la fois les fonctionnaires et les pensions. L’heure était venue des coupes budgétaires et de la rigueur. Il y avait eu alors cette interminable période de conflits sociaux. Les syndicats qui bloquaient le pays. Les banderoles dans les rues. Les transports paralysés. Les files devant les stations essence. Les papis et les mamies qui font des stocks, leurs caddies débordant de boîtes de cassoulet et de paquets de farine. Pénurie de PQ dans les rayons des supermarchés. Les envoyés spéciaux BFM qui se prenaient pour des reporters de guerre sur fond de pneus qui brûlent et de drapeaux rouges. Des voitures avaient été incendiées ici ou là. Des baffes et des coups de batte étaient tombés. Des gaz lacrymogènes et des LBD aussi. Les gilets jaunes étaient repartis dans l’arène. Du coup, le gouvernement avait choisi de protéger ses fonctionnaires. Il n’y avait pas eu de coupe sombre dans les salaires de la fonction publique.
Il faudrait donc qu’on se paie nos vieux nous-mêmes. De là le brainstorming et l’impôt au doux nom de Solidarité-Générations. Le principe était simple. Ou tes vieux sont blindés et n’ont pas besoin de toi. Ou tu raques toi-même leur pension par le biais de ce foutu impôt. Ou tu les prends chez toi ! Le fonds de solidarité de l’État ne prendrait en charge, dans des dispensaires, que les personnes en très grande difficulté n’ayant pas de descendance.
Cela avait été la débandade. Grand branle-bas de combat, tout le monde sur le pont. Sauve qui peut ! On avait beau se lamenter, s’arracher les cheveux en regardant le ciel, pleurer en se tordant les bras, il n’y avait rien à faire, pas de solution. La génération sacrifiée devait prendre en charge la génération dorée des baby-boomers. Un comble ! Une fois encore, la génération muette s’était tue. Avait docilement subi sans rien dire. Personne n’était descendu dans la rue pour protester, après les fonctionnaires on avait trouvé que cela suffisait. À quoi bon, d’ailleurs. Circulez, y’a rien à voir !
On avait fini par croire qu’on était maudits, juste pas nés sous une bonne étoile. La bonne fée ne s’était pas penchée sur notre berceau, dans les années 70, elle avait tout donné à nos parents, elle n’avait plus rien en magasin ! Il est vrai qu’elle avait voulu se rattraper de sa bourde, la bonne fée. Elle avait merdé avec la génération qui avait connu la guerre, les privations, la déportation, l’enfer. Grosse boulette. Alors elle avait gâté pourri les suivants, les bébés Cadum d’après-guerre. Pour ce qu’ils en avaient été reconnaissants ! Ces enfants gâtés, nourris dans l’abondance des Trente Glorieuses, avaient fait leur petit caprice d’ados. En mai 68, ils s’étaient affranchis des règles. Désormais, il serait interdit d’interdire et l’amour serait libre. C’était à prendre ou à laisser ! Ils avaient envoyé bouler leurs propres parents, ceux-là mêmes qui les avaient sauvés de l’envahisseur nazi. Ils avaient fumé des pétards, les fleurs dans les cheveux, tout pouilleux avec des guitares et des peace and love partout. Et puis quand ils en avaient eu marre de déconner, ils avaient pris le pouvoir. Leurs enfants paieraient la facture.
Les glaçons avaient presque tous fondu. Il but une gorgée de whisky.
Il repensa à Valérie, une vieille copine de fac, qui s’était retrouvée du jour au lendemain avec deux pensionnaires de plus à la maison. Ses deux gosses dormaient dans des lits gigognes. Ses géniteurs octogénaires occupaient son lit tandis qu’elle passait toutes ses nuits sur le canapé clic-clac du salon. Déjà, être mère célibataire était une vraie gageure au quotidien, mais mère-et-fille célibataire s’apparentait à une épreuve de force. Le summum de la malchance. Le châtiment suprême. Les sociologues n’avaient pas encore trouvé de terme pour ce nouveau type de foyer. Les familles monoparentofiliales ? Les néo-damnés, oui ! Valou avait vieilli de dix ans en quelques mois. Elle ne passait plus guère au Mushroom Café. Plus le temps. Les quelques nouvelles qui lui parvenaient ne provenaient que de Snaps pris tard le soir sur le canapé de son salon.
C’est Ikéa qui avait dû se frotter les mains. Boom du marché du canapé-convertible !
Puis, peu de temps après, Manu, son grand pote, s’était tiré sans crier gare, du jour où il avait reçu la lettre fatidique. Son affaire de food-truck marchait bien. Il s’était constitué une solide clientèle fidèle. Il commençait à sortir la tête de l’eau. Il envisageait même d’ouvrir un restaurant. Il était parti en laissant les clés dans la boîte aux lettres. Quand la nana de l’agence immobilière qui lui louait son logement s’était décidée à se rendre sur place, après moult relances, elle avait découvert un appartement intact. Comme déserté dans l’urgence d’une catastrophe. Oradour-sur-Glane ou Pompéi. Une multitude d’enveloppes glissées sous la porte encombrait l’entrée. La vaisselle sale attendait dans l’évier. Le cendrier sur la table basse était plein. Un épais voile de poussière recouvrait les meubles. La plante verte faisait la gueule et la penderie était vide. Personne ne savait ce qu’il était devenu. Tous les copains y allaient de leur version. Quelques mois plus tard, une étrange demande d’ami lui était parvenue sur Facebook. Un barbu qu’il ne connaissait pas. Croyait-il. Il avait presque rejeté la demande. La curiosité l’avait emporté pourtant. Ce n’est qu’en voyant le food-truck sur une photo prise au festival de Sopot, dans la baie de Gdansk, qu’il avait compris que Manu s’était fait la malle. Il semblait heureux. Il était entouré de grandes blondes aux jambes aussi longues que leur jupe était courte. Il était compliqué d’échanger, le fisc traquait les déserteurs sur les réseaux sociaux et nombre de ceux qui étaient en cavale se faisaient cueillir à cause de leurs indiscrétions. Mais en filigrane, il avait compris que tout allait bien pour Manu, qu’il avait fui vers l’est et renonçait à rentrer en France. Il vivrait au jour le jour, sur la route, mais seul !
Combien avaient fui comme lui ? Le gouvernement ne communiquait presque jamais sur le sujet, arguant de l’absence de statistiques exactes. Argument fumeux s’il en était. Mais les rumeurs allaient bon train. Les ventes de biens immobiliers auraient explosé, menaçant le marché d’effondrement. Plus personne ne voulait être propriétaire. Ou alors d’un tout petit studio dont les proportions rendaient impossible l’accueil d’un parent. On disait que les petits malins avaient fractionné leur logement en plusieurs studios ou chambres d’étudiants. Des familles avaient parfois deux adresses différentes. Les couples ne vivaient plus en concubinage. On racontait même qu’il y avait eu des divorces de complaisance. La fuite vers l’étranger était difficile à quantifier, mais des sites d’information alternative annonçaient des chiffres astronomiques. Plus délicat pour le gouvernement, le taux de suicides des quadras et quinquas aurait bondi. En quelques mois, les 5000 suicides auraient déjà été atteints, dépassant les chiffres annuels habituels.
Il se passa la main dans ses cheveux en broussailles. Qu’allait-il bien devenir ? Lui qui commençait à trouver ses marques, à apprécier sa toute petite vie. La maturité de la quarantaine avait asséché ses rêves et il avait fini par accepter qu’il ne serait jamais prof de lettres, jamais comédien non plus. Il serait serveur au Mushroom Café pendant encore un paquet d’années. Un jour, peut-être, il espérait en prendre la gérance. Bernard, le patron, l’aimait bien et lui en parlait souvent. Pour cela, il faudrait mettre de l’argent de côté. Mais il avait la même impression que lorsqu’enfant, il avait économisé centime après centime pour s’acheter son premier Amstrad. Une tirelire-tonneau des Danaïdes. Finalement, il l’aimait bien sa minuscule vie merdique. Personne sur le râble. Petite barque qui bringuebalait tant bien que mal sur le courant, mais au moins il était le seul capitaine à bord.
Le verre était vide. Il referma la fenêtre et le posa dans l’évier. On verrait demain. Demain. Il préférait repousser à demain toutes les préoccupations, les corvées, les prises de tête, comme on pousse une grosse boule de poussière sous un meuble. Savourer les quelques ondes de bien-être que commençait à diffuser le whisky dans son corps.
— Momo, tu viens ?
Le chat le suivit de sa démarche chaloupée. C’était l’heure du repos, il le savait. Il sauta sur le lit et se chercha une position propice au sommeil de chat : en boule, la truffe enfouie dans le pelage de sa queue.
Son maître sortit peu après de la petite salle d’eau attenante. En caleçon à fleurs. Très années 80. Il se foutait pas mal de la mode. Il adorait sa collection de caleçons en coton fleuri. Celui-ci était tellement usé à l’entrejambe que le tissu était devenu translucide, bientôt il serait complètement déchiré. Les marguerites de l’imprimé flottaient sur ses jambes maigrelettes. Il n’avait jamais fait de sport depuis les cours d’éducation physique obligatoires au lycée. Où il n’avait d’ailleurs jamais brillé. Il avait toujours été ce grand échalas efflanqué, aux épaules tombantes. Le grand Duduche. En brun. De surcroît, avec la quarantaine, les excès et son régime alimentaire — presque exclusivement composé de pâtes, de pizzas et de plats congelés —, il avait vu son abdomen s’arrondir, enfler et retomber par-dessus sa ceinture comme un soufflé raté. Un maigre à bedaine.
Le lit n’était pas fait. Des plis à foison sur toute la surface. Un tsunami de draps. À la tête, un bouquin ouvert et posé à l’envers. La couette tirebouchonnée poussée dans un coin. Et Momo qui trônait déjà au sommet d’un oreiller. Il ne faisait jamais son lit ou presque. À quoi bon ? De temps à autre, lorsque l’odeur de nuit imprégnait trop les draps, il jetait tout dans la machine à laver et repartait pour un tour.
Il alluma la petite lampe de bureau sur la table de chevet. Les ronds luisants laissés par un verre sale, probablement un whisky, y dessinaient des anneaux olympiques psychédéliques. Il s’allongea. Ses membres le remercièrent aussitôt en lui procurant une vague de bien-être qui ondula de la plante de ses pieds jusqu’à l’extrémité de sa colonne vertébrale. Il hésita. Il sentait bien que dans sa tête tous les scénarios engendrés par la lecture du courrier fatidique s’entrechoquaient violemment. Le whisky l’avait alangui, mais pas au point d’empêcher son cerveau de bouillonner. Il tendit le bras. D’un geste qui révélait une certaine habitude, sans bouger et de sa seule main gauche, il détacha un comprimé d’une tablette argentée abandonnée sous la lampe. Un somnifère. Une toute petite pastille de sommeil sans rêves. Il n’allait jamais chez le médecin, mais nul besoin, lorsqu’on travaille dans un bar, on connaît du monde. Son copain Marco lui procurait tous les médocs qu’il voulait. Ex-camionneur, licencié pendant la crise de 2008, il travaillait désormais dans le portage des repas à domicile du pôle Seniors de la mairie de Bordeaux. Inutile de préciser qu’il avait accès à des tiroirs débordants de pilules de toutes les couleurs et de toutes les formes. Les plus gros junkies de France ont les cheveux bleutés, des culs-de-bouteille au bout du nez et des charentaises aux pieds. Des petites gourmandises pour faire passer le temps plus vite avant de passer l’arme à gauche. Tous accros à leurs bonbons. Avec les compliments de la Sécu !
— Bougez pas, mamie, je vais vous l’attraper, votre médicament !
Et hop, une boîte de Rohypnol dans la poche de sa blouse. Marco ne revendait qu’exclusivement aux copains. Il en avait beaucoup. Sa petite combine était florissante et lui permettait de s’arrondir les fins de mois. Parfois il payait des tournées au frais de papi et mamie. Ils s’esclaffaient tous d’un air entendu.
— À la vôtre !
2
Le problème avec les somnifères, c’est que le réveil est souvent pâteux. Comme s’il fallait monter une dune du Pyla interminable dont le sable se déroberait sans cesse sous les pieds.
Mais là, quelque chose ne collait pas. D’abord cette sensation bizarre. Un picotement et une ondulation régulière au niveau de son bas ventre. Ces mouvements de compression à la régularité de métronome ne correspondaient à rien. Il y avait aussi ce vrombissement lointain, comme un hélicoptère à l’horizon.
Il fallait remonter à la surface. Rassembler ses idées. Au prix d’un énorme effort, il parvint à s’extirper des profondeurs du sommeil et ouvrir un œil.
— Momo, merde !
En fait, point d’hélicoptère à l’horizon ou de vagues sur son estomac, Momo était en train de lui piétiner le ventre, les yeux mis clos, les griffes ouvertes de plaisir, ronronnant à s’en exploser la truffe. C’était sa façon à lui de lui signifier qu’il l’aimait, mais qu’il était grand temps de déjeuner.
Il repoussa le chat d’un mouvement brusque et se redressa. Il n’avait jamais été du matin. Il lui fallait un bon quart d’heure et un café avant de pouvoir être aimable. Même avec Momo.
Il tendit le bras, saisit son portable. Dix heures passées ! Il se frotta les yeux, se gratta la tête comme si cela pouvait accélérer le processus de réveil. Soudain, le spectre de la lettre surgit des abysses de son esprit. Bienheureuse nuit sans rêve, où tous les ennuis disparaissent.
Tandis que la cafetière crachotait dans la tasse, il tartina une tranche de pain de mie de mayonnaise, y déposa une feuille de salade iceberg et une tranche de jambon, puis la plia en deux et croqua à pleines dents. Deux bouchées et tout fut englouti. Momo lapait son lait avec sa délicatesse habituelle. Il se demandait toujours comment ce foutu chat pouvait gober aussi goulûment sa pitance avec une telle élégance.
Il se leva, la tasse à la main. D’un coup de souris, il réveilla son ordinateur somnolent. En deux clics, il chercha la musique qui convenait le mieux à son état d’esprit du moment. Il avait besoin de chaleur, d’amitié. Il lui fallait donc une valeur sûre, un tantinet nostalgique.
Les cris et sifflets de la foule en délire, puis la voix chaude de Bono, enfin les premiers accords de Helter Skelter en live. Plongée immédiate en 1988. La première année de fac. De nouvelles têtes. De nouveaux profs. Un nouveau monde. Avec Évelyne, sa voisine de TD, également fan inconditionnelle de U2, il avait été voir trois fois d’affilée Rattle and Hum au cinéma. L’album éponyme était de loin le meilleur selon lui. C’était plus qu’une suite de chansons. C’était le sourire d’Évelyne, ses yeux qui brillent dans la salle de cinéma, son rire à la sortie lorsqu’elle avait dit « on y retourne ? » Il avait dix-huit ans. Un monde encore plein de rêves, où tout restait possible. Un monde lumineux et insouciant où il s’imaginait un avenir doré. Bien loin des galères, des abandons, des trahisons et des bassesses qui ponctueraient les années suivantes.
Il ouvrit grand la fenêtre et s’assit en tailleur sur le tapis du salon, offrant son visage aux rayons du soleil qui perçait entre les toits. Il avala deux gorgées de café. Se brûla la langue en maugréant. Il n’avait vraiment pas l’élégance de Momo.
Il saisit le combiné de son téléphone fixe. Oui, il faisait partie de ces gens qui ont encore un téléphone fixe. Et s’en servent. La conversation risquait de durer. Détenteur d’un forfait bon marché spécial kid, « mon premier téléphone » pour les 6-10 ans, il lui était impossible d’appeler quiconque avec son portable. Juste bon à être joint et à gérer les urgences. Il composa le numéro de Christophe et Nicolas sur le vieux clavier aux touches crasseuses. Sans doute ses meilleurs potes. Ils l’avaient hébergé et dépanné quand il avait traversé sa dernière galère. Seul et sans ressources. Ils l’avaient très certainement sauvé de la rue.
— Nico ? C’est moi. Tu as un moment, là ?
— Max ? Comment va, mon gars ? Ça fait un bail…
— Nico, je suis dans la merde !
Sa voix tremblait. Il essuya sa main moite sur les marguerites de son caleçon. Il ne savait pas par où commencer.
— Ils m’ont eu, Nico. J’ai reçu la lettre. Mes parents ne sont ni morts ni riches. Du moins mon père. Je dois le prendre à la maison. Tu t’imagines ?
—…
Il avala une nouvelle gorgée de café. Le silence au bout du fil devenait pesant. Nicolas devait chercher ses mots, réfléchir à toute vitesse à une solution, une boutade, n’importe quoi qui le fît sourire. Il avait un don pour trouver le mot juste.
—… Ah, merde !
Si Nico lui-même était en panne d’inspiration, c’est que la situation était grave.
— J’ai quinze jours.
— Tu ne peux pas payer l’impôt ?
— Tu parles, impossible. J’ai encore mon prêt immobilier sur le dos pendant quatorze ans. Et puis de toute façon, mon salaire est bien trop bas pour sortir une telle somme tous les mois…
Il percevait l’embarras de Nicolas au bout du fil.
— L’ennui, c’est que l’impôt est calculé non seulement en fonction de tes revenus, mais aussi de la pension de retraite que percevait ton père. C’est là tout le problème, cette génération a bénéficié de calculs très avantageux, c’est pour ça que la plupart des gens ne peuvent pas payer… Écoute Max, rejoins-moi au Perdi Tempo pour déjeuner, disons midi et demi, porte-moi ton avis d’imposition, je vais voir ce que je peux faire, j’ai une amie qui travaille aux services sociaux. Elle me dira si un recours est possible…
— Tu crois ?
— Je dois être honnête ?
— À tout à l’heure.
Il reposa le combiné. C’était bien ce qu’il craignait. Qu’espérait-il ? Il était célibataire, sans enfants, propriétaire et avait un emploi. De quoi se plaignait-il ? Au regard de la plupart de ses congénères, on pouvait même dire qu’il était verni.
Un minuscule espoir s’était immiscé dans la voix pénétrante de Nico. Il savait que son ami avait beaucoup de relations et ferait tout son possible pour le sortir de l’impasse. Même si, avec Christophe, ils n’étaient certes pas confrontés à ce genre de problème. Nicolas était le dernier né d’une vieille famille bordelaise propriétaire de vignobles à Saint-Émilion. Son frère et sa sœur travaillaient au château, faisaient semblant de se rendre indispensables au négoce du grand cru familial. Lui, dirigeait une galerie d’art. Le rebelle de la famille : il aimait les hommes et l’art. Une aberration pour le clan saint-émilionnais. C’est au prix d’interminables batailles, de renoncements et de joutes infinies qu’il avait réussi à faire accepter Chris, l’amour de sa vie. Chris le sportif. Un corps d’Apollon. Joueur de hand-ball qui avait dû abréger sa carrière pour cause de blessure et à qui Nico avait « offert » une salle de sport qu’il dirigeait désormais. Inutile de dire qu’ils avaient l’habitude d’aplanir les difficultés à coup de chèques. Non seulement ils n’avaient pas à subvenir aux besoins de leurs ascendants, mais c’était même plutôt l’inverse.
Tout à ses réflexions sur les injustices de la vie, Maximilien Lalouse se leva. Jamais son patronyme ne lui avait paru coller aussi bien à la sienne, comme une malédiction qu’il se traînait depuis les moqueries du collège. Marqué dès la naissance par un nom-anathème. Damné dès l’utérus maternel.
Les rayons du soleil avaient disparu, ils léchaient désormais les tuiles de l’immeuble d’en face. Il se gratta avec nonchalance les parties génitales à travers le tissu à marguerites. Il y avait belle lurette que ces petits détails de bienséance ne le préoccupaient plus. Momo ne se plaignait pas, alors à quoi bon ? Il ouvrit le réfrigérateur, décapsula une boîte de boisson énergisante et la but d’un trait. Lorsqu’il avait pris un somnifère, il lui semblait être en sous-régime une bonne partie de la journée, comme si ses membres étaient gourds et son cerveau au ralenti. L’excès de café lui procurant des aigreurs d’estomac, il avait pris l’habitude de boire une canette de potion magique avant de se doucher. Il n’aimait pas ce goût doucereux de sirop pour la toux, mais c’était un mal nécessaire. Il émit un rot sonore et jeta la canette dans la poubelle à la façon d’un joueur de NBA qui marque un panier. Elle rebondit sur le bord et alla se ficher derrière un meuble. Il jura en soupirant, à quatre pattes, le bras tendu pour attraper la boîte rebelle. L’espace d’un instant, il crut y déceler l’orée d’une nouvelle journée merdique.
Une de plus.





























