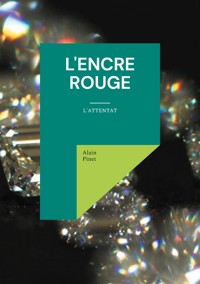Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Titou est un jeune garçon qui se raconte. De retour au Havre, après quelques années d'absence, il fait le constat de sa vie, en décrivant deux environnements différents : Son enfance et sa vie d'adulte. Le Havre est devenue sa ville, il la dépeint telle qu'il l'a connu et telle qu'elle est devenue, et dresse ici, un portrait de la société, de ses craintes et les dérives qu'il constate. Loin d'être un traité de philosophie, l'auteur marque sa différence. Ce que l'on a fait, ce que l'on a laissé faire, ce que l'on aurait dû faire reste un ambiguë dilemme face au monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« LES OISEAUX » une œuvre de Jean Pierre LARTISIEN
Ils trônent majestueux, sur la place de l’Hôtel de Ville du Havre, comme gardiens du temps et des hommes, en rappelant à chacun la petitesse de qui nous sommes, nous, humains faillibles qui perdons nos repères dans la mouvance du temps
Collection
AVANT PROPOS
Plaidoyer pour une vie est une simple approche de ce que ma génération aurait peut être, et sans aucune certitude, dû prévoir et faire pendant qu’elle le pouvait encore, pour que le monde change et tienne compte de l’humain plutôt que de la richesse et du pouvoir.
Il met en parallèle, les rêves d’un gosse qui doit grandir trop vite, et qui est idéaliste, face au monde réel tel qu’il est et tel qu’il se vit au quotidien, en utilisant les technologies nouvelles, les moyens de communication les plus sophistiqués, et les hommes comme otages d’un système bien huilé, rompu à dominer et à générer toujours plus de profits, au détriment des valeurs essentielles qui ont menées l’humanité jusqu’à ce jour.
Aucun système n’est parfait, et pourtant, celui dans lequel nous vivons perd de sa substance de jour en jour, faisant fi des catastrophes en tous genres à venir, qu’elles soient naturelles, exceptionnelles, ou plus simplement générées par la destruction des ressources de la planète « terre ».
« A trop pomper le puits, l’on finit par l’assécher ! »
Collection
Sommaire
Cours gamin, Le temps passe, il ne s’arrête jamais
Tu m’enfermes ? Non, tu me rends libre
Décris ton paysage, ton endroit, et ton rêve grandira
La décision
Conseil d’administration
Arrêt sur image
ça y est, j’ai 14 ans
Le crépuscule éteint le jour qui décline
J’assume
« Cours gamin, Le temps passe, il ne s’arrête jamais »
20 Avril 2015.
C’est un lundi comme tant d’autres, sans plus ni moins, et somme toute une journée qui s’annonce ordinaire.
Pourtant, c’est précisément ce jour que j’ai choisi pour écrire, ouvrir mon esprit, mon cœur, et probablement mon corps.
Pourquoi ?
Je ne saurai dire quelles raisons me poussent ainsi à coucher sur le papier cette histoire qui me touche.
Peut être parce qu’elle me ressemble et qu’en ce sens elle me libère, même si au passage, elle affecte mon être au plus profond.
J’imagine que certains la trouveront banale et sans intérêt, d’autres ni trouveront là qu’un écrit de plus, quelques mots qui se suivent pour former phrases, paragraphes et récit.
Peu m’importe en vérité, parce que sur le fond, c’est mon histoire, et qui mieux que moi ne saurait alors la conter.
Je suis assis là, sur un banc littéraire, face à la mer et au port, voyant défiler les bateaux dans un balai continuel et laissant derrière eux une trainée blanche sur l’eau étincelante.
C’est un retour aux sources d’une période de ma vie, et sans raison particulière, je suis revenu là, au Havre, pour trouver inspiration et nouveau souffle.
J’en manquais, c’est vrai, et sans doute était il temps pour moi de donner un nouveau sens à ma vie.
C’est là, sur ce banc, qu’à germé en quelques jours, le besoin de prendre cette plume trop longtemps oubliée au fond de l’une de mes poches.
Mais aujourd’hui, seule et sans contrainte, il sera difficile de l’arrêter car elle court seule sur la première feuille de mon bloc de papier.
Je suis né au soir d’un 24 Décembre, d’un père et d’une mère exploitants agricoles, dans le bourbonnais, en Allier, juste après que trois étudiants algériens se voient tabassés à l’université à Paris.
C’est dire dans quel climat put s’annoncer ma venue au monde…
Terre oubliée sans doute, l’ALLIER, ancien fief des Ducs de BOURBON, fut rattachée administrativement à la Région AUVERGNE.
Pourtant, le Bourbonnais ne ressemble aucunement à l’image qu’offrent les trois autres départements de la région. HAUTE LOIRE, CANTAL et PUY DE DÔME sont des terres de volcans éteints dont on distingue encore le sommet des cheminées.
Ainsi s’élève tout autour de leur paysage, la chaîne des Puys.
Leurs habitants ont conservé cet accent particulier et chantant venu du Sud.
Mon Bourbonnais lui, il ne l’a jamais eu.
Il a l’esprit de la terre, il a sa dureté, et il a cette manière indéfinissable de rouler les R comme en BOURGOGNE. Il a le temps de vivre, et peut-être est-ce pourquoi il a du mal à entrer dans la folle vitesse du 21éme siècle.
Mais c’est mon pays, là où je suis né, là où j’ai grandi.
Je vous ferai grâce de toute son histoire moyenâgeuse, et du temps de sa grandeur passée, lorsque les Ducs de BOURBON tenaient le royaume de France, après que VERCINGETORIX sortit victorieux des légions de ROME, en l’an 52 avant JC, sur le plateau de GERGOVIE, là bas au sud, tout près de CLERMONT FERRAND.
Le Bourbonnais est né à BOURBON L’ARCHAMBAULT, et ce ne sont pas moins de sept rois qui ont présidé les destinées de la France, d’HENRI IV à CHARLES X.
Vous comprendrez aisément la fierté du bourbonnais, car il sait d’où il vient.
Alors, pourquoi voudriez-vous qu’il soit ainsi oublié par tous, isolé et loin des routes commerciales, perdu dans son centre France, alors qu’il en est le berceau ?
Paradoxe de l’histoire, celui qui fut ainsi le tout premier territoire de la royauté de France, devient et demeure un oublié de la république, seul et parfois contre tous, sans rébellion, dans le silence, il reste pour longtemps encore, un patrimoine exceptionnel qui ne se découvre qu’aux plus curieux des touristes de passage.
Ici, on ne s’arrête que pour une courte halte au moment des vacances, sur la route qui mène à la Méditerranée.
Et pour ce faire, deux routes nationales le traversent. La nationale 7 qui file vers MARSEILLE, et la Nationale 9 qui descend par les volcans, les hauts plateaux du LARZAC et leur rocaille, jusqu’à BEZIERS.
Il faut bien vous dire que depuis quelques années, il y a bien eu des aménagements et des routes à deux fois deux voies qui ont été réalisées. Mais le revers de la médaille est sévère, puisqu’ainsi, en Allier, on ne s’arrête plus, on file à toute vitesse sur les autoroutes, jusqu’à l’aire des volcans, en territoire Auvergnat, en oubliant notre éternel pâté aux pommes de terre, et notre vin de Saint Pourçain, nos merveilleux bœufs charolais, et nos fromages au lait cru.
Bref ! On nous oublie à défaut de nous reconnaître comme patrimoine mondial, et pourtant, nous sommes l’histoire de France.
Quel département peut-il s’enorgueillir d’avoir fait naître le premier des Bourbons ?
Et puis, nous avons ici aussi notre triste record, notre fameuse mauvaise note : l’axe routier Est Ouest surnommé la route de la mort.
Depuis plus de 30 ans, aucune administration n’a réussi à terminer de bout en bout, cette route meurtrière.
Elle n’a ce record malheureux, que par la négligence de ceux qui ont jusqu’à présent piloté le projet.
Ils n’ont guère trouvé mieux que de sanctionner les utilisateurs par des PV à tout va et des radars flashants automatiques tout léger excès de vitesse.
Alors, n’osez pas me dire qu’il n’y a pas la volonté de l’oubli !
Ce Bourbonnais là dérangerait-il au point de vouloir le détruire ?
Pour autant, je ne pourrais vous épargner les bois, les forêts, le bocage et l’appartenance à la terre, que le travail acharné des hommes a rendue utilisable et fertile, généreuse et nourricière, mais ô combien capricieuse.
Tantôt fine et légère, elle est, en certains endroits, lourde et collante, calcaire ou glaiseuse, humide ou sèche, elle est ainsi difficile ou tendre, comme le sont les hommes qui l’ont travaillée.
Parcelles après parcelles, séparées par des haies touffues d’ormes, de charmes, de chênes, de ronces, d’églantiers piquants, qui servent ainsi encore de barrières naturelles au bétail paissant calmement dans les vertes prairies, elle est terre de bocage.
Idéalement frontières naturelles des propriétés, ces haies ont parfois disparues, pour permettre aux énormes engins agricoles de trouver une utilité effective dans les fermes, même si, sur le fond, cette dernière n’est qu’illusion relative.
Cédant plus à une pression économique de consommation galopante, et plus encore à une méthode comptable privilégiant l’investissement matériel à force d’emprunts, dont les intérêts font parfois vaciller la survie de l’agriculture, l’avenir de nos pittoresques fermes, les hommes achètent, s’endettent, et parfois en meurent.
Ici, dans ce bourbonnais inclassable, l’on nait, l’on vit, et l’on meurt sur sa terre.
C’est ainsi, et cette appartenance est si forte que l’homme est rugueux, méfiant, fort et tendre à la fois.
Il guette, surveille, patiente avant d’ouvrir sa porte à l’inconnu.
La plupart a abandonné les bâtiments ancestraux pour des hangars appelés stabulations jetées à tous vents, où vient se réfugier le bétail, et où seules des balles de foin ou de paille se proposent comme murailles infranchissables mais éphémères.
Pauvres pierres empilées unes à unes à la force des bras, tantôt blanches, tantôt rouges, et formant les murs des étables, des granges et des habitations, qu’êtes vous devenues ???
De nos rivières et ruisseaux, j’en garde le souvenir intarissable des poissons argentés que nous pêchions mes frères et moi, dans le bief du moulin de la Sioule, là bas, à Bayet, au lieudit « Entre-miaule », avec nos ridicules cannes en bambou, armée d’un simple fil de nylon, d’un bouchon en liège coloré et d’un hameçon rouillé que nous ne prenions jamais le temps de changer.
Nous trouvions sous les pierres, de pauvres vers de terre que nous accrochions sans égard pour une quelconque souffrance de l’animal, en le transperçant de part en part, par ce crochet piquant qui faisait gicler de ses entrailles, une bouillie de terre dont il se nourrissait.
En ce temps là, loin de nos esprits étaient les mots « douleurs et souffrances », car comme tout enfant, nous étions à l’âge de l’insouciance et de l’inconscience.
Merveilleux temps où le partage régnait en maître mot, dans nos jeux comme dans nos vies d’enfants. Il n’existait alors ni rancœur, ni rancune, ni jalousie.
Nous réalisions nos corvées en râlant certes. Mais il eût été bien difficile de s’y soustraire.
Bien que chétif, j’étais déjà classé parmi les « grands » malgré mon jeune âge, dans cette fratrie de neuf enfants.
Né le quatrième, il eût été délicat de passer mon tour au profit d’un plus jeune encore.
Ainsi, nos rires, nos joies, nos peines, restaient confinés au fond de nos cœurs et de nos esprits.
Ils marqueront plus tard, notre futur et notre vie d’adulte.
C’est en groupe d’âge, à la queue leu-leu, que nous marchions derrière le plus âgé, pour des explorations exceptionnelles de notre lieu de vie, de notre environnement. Rainettes, Escargots, vers de terre, limaces grises ou rouges, mulots, terriers de lapins ou de renards, nous explorions tout ce qui était à portée de nos yeux curieux.
Nous nous imaginions dans des contrées lointaines, aventuriers d’antan, traversant les âges, la tête dans les nuages, tantôt templiers, tantôt cow-boys, ou vêtus de cape que nous confectionnions avec des sacs d’engrais préalablement découpés et armés d’une épée de bois que nous avions fabriquée en cachette, avec minutie et précision, dans l’atelier de notre père.
Nous devenions ainsi pour un temps, les personnages intemporels que nous inspirait l’unique chaîne de télévision et de ses séries diffusées le jeudi après midi.
C’était le seul jour de semaine où nous étions autorisés à nous installer devant l’écran pendant le temps de diffusion des émissions enfantines. Je ne vais rajeunir personne en parlant de Jean NOHIN, de nounours, de la piste aux étoiles et de son Monsieur Loyal Roger LANZAC. Mais cela resituera pour certain, l’époque extraordinaire que nous vivions, avec pour compagnons de route, Pimperonnelle et Nicolas et la maison de Toutou, et les interminables Interlude et petit train de la mémoire. Et puis les Shadocks qui ne cessaient de pomper.
Mon Bourbonnais, mes racines, je le conserve comme un joyau dans mon cœur, dans ma tête.
Il m’arrive encore, lorsque j’y séjourne, de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux villages que je n’avais pas pris le temps de traverser plus tôt.
La vie est ainsi.
Elle égrène son temps, n’allant qu’à l’essentiel de l’instant, ne nous conduisant les uns et les autres que vers nos propres points d’intérêts du moment, en créant des œillères de part et d’autre de notre regard, nous faisant oublier peu à peu ceux que nous sommes, et d’où nous venons.
Je me souviens de ces jours où, chargé de garder un œil sur le troupeau d’une dizaine de vaches dispersées dans une prairie naturelle proche de la ferme, non munie de clôture et entourée de blé sur un côté, de maïs du côté opposé, de luzerne jouxtant les bâtiments de la ferme, et de betteraves fourragères sur le dernier des côtés, je me perdais dans mes rêves d’enfant.
Assis au fond d’un fossé me séparant d’un champ voisin, je m’abritais du vent, à côté de Dick, le chien fidèle qui suivait le troupeau dès qu’il sortait de l’étable, en mordillant le jarret des bêtes sans raison apparente.
Ainsi, sous l’ombrage d’un orme, mon regard se perdait là haut dans le ciel où les nuages dessinaient parfois, des êtres étranges ou des formes fugitives qui transportaient mon imagination dans l’irréalité du monde.
J’y voyais tant de choses, dans ces fugitives images…
Qu’il était doux à mon esprit de s’envoler dans cette immensité sans cesse renouvelée.
C’est en sifflant le plus souvent, que j’accompagnais les nuages dans leurs œuvres.
Oubliant parfois même le fondement même de la tâche qui m’avait été confiée, je laissais involontairement le troupeau s’écarter de la prairie pour le retrouver broutant ci et là dans le proche blé en herbe, ou la luzerne voisine.
Il me fallait alors sans plus attendre, courir à perdre haleine pour sortir le plus rapidement les bêtes de ce lopin de terre interdit, avant qu’elles ne se gavent de trop, et gonflent à pouvoir en crever.
La fermentation quasi immédiate des pousses fraîches se transformait en gaz, gonflant inéluctablement leur panse qui devenait énorme au point d’éclater.
Ce fâcheux aléa aurait alors nécessité l’intervention de mon père, ce qui n’aurait pas manqué de provoquer une réaction dont j’aurai pu me souvenir longtemps.
Quand au chien affolé, ne sachant quelle attitude retenir, il partait en croisade contre l’une ou l’autre des bêtes, jusqu’à les perdre de vue dans le champ, ne laissant derrière elles qu’une désolation de plans couchés qui ne relèveraient jamais la tête.
En ces instants malheureux de mon existence, la colère laissait place au désarroi et à l’impuissance.
Elles allaient loin et parfois jusqu’au champ de maïs du voisin.
Il ne me restait alors que l’appel à l’aide auprès de mes frères, pour tenter de sortir le troupeau de l’endroit où il s’était installé en résidence.
Cette variante de nourriture à profusion et à portée de gueule, les vaches l’appelaient de leurs vœux, j’en étais persuadé !!!
A croire qu’elles étaient dressées à me causer du tort !!!
Par le fait, elles me conduiraient tout droit à la dure punition qui me serait forcément donnée, lorsque juste avant que ne tombe la nuit, l’on rentrerait le troupeau à l’étable, où chacune reprendrait sa place, comme si de rien n’était, et se laisserait attacher pour la nuit.
Je voyais bien que mon pauvre bâton ne présentait qu’un piètre rempart, et qu’une arme faible devant ces énormes charolaises blanches aux énormes yeux, dont la cambrure des cornes rappelait qu’il valait mieux s’écarter à leur passage.
Elles faisaient exprès de me fixer droit dans les yeux, défiaient ma soi-disant autorité de berger de l’instant, et d’un coup de tête rageur, elles faisaient voler mon bâton au bout de mon bras tendu, hors de portée de leurs jarrets.
Qu’il était frustrant, du haut de mon mètre vingt, de ne pourvoir dominer ces monstres de chair et de sang !
Oui, elles me faisaient peur, et c’est tremblant de tous mes membres que je me rapprochais peu à peu d’elles.
Folles, elles devenaient folles, levant leur derrière et jetant les pattes arrières en direction de la gueule de Dick, qui tentait de mordiller leurs jarrets en le prenant au vol.
Lui, ce chien bizarre, il ne comprenait rien du tout, et il n’écoutait que son instinct. Tenter de le raisonner était une peine perdue.
Plus il s’approchait des monstrueuses bêtes, plus elles s’éloignaient.
Alors il continuait de les pousser encore plus avant, s’enfonçant toujours plus loin, bien au-delà de nos terres, elles atteignaient vite les champs des voisins, peu enclins à pardonner telle intrusion dans leur domaine.
Ce serait inéluctablement la guerre !!!
Il m’arrivait parfois de les poursuivre jusqu’à la nuit noire, dans un bosquet dont l’inconnu nous faisait peur.
Il était bien trop éloigné de la ferme pour que nous soyons en mesure de l’explorer.
C’était le diable, la zone interdite, là où s’aventurer était un risque si grand de se perdre, qu’on y imaginait des monstres si puissants, qu’aucun enfant n’en revenait jamais. Pourtant, les vaches elles, elles y allaient !!!
Et il fallait bien les récupérer, sinon où seraient le lait, la crème, le beurre, le fromage qui garniraient la table de nos lendemains ????
En ce temps là, presque tout ce que nous mangions était produit sur l’exploitation.
Seuls le pain, la viande de boucherie, ainsi que l’épicerie faisaient l’objet d’achats externes.
Perdre un œuf par maladresse pouvait nous coûter très cher !!!
Nous avions intérêt à la prudence de nos actes.
Privé de dîner était une punition extrême dont nous pouvions parfois souffrir.
« Qui dort dîne !!! » Entendait-on parfois
Tu parles !
Quand tu n’as rien dans le ventre, c’est vrai tu dors, mais ta faim reste quand même !!!
Que dire aussi de ces jours où nous étions conviés au ramassage des sarments de vigne qui s’éparpillaient dans les rangs, après la taille.
Elle éreintait mon père, cep après cep, sur les genoux du matin jusqu’au soir.
Il ne laissait suivre qu’un pauvre sac en toile de jute normalement destiné à contenir le grain ou la farine, et l’affectait occasionnellement à la protection de ses genoux plantés dans le sol rocailleux des vignes, situées sur les coteaux dominant l’exploitation.
Nous devions suivre ainsi, rang après rang, ces bouts de bois déformés qui avaient portés les grappes de la dernière récolte, les porter par brassées jusqu’en bas des rangs pour en faire des tas cornus en tous sens.
Ils seraient ensuite ramassés pour servir à allumer le foyer de l’énorme cuisinière ROSIERE en fonte qui ornait la cuisine, ou plus simplement brûlés sur place, servant à cuire quelques patates pour un encas en pleine nature, au milieu de la matinée.
Ces branchages arrogants et difformes nous arrachaient le visage ou les jambes, et nous revenions au logis dans le même état que ces guerriers francs après la bataille, tailladés de partout, griffés et sanguinolents.
« Ne te plains pas, c’est le métier qui rentre » !
Entendre cela équivalait à se contenter de se taire, ne pas se plaindre et apprendre à supporter la douleur et à se débrouiller tout seul…
Il en était d’ailleurs de même, lorsque nous étions conviés à suivre la presse après la moisson, pour constituer des tas de bottes de paille, facilitant ainsi leur ramassage et leur chargement sur les remorques.
Les chaumes arrivaient à mi jambes et écorchaient à chaque pas nos frêles gambettes de gamins, jusqu’à ce que nous trouvions l’idéale méthode pour les coucher sous nos pieds, avant qu’elles ne nous agressent, et enfouissent sous la peau tendre de nos jeunes années, des morceaux de paille éclatés qui pourriraient, et feraient naître d’affreuses rougeurs purulentes qu’il faudrait ensuite percer par l’aiguille, pour en désinfecter l’endroit.
Personne ne souhaitait ce châtiment.
La douceur de l’action à venir n’était que relative, et nous avions plus peur de ne pas la supporter que le fait en lui-même…
Tel était le prix à payer pour notre labeur.
Les enfants d’aujourd’hui ne connaitront jamais cela, jamais leur apprentissage de la vie ne leur permettra d’ancrer dans leur mémoire la véritable douleur du corps en apprentissage d’un quelconque travail, ou d’une corvée imposée.
Ils ont aujourd’hui un regard virtuel de la réalité.
Le jeu vidéo a remplacé nos combats et duels où, munis de notre fameuse épée de bois, nous combattions avec force et courage, l’intrus empiétant sur notre territoire.
Les coups sur les mains et sur les bras, nous les ressentions vraiment lorsque l’attaque de l’adversaire réussissait à toucher.
Il fallait apprendre l’art de l’esquive, et apprendre à bouger.
Eux, ils ne bougent qu’à peine les fesses dans le fauteuil, en appuyant sur un bouton dont ils connaissent toutes les fonctions.
Quand à la blessure, eux, ils en rient, elle ne les blesse jamais.
Nous, quand la douleur se faisait ressentir, on en pleurait !
Le prix de la victoire pouvait parfois être amer lorsque par inattention, nos coups portaient si fort que l’autre partait en hurlant jusqu’à la maison pour soigner son mal. L’issue de cette victoire éphémère se transformait en vagues de reproches et de calottes qui marquaient le visage ou les cuisses.
Le martinet aux lanières de cuir agressives avait cours, et il était prudent de l’éviter au mieux.
Aussi noir puisse t’il vous apparaître, nous aimions ces instants passés près de notre père qui ne disait mot.
Il ordonnait, et nous exécutions.
Le plaisir, nous le prenions autant que lui.
Lorsqu’il nous appelait pour le casse-croûte, il avait ce don prodigieux de nous récompenser à sa manière, par de petites choses simples.
Le saucisson qu’il coupait en épaisses rondelles, la tranche de pain généreuse qu’il nous tendait, la goutte de vin qu’il ne manquait pas d’ajouter à notre verre d’eau, et ce malicieux sourire qu’il gardait au coin des lèvres, avec un regard tendre et chaleureux.
Si nous craignions ses colères, elles furent si rares que les oublier fut extrêmement facile.
Le temps à cette particularité de favoriser une véritable sélection des souvenirs, et pour ce faire, il ne permet de conserver en mémoire qu’une grande majorité de bons moments de la vie.
C’était un homme simple.
De taille moyenne, un mètre soixante dix environ, ce qui veut dire plus petit que maintenant, sa carrure avait été forgée par un travail dur et harassant. Elle nous imposait de suite le respect.
Il parlait peu, mais juste et vrai.
Il aimait rire et faire rire.
Jovial en tous moments, il était franc et sincère, et tous les moyens semblaient bons pour nous rendre heureux.
Certains dimanches, aux beaux jours, il nous emmenait à la forêt pour passer d’agréables moments autour d’un pique nique.
Ah ! La forêt des Colettes !!! Quel nom pour une forêt !!!
Elle était forcément bien nommée puisque c’est aussi le prénom de notre mère.
Avec un ballon et neuf enfants dont huit garçons, le jeu devenait facile à trouver, et il jouait alors avec nous.
Il faut dire que parfois, il frappait un peu trop fort dans le cuir râpé de cette boule gonflée d’air.
A l’issue du tir et du contact de l’objet agressif sur la cuisse, une rougeur de sang apparaissait, et irritait la peau fragile de nos membres endoloris.
Ses excuses ne modifiaient en rien la douleur de celui qui l’avait reçu telle une bombe sur la partie du corps non choisie.
Mais si la victime pleurait, dans le même temps, ce coup faisait rire toute les autres membres de la famille, et ainsi devenant communicatif, tous ces visages déformés par des bouches grandes ouvertes, fendues de gauche à droite et laissant s’exclamer des sons aigus et joyeux, rendaient la douleur éphémère et supportable.
Il n’en restait le lendemain, qu’une forme arrondie persistante qui ornait la cuisse ou le visage, mais qui finirait par s’estomper avec le temps.
Brefs instants de vie que je vous conte ici, juste pour vous dire que l’enfance a et aura toujours deux visages.
L’un fait d’instants immémoriaux, magiques parfois, gravés à jamais dans nos corps et nos cœurs.
Chacun en conservera des bribes, des touts ou parties, du bon comme du mauvais, et en fera bonheur ou douleur.
L’autre sera faite d’oubli, volontaire ou involontaire.
Lorsque cette omission est involontaire, rien ne peut la ramener à la vie.