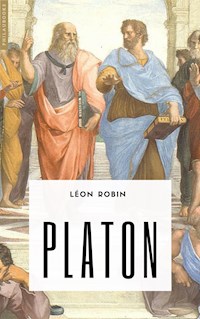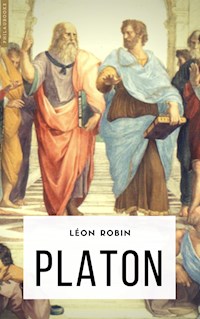
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Texte révisé suivi d'une biographie chronologique de L.Robin.
Extrait.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Platon
Léon Robin
Copyright © 2020 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0217-8
Table des matières
Avant-propos
1. La vie et les écrits
2. Qu'est-ce que savoir ?
3. La méthode du savoir
4. Phénomènes et choses
5. Le monde, l'âme et la divinité
6. La conduite humaine
Conclusion
Bibliographie
Biographie chronologique de L.Robin.
Avant-propos
Edition de 1935.
Ce livre repose sur un double postulat : l’un est que Platon est principalement un philosophe ; l’autre est que, à ce titre, il a ou essaie d’avoir une doctrine. Que Platon, philosophe, soit en outre un très grand artiste, rien n’est plus certain ; mais pourquoi l’art serait-il plus incompatible avec la philosophie que ne l’est cette dernière avec la science ? Il me semble d’autre part inconcevable qu’un philosophe puisse avoir réfléchi sur le savoir et sur ce qui en est l’objet et la méthode, sur la conduite et sur ce qui en est la règle, sans avoir fait effort pour systématiser les résultats de sa réflexion, après les avoir précisés et clarifiés. Ce qu’il y a de particulier chez Platon, c’est que cet effort s’accomplit devant nos yeux, sous forme de recherche et sous forme de critique, et que presque jamais les résultats positifs n’en sont dogmatiquement exposés. Toutefois, derrière ce spectacle, qui nous est offert par les dialogues, de la recherche et de la critique, il y a eu l’enseignement ; et pour Platon, il nous l’a dit solennellement dans Phèdre, c’était le principal. Or, si cet enseignement, dans sa substance, nous est, plus que le reste, enveloppé de brume, il n’est pas douteux du moins que ce devait être quelque chose de fortement défini et peut-être même d’un peu raide. Autrement, on s’explique mal que des disciples immédiats aient pu s’attacher à cet enseignement et le continuer, soit d’ailleurs pour en exagérer tel ou tel aspect (Speusippe et Xénocrate), soit pour l’accommoder en le corrigeant (Aristote), bref, que de toute façon, entre leurs mains, il ait pris sans délai la figure d’une « scolastique ». De ce double postulat découle le plan de ce livre : un exposé de l’œuvre, comportant d’une part une distribution systématique des idées (dont on ne méconnaît pas l’enchevêtrement réel), et, d’autre part, une histoire de ces mêmes idées, c’est-à-dire que, dans chacun des domaines sur lesquels, une fois dissociés, on les aura groupées, on cherchera à dessiner la courbe probable de leur évolution.
Le nombre est vraiment redoutable des livres qui ont été écrits sur Platon, sur telle partie de son œuvre, sur tel aspect de sa doctrine : la bibliographie n’en retiendra forcément que les plus importants. D’un autre côté, la place de l’exposition m’est étroitement mesurée, à peine suffisante pour faire seulement sentir quelle est la hardiesse de la pensée de Platon, sa force et sa variété. Aussi m’excusera-t-on, je l’espère, de n’avoir pas étalé au bas de mes pages une multitude de renvois aux travaux de mes devanciers : à quoi bon noter, là où il existe, mon accord avec eux ? À quoi bon signaler des divergences dont il serait impossible de donner ici les raisons déterminantes ? Une mise au point qui aspire à n’être pas un capharnaüm d’interprétations antagonistes, duquel ne peut surgir la moindre clarté, suppose nécessairement au contraire un choix entre celles qui ont été effectivement proposées, ou qui sont possibles et justifiables. Sur les motifs de ma décision, le cadre même de ce livre m’interdisait le plus souvent de m’expliquer en détail. Ce qui importait davantage, c’était l’indication précise des textes de Platon qui m’ont semblé propres à légitimer mes vues, c’était une analyse de ce qu’ils contiennent. Si brève qu’elle soit, la bibliographie fournira le moyen de confronter ces vues avec d’autres, identiques, voisines ou enfin totalement différentes.
L. Robin
N.B. : Les mots grecs ont été transcrits en caractère latin ; la lettre y a été constamment employée comme équivalent de la lettre grecque υ ; le h, de l’aspiration initiale (esprit rude).
La vie et les écrits
Biographie
À l’exception de quelques données, non douteuses en elles-mêmes encore que la chronologie en demeure passablement incertaine, la biographie de Platon est surtout riche de conjectures, dont quelques-unes se fondent uniquement sur l’idée que, d’autre part et selon notre humeur, nous avons pu nous faire de la personnalité du philosophe.
On place communément la naissance de Platon en 428/7 ; mais on exclut ainsi, sans le dire, une autre tradition qui la placerait en 429. En la fixant au 7 du mois de Thargélion (mai), on suit encore une tradition dont l’intention était probablement de faire coïncider cette naissance avec le jour anniversaire, dans le calendrier religieux d’Athènes, de la naissance d’Apollon ; ne veut-on pas aussi que sa mort ait coïncidé avec cette même fête ? Il est possible d’ailleurs que la date généralement admise pour la mort, 348/7, ait servi de base au calcul de la date de naissance ; or ce calcul variera nécessairement avec le choix qu’on aura fait, pour la durée de la vie, entre le nombre rond de quatre-vingts ans et ce même nombre, accru dans certains témoignages d’une ou de deux unités. Encore est-il permis de penser que, si généralement on a préféré quatre-vingt-un ans, c’est peut-être pour des raisons d’arithmologie mystique et parce que ce nombre est le carré de 9, qui à son tour est le carré du premier nombre impair ! Dans l’art de supputer les dates les chronologistes anciens mettaient beaucoup de fantaisie ; de notre côté, nous présentons trop souvent comme des certitudes le résultat de calculs dont la base est entièrement arbitraire. Tout ce qu’on devrait se borner à dire, c’est que Platon est né dans les trois ou quatre premières années de la guerre du Péloponnèse, aux alentours du temps où mourait Périclès, victime de la grande peste d’Athènes, — et qu’il est mort une dizaine d’années avant la victoire de Philippe à Chéronée, qui devait consacrer définitivement l’asservissement de la Grèce à la domination macédonienne.
Que Platon fût athénien et de la meilleure noblesse, c’est incontestable, quoiqu’il n’y ait pas toujours accord entre les témoins sur les origines. La famille de son père Ariston prétendait, assure-t-on le plus souvent, descendre de Codrus, le dernier roi d’Athènes ; ce qui autorisait à remonter bien loin au-delà, jusqu’à un petit-fils de Poséidon lui-même ! Du côté maternel l’illustration était moins grande, mais mieux établie : Périctionê était en effet la fille d’un Critias — celui qui figure dans le Timée (cf. 21ab, 25 d sqq.) et qui est le protagoniste du dialogue désigné par son nom —, lequel était lui-même le petit-fils d’un autre Critias, dont enfin le grand-père était un certain Dropide, très intime ami de Solon, le premier législateur d’Athènes. Elle était donc ainsi cousine germaine de ce Critias qui fut l’âme de la Tyrannie des Trente et sœur de Charmide, un des dix commissaires établis au Pirée par les Oligarques. De son mariage avec Ariston elle avait eu plusieurs enfants : Adimante et Glaucon étaient de beaucoup, semble-t-il, les aînés de Platon ; Pôtonê fut la mère de Speusippe, qui devait succéder à son oncle à la tête de l’Académie. Devenue veuve peu après la naissance de Platon, Périctionê se remaria avec un certain Pyrilampe qui était son oncle maternel (cf. Charmide 158a), et dont elle eut au moins un fils, cet Antiphon qui est le narrateur du Parménide (voir le début de ce dialogue). Notons enfin que, d’après une tradition, le vrai nom de Platon aurait été celui de son grand-père paternel, Aristoclès. Mais, quant au sens du prétendu sobriquet, l’ingéniosité des dépositaires de cette tradition se donne carrière : pour l’un l’idée de largeur, impliquée par le surnom, se rapporterait à l’ensemble de la carrure ; pour un autre, aux proportions du front ; pour un troisième, à l’ampleur du style ! Ils n’ont donc fait, semble-t-il, que chercher à interpréter historiquement un simple calembour.
Sans nul doute, l’éducation du jeune homme fut celle que comportait la situation de ses parents. Mais, dès qu’on cherche à préciser le point qui nous intéresserait le plus, la formation philosophique, aussitôt commence l’incertitude. Ainsi, l’affirmation d’Aristote (Métaph. À 6, 987 a, 32 sqq.) que, avant d’entrer dans le cercle socratique, Platon aurait été l’élève de l’Héraclitéen Cratyle a été contestée : ne résulterait-elle pas en effet tout bonnement d’une inférence, fondée sur la façon dont Platon aurait modifié la doctrine de Socrate, et justement pour la mieux adapter aux changements incessants que révèle l’expérience ? Et maintenant, à quel âge s’est-il attaché à la personne de Socrate ? Si c’est, comme on l’admet en général, à vingt ans, alors l’initiation alléguée à l’Héraclitéisme aurait commencé et fini singulièrement tôt ! D’autre part, autour de ce Socrate qui fut alors, Aristophane nous en est le meilleur garant, une des figures marquantes de la Cité, il n’y avait probablement pas que des disciples, ou mieux des fidèles, mais aussi des curieux occasionnels : c’est à ce titre qu’avaient dû le fréquenter Critias, Charmide et les frères aînés de Platon, et à ce titre aussi qu’ils ont pu introduire le jeune homme auprès de lui. Au surplus, la peinture que, dans certains dialogues comme le Lysis ou le Charmide, Platon nous a faite des entretiens de son maître donne à penser que des enfants en étaient parfois les interlocuteurs : ce qui nous obligerait à reculer en deçà de la vingtième année les premières impressions produites sur lui par la pensée de Socrate ; elles pourraient donc être antérieures à son entrée dans l’école de Cratyle. En tout cas, il n’est guère croyable, ni que Platon ait pu être déterminé par l’influence de ses parents à resserrer des relations qui risquaient de détourner son esprit des réalités positives et des exigences du moment ; ni qu’il ait senti lui-même le besoin logique de chercher dans le concept cet élément stable dont la connaissance ne peut se passer et qui faisait défaut au mobilisme héraclitéen. Plus vraisemblablement, ce fils de grande famille, appelé à jouer un jour un rôle dans la Cité, déjà capable de juger les actes et les méthodes politiques, s’est attaché à Socrate surtout en raison de prédications de celui-ci sur la justice, qui régnerait dans l’État le jour où le principe des compétences y aurait remplacé le principe égalitaire. Le désordre et l’impuissance du gouvernement démocratique aboutissant au désastre qui termina en 404 la Guerre du Péloponnèse, le despotisme sanguinaire du gouvernement oligarchique qui vint ensuite, voilà quels furent peut-être les plus pressants motifs qui déterminèrent Platon à s’attacher d’une façon plus étroite à l’homme dont il dira plus tard (à la fin du Phédon) qu’« entre tous ceux de son temps qu’il lui a été donné de connaître, il fut le meilleur et en outre le plus sage et le plus juste ».
Après la chute des Trente et le retour des bannis (403/2), Athènes connut une heure de magnifique espérance, où l’on put croire, à condition de n’y pas regarder de trop près, que seraient oubliées toutes les divisions, que la restauration démocratique relèverait la République de sa déchéance et guérirait ses blessures. Si l’on ajoute foi aux renseignements que contient la VIIe Lettre (324b-326b), et mise à part toute question d’authenticité, Platon avait été cruellement déçu par le gouvernement des Trente, vers lequel auraient pu l’attirer des traditions de famille et des motifs personnels ; il gardait encore cependant, et quoique les conditions fussent tout autres, quelque désir de participer aux affaires publiques ; mais une renonciation radicale se serait bientôt imposée à lui, aussi longtemps du moins que les États seraient ce qu’ils sont à présent : les Trente avaient voulu faire de Socrate le complice de leurs iniquités, et voici que maintenant la démocratie accueillait contre le Sage une calomnieuse accusation d’impiété et qu’elle le condamnait à boire la ciguë ! Quand bien même ces soi-disant confidences seraient seulement des inductions, dont l’Apologie (32 c) et la République (V, 473 d) par exemple auraient fourni la base à un adroit faussaire, c’est un fait que l’unique indice d’une ambition politique chez Platon se rapporte à ces voyages de Sicile dont il sera question plus tard, et par conséquent à la découverte, ailleurs qu’à Athènes, des conditions grâce auxquelles pourrait être réalisé un État à la tête duquel la philosophie prendrait la place qui de droit lui revient.
À la dernière journée de son maître Platon, nous dit-il lui-même, n’assista pas, empêché par la maladie (cf. Phédon 59 b) : rien n’autorise, ni à douter de son affirmation, ni à penser qu’il aurait appelé maladie un chagrin dont n’aurait pas triomphé la conscience d’un devoir à remplir. Il ne semble pas que les amis athéniens de Socrate aient pu légitimement croire ensuite leur sécurité menacée. Toujours est-il cependant que plusieurs d’entre eux, dont Platon, gagnèrent Mégare, toute proche d’Athènes et où ils savaient devoir trouver près d’Euclide, de Terpsion et de leur groupe une affection sympathique et, au besoin, secourable. L’influence de ce séjour sur la pensée de Platon ne peut être conjecturée sans témérité. Selon toute vraisemblance il ne fut pas très long : Platon appartenait en effet à la classe des Chevaliers ; ceux-ci eurent, vers ce temps, fort à faire pour la protection du territoire ; des obligations militaires durent fréquemment s’imposer à lui. Notamment, il est probable qu’il prit part (394) à la bataille de Corinthe, où les Spartiates et leurs alliés battirent les Athéniens et les Thébains.
On admettra donc difficilement que les voyages de Platon, à moins d’avoir été rapides et peu étendus, puissent se placer avant 396. Il est au contraire plus vraisemblable qu’avant 391/0, c’est-à-dire avant l’approche de la quarantaine, il ne fit hors d’Athènes aucune absence de quelque durée. Dans cette hypothèse on admettra que déjà Platon a écrit un bon nombre de ses dialogues, et particulièrement tous ceux qu’il a consacrés à défendre la mémoire de son maître ; peut-être même le Sophiste Polycrate a-t-il déjà publié son fameux pamphlet, où il ressuscitait Anytus pour imputer à Socrate tous les malheurs d’Athènes, en raison de l’action qu’il aurait exercée sur l’esprit d’Alcibiade ; réponse ou non à cette accusation posthume, le Gorgias enfin serait antérieur à cette longue absence. Il n’est pas impossible d’autre part que, sans avoir encore fondé proprement une école, Platon fût dès cette époque le chef d’un groupe socratique indépendant. Au surplus, qu’est-ce que le Gorgias ? Une attaque passionnée contre les maîtres de rhétorique qui enseignent l’art de faire triompher, aussi bien devant l’Assemblée qu’au tribunal, n’importe quelle cause, de flatter les passions de l’auditoire au lieu de l’éclairer ; une apologie exaltée de la Justice, le plus grand des biens pour la société comme pour l’individu, et préférable même à l’existence ; une condamnation violente de la fausse égalité, celle sur laquelle justement se fonde tout le système politique de la démocratie. On ne s’étonnerait donc pas que, à la suite d’un tel réquisitoire contre les conceptions, les méthodes et les pratiques dominantes, et surtout si ce réquisitoire reflétait un apostolat auquel déjà ne manquaient pas les adeptes, Platon eût en effet senti le désir de s’éloigner, ne serait-ce que par besoin moral de respirer une autre atmosphère.
L’Égypte, qu’alors il s’y soit ou non rendu pour la première fois, eut d’abord sa visite. Un tel voyage pour un Athénien n’avait rien d’une aventure, et Platon, dit-on, l’aurait fait en négociant, emportant avec lui une cargaison d’huile, le produit de ses olivaies ; vendue sur le marché de Naucratis elle devait lui procurer le moyen de continuer son voyage. Celui-ci se serait ensuite poursuivi vers Cyrène. Sans doute n’y rencontra-t-il pas seulement le mathématicien Théodore, qui sera l’un des personnages du Théétète, mais peut-être aussi bien quelques philosophes qu’il avait connus dans l’entourage de Socrate : ainsi Aristippe, quoique l’humeur de ce dernier fût passablement vagabonde, ou bien son associé Cléombrote (cf. Phédon 59 c) ; on verra plus tard quel rôle important a joué dans la vie de Platon un autre citoyen de Cyrène (cf. infra). De là gagna-t-il directement l’Italie méridionale, ou bien retourna-t-il auparavant à Athènes ? En faveur de cette dernière hypothèse, défendue par ceux qui placent cinq ou six ans plus tôt le premier voyage de Platon, on fait valoir que, selon Plutarque (De genio Socratis 7, 579 a sqq.), il serait en revenant d’Égypte passé par Délos ; ce qui conduit en outre à intervertir l’ordre des escales. Mais n’est-ce pas une de ces inventions, comme il y en a tant chez le bonhomme de Chéronée, et dont l’objet serait de rapporter au plus illustre philosophe géomètre de l’Antiquité le problème fameux de la duplication du cube, ou problème de Délos 1 ? Quelle que soit l’hypothèse adoptée sur l’endroit d’où venait Platon, il est très probable que, en se rendant en Italie, son intention était de connaître le Pythagoricien Archytas. Celui-ci, grâce à son ascendant personnel, avait réussi à instituer, ou plutôt à maintenir dans Tarente un gouvernement dont l’autorité se fondait mystiquement sur la philosophie et la science. Si l’ambition profonde de Platon était de réformer la société et l’État, de quel intérêt devait être pour lui cette survivance privilégiée d’un état de choses que, depuis 410 environ, la révolution avait partout ailleurs aboli dans la Grande Grèce ! Une tradition était assez communément reçue dans l’Antiquité : Platon aurait profité de sa présence dans les milieux pythagoriciens pour se procurer, à prix d’argent ou autrement, les écrits secrets, soit de Pythagore, soit de Philolaüs, lequel serait plagié dans le Timée (Diog. Laërce VIII, 84 sq.), soit de tous les deux. Que cette fable ait été imaginée par des Pythagoriciens pour accaparer le Platonisme à leur profit, ou bien par des Platoniciens pour faire bénéficier les doctrines de leur maître du prestige qui s’attachait aux mystères du Pythagorisme, de toute façon elle ne mérite aucun crédit.
Platon cependant quitte alors l’Italie pour se rendre en Sicile, répondant à l’invitation que lui avait adressée Denys, tyran de Syracuse, peut-être même par l’amicale entremise d’Archytas. Sur l’époque, les informations de la VIIe Lettre s’accordent assez bien avec les vraisemblances obtenues d’autre part : « Quand la première fois je me rendis en Sicile, y est-il dit (324a, cf. 326 b), j’avais alors à peu près quarante ans ».
Il y avait donc un quart de siècle environ que les Athéniens avaient vu se finir de la façon lamentable que l’on sait leur folle expédition contre la Sicile, vers le milieu de la guerre du Péloponnèse. C’était l’effondrement d’un vaste dessein impérialiste : Alcibiade leur avait en effet persuadé que, maîtres de la grande île, si merveilleusement située et si riche, ils le seraient aussi de la Méditerranée tout entière et assureraient à leur empire d’inépuisables ressources. À la suite de cet événement, la Sicile, au contraire de ce qu’on aurait pu attendre, traversa une période extraordinairement troublée. Les Carthaginois, jadis refoulés ou contenus par Gélon, puis par son frère Hiéron, ces deux tyrans qui avaient élevé très haut la puissance de Syracuse, commençaient à redevenir menaçants ; les cités grecques du nord-ouest étaient tombées entre leurs mains. Or, au temps de l’arrivée de Platon, il y avait plus de quinze ans déjà que, profitant de circonstances favorables, Denys avait réussi à renverser la démocratie qui s’était établie à Syracuse et à y devenir progressivement le maître absolu.
Sa cour était fastueuse et l’on y menait, à l’exemple du prince, la vie la plus dissolue. Quelle puissante curiosité politique a pu déterminer Platon à compromettre sa dignité de philosophe dans une telle compagnie ?
Et, si c’est à Denys que revenait l’initiative de la rencontre, quels motifs pouvaient lui inspirer le désir de recevoir Platon à sa cour ? La notoriété de celui-ci devait être déjà grande, et sans doute ne se recommandait-il pas seulement de sa parenté avec Critias et de ses sympathies doriennes. Quoi qu’il en soit, il ne fallut pas longtemps à Denys pour juger importune la présence de cet hôte de marque. Mais d’où vint le mécontentement du prince ? De remontrances morales qui lui auraient été faites ? de conseils politiques indiscrets ? Prit-il ombrage de l’enthousiasme que les propos du philosophe avaient inspiré à son jeune beau-frère, Dion (dont la sœur était une de ses deux femmes), et des sentiments de particulière amitié dont celui-ci était payé en retour ? Il est possible enfin (car notre chronologie est fort incertaine) que la mauvaise humeur de Denys visât en Platon principalement l’Athénien : c’est en effet aux Jeux olympiques de 388 que Lysias2, en appelant les Grecs à l’union contre les tyrannies et en signalant la menace particulière que constituait à l’ouest la puissance de Denys, suscita une véritable émeute contre l’ambassade du prince syracusain.
Toujours est-il qu’un beau matin Platon fut embarqué sur un navire qui ramenait dans son pays un envoyé de Sparte. Est-il vrai que Denys se fût entendu avec ce dernier pour une escale imprévue dans l’île d’Égine ? ou bien la tempête obligea-t-elle à y aborder 3 ?
Or les Éginètes étaient alors en guerre avec les Athéniens : c’était donc pour Platon, sinon la mort, du moins l’esclavage. Par bonheur il fut, raconte-t-on, reconnu d’un riche Cyrénaïque, Annicéris, peut-être celui dont le nom figure parmi les disciples d’Aristippe. Racheté et libéré par lui, il put enfin rentrer à Athènes. Ainsi se termina, en 387 environ, la première aventure sicilienne de Platon.
Le résultat ne semble pourtant pas avoir affaibli, ni l’énergie de sa vocation d’éducateur, ni la conscience qu’il a de sa mission régénératrice : il sera le guide de la jeunesse, il la préparera par la science et la philosophie au rôle politique qui, plus tard, sera le sien. C’est alors qu’il aurait établi le lieu de son enseignement dans un gymnase que, du nom déformé d’un vieux héros athénien, patron de tout le site, on appelait Académie. Puis il achète un parc contigu au gymnase, afin d’y élever les logements des élèves. L’endroit était au nord-ouest de la ville, vers la Porte Dipylon (la Double Porte), dans le voisinage du Céphise dont les ruisselets arrosaient la plaine ; à peu de distance du bourg de Colone, le pays natal de Sophocle, et de son fameux bois d’oliviers. Ce fut, jusqu’au temps de Sylla, la résidence de l’École. Celle-ci fut alors transportée à l’intérieur de la ville dans le gymnase dit de Ptolémée : c’est là qu’enseigna Antiochus d’Ascalon, un des maîtres de Cicéron. L’ancien domaine n’est plus désormais qu’un lieu de pèlerinage4.
L’Académie a été la première école de philosophie dont l’existence puisse être affirmée avec certitude, la première en tout cas qui ait été vraiment ouverte à des élèves, et ne fût plus une association fermée de chercheurs ou une confrérie de libres croyants. Elle constituait une sorte d’Université, possédant un statut juridique, un règlement intérieur, un budget de dépenses et recettes ; en outre de logements destinés, sinon aux maîtres, du moins aux élèves, elle comprenait des salles de cours, un local consacré aux Muses (Muséum) où étaient conservés les livres et des collections scientifiques de toutes sortes ; avec le temps l’enclos se peupla de statues de philosophes et de chapelles commémoratives. Quant au corps enseignant, sous la direction du Chef d’École ou Scolarque, il comptait plusieurs maîtres, probablement spécialisés : Speusippe, Xénocrate, Héraclide du Pont furent du nombre de ces maîtres ; Eudoxe de Cnide et Théétète professèrent à l’Académie les mathématiques, en y joignant même, le premier, l’astronomie ; Aristote passe pour avoir été chargé de l’enseignement de la rhétorique.
Quel était le mode d’enseignement ? Il est peu probable qu’il ne fût constitué que par le dialogue, et sans doute variait-il tant selon l’objet que selon l’auditoire. Certes, les dernières pages du Phèdre (275 c sqq.) montrent que la méthode préférée de Platon est la recherche vivante, où la pensée de l’élève communie activement avec celle du maître. À vrai dire, son dessein à cet endroit est surtout de critiquer la méthode de ses concurrents, les maîtres de rhétorique : ceux-ci enseignaient en effet des procédés littéraires ou oratoires au moyen de cahiers ou de livres, compositions types où ils avaient, une fois pour toutes, mis en œuvre ces procédés ; modèles qu’ils analysaient et commentaient devant leurs élèves, discours de parade (ou épidictiques), lectures publiques destinées à faire montre de leur talent. Pas davantage Platon ne songe alors à prononcer contre la composition écrite et publiée une condamnation sans réserve : c’eût été renier son passé d’écrivain ; et de fait, après qu’il eut ouvert son école dans l’Académie, il ne cessa pas pour cela d’écrire. Mais ce qu’il demande au livre, ce n’est pas de coopérer à l’enseignement lui-même : c’est seulement, ou bien d’être un moyen accessoire de perpétuer, pour soi-même autant que pour ceux qui y ont été associés, des recherches et des débats qui ont eu lieu à l’intérieur de l’École, ou bien de servir à en donner un aperçu au-dehors et pour un public plus étendu ; aperçu suffisant pour piquer la curiosité, non pour la satisfaire. Il est enfin presque certain que ce n’étaient pas des dialogues, ces « doctrines non écrites » (agrapha dogmata) dont parle Aristote, ces leçons Sur le Bien que mentionne Aristoxène de Tarente, le fameux spécialiste pythagoricien de l’harmonique, qui était passé dans l’école d’Aristote (cf. infra, IV, III), et dont Xénocrate et Aristote lui-même avaient fait des rédactions. C’est donc que la méthode, dite socratique, d’enseigner par interrogations et réponses et sous la forme d’une dialectique vivante et agissante, n’a pas été d’une façon constante la méthode pratiquée par Platon dans son École. Au moins vers la fin de sa carrière, il semble avoir donné sur certains points de sa doctrine des expositions continues et proprement didactiques.
L’Académie, dit-on, connut immédiatement le plus éclatant succès : de tous les points de la Grèce et de l’Asie hellénisée on venait s’y instruire ou lui apporter l’hommage d’un concours particulier. Une des raisons de ce succès résidait peut-être dans le programme que s’était tracé Platon : son but, on l’a vu, semble en effet avoir été de déterminer un plan d’études, tel que les élèves capables de le suivre jusqu’au bout fussent en état, par la suite, d’administrer les cités selon la justice. Or c’était, depuis longtemps, aux yeux des Grecs, une des plus hautes fonctions du philosophe d’être un législateur ou un chef de gouvernement : Héraclite en avait eu, sans succès, l’ambition à Éphèse ; mais le Pythagorisme avait été à la fois une théorie et une organisation politiques ; Parménide passait pour avoir été le législateur d’Élée et les Thouriens avaient, dit-on, demandé une constitution à Protagoras. Faut-il qu’une tâche si importante soit abandonnée à l’arbitraire individuel, sans principes définis et de valeur universelle, sans méthode propre à guider sur la route de la vérité ? Platon ne le veut pas, et, convaincu qu’il est le détenteur, sinon de cette vérité, du moins de ses principes et de sa méthode, il se croit seul capable de dire en quoi consiste la tâche et d’y préparer les autres. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait existé, au moins nominalement, des États « platoniciens ». Une fois rentré dans sa patrie, plus d’un élève de Platon eut l’ambition d’y introduire quelque chose de la politique du Maître. L’exemple le plus significatif serait celui de ces petites principautés asiatiques d’Atarnée (au bord de la mer, à l’ouest de Pergame), d’Assos (au nord de Lesbos) et de Scepsis (en Troade), auxquelles une tradition, reflétée par la VIe Lettre, lie les noms d’Hermias, de Coriscus et d’Éraste, or, après la mort de Platon, c’est à la cour d’Atarnée chez Hermias que, comme dans un milieu ami, vinrent séjourner Xénocrate et Aristote ; celui-ci a vécu à Assos et paraît y avoir tenu une école, filiale de l’Académie ; souvent aussi le nom de Coriscus revient sous sa plume ; enfin c’est à Scepsis, dit-on, que se trouvaient ses manuscrits, ou une partie de ceux-ci.
Voici un autre indice de la prédominance de l’orientation politique dans l’éducation de l’Académie : si Dion a été l’élève de prédilection, n’est-ce pas que Platon voyait en lui celui que désignait sa naissance pour présider, en philosophe, aux destinées d’un État puissant ? Or, vers 367, la mort soudaine du vieux Denys appelle sur le trône le fils aîné de celui-ci. Ce second Denys avait trente ans à peine ; par méfiance, son père l’avait toujours tenu à l’écart des affaires ; au milieu d’une vie dissipée il ne connaissait d’autre occupation sérieuse que de fabriquer de ses mains des bibelots, ou bien de faire des vers !
Il semblait donc devoir être un instrument docile entre les mains de Dion. Aussi celui-ci se hâta-t-il d’avertir Platon : nul moment ne pouvait être plus favorable à la réalisation d’une réforme politique ; avide de recevoir les enseignements du maître de l’Académie, le jeune prince s’empresserait sans nul doute de se laisser guider par celui-ci et par lui-même. À ses instances se joignirent peut-être celles d’Archytas de Tarente. Platon, semble-t-il, n’avait pas depuis très longtemps achevé la République : l’occasion était magnifique d’en expérimenter les possibilités d’application. Il n’hésite donc pas à abandonner son École qu’il laisse, dit-on, à la direction d’Eudoxe, et, au printemps de 366, il s’embarque pour la Sicile.
L’accueil de Denys fut très flatteur ; on ne pouvait souhaiter d’élève plus zélé. Des froissements ne tardèrent pas cependant à se produire. Platon voulut-il se prévaloir à l’excès de son autorité de chef d’une grande école ? Denys lui rappela-t-il les égards dus à un souverain ? Ce qui est en tout cas hautement probable, c’est que Dion et Platon ne cachèrent pas suffisamment leur dessein de se substituer à lui dans l’exercice réel du pouvoir, et peut-être même de le remplacer par un des fils que le vieux Denys avait eus de la sœur de Dion, son autre épouse. Sans doute le mécontentement et les soupçons du tyran furent-ils, en outre, sournoisement excités par Philistus, l’historien, qu’il avait rappelé de l’exil auquel son père, après lui avoir dû l’autorité, l’avait néanmoins condamné. La désillusion dut être brutale : Dion fut banni et Platon, au contraire, contraint de rester ; véritablement prisonnier dans la citadelle qui servait de palais à son royal élève, dont l’appétit philosophique se montrait, par calcul, plus exigeant que jamais ! N’avait-il pas ainsi un otage, qui le garantissait contre les entreprises possibles de l’exilé ? S’il se décida cependant à abandonner un si précieux gage, c’est que, forcé de partir pour l’Italie à l’occasion d’une expédition militaire, il n’avait plus de prétexte pour refuser à Platon son congé. Mais il lui fit promettre de revenir, promettant de son côté que Dion serait bientôt rappelé. Feinte promesse, on le devine, et dont il retardait toujours l’exécution. Bien mieux, dans le temps même où il signifiait à Dion, une fois de plus, que l’heure du retour n’avait pas sonné, il invitait Platon à se rendre à Syracuse, comptant sur la présence de celui-ci pour rehausser encore le renom littéraire de sa cour ; il aurait même, cette fois aussi, prié Archytas d’appuyer sa requête. Si l’on en croit là-dessus la VIIe Lettre (338 a sqq.), Dion ne fut pas le moins empressé à solliciter Platon d’accepter l’invitation : sinon, ses chances, qui se confondaient avec celles de l’expérience politique rêvée par le philosophe, risquaient d’être définitivement compromises. Non sans hésitation, car il avait alors de beaucoup dépassé la soixantaine, Platon se décida enfin à entreprendre vers la Sicile son troisième voyage (361), confiant cette fois à Héraclide du Pont la direction de l’Académie. Il n’y avait pas bien longtemps cependant qu’il était à Syracuse, que déjà les choses commençaient de se gâter. Est-il vrai, comme le raconte la Lettre, que Denys ait été rebuté par la discipline rigoureuse à laquelle Platon prétendait soumettre son zèle de philosophe amateur ? qu’il ait à son tour mécontenté le Maître en se vantant, ce qui était faux, d’être entièrement instruit de certains points « réservés » de la doctrine ? ou bien s’irrita-t-il que Platon lui eût arraché la grâce d’un certain Héraclide en qui, non sans bonnes raisons, le tyran avait reconnu un dangereux ennemi ? Ce qui est plus probable que ces récits trop circonstanciés, ou auxquels l’ésotérisme fournit une base suspecte, c’est que Platon dut mettre une insistance maladroite à plaider la cause de Dion et à réclamer son rappel. C’est justement alors, semble-t-il, que furent en effet confisqués les biens de Dion, à qui d’ailleurs on avait déjà cessé de servir ses revenus, et que fut, en outre, assignée à Platon une résidence qui le mettait en danger de mort. Il fallut une énergique intervention d’Archytas, envoyant même, dit-on, le vaisseau qui le ramènerait à Athènes, pour que Denys renonçât à sa vengeance et se résolût enfin à le relâcher.
Ce dernier séjour en Sicile avait duré un peu moins d’un an. Platon, regagnant la Grèce, s’arrête à Olympie : c’était l’année des Jeux et il s’y rencontre avec Dion. Tout espoir d’une solution amiable devait être abandonné. On se concerte donc sur un plan d’action, et Dion commence de recruter un peu partout des partisans ; les éléments jeunes de l’Académie devaient lui fournir son état-major. En, il n’avait pu rassembler encore qu’une très maigre troupe ; il a néanmoins l’audace de prendre la mer ; sa petite flotte échappe au barrage qui devait l’arrêter ; son débarquement en Sicile une fois connu, quelques milliers de partisans se joignent à lui, et, profitant de l’absence de Denys, il se présente devant Syracuse qui lui ouvre ses portes. Ce n’était toutefois qu’un demi-succès ; car le château, dans l’île d’Ortygie, demeurait aux mains des partisans de Denys, et celui-ci ne devait pas tarder à les y rejoindre. Les difficultés de la position de Dion croissaient de jour en jour, issues en partie des événements eux-mêmes, mais aussi de son esprit autoritaire et de son manque de perspicacité. Après trois années et toute une suite extraordinaire de vicissitudes, dont le détail est sans intérêt pour la biographie même de Platon, peut-être finit-il par se rendre insupportable à tous et même à ses amis, si bien qu’en il fut assassiné à l’instigation de Callippe, le plus intime d’entre eux. Il avait été pour Platon le disciple de prédilection, le philosophe roi ou le roi philosophe, dont l’avènement devait marquer pour un État le début de l’ère de la justice et de celle du bonheur. La mort de celui dont il espérait tant fut, peut-on croire, une grande douleur pour le vieux Maître, et qui s’ajoutait à la plus cruelle déception. Celle-ci n’alla pas cependant jusqu’à lui enlever sa confiance dans l’objectif à atteindre et dans les méthodes qui pouvaient mener au succès : les Lois en effet, qui sont son dernier ouvrage, en portent encore le témoignage. Quoi qu’il en soit, Platon continua d’enseigner et d’écrire et, quand il mourut en 348/7 environ, âgé de quatre-vingts ans ou un peu plus, il était, dit-on, en train d’achever ce dernier livre. Son testament, qui paraît être authentique, ne contient que des dispositions personnelles, sans rien qui puisse intéresser l’historien de la philosophie ; un seul enfant y est mentionné, un fils du nom d’Adimante. À la tête de son École Platon laissait, désigné par lui pour être son successeur, son neveu Speusippe.
Une tradition, qui n’est peut-être qu’une inférence psychologique, veut que ce choix ait vivement irrité Aristote et Xénocrate, déterminant leur départ pour l’Asie Mineure, auprès d’Hermias.
Est-il utile maintenant de prétendre esquisser un portrait moral de Platon ? Prétention sans doute aussi vaine que celle de retrouver une image authentique de ses traits : des préférences subjectives, difficiles à justifier sérieusement, n’induisent-elles pas le plus souvent à le reconnaître dans tel ou tel buste antique ? De quel critérium usera-t-on d’autre part pour se faire du caractère de Platon une image ressemblante ? Certains auteurs dans l’Antiquité l’avaient peint sous des couleurs peu flatteuses : Aristoxène le Musicien et les historiens Théopompe et Timée. Quand ceux-ci, ou d’autres, taxent Platon d’orgueil, quand ils parlent de la vivacité de ses antipathies, quand ils incriminent ses mœurs, de quel droit soutenons-nous délibérément que ce sont de pures calomnies ? Notre admiration pour le philosophe et pour l’écrivain ne nous porte-t-elle pas à interpréter dans un sens favorable des passages qui pourraient l’être en un sens tout opposé ? N’est-il pas, dirons-nous, permis au génie d’avoir la conscience de sa supériorité ? les inimitiés de Platon n’étaient-elles pas pleinement justifiées ? peindre une perversion de l’amour qui est honorée par les gens les plus cultivés, y faire des allusions complaisantes, est-ce partager cette erreur et la mettre soi-même en pratique 5? Entre les sentiments que Platon fait exprimer aux personnages de ses dialogues, nous retiendrons donc de préférence ceux qui nous semblent les plus propres à embellir la figure de notre héros. Quand il s’agit d’un philosophe, c’est déjà beaucoup que l’historien fasse en sorte de le bien lire et de comprendre sa pensée.
ÉCRITS
Parmi les anciens, Platon est pour nous un auteur privilégié : un des rares en effet dont tous les écrits nous soient parvenus, préservés peut-être par la beauté littéraire de certains d’entre eux contre l’indifférence et contre les chances consécutives de destruction. En ce qui le concerne, notre embarras vient plutôt des doutes que peut inspirer l’authenticité de quelques-uns de ceux qui nous ont été transmis sous son nom. Avant de tenter le discernement des apocryphes, on doit envisager la forme même sous laquelle se présentent tous ces écrits ou, plus exactement, la plupart d’entre eux. À l’exception en effet du recueil des Définitions et des treize Lettres, tous sont des dialogues.
Or il ne semble pas qu’avant Platon le dialogue ait jamais été employé par un philosophe pour exprimer sa pensée. Quand on le dit de Zénon d’ Élée, c’est vraisemblablement une conjecture, dont l’origine serait cette assertion d’Aristote que Zénon aurait inventé la dialectique.
La question se pose donc de savoir quels motifs ont pu déterminer Platon à employer cette forme littéraire. — Aristote, parlant de ce qu’il appelle les « compositions » ou les « dialogues socratiques », semble dire que le modèle d’après lequel ils ont été conçus était l’œuvre d’un certain Alexamène de Styra ou de Téos, et en outre il compare ce genre d’écrits aux « mimes » de Sophron et de Xénarque, c’est-à-dire à ces esquisses dialoguées, fort en honneur, dit-on, à Syracuse, où l’on cherchait à « mimer » la vie de chaque jour. Mais le point que vise surtout la comparaison d’Aristote, c’est que, dans les deux cas, il s’agit d’une œuvre d’art et, par conséquent, d’une « imitation » ; puis, en second lieu, que de part et d’autre le dialogue n’est pas en vers comme dans la comédie, mais en prose (Poét. I, 1447 b, 9 sqq. et fr. 61 ; Rhét. III 16, 1417 a, 18 sqq.). Aussi semble-t-il bien difficile de prétexter ce rapprochement littéraire pour alléguer une prétendue influence de Sophron sur Platon lors du premier séjour de celui-ci à Syracuse, et comme si jusque-là il n’eût écrit aucun dialogue 6 ! Épicharme était sans doute plus répandu et l’on sait quelle admiration Platon avait pour lui (cf. Théét. 152e) : est-ce parce que dans ses comédies il y avait de la philosophie ?
Peut-être serait-il permis de supposer que Platon a songé à l’imiter sous ce rapport, mais avec un autre centre de perspective et en renonçant à la forme poétique. Or, justement, c’est une tradition que Platon, lorsqu’il se fut définitivement attaché à Socrate, aurait brûlé ses essais poétiques et des ébauches de tragédies où se faisait vraisemblablement sentir, outre l’ambition de suivre l’exemple de son cousin Critias, l’influence de la pensée philosophique d’Euripide. Mais une telle renonciation ne concernait sans doute que la forme : ne lit-on pas à la fin du Banquet qu’il appartient au même homme, et c’est le philosophe, de composer comédies aussi bien que tragédies ?
Voici donc comment on peut, sans prétendre à une chimérique certitude, se représenter les motifs qui auraient déterminé Platon à traduire sa réflexion philosophique dans de petits drames en prose, dont le mouvement serait celui d’une conversation familière. Tout d’abord, son tempérament d’artiste devait répugner à l’idée d’une exposition didactique, se plaire au contraire à imaginer une œuvre d’art où s’exprimeraient, avec toutes les apparences de la vie, les attitudes diverses et individuellement caractérisées de plusieurs esprits, placés en face d’un problème philosophique à discuter. Et maintenant, pour réaliser un tel dessein, il avait son centre de perspective tout trouvé : son art n’aurait qu’à imiter ce qui précisément avait été la méthode par laquelle Socrate avait renouvelé l’esprit de la philosophie, tant par rapport aux « Physiciens » du passé qu’à l’égard des « Sophistes » du présent. Non pas sans doute ce Socrate qu’Aristophane avait représenté unissant en sa personne les caractères des uns et des autres, tenant école, et de physique et de rhétorique ; mais ce Socrate qui, professant au contraire ne rien savoir, poursuivait, sur la place publique et dans les palestres, sa perpétuelle enquête auprès de ceux qui se flattaient de posséder un réel savoir ; à seule fin, disait-il, de vérifier cet oracle de la Pythie qui l’avait proclamé le plus sage des hommes. Du jour où, de la sorte, il s’était reconnu investi d’une mission par le dieu de Delphes, le dieu guérisseur et libérateur, il n’avait eu d’autre occupation que de converser, mêlant peut-être à ses entretiens quelque élément de prédication ; non cependant pour enseigner, ce qui eût contredit l’attitude qu’il avait adoptée, mais pour encourager ses auditeurs (c’est ce qu’on appelait protreptique) à adopter en face de la vie une attitude semblable à la sienne. Il ne laissait d’ailleurs en mourant aucun écrit où se reflétât cet apostolat : il n’avait voulu, en toute humilité, que donner un exemple de ce que peut produire l’esprit critique uni à l’amour désintéressé du vrai. Aussi ceux que son apostolat avait conquis voulurent-ils que le souvenir n’en fût pas perdu et que l’exemple survécût à celui qui l’avait donné. C’est de cette intention qu’est sorti ce genre littéraire original qu’Aristote appelle le logos sôcraticos, la « composition socratique ».
Que Platon ait été ou non le créateur du genre, du moins est-il certain qu’il n’a pas été le seul à le pratiquer : plusieurs autres socratiques, Antisthène, Aristippe, Eschine, Euclide, Phédon, avaient écrit de telles compositions dialoguées, que nous avons perdues et dont certaines à la vérité étaient suspectes dès l’Antiquité. Ce dont on ne peut guère douter non plus, c’est qu’ils n’interprétaient pas de la même façon la pensée de leur maître et qu’ils se sont à ce sujet plus ou moins âprement combattus. On se persuade donc aisément que, dans ces compositions, les auteurs devaient se croire autorisés à faire dire à Socrate ce qui leur semblait avoir été, en fait ou en droit, sa véritable pensée par rapport à la question sur laquelle ils avaient choisi de faire porter l’entretien. C’est ce que montreraient, ou bien les Mémorables de Xénophon, où Socrate parle de tant de choses qui sont incompatibles avec ce qu’on sait de sa vie, tandis que celle de Xénophon suffit à en donner l’explication la plus naturelle ; ou bien, dans les dialogues de Platon, tous ces anachronismes, toutes ces marques d’un agencement littéraire, qui sont pour lui autant de moyens de suggérer discrètement à son lecteur que le personnage de Socrate est un élément d’une fiction, que, si les personnages mis en scène sont d’un autre temps, c’est pourtant à des préoccupations philosophiques ou littéraires du temps même de l’auteur que répond leur entretien : personne alors ne devait s’y tromper. Au surplus, Socrate n’est même pas le protagoniste nécessaire, ni même un personnage obligatoire, de la « composition socratique » : ainsi, dans le Sophiste et dans le Politique, le premier rôle est tenu par un « Étranger d’Élée », dans le Timée par le Pythagoricien de ce nom, et enfin, dans les Lois, dont la scène se passe en Crète et d’où Socrate est complètement absent, par un « Étranger d’Athènes ». Et cependant ce dernier ouvrage doit être lui-même encore considéré comme un échantillon du genre dont il s’agit : il en conserve en effet le trait essentiel, l’emploi de la méthode interrogative ; il le conserve même sans nécessité, quand l’Étranger athénien, au lieu de faire un exposé continu de la question sur laquelle ses interlocuteurs sont incapables de jouer leur partie dans un entretien, reste fidèle au dialogue en se faisant à lui-même demandes et réponses (X 892e sqq.). C’est que, comme on le verra, il n’y a pas de recherche possible sans la dialectique, qui est l’art d’interroger et de répondre, l’art de conduire méthodiquement le dialogue, pour écarter, d’abord, des conceptions inconsistantes ou incomplètes et pour atteindre, ensuite, la vérité. Entre une telle méthode et la démonstration mathématique, il y a des différences que Platon a pris lui-même soin de noter (cf. infra, IV, I) ; elles sont cependant analogues, étant l’une et l’autre progressives : ce qui signifie seulement que l’avance doit se faire pas à pas, et seulement quand le meneur du jeu et ses partenaires ont réussi à se mettre d’accord, et dans l’ordre requis, sur chaque point de la question totale. Ainsi donc le dialogue s’imposait doublement, et comme forme littéraire propre à donner une image de ce qu’avait été l’activité de Socrate, et comme répondant exactement aux exigences reconnues de la recherche.
De ce qu’il y a, comme on vient de le voir, des dialogues où Socrate n’est pas le protagoniste et même où il ne paraît pas, faut-il conclure, d’une part, que tous ceux où il tient la première place sont une sorte de « mémorial », et, d’autre part, que ceux où il n’en est point ainsi sont les seuls où Platon ait exprimé ses idées personnelles 7 ?
Ainsi, dans le premier cas, les idées exposées seraient celles de Socrate et le milieu décrit, celui dans lequel il a vécu ; l’œuvre propre de Platon serait uniquement celle d’un metteur en scène, d’un artiste capable de faire de ce « mémorial » philosophique une parfaite imitation de la réalité, tant psychologique que sociale. À la vérité, il y a bien un dialogue, le Philèbe, dont la doctrine serait purement platonicienne, et dans lequel cependant Socrate redevient le protagoniste : c’est, dit-on, qu’il y a, dans l’esprit de Platon, une liaison nécessaire entre les problèmes de la morale, dont traite ce dialogue, et la personne de Socrate. À la vérité encore, dans le Parménide et le Théétète, Socrate a également un rôle de premier plan, et pourtant un autre esprit anime déjà ces dialogues : crise réelle, sans doute ; mais on pense que Platon n’a pas pris conscience encore de la nouveauté de ses vues et du schisme qui se prépare. En résumé, il y aurait deux hommes en Platon philosophe : l’un, qui n’est autre au fond que Socrate, et le second, qui seul est vraiment Platon. — Mais, en prétendant ainsi attribuer à la majeure partie des dialogues une valeur avant tout historique ou documentaire et, secondairement, artistique ou de présentation, on s’expose à de sérieuses difficultés.
Ce dont on conviendra cependant tout d’abord, c’est qu’elles ne résultent pas de l’existence, déjà signalée, d’anachronismes dans les dialogues. Que par exemple, dans le Banquet (193 a), dont la scène se place en 416, Platon mette dans la bouche d’Aristophane une allusion à un événement de 385, le démantèlement de Mantinée par les Spartiates et la dispersion de ses habitants (ce qu’on appelait un dioecisme) ; que dans le Ménon (90a) Socrate fasse lui-même, à propos d’Isménias de Thèbes, allusion à un fait postérieur de quatre années à sa mort ; que dans le Ménexène (244d-246a) il soit question dans le prétendu discours d’Aspasie, que récite Socrate, de nombreux événements postérieurs à 399, et notamment de la paix d’Antalcidas qui est de 387 ; que de même, dans Ion (541 d) Socrate parle de faits qui se placent entre 394 et 391, etc., tout cela importe fort peu. En effet, notons-le d’abord, la détermination des allusions dont il s’agit est loin d’être incontestable : peut-être ne sont-elles anachroniques que pour nous et par un effet de notre ignorance, qui est en général profonde dès qu’il ne s’agit plus d’événements politiques ou militaires considérables. Bien plus, l’anachronisme fût-il même dûment établi, il ne prouverait rien contre l’historicité de l’entretien au milieu duquel on l’aura décelé : n’est-ce pas un trait rapide de fantaisie, destiné à rompre le charme et à empêcher l’illusion de devenir trop complète ? bref, quelque chose comme ce que serait la signature d’un artiste moderne sur une copie qu’il a faite d’après l’ancien ?
Voici qui semble en revanche ruineux pour la conception dont il s’agit. Minutieusement analysés, les dialogues offrent des témoignages manifestes d’une composition par laquelle les données de fait sont transfigurées, au point de ne fournir à l’historien aucune garantie par rapport à tout ce dont elles sont, dans le dialogue, l’accompagnement. Considérons par exemple le Phédon : les circonstances de la mort de Socrate fournissent seulement un fond de tableau, qui peut d’ailleurs être fidèle, propre à recevoir, dans le décor et avec la lumière qui conviennent, une théorie de l’âme et de ses destinées ; théorie que nombre d’indices permettent d’attribuer à Platon et dont il serait en tout cas bien étrange que Socrate eût retardé l’examen jusqu’à son dernier jour. — Mais, dit-on, voyez avec quel soin, au début du Banquet, du Théétète, du Parménide, Platon indique l’origine de ses informations, les voies par lesquelles elles lui sont parvenues, les conditions dans lesquelles elles ont été recueillies. Par lui-même cependant un tel procédé éveille les soupçons : n’est-ce pas précisément celui que commande une fiction destinée à donner l’illusion de la vérité historique ? — En résumé donc, ce qu’on cherchera dans les dialogues, c’est Platon lui-même, Platon reflétant la pensée de Socrate sur le miroir, qui possède sa courbure propre, de sa pensée personnelle ; puis, prolongeant et élargissant celle-ci par une réflexion originale sur l’Éléatisme, l’étendant alors bien au-delà de ce qui primitivement avait pu lui sembler être simplement l’expression authentique du vrai Socratisme.
Ce n’est pas seulement par le rôle de Socrate que diffèrent entre eux les dialogues, c’est aussi par la forme littéraire, au double point de vue de la structure et du style. — Une première distinction est très apparente. Certains dialogues ont une structure dramatique ; comme dans une pièce de théâtre, les interlocuteurs y sont immédiatement devant nous sur la scène ; ce sont les plus nombreux. D’autres sont des dialogues racontés, ou bien par Socrate lui-même (Charmide, Lysis, République), ou bien par un personnage qui tantôt rapporte en témoin un entretien de Socrate auquel il a assisté (Phédon), tantôt raconte le récit qu’on lui en a fait, soit que la transmission ait lieu par un seul intermédiaire (Banquet), soit qu’elle en suppose plus d’un et se présente comme le récit du récit d’un récit (Parménide). Parmi les dialogues racontés on distinguera ceux où le récit est simplement précédé d’une introduction dialoguée (Protagoras, Banquet) et ceux où le dialogue initial vient de temps à autre couper le récit (Euthydème, Phédon). Un cas entièrement distinct est celui du Théétète ; une conversation y introduit, non pas un récit, mais un dialogue direct : Euclide de Mégare, le témoin que fait parler Platon, déclare en effet (143bc) que, s’il a donné la forme dramatique à ce qui normalement devrait être un récit, c’était pour éviter les « dit-il », les « répondis-je », pesantes conséquences de la forme narrative. Deux variétés doivent encore être envisagées : l’Apologie de Socrate est un discours, mais il s’y intercale pourtant une partie dialoguée (24b-27d), où Socrate feint de s’entretenir avec un de ses accusateurs ; dans Ménexène c’est le dialogue qui sert de prélude au discours, celui d’Aspasie rapporté par Socrate, et dans Timée et Critias, à l’exposé de caractère didactique, fait par chacun des deux personnages dont ces dialogues portent les noms. La structure des dialogues est donc très variée. Elle l’est encore en ce sens que certains contiennent de fort longs morceaux d’un seul tenant, ainsi par exemple (et sans parler, bien entendu, des Lois qui ressemblent plutôt à un traité qu’à un dialogue) la prosopopée des Lois dans le Criton (50 a sqq.), dans le Gorgias le discours de Calliclès (482e-486 d) et la réponse de Socrate (506c-509c, 528 a jusqu’à la fin), etc. Le Phèdre enfin renferme trois discours, dont l’un est censé être de Lysias (et il n’est pas impossible qu’il le soit en effet), les deux autres de Socrate.
Considérons maintenant le style des dialogues. Sans doute est-il superflu, et d’ailleurs étranger à notre propos, d’en détailler ici les mérites littéraires. La vie circule en eux ; chacun de leurs personnages, au moins le plus souvent, a son attitude et sa façon de parler, bref une individualité, qui est autre chose qu’une simple différence ou opposition d’opinions. La familiarité du tour s’y harmonise sans peine avec cette subtile rigueur du raisonnement, où des critiques trop pressés ont cru parfois découvrir les pires sophismes, et aussi avec l’élévation du ton. Certaines pages du Phédon sont à ce dernier point de vue tout à fait remarquables ; la fin particulièrement a une grandeur tragique, qui produit sans effort le plus intense effet d’émotion. Le début du Protagoras, celui du Charmide sont de petits tableaux, où la justesse pittoresque de l’observation s’allie à la plus fine ironie. Dans le Banquet, si riche de ces parodies dont le Protagoras offrait déjà d’excellents exemples, l’éloge de l’amour par Aristophane, l’entrée en scène d’Alcibiade, son réquisitoire contre Socrate qui tourne à l’apologie de celui-ci, ce sont d’incomparables morceaux de haute et savoureuse comédie. La bouffonnerie n’en est pas absente, pas plus qu’elle ne l’est de quelques pages de l’Euthydème. Faut-il parler aussi, et encore à propos du Banquet, du lyrisme qui se déploie dans certaines parties du discours de Diotime, ou du second discours de Socrate dans le Phèdre ? Ou bien enfin de l’éloquence ardente avec laquelle, dans Gorgias (par ex. 480a-d, 507c sqq., 512 d sqq.) et dans la République (par ex. le morceau de Glaucon au début du livre II), Platon flétrit l’injustice et exalte la vertu, bafouée et suppliciée ? avec laquelle, dans Théétète, il compare les deux modèles de vie qui s’offrent à la conscience de l’homme (172c-177c) ? avec laquelle encore est stigmatisée dans Phèdre (259e sqq.) la funeste culture formelle des écoles de rhétorique, et honoré au contraire un enseignement capable de déposer dans les esprits une semence éternellement féconde ? Sans doute, l’âge venant, les dons de l’artiste n’ont-ils pas été, avec la même aisance, mis au service de l’idée. Mais ce n’est pas sans compensation : alors en effet, dans la détermination et la discussion des problèmes, la puissance dialectique sait trouver la langue abstraite qui lui convient ; si parfois cette langue a quelque chose d’un peu raide et tendu, elle reste vigoureuse et ne mérite pas les sévérités que lui ont prodiguées certaines critiques.
Jusqu’à présent un problème, dont l’importance avait été indiquée un peu plus haut, a été négligé : c’est de savoir, non pas si notre collection est complète, nous y reviendrons, mais bien plutôt si tout ce qu’elle contient est véritablement de la main de Platon. Déjà les Anciens tenaient pour apocryphes plusieurs des dialogues qui en font partie : Éryxias, Axiochus, Démodocus, Sisyphe, Alcyon, Du Juste, De la vertu et le recueil des Définitions, qui passait pour être de Speusippe. Ils suspectaient 8Hipparque, Les rivaux (Anterastœ), le Second Alcibiade et, notamment Proclus (d’après Olympiodore dans ses Prolégomènes à la philosophie de Platon, chap. 25), l’Épinomis qui, comme son nom l’indique, se donne pour un complément aux Lois9, par lequel serait tenue la promesse, faite dans le dernier livre, d’un exposé plus développé touchant les degrés supérieurs de l’éducation.
À cette liste on ajoute généralement aujourd’hui Minos, Théagès et Clitophon10. Il fut même un temps, depuis 1820 environ jusque vers la fin du siècle, où la suspicion s’étendait plus loin encore : elle n’atteignait pas seulement l’Hippias I, que du reste on n’a pas renoncé à suspecter, mais aussi les Lois et enfin, ce qui a marqué l’apogée de l’« hypercritique », ces grands dialogues où se déploie avec le plus d’ampleur ce que nous jugeons être la pensée profonde de Platon : Parménide, le Sophiste, le Politique et Philèbe.
Il est impossible de signaler ici les raisons alléguées pour et contre ; il suffira de rappeler ceci : on récusait ces derniers dialogues simplement parce qu’ils n’offraient pas de la pensée de Platon l’image qu’on s’en était préétablie ; si aujourd’hui on n’en conteste plus l’authenticité, c’est surtout grâce à un inventaire minutieux des références aristotéliciennes.
Ce qui d’ailleurs caractériserait l’attitude actuelle de la critique, ce serait plutôt qu’elle donne maintenant sa confiance à des œuvres hier discréditées, comme l’Épinomis et les Lettres. En faveur du premier, on fait surtout valoir, et la faiblesse de la tradition qui lui attribue pour auteur l’éditeur supposé des Lois, Philippe d’ Oponte, et surtout la ressemblance qu’il y aurait, avec une raideur encore plus accentuée, entre la langue des Lois et celle de l’Épinomis.
Quant aux Lettres, il est aujourd’hui peu de critiques pour imiter les Anciens et les accepter toutes en bloc ; deux cependant, la VIIe et la VIIIe sont presque unanimement tenues pour authentiques. Les arguments allégués, dans ce dernier cas et dans tous les autres, se fondent, ou bien sur des comparaisons stylistiques, ou bien sur des vraisemblances internes, et tant par rapport à la doctrine que par rapport aux personnages ou aux faits historiques dont il est parlé dans la lettre considérée. Un livre tel que celui-ci ne peut comporter l’examen des raisons du premier ordre : si en effet ces lettres sont l’œuvre de faussaires (et l’on sait assez de quelle faveur a joui parmi eux le genre épistolaire !), ceux-ci n’ont pu manquer de s’appliquer à pasticher le style de l’auteur ; pour savoir si le succès de l’imitation a toujours été complet, il faudrait donc une analyse singulièrement minutieuse ; or, les divergences et les hésitations des meilleurs juges prouvent assez combien le problème est délicat. Quant aux vraisemblances internes, elles ont une valeur toute subjective : si l’on juge parfois qu’elles s’imposent, n’est-ce pas qu’elles viennent à point nommé soutenir telle ou telle conception préalable de la doctrine ou de l’histoire ? Mais on peut éprouver une impression très différente : se méfier, par exemple, ou de l’insistance avec laquelle est naïvement souligné ce qui peut passer pour un indice d’authenticité ; ou bien encore de la façon dont s’insèrent dans le texte certaines formules remarquables qui proviennent des dialogues ; ou enfin de cette affectation de mystère qui se manifeste çà et là en ce qui touche à la doctrine (cf. supra). Que les Lettres contiennent des indications intéressantes, c’est possible ; mais cela ne décide rien quant à leur authenticité.
Supposons maintenant que l’on ait réussi à ne garder que des écrits incontestablement authentiques ; un autre problème se pose alors, et qui n’est pas moins épineux, celui de savoir dans quel ordre il conviendra de les ranger. Les éditeurs de Platon dans l’Antiquité, peut-être à partir d’une grande édition que l’Académie aurait publiée vers la fin du IVe siècle av. J.-C., se contentaient d’un classement artificiel, dont le principe, d’ailleurs variable, reste dans le détail assez obscur : classification trilogique 11 d’Aristophane de Byzance (fin du IIIe s.), l’un des plus illustres bibliothécaires d’Alexandrie ; ou classification tétralogique, connue sous le nom de Thrasylle (grammairien et astrologue de la cour de Tibère), mais qui semble être notablement plus ancienne.