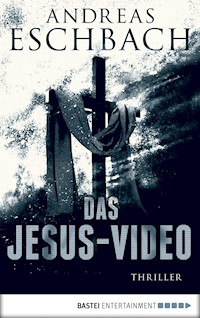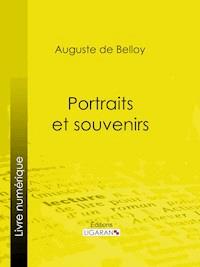
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Saturne dévorait ses enfants ; Paris se dévore lui-même, et il ne n'en porte que mieux ; à tel point qu'après une absence de peu d'années, on le retrouve méconnaissable, tant ce régime accroît sa fraîcheur et son embonpoint. Où et quand s'arrêtera-t-il ? Combien de ceintures encore est-il destiné à faire craquer ? Il y aurait à le prédire, aujourd'hui que les poètes eux-mêmes n'ont plus la prétention d'être devins."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J’avais sauté par la fenêtre pour aller faire un tour en Italie. Dix-neuf ans d’âge, un ami et quelques louis dans ma ceinture, tel est le triple fonds sur lequel je comptais pour ne manquer de rien en route.
Arrivé à Marseille, hélas ! je n’avais déjà plus mon ami, et mes dix-neuf ans touchaient à leur terme, et, quant à mon petit trésor, il était réduit de moitié. C’était le cas de prendre le plus long ; ce à quoi je ne manquai pas.
Cette façon de violenter la fortune m’a toujours plu et m’a souvent réussi.
Le plus long pour aller de Marseille à Nice, c’était évidemment l’extrême littoral ; je le suivis sans y penser, m’arrêtant à tout propos, revenant même quelquefois sur mes pas, m’étonnant, jouissant d’un rien, savourant ma jeunesse. On m’avait dit que toute cette côte ressemblait à la Grèce ; c’en était assez pour faire de moi un Anacharsis. Tout m’était raison ou prétexte pour invoquer les souvenirs de cette terre fortunée, où les émigrés de l’Ionie croyaient jadis retrouver leur patrie ; j’y cherchais partout leurs vestiges, et, à défaut de rien de tel, je suivais, sur la foi de l’étymologie, le triomphant itinéraire de ces Grecs de troisième main, de ces colons de Massilie, qui successivement fondèrent Karsiki, aujourd’hui Cassis ; – Kitharista, Ceyreste, – Olbia (l’heureuse), Eoube, – Arkè (la citadelle), appelée plus tard Hieron (le sanctuaire), puis en provençal Hiéro, d’où les barbares ont fait Hyères ; – Antipolis (la sentinelle), Antibes, – et enfin Nikaïa (ville de la victoire), qui n’est plus aujourd’hui que Nice, une auberge de poitrinaires.
Karsiki, ma première étape, m’avait retenu quatre jours : c’était pour moi un petit port de la Grèce homérique, quelque chose comme Phorcys en Ithaque, ou Leukè tout près de Phocée. La fille de mon hôte, une enfant de quinze ans à peine, s’appelait par bonheur Zoé ; ses cheveux étaient blonds et naturellement ondés ; un front bas et uni, un nez droit et partant du front sans flexion aucune, achevaient d’en faire une Grecque.
Un malin, j’eus la hardiesse de lui dire en passant : Kaïre, Zoé mou. Elle me répondit en provençal : Coumpreni pas, mousu. Mais évidemment elle avait compris, car elle était rouge comme une fraise. Chaque matin, c’était de même, et voilà tout. Ah ! ce fut un délicieux roman, quoique bien simple.
Tout me charmait dans cet aimable Karsiki, même son air un peu sauvage, comme son nom, du reste ; mais ce nom était grec. Je vois encore son petit port, où ne peuvent mouiller que des navires d’un très faible tonnage, tels que celui qui porta Télémaque à Pylos, et ses maisons blanches, si basses, qu’à peine émergent-elles des flots de son bassin, belle nappe d’un bleu-turquoise, au centre de laquelle bouillonne une source d’eau douce : le beau thème pour un Ovide !
À droite, une plage dorée, des champs stériles, rocailleux, zone étroite que dominent des cimes d’un violet tendre ; à gauche, des rochers rougeâtres qui vont s’élevant jusqu’au cap de l’Aigle et que couronnent des touffes d’arbousiers, et déjà les sapins d’une vaste forêt qui s’étend jusqu’à la Ciotat. De ce côté, pas une habitation, ni quoi que ce soit de main d’homme. Rien n’y a dû changer sans doute depuis un temps très reculé ; j’aimais à le penser, du moins, pour ne pas gâter mon rêve. Là, je nageais en pleine Hellade ; là, j’étais un Grec des temps fabuleux. Dépouillant tous mes vêtements, pour n’avoir plus rien de moderne, j’appelais, j’invoquais les divinités de la mer dans un bain de saphirs liquides semé d’étranges voies lactées, émaillé de blancheurs rosées, nimbes flottants des Néréides ; je plongeais jusqu’à perdre la vue, l’ouïe, le sentiment : spasme voluptueux, extase sensuelle, divine expansion de la partie dans le grand tout. Ce qu’alors je voyais d’une seconde vue, c’était assurément un rêve, et même alors, au fond, je n’osais guère y croire. Mais, en rouvrant les yeux avec regret sur la plage de sable où la mer m’avait rejeté, je pus m’imaginer une fois, sans trop de folie, qu’Agavé, Amphitoé, Climène, ou Thoosa, l’unique fille de Phorcys, m’avait sauvé de la fureur du vieux Nérée.
Il fallut partir cependant, il fallut quitter Karsiki, et sa blanche nymphe Zoé, et son vin généreux, – de la poésie en bouteilles.
Heureusement que j’allais à Ceyreste, à Ceyreste la cithariste !
Chemin faisant, ce nom qui m’attirait et réglait mon pas comme une musique, je le redisais lentement : Kitharista ! Kitharista ! Et, soit que sa vertu magique transformât pour moi la contrée, soit que cette zone de la Provence, encore voisine de la mer, ressemble autant qu’on le dit à la Grèce, je voyais, je sentais l’Attique.
J’envoyais des baisers et des sourires attendris à ces touffes de thym, de serpolet et de lavande, qui me rendaient les parfums vantés de l’Hymette et du Pentélique, et je parlais en grec à leurs peuples d’abeilles toujours blondes et bourdonnantes comme au temps qui les vit bourdonner et blondir autour du berceau de Platon. J’adorais, pénétré d’une voluptueuse horreur, les Forces, les Cabires, divinités cachées sous ces rocs d’un gris rose, pailletés de mica, tigrés de mousses jaunissantes, couronnés de ces câpriers dont les fleurs, quand le vent les berce, palpitent comme autant de papillons nacrés.
Entre les fentes des rochers se tordaient, à les prendre pour des couleuvres, les branches noueuses du grenadier sauvage, du lentisque au feuillage grêle ; et puis venaient le myrte frissonnant, le lierre et ses corymbes, le tithymale et ses ombelles, toute une flore métallique. Çà et là s’élançaient des buissons d’églantiers, dont les jets vigoureux se courbaient en arceaux sous l’étreinte du chèvrefeuille ou du smilax aux grappes rouges, aux vrilles animées qui cherchent où se prendre ; puis une futaie d’oliviers blonds comme les cheveux de la blonde Athénè, arbres élyséens qui semblent faits pour abriter des mânes.
Grâce aux dieux, ce n’étaient plus ces prés humides, chargés de miasmes grossiers, qui m’oppressaient naguère encore, ces gras pâturages normands où l’air est visible et tangible, nature obèse, et froide, et lourde, où toute sève est une lymphe, où les troupeaux mélancoliques semblent rêver à l’abattoir.
Ah ! chère gueuse parfumée ! chez toi tout est sec, et nerveux, et sain. Grâce aux dieux immortels dont Phocée te transmit le culte, il ne le reste rien des Gaulois, ces vaincus. Apollon Saurochthone, le radieux archer, a percé de ses flèches d’or tes sombres forêts et leurs sombres druides ; de ce jour, ivre de lumière, tu as adoré la nature et ses forces divinisées, mais tu ne l’as pas confondue avec son auteur. Au-dessus de tes dieux jeunes, humains, charmants, tu as toujours placé Jupiter, Zeus, Deus, le dieu d’Homère et de Socrate ; tu l’as voulu distinct de la nature ; tu t’es souvenue de Bacchus, ce fils de Jupiter, qui vainquit l’Inde panthéiste, et de Thémistocle, et de Miltiade, et d’Alexandre, ces boulevards de la raison humaine, ces prédécesseurs, ces figures des Godefroy, des Charles Martel, des saint Louis. Tu as été païenne, tu l’es peut-être encore un peu ! mais tu ne seras jamais panthéiste, tu as trop d’esprit pour cela.
Et, parlant ainsi, je marchais, et sous mon pied le sol natal rendait un son métallique, profond : c’était la voix de Ghè la grande mère ; frappé de cette idée, saisi d’une tendresse filiale pour cette terre que mes premiers pas ont foulée, je tombai à genoux et la baisai dévotement, lui demandant avec ardeur de me rouvrir un jour son sein et d’y conserver ma dépouille. Puisse-t-elle s’en souvenir !
Comme je relevais la tête, le cœur nageant dans cette divine fraîcheur qui suit tout acte sincèrement religieux, au détour d’un sentier, arrêté devant moi et fixant sur moi un œil curieusement sympathique, se tenait un jeune homme ; – mais était-ce bien un jeune homme ? Au moins est-il certain qu’il voulait se donner pour tel.
Vêtu d’une simple chlamyde grise, les bras nus, les cheveux flottants sous le pétase à bords échancrés des cavaliers du Parthénon, il me dominait au moins de la tête, bien que je sois de taille moyenne. Ces divers points indiquaient clairement un dieu ; mais d’autres parties de son costume et de sa personne, tels qu’un pantalon de nankin et des souliers jaunes, montraient que ce dieu, en tout cas, n’entendait se manifester qu’à demi.
– Mounte vas, pichoun ? me dit-il en montrant au moins trente-deux dents blanches.
Je souris finement, en païen qui sait vivre, mais qui ne veut pas toutefois passer pour un sot, et, respectant un incognito qui nous mettait tous deux à l’aise, je lui répondis en sa langue que je me rendais à Ceyreste.
– À Ceyreste ! fit-il d’un air étonné, comme il convenait à son rôle ; mais vous en avez quitté la vraie route depuis une demi-lieue environ. Au reste, je vais moi-même de ce côté par la traverse, que vous pourrez suivre avec moi.
Une telle condescendance me ravit, comme vous pensez ; je commençai à suivre mon guide céleste, qui ralentit bientôt le pas, et, tirant de sa poche un étui de Manille, m’offrit un havane dont le parfum valait au moins celui de l’ambroisie, du moly ou du népenthès.
Chemin faisant, je m’enhardis ; la conversation s’anima. Mon guide connaissait à fond les antiquités monumentales historiques et légendaires de la contrée. Une ou deux fois j’osai lui tenir tête ; nous discutâmes, je m’échauffai, et, oubliant enfin que j’avais affaire à un dieu, j’entrai, sur une religion qu’il devait connaître bien mieux que moi, dans des considérations à perte de vue qui parurent le divertir. Il le fit voir, je me fâchai.
– Vous faites tort à vos arguments, me dit-il, en les présentant d’une façon trop scolastique. La gravité sied toujours mal non seulement à un jeune homme, mais je dirai à un Français laïque. Un de nos plus grands avantages sur toutes les nations du monde, c’est que les autres, tels que les Allemands, par exemple, disent gravement des folies, tandis que nous disons gaiement des choses sages. Pardonnez-moi cet humble avis qu’autorise à demi mon âge ; car j’ai bien, j’imagine, quelques années de plus que vous.
Cette façon polie de me rappeler sa divinité me fit rougir et me charma. Nous arrivions en ce moment à une sorte de carrefour irrégulier que je crois voir encore. Mon guide me montra un sentier qui s’élevait en pente douce, et il m’engagea à le suivre.
– C’est le plus long, dit-il, mais il vous conduira à la source des Grâces, qui consacre la tradition dont je vous parlais tout à l’heure. Les Grâces avaient là, dit-on, un sacellum où il se faisait des miracles. Votre amour pour l’antiquité mériterait bien d’en obtenir un. En tout cas, le lieu est charmant comme le nom qu’il porte, n’est-ce pas ? la source des Grâces ! Si vous voyez ces dames, offrez-leur mes hommages et demandez-leur de vous inspirer.
Et, là-dessus, il me serra la main à l’écraser. Je ne pus retenir un léger cri, et je fermai les yeux, comme il est naturel en pareil cas ; quand je les rouvris, mon guide avait disparu, laissant après lui un parfum exquis de tabac et un nuage de fumée.
– Si c’est un demi-dieu, pensai-je, – il avait baissé de moitié dans mon esprit, – c’est au moins un des douze hercules.
Plaisanterie à part, je regardai partout autour de moi et ne vis plus aucune trace de mon guide ; la route montait cependant, et mon regard plongeait sur le sentier qu’il devait prendre ; mais, à dix-neuf ans, rien n’étonne.
Je marchais depuis un quart d’heure dans la direction indiquée, lorsqu’un léger bruit d’eau, doux et mystérieux, un chuchotement de naïade, me fit soudain battre le cœur. Je m’arrêtai un moment, respirant à peine, comme les amoureux, dit-on, au seuil d’une porte entrouverte. Déjà l’herbe plus drue était humide sous mes pieds ; les arbres grandissaient colorés de teintes plus sombres ; l’haleine de la source éventait doucement mes tempes, s’insinuait de fibre en fibre jusqu’à mon cerveau rafraîchi. Je marchais ou plutôt je glissais sans bruit comme une ombre, guidé, porté par mon désir. Enfin, au bas d’un tertre hérissé de genêts et d’oliviers sauvages, entre deux beaux platanes qui s’élevaient comme un portique, parmi les fraisiers rougissants, l’asphodèle, les anémones, je pus voir miroiter le bassin de la source.
Trois minces filets d’eau, sortant de canaux envahis par la mousse et les saxifrages, tombaient avec mille glouglous charmants dans la nappe sonore. Prosterné, recueilli, j’écoutais avec une indicible ivresse ce gazouillement cristallin. Peu à peu j’en saisis le rythme : les gouttes, en tombant, sonnaient des longues et des brèves agencées en dactyles, en trochées, en spondées, mélopée vague encore et toute musicale, mais dont bientôt les notes résonnèrent à mon oreille, accrues de sons articulés, de syllabes connues, puis de mots encore sans suite, et d’où enfin jaillit un vers dont tel est à peu près le sens :
Bizarrerie ! les Grâces, en rendant cet oracle un peu vague comme tous les oracles, avaient pris la voix de mon inconnu. Tout est mystère chez les Grâces : un de plus ne m’étonna pas d’abord de leur part. J’avoue cependant qu’en y réfléchissant depuis, il m’est arrivé de me dire que mon guide avait bien pu gagner la source par un chemin détourné, et là, caché dans quelque coin, abuser de ma crédulité mystique.
Quoi qu’il en soit, naturel ou surnaturel, le conseil m’a paru si bon et si conforme à mon qu’il m’a toujours servi de règle.
Saturne dévorait ses enfants ; Paris se dévore lui-même, et il ne s’en porte que mieux ; à tel point qu’après une absence de peu d’années, on le retrouve méconnaissable, tant ce régime accroît sa fraîcheur et son embonpoint. Où et quand s’arrêtera-t-il ? Combien de ceintures encore est-il destiné à faire craquer ? Il y aurait folie à le prédire, aujourd’hui que les poètes eux-mêmes n’ont plus la prétention d’être devins.
De tout ce qui faisait, il y a seulement quinze ans, le caractère et la physionomie de la capitale du monde, une partie a disparu ; le reste, pour se perpétuer, a dû s’embellir ou au moins s’accroître, ce que l’on voit surtout par les cafés, ces cafés célèbres dans le monde entier, et qu’un Anglais appelait encore, en 1849, l’institution la plus solide de la France. Mais les institutions elles-mêmes ne se conservent qu’à condition de s’altérer, de s’imprégner de l’air du temps, et c’est encore là une observation que me suggèrent nos cafés.
Leur nombre presque centuplé, l’énorme accroissement de leur clientèle, le luxe inouï mais uniforme de leur décoration, ces dorures, ces marbres, ces glaces à profusion, autant de progrès, si l’on veut ; mais, pour le curieux, pour le flâneur sentimental à la façon de Sterne, pour l’étranger à qui les salons ne sont pas ouverts, pour tant d’honnêtes gens à qui leur pauvreté les ferme, pour tous ces parias enfin, petits écrivains, petits employés à qui notre luxe interdit le mariage et la famille, et qui, le soir venu, n’ont ni feu ni gaieté, ni amour, ni jeunesse dans leur mansarde, tout cela vaut-il bien le caractère, la vie propre qui distinguaient naguère encore plusieurs des cafés de Paris ?
Je ne remonte pas jusqu’au café Procope, cette contre-académie libre, dont les arrêts avaient jadis plus de crédit que ceux de l’Académie officielle : celui-là est déchu depuis trop longtemps de sa suprématie philosophique et littéraire. Je laisse également de côté le café de la Comédie, et tels autres où la société la plus polie qui fut jamais venait, disait-elle, apprendre à penser, arsenaux de malice où, le café aidant, l’esprit français étonnait et charmait le monde par des décharges électriques prises partout pour une aurore : tout cela est trop loin de nous ; je parle de ce que j’ai vu, de ce qu’ont pu voir nos contemporains, et que ne verront pas nos neveux, – ils n’en mourront pas, après tout ; – je parle de ces centres de réunion, dont plusieurs existent encore, mais à quel point tristes, muets, déserts, méconnaissables !
Un surtout, jadis champ de bataille des classiques et des romantiques, était encore plein de vie il y a douze ans, mais d’une vie étrange, artificielle, et dont le terme pouvait être aisément prévu : il rassemblait encore chaque soir les promoteurs, docteurs ou simples adhérents d’une demi-douzaine environ de sectes philosophiques, dont chacune avait eu son jour, ou au moins son quart d’heure, de discussion et d’éclat.
L’école phalanstérienne et le saint simonisme comptaient là, en nombre à peu près égal, des représentants sincèrement enthousiastes. Plusieurs dieux mêmes s’y montraient dépouillés de rayons : laissant le monde aller comme il voulait pour quelques heures, ils jouaient honnêtement aux dominos, quand il leur eût été si aisé de tricher en usant de leur puissance surnaturelle. On pouvait les entendre, entre deux parties, causant de la pluie et du beau temps, comme s’ils n’eussent été pour rien dans ces importants phénomènes. Ce lieu avait pour eux un attrait tout particulier : ils y trouvaient au moins quelqu’un pour nier leur divinité, ne fût-ce que par complaisance. L’apôtre Jean Journet débitait parmi eux, au plus juste prix, ses petites brochures mystiques. Celui qui fut Ganneau, le mapa (maman et papa de l’humanité), exposait, en caressant sa longue barbe, les mystères de l’évadaïsme ; autour de lui fumaient et discutaient de spirituels mystagogues et d’ingénieux thaumaturges, des paysagistes ariens, des employés bouddhistes, des hussites sans profession, tous se croyant des novateurs, et la plupart très convaincus, mais tolérants, et vivant bien ensemble quoique parlant tous à la fois.
Aujourd’hui, ce vaillant café est toujours à la même place ; la bière y est aussi bonne que par le passé, le café aussi chaud et aussi parfumé. L’entresol où s’agitèrent tant de problèmes, où furent cessées tant de pipes, est toujours aussi sombre, aussi bas de plafond, aussi enfumé que dans ses beaux jours, dont il a respecté les traces ;…
Si la foi, au temps dont je parle, exubérante, extravasée, habitait le café du Théâtre-Français, le scepticisme, en revanche, dominait au divan de la rue Lepelletier. Le paradoxe et la fantaisie s’y étaient glissés à la suite, et ne s’épargnaient pas eux-mêmes. Tous les beaux esprits relevant de ces trois forces négatives, et plusieurs même des champions actuels de l’autorité religieuse et politique, ont paru, ne fût-ce qu’un jour, dans cette arène étroite, mais vivante, où ils ont plus ou moins brillé.
Mais on rencontrait là des gens obscurs, des inconnus, qui se permettaient de vous contredire ; un garçon même, nommé Baptiste, qui ne servait qu’à leur tour les gens arrivés.
Évidemment, ce drôle était un envieux.
De plus, on n’y faisait de crédit à personne ; esprit comptant ; c’était la règle.
Ajoutons enfin que l’égalité devant la plaisanterie est rarement du goût des hommes arrivés : cette juste distribution du sarcasme éloigna beaucoup d’auteurs et d’artistes sur qui venait de se briser la sainte ampoule du succès. Ils auraient dit volontiers comme Talleyrand ou Cambacérès, je ne sais : « Ne le gêne pas, mon ami ; lorsque nous sommes entre nous, appelle-moi tout bonnement monseigneur. »
On reconnaît encore aujourd’hui ces illustres à la façon particulière dont ils prononcent le mot divan.
Et pourtant, ce divan, il n’est plus qu’un café comme un autre : une lueur de gaieté y brillait encore en 1818 : la discussion l’éteignit.
L’esprit a horreur de la politique, et la politique le lui rend bien.
La plupart des cafés célèbres sont ainsi tombés en désuétude, ou ont perdu leur ancienne physionomie ; quelques-uns même ont complètement disparu ou vont disparaître. Seul, peut-être, le café de la Régence a conservé sa spécialité et sa clientèle. – La baguette d’or d’une fée l’a transporté à quelques toises de son emplacement primitif, sans qu’aucune pièce de ses innombrables échiquiers en ait tremblé sur sa base légère, sans qu’un seul des joueurs ait cru avoir bougé de place ; mais où est Alfred de Musset ?
Partout ailleurs, dans les cafés aussi bien anciens que nouveau, règne un pêle-mêle navrant, un luxe brutal, uniforme, un va-et-vient de fourmilière, une annihilation de l’individu, si complète, qu’on a besoin de se pincer de temps en temps, non pas seulement pour se faire rire, mais pour bien s’assurer qu’on existe, qu’on ne fait pas partie intégrante de son voisin.
Adieu donc, paniers, vendanges sont faites ! Adieu le bon vieux temps ! adieu la bonne mine d’hôte, l’accueil souriant et respectueux des garçons ! adieu ces entrées solennelles qu’on venait voir par curiosité ! celle entre autres du commandeur Odoard de la Fère, un digne pilier du café Valois !
À midi précis, le canon du Palais-Royal l’annonçait ; il apparaissait sur le seuil et s’y arrêtait un moment, promenant dans la salle un regard doux et assuré, et comme rentrant avec volupté dans la possession de ses habitudes ; la droite fermement appuyée sur sa canne – un jonc à pomme de porcelaine blanche et bleue, – il rejetait d’un revers de la gauche son vieux manteau brun passé de couleur, au collet de vison pelé. Mais ne souriez pas ; jamais manteau semé d’abeilles ou de fleurs de lis d’or ne fut écarté avec un tel geste. On avait vu Talma l’étudier furtivement ; mais, le pauvre homme, il n’était pas né commandeur !
Le manteau écarté, – c’était comme un signal, – Pierre, un garçon, d’un ton respectueux et d’une voix de basse-taille, prononçait gravement les paroles suivantes :
– Le commandeur Odoard de la Fère : le chocolat à la crème ordinaire.
Et un autre garçon renvoyait aux cuisines la formule sacramentelle :
– Le commandeur Odoard de la Fère : le chocolat à la crème ordinaire.
Le commandeur s’avançait alors vers le fond de la salle sans encore saluer personne, mais en adressant à chacun de nous un regard qui semblait nous dire :
– Messieurs, les dames avant tout.
Arrivé en face et tout près du comptoir, il en saluait la divinité, et aussitôt la bonne et jolie petite Henriette détachait d’un bouquet placé à côté d’elle une fleur que le commandeur arborait galamment à sa boutonnière ; puis, après quelques mots – toujours les mêmes – échangés avec la petite, il se plaçait à une table, ou, pour mieux dire, à sa table à lui, à la table du commandeur ; et là, après nous avoir tous réjouis d’un signe de tête amical, il commençait à savourer le chocolat à la crème ordinaire, c’est-à-dire une tasse de chocolat dans laquelle on lui versait la partie de crème montée à la surface d’une casserole de lait bouillant.
Et qu’on ne se figure pas que ces petites attentions délicates fussent le privilège du seul commandeur Odoard : chacun de ses contemporains était gâté de même ou d’une façon analogue.
Ainsi le marquis de Rivarol (frère aîné de l’écrivain), qui aimait le moka pur, sans mélange de martinique, avait sa cafetière à part.