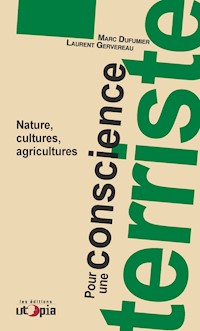
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Utopia
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Französisch
L‘agriculture et l’alimentation sont au centre de nombreuses préoccupations actuelles : santé, écologie, climat, social, éthique... Pourtant on hésite parfois à prononcer certains mots comme élevage, vegan, pesticide, chasse, pratiques culinaires… et même « écologie ».
Nous préparons-nous à des sociétés de guerre civile entre productivistes et apôtres de la préservation ?
Voici un livre rédigé par deux auteurs à la compétence indiscutable qui donne des repères sur l’agroécologie et l’histoire de l’écologie. Un livre qui examine également les fonctions culturelles de l’alimentation et qui dessine les pistes d’organisations locales-globales, dans l’intérêt collectif et la valorisation de la diversité.
Il est plus que temps de travailler à s’adapter aux défis de l’époque et de changer d’échelle en prenant en mains notre univers local.
Mais pas n’importe comment, pas avec les œillères dangereuses du local - localisme: en ayant au contraire une conscience « terriste » de notre aventure environnementale commune. Nous sommes ainsi dans une période de basculement nécessaire des pensées. Sur tous les sujets.
À PROPOS DES AUTEURS
Marc Dufumier est agronome, professeur honoraire à AgroParisTech, et président de la Fondation René Dumont. Il est membre du comité scientifique de la Fondation pur le Nature et l’Homme.
Laurent Gervereau est vice-président de la Fondation René Dumont et président de Nuage Vert – musée mobile Vallée de la Dordogne. Il a fondé en 2005 à AgroParisTech le Musée du Vivant (premier musée international sur l’écologie) et co-préside le CIRE (Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Ecologie).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Collection Ruptures
Les Éditions Utopia
61, boulevard Mortier – 75020 Paris
www.editions-utopia.org
www.mouvementutopia.org
Diffusion : CED
Distribution : Daudin
© Les Éditions Utopia, janvier 2022
Sélection d’écrits des mêmes auteurs
Dufumier M., Agricultures et paysanneries des tiers mondes, Karthala, Paris, 2004.
Dufumier M., Famine au Sud, malbouffe au Nord, Éditions Nil, Paris, 2012
Dufumier M., 50 idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation, Éditions Allary, Paris, 2014.
Dufumier M., L’agroécologie peut nous sauver, Éditions Actes Sud, Arles, 2019.
Dufumier M., De la terre à l’assiette. 50 questions essentielles sur l’agriculture et l’alimentation, Éditions Allary, Paris, 2020.
Laurent Gervereau, Ici et partout. Trois essais d’écologie culturelle, Paris, Plurofuturo, 2010.
Laurent Gervereau, Vagabondages à Wallis, Futuna & Alofi. Parcours d’écologie culturelle, museeduvivant.fr / decryptimages.net (Musée du Vivant, Ligue de l’Enseignement et Institut des Images).
Laurent Gervereau, Une histoire générale de l’écologie en images, Paris, Plurofuturo, 2011.
TOUT VERT ! Le grand tournant de l’écologie (1969-1975) (codirigé avec Cécile Blatrix), Paris, Musée du Vivant-AgroParisTech, 2016.
Cécile Blatrix, Laurent Gervereau (dir.), Biodiversité et Culturo-diversité. Ne plus séparer nature et culture, Paris, Musée du Vivant-AgroParisTech, 2019. Avec la participation de Marc Dufumier.
SOMMAIRE
Introduction
Choc des égoïsmes ou complémentarité des points de vue ? La diversité, ça s’apprend
Apprendre la diversité dans une écologie culturelle : entre identités fermées et identités imbriquées
Sortir de la confusion généralisée et des sectarismes par une philosophie de la relativité aidant à sauter les frontières : nature-culture, villes-campagnes, local-global, tri rétro-futuro, connexion-déconnexion…
Agriculture et écologie
Agriculture et nature
Écologistes et écologues
L’agroécologie
L’agriculture d’abattis-brûlis
Les agricultures manuelles avec labour à bras
L’association agriculture-élevage avec traction animale
La riziculture inondée
L’agriculture motomécanisée
Les agricultures de front pionnier
Les enjeux actuels
Chasse, pêche et biodiversité
Les sociétés de chasseurs - pêcheurs - collecteurs
Les grands mammifères menacés d’extinction par le braconnage et la déforestation.
Le retour des loups et des sangliers en France
La biodiversité marine en danger
La planète en surchauffe
Agriculture et alimentation
Les enjeux
Mettre fin aux inégalités extrêmes de revenus à l’échelle mondiale
Cesser d’exporter vers les pays du Sud des produits de bas de gamme vendus à vil prix
Manger sain et équilibré
Succès et limites de la révolution verte dans les pays du Sud
Le défi d’une agriculture à la fois plus productive et durable dans les pays du Sud
Le défi d’une agriculture plus artisanale et respectueuse de l’environnement dans les pays du Nord
Promouvoir partout des formes d’agricultures paysannes
Agriculture et biodiversité
Qu’est-ce que la biodiversité ?
La biodiversité au sein des écosystèmes
Les services écosystémiques
Les ratés d’une agronomie bien trop normative
Changer de paradigme
Élevage et véganisme
La naissance de l’élevage
La viande, le lait, les œufs et le poisson : des aliments très désirés
Les reproches faits à l’élevage
Le bien-être animal
L’antispécisme
Naturel et culturel
La diversité des complexes culturaux et des régimes alimentaires
Le pain et le vin
Les « civilisations du riz »
Le maïs pour les cochons
Les tubercules et les racines pour les pauvres
La viande et les fromages pour les riches
Thé, café, ou chocolat ?
Vers une homogénéisation des régimes alimentaires ?
Paysans et paysages
Le défi éducatif : un enjeu de dialogue planétaire
La boussole éducative
Comprendre et enseigner l’Histoire et nos réalités stratifiées : un changement d’échelle nécessaire
Retour au local pour penser global : se vouloir terriste
Un pacte commun évolutif
Besoin d’opposition binaire ? Définir un « Aterrisme » ?
Être Terriste, c’est quoi ?
Annexes
Pour une éducation environnementale
Ça commence où, quand, comment ? De l’animisme au monothéisme
Des Bishnoïs ou de Gilgamesh au Roman de Renart, l’échange populaire immémorial avec la flore et la faune
« Découvrir », renommer et inventorier la planète
La défense de la « nature » contre l’industrialisation naissante, de Rousseau à Humboldt
Le jardin : « prison », conservatoire, reflet du monde, création savante et populaire ?
L’évolution par Darwin et Haeckel invente le mot « écologie » en 1866
L’importance des femmes / Les débuts de la cause animale
Thoreau, Emerson, Muir et le Sierra Club, Reclus
Art nouveau pour le peuple, les communautés libertaires, le naturisme
Le sport et les spectacles de masses / gauche et droite contre le taylorisme dans les années 1930 et 1940
Pionniers et pionnières environnementalistes au temps du boom économique
Les hippies et le grand tournant de 1970
Sustainable Development, décroissance, climat et grands rassemblements internationaux
Références bibliographiques
Notes
Les Éditions Utopia
Introduction
Choc des égoïsmes ou complémentarité des points de vue ? La diversité, ça s’apprend
Ce livre en lui-même est un dialogue, dialogue entre un agronome, héritier de René Dumont à AgroParisTech, Marc Dufumier, et celui qui (Laurent Gervereau) dans la même grande école, venu du monde des musées et présidant l’Institut des Images, travaillant à la fois sur l’histoire générale du visuel et l’écologie culturelle, a créé en 2005 le Musée du Vivant (premier musée international sur l’écologie). Les approches sont complémentaires et c’est là l’intérêt de l’ouvrage. Comment en effet prétendre saisir globalement des questions qui concernent le fonctionnement de toute une planète hier, aujourd’hui et demain (excusez du peu…), si c’est pour les traiter par petits morceaux ? En même temps, les vues très généralistes et fumeuses fondées surtout sur l’air du temps s’avèrent peu ancrées et peu pertinentes.
Cela correspond donc à une nécessité intellectuelle et pratique. Il faut en effet désormais s’efforcer de devenir des spécialistes-généralistes. Boris Vian (ingénieur de l’École Centrale) disait : « Le monde est aux mains d’une théorie de crapules qui veulent faire de nous des travailleurs et des travailleurs spécialisés encore ; refusons. Sachez tout… Soyez un spécialiste en tout. L’avenir est à Pic de la Mirandole. ». Effectivement, les nécessités de compréhension de notre être-au-monde nécessitent à la fois de devenir très savants et très spécialisés sur tel ou tel domaine, d’avoir une expertise fine évolutive, et aussi d’être capables d’une vision large. Le minuscule s’enrichit de l’appréhension du global, tandis que le global a besoin d’exemples concrets.
Pour les aspects pratiques, le retour au local, à la vision directe, est indispensable. Nous ne devons pas vivre uniquement comme individus connectés qui sont en fait déconnectés de ce qui est leur être-au-monde à force de voir à distance pour ne plus regarder leur brosse à dents. Le cœur de ce livre vous explique comment appréhender ainsi des questions vitales du quotidien. Mais circuits courts, économie circulaire, décrochages autarciques ne sauraient faire oublier que lorsqu’un cyclone passe ou que le climat se réchauffe, les frontières n’ont aucun sens.
Le local-localisme est ainsi dangereux pour les « autres » (source de xénophobie) et dangereux pour soi, car décrocher totalement n’évite nullement par exemple les pollutions de l’air, des terres et des eaux, ni d’ailleurs ces marottes humaines que sont les guerres incessantes dans une volonté de puissance sans issue. Il est temps alors – nous le développerons dans la partie finale – de développer une conscience terriste (suivant le mot répandu pour désigner la planète, inventé par quelques humains). Quel est l’intérêt de ce terme ? De fait, nous sommes Terriennes et Terriens, mais l’Histoire nous montre que ce n’est pas lié à un souci particulier de notre planète commune, au contraire. Être terriste, c’est vraiment vouloir vivre de façon locale-globale, dans la volonté de défendre notre planète commune unique.
Il s’agit alors de repenser nos organisations comme nos comportements individuels, de penser à un Pacte commun planétaire évolutif, de franchir ce cap qui est celui du passage d’une pensée trop exclusivement humaniste à une pensée terriste, c’est-à-dire celle d’une vraie conscience d’un environnement global en interactions.
Ce livre est ainsi une forme de petit guide. Il se situe par-delà les clivages et les réflexes sectaires ou sectorisés. Il essaie de fournir des éléments d’appréciation, tandis que deux périls opposés nous guettent : l’uniformisation et l’éclatement. L’univers des humains est en effet partagé entre un mouvement d’uniformisation forcée, avec des consommations addictives destructrices de l’environnement et de la diversité culturelle dans un grand hôpital planétaire de la norme sanitaire et sécuritaire, et, à l’inverse, un fractionnement très problématique et dangereux, un émiettement en autant de communautés concurrentes, soit autarciques et fermées, soit à visées expansionnistes pour imposer un seul mode de vie et un seul mode de pensée. Les tendances récentes ne font que confirmer ces périls : mise en place de sociétés du contrôle et de la norme (en temps de pandémie ou pas), avec une carotte absurde qui est le leurre nocif de l’immortalité, et affrontements de groupes dans des visions différentialistes qui instrumentalisent l’Histoire. Tout cela est évidemment très dangereux.
Apprendre la diversité dans une écologie culturelle : entre identités fermées et identités imbriquées
Cheminons ensemble dans la pensée. Réalisons un « Chemin de pensées ». Charles Darwin, après son retour de voyage sur le HMS Beagle, s’installe à Downe House. Il organise dans le parc un sentier de sable qui forme une boucle, partant de la maison, traversant une zone arborée et revenant vers la maison près d’une haie. Il l’intitule « Chemin de pensée » et le parcourt chaque jour. Parcourons-le ensemble, car chacune ou chacun est de fait le philosophe de sa vie, réalisant des choix, même et surtout quand ils pensent ne pas en faire.
Parlons « mots ». Le mot « nature » a une présence attestée à partir de 1119 en français, issu du latin « natura », le caractère naturel, l’univers. Ce terme, évoquant l’environnement biophysique des humains, va s’opposer dans la civilisation chrétienne à la « culture » (du latin « cultura ») qui caractérise justement ce qui est commun aux humains et ce qui fait lien. Il pourrait y avoir donc, suivant cette conception, une frontière totale entre le non-humain (la nature) et l’entre-humain (la culture). C’est d’ailleurs ainsi que cette nature mystérieuse et dangereuse, cette nature à dompter, fut présentée. Et pourtant le latin « cultura » veut aussi bien dire cultiver la terre que cultiver les esprits… Et pourtant, de nombreuses civilisations, notamment les animistes aux pratiques très anciennes, ne connaissent pas de séparation nature-culture et n’ont pas de mot pour « nature ». Comme chez les Inuits1, leur univers est un tout avec flore, faune, humains, minéraux, cosmos, dans un environnement global en interactions.
La nature dans ce contexte est cependant soit utilitarisée, réduite à un produit à transformer et à rationaliser par les humains, soit montrée comme un paradis idéal et intemporel, comme si elle n’était jamais le résultat des évolutions, des interactions, et comme si elle n’était pas non plus sujette aux accidents qui sont aussi probables que leur absence. Une « nature » très peu naturelle. Une nature destinée à servir l’idéologie du « progrès » et la volonté prométhéenne des humains, domestiquant cette nature et se servant de la flore, de la faune, de l’eau, de l’air et de la terre. Pas très naturelle non plus cette « nature » pour ses zélateurs absolus, intégristes d’une nature qu’ils conçoivent parquée, sans évolution et si possible sans humains.
Vous verrez à la fin de ce livre quelques repères sur l’histoire longue de l’écologie, vue sous l’angle des manières dont les humains ont conçu leur rapport à la « nature », bref, de l’histoire environnementale avec quelques repères bibliographiques permettant d’aller plus loin et d’explorer. Atteindrons-nous avec cela ce qu’Arne Naess appelle une « écosophie »2, lui apôtre de l’« écologie profonde » ou radicale définie dans un article de 1973 : une écosophie où l’humain n’est qu’un élément dans la défense de la biosphère ?
Et nos consciences ? Et nos identités ? Il existe un éclatement des modes de pensée. Positivement, par certains côtés, car nous vivons une forme de « créolisation » (formule chère à Édouard Glissant) de la pensée, en tout cas des hybridations, où quelqu’un peut aimer les sushi et le foot, se sentir très marocain et avoir une culture juive, pratiquer les jeux vidéo et faire du foot, lire des textes taoïstes et se renseigner sur les soufis… Ce sont des identités imbriquées. Facteur de diversité et de choix (s’il est conscient). Facteur dangereux quand il correspond à une perte de repères et une porosité à toutes les dernières modes, pour finir souvent par se fixer dans les règles les plus dures d’intégrismes exclusifs : identités fermées.
L’alternative à la consommation addictive ou aux sociétés fermées (religieuses ou non), aux vérités arrêtées, ne pourrait-elle pas être la conscience bioculturelle, l’idée du commun et de la défense nécessaire du commun, une forme d’écologie culturelle3 ? Finalement, dans les villes ou les campagnes, qu’est-ce qui importe plus que l’environnement, les conditions de vie ? Et veut-on vivre de façon semblable à Limoges ou Ouagadougou, à New York ou Salvador de Bahia, à Canton ou Futuna ?
La relativité est le contraire du relativisme : elle est une invitation aux choix éclairés, quand le relativisme est une soumission à un n’importe quoi qui n’est justement pas n’importe quoi. Pourtant, la « nature » n’est ni bonne, ni mauvaise, les humains non plus. Le choix éclairé est essentiel (d’où l’importance de l’éducation et des expérimentations à tout âge). Il consiste dans des choix rétro-futuros : individuellement et collectivement, considérer les traditions à conserver et là où l’on veut innover. Dans le mouvement, Élisée Reclus considérait déjà les ambivalences : « Le fait général est que toute modification, si importante qu’elle soit, s’accomplit par adjonction au progrès de regrets correspondants4. » Ce bilan évolutif est essentiel. Il est la base de la diversité planétaire, d’une diversité choisie et pas subie. Il permet de sortir de cette notion dangereuse du « progrès » (d’ailleurs sans signification chez de nombreux peuples) pour affirmer la notion de « mouvement » et d’expérimentation.
De même, respecter la diversité n’est pas seulement constater les différences et permettre à chacune et à chacun de les vivre dans la complémentarité sociale, c’est adopter une attitude volontariste et évolutive. Faire des identités imbriquées des identités choisies.
Sortir de la confusion généralisée et des sectarismes par une philosophie de la relativité aidant à sauter les frontières : nature-culture, villes-campagnes, local-global, tri rétro-futuro, connexion-déconnexion…
Le Hopi Don C. Talayesva racontait en 19595 : « L’oiseau-moqueur imite le chant de tous les autres oiseaux […] Dans une danse, un des danseurs a imité l’oiseau-moqueur ; d’abord, il imitait tous les oiseaux, puis il parlait comme un Navaho, un Havasupai et un Hopi ; il imitait aussi le bétail, les chevaux, les moutons et les ânes ».
Lie-tseu, théoricien du taoïsme chinois, dans Le Vrai Classique du vide parfait, écrit : « La majorité des hommes s’en tient à l’identité de la forme et néglige l’identité de la connaissance. Or, ce qui m’est semblable par la forme, je m’en sens proche et je l’aime. Ce qui m’est différent par la forme, je m’en sens étranger et je le crains. ».
La philosophie de la relativité nous aide à franchir les frontières. Ce sont d’ailleurs souvent des frontières mentales avant que d’être physiques. Nous avons parlé de nature-culture. Mais il en est d’autres.
Riche-pauvre en est une autre qui a polarisé le xxe siècle et est plus que jamais d’actualité. Nul doute – nous l’avons déjà évoqué – que l’accumulation exponentielle de l’argent par 1 % de la population mondiale est non seulement une injustice mais une aberration économique. Une fois cette évidence dite, que faire ? Généralement, ce sont des considérations macro-économiques qui sont avancées. Il faudrait peut-être faire l’inverse et reprendre les choses à la base, sur le terrain, dans l’organisation des entreprises, la qualité des services publics, avec des critères sortant du pécuniaire sur la qualité de vie, la mobilité, la possibilité de réalisation individuelle et collective. L’environnement reprend alors sa part, ainsi que le tissu culturel au sens large (sport et gastronomie sont aussi des éléments culturels…).
Richesse et pauvreté ne se résument en effet pas à la quantité d’argent. Les situationnistes parlaient à juste titre de « misère » pour la médiocrité des conditions de vie. Une philosophie de la relativité réévalue ces classements obsolètes pour de nouvelles exigences. Déjà les étudiant-e-s ingénieur-e-s essaient de postuler en identifiant les entreprises à valeur ajoutée écologique et ayant une éthique interne. Mais l’enjeu est considérable partout : à quand la pression des consommactrices et consommacteurs ? Les plus modestes en matière d’argent sont dans des situations très différentes suivant leurs modes de vie : la pauvreté est un esclavage pour certains ; elle est une autre manière de vivre ailleurs.
Ville-campagne est une autre opposition qui perd son sens. L’industrialisation et la mécanisation ont provoqué des hyper-concentrations urbaines. Désormais, la connexion permet d’agir à distance et change la situation des campagnes. Elle est utile. C’est une nouvelle route. Mais comme toutes les routes, elle apporte ses périls : manipulations commerciales et politiques, surveillance généralisée, hygiénisme dans une idéologie de la durée et du contrôle. De leur côté, les villes se posent les questions de la végétalisation (pas uniquement pour des raisons climatiques) et de l’agriculture urbaine. C’est ainsi une conception des villes qui change, vues non plus comme des « blocs » en expansion constante mais comme une agrégation de villages6.
Alors, nous continuons à attendre de pouvoirs intermédiaires (les États), quand nos questions quotidiennes devraient relever d’une démocratie du quotidien locale. Certains souhaitent une démocratie directe, ce qui a sa justification dans le cas de choix ponctuels par référendums locaux. Il n’empêche que la démocratie élective a le mérite de la délégation de pouvoir pour des citoyennes et citoyens qui ne pourraient sans cesse statuer sur tout en connaissance de cause. Il est un aspect aussi peu abordé : la politique, au sens noble du souci de la cité, nécessite un équilibre entre l’amélioration de l’existant en restant très concret et proche des préoccupations des habitantes et habitants et une pensée (présente-future) de l’évolution et des projets pour la cité (minuscule ou immense). Cela nécessite un fonctionnement stratifié du plus petit au plus grand où chaque décision se prend au bon niveau de compétence dans un fédéralisme planétaire : local, régional, national, continental, planétaire. Pour l’instant, les choses sont peu réparties et peu structurées.
Cette vision locale-globale induit parallèlement de sortir de pensées économiques planétaires qui sont également aberrantes : une croissance exponentielle avec consommation addictive, obsolescence programmée et destruction des ressources naturelles ; une vision caricaturée d’une décroissance qui serait la perte de la machine à laver et une nourriture de subsistance (ce n’est pas ce que disent en fait les décroissants). Dès 2008, au moment de la crise financière, a été avancée l’idée de « croissances différenciées » qui sont des évolutions différenciées.
Ce n’est pas utopique, ce qui est utopique est la façon dont des dysfonctionnements délétères et mortifères perdurent, ce qui est utopique, et surtout absurde, c’est le masochisme de l’humanité causé par des égoïsmes idiots à court terme. Dès avant la vision chrétienne du Bien et du Mal, les penseurs ont voulu humaniser la nature en donnant du sens aux événements, soit en louant les bienfaits de la nature, soit en se désespérant des imperfections d’une nature qu’il faut corriger7. Dans L’Odyssée, le mythique Homère décrit cette nature idyllique : « Au rebord de la voûte, une vigne en sa force éployait ses rameaux, toute fleurie de grappes, et près l’une de l’autre, en ligne, quatre sources versaient leur onde claire, puis leurs eaux divergeaient à travers des prairies molles, où verdoyaient persil et violettes. Dès l’abord en ces lieux, il n’est pas d’Immortel qui n’aurait eu les yeux charmés, l’âme ravie. » L’harmonie naturelle est surnaturelle. Mais la « nature » fait peur aussi (tempêtes, tremblements de terre…). Lucrèce constate ainsi dans De Natura Rerum (De la Nature) : « la nature n’a nullement été créée pour nous par une volonté divine : tant elle se présente entachée de défauts ! ». Fascination et défiance se combinent. En fait, la « nature » n’est ni bonne ni mauvaise (sentiments très humains), elle est. Les animistes, dans leur symbiose, l’ont pressenti.
Alors, explorons nos pratiques.
Agriculture et écologie
Pollution de l’air, des eaux et des sols, dioxine dans les poulets, Fipronil dans les œufs, pesticides cancérigènes sur nos fruits et légumes, « vache folle » dans nos steaks, effondrement des abeilles et autres insectes pollinisateurs, perte de biodiversité, paysages défigurés, algues vertes sur le littoral, odeurs nauséabondes dans les sites touristiques, etc. : les sujets de querelles ne manquent vraiment pas entre agriculteurs et écologistes. La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ne cesse de dénoncer les campagnes de dénigrement (« l’agribashing ») dont seraient aujourd’hui victimes les producteurs. Bien qu’un sondage Odoxa-Dentsu Consulting1 réalisé en février 2020, à la veille de l’ouverture du salon de l’agriculture, pour France Info et Le Figaro, révèle que 9 Français sur 10 ont en fait plutôt une bonne opinion des agriculteurs, même s’ils se disent aussi de plus en plus préoccupés par la qualité de leurs aliments.
La stigmatisation des agriculteurs ne paraît donc pas un fait majoritaire. Mais une chose est sûre : l’écologie est devenue un souci de plus en plus présent dans les débats sur le devenir de notre agriculture et de notre alimentation. La question se pose de savoir comment nous en sommes arrivés à la situation actuelle et à quelles conditions il serait désormais possible de réconcilier les uns et les autres : comment favoriser et promouvoir la mise en place de nouveaux systèmes de culture et d’élevage qui soient à la fois capables de fournir les produits agricoles et alimentaires dont ont vraiment besoin nos sociétés et de protéger au mieux notre environnement, pour le bien-être du plus grand nombre ?
Agriculture et nature
Il y a environ 10 000 ans, à l’époque du néolithique (l’âge de la pierre polie), toutes les sociétés humaines vivaient encore de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Ces modes de prédation qui prédominaient dans l’ensemble des régions habitées de notre planète étaient déjà très variés, en relation avec la diversité des conditions écologiques locales et, dans une moindre mesure, de la nature des équipements disponibles pour ce faire. De façon à satisfaire leurs besoins alimentaires et vestimentaires, les populations s’évertuaient tant bien que mal à extraire des ressources végétales et animales sauvages au sein d’écosystèmes que l’on pouvait alors considérer comme exclusivement naturels. Au total, le nombre des humains n’était sans doute guère supérieur à 5 millions.
La population mondiale dépasse aujourd’hui les 7,8 milliards d’habitants et la seule prédation ne parviendrait sans doute pas de nos jours à nourrir plus d’un demi-milliard de personnes. Cet accroissement démographique est dû pour l’essentiel au développement de l’agriculture dans la plupart des pays du monde. Le passage de la prédation à l’agriculture intervenue au néolithique a donc permis tant bien que mal de nourrir et satisfaire les besoins d’une population croissante. Les sociétés ne vivant aujourd’hui que de chasse, pêche ou cueillette, au sein d’écosystèmes exclusivement naturels, ne subsistent aujourd’hui que dans de rares régions très peu densément peuplées : en Papouasie-Nouvelle Guinée, au sein de la forêt amazonienne, en Afrique centrale et australe, etc.
Et si l’agriculture ne parvient toujours pas de nos jours à nourrir et vêtir correctement l’humanité tout entière, cela n’a en fait rien à voir avec un manque de produits agricoles disponibles pour l’alimentation et les tenues vestimentaires. Nous verrons que la production agricole mondiale est déjà à même de satisfaire les besoins de première nécessité d’environ 11 milliards d’habitants ; mais une grande partie de celle-ci échappe aux populations les plus pauvres de la planète et est de fait accaparée par les plus riches pour être gaspillées, nourrir des animaux domestiques, fabriquer des agrocarburants et servir de matières premières pour des industries productrices de biens de moindre utilité (confiseries, jouets, décorations, etc.).
L’agriculture se présente toujours comme un ensemble de pratiques au moyen desquelles des travailleurs aménagent et mettent en valeur les écosystèmes situés dans leurs environnements plus ou moins immédiats, afin d’y produire des aliments et autres biens ou services utiles à leurs sociétés. Cet aménagement d’écosystèmes spécifiquement agricoles (les agroécosystèmes) est un processus délibéré de réduction de la biodiversité au sein des aires concernées afin d’y favoriser la reproduction, le développement et la croissance d’un nombre limité d’espèces végétales et animales préalablement domestiquées. Ce processus de simplification d’écosystèmes qui ne sont donc plus désormais totalement naturels peut de ce fait aboutir à leur fragilisation, avec la prolifération en leur sein de multiples ravageurs et agents pathogènes, au risque d’y voir disparaître de très nombreuses autres espèces microbiennes, végétales et animales.
Écologistes et écologues
Agronome de terrain obsédé par les famines dans ce qu’on appelait autrefois le Tiers-monde, le professeur René Dumont2 fut sans doute l’un des premiers écologistes en France à nous alerter sur les répercussions dramatiques que pouvaient avoir les modes de production et de consommation prédominants au sein des pays industriels sur le devenir de notre planète et le bien-être de ses habitants. Conjointement avec deux autres agronomes célèbres, Lester Brown3 et René Dubos4, il ne cessa, à la suite de la conférence des nations unies sur l’environnement qui s’était tenue à Stockholm en 1972, de nous mettre en garde contre les dangers que court l’humanité, du fait des changements climatiques et des risques croissants de ne plus pouvoir assurer la reproduction des capacités productives de la terre.
L’écologie ne devrait pas être exclusivement considérée comme une préoccupation politique, celle des écologistes, mais nécessiterait d’être aussi envisagée comme une discipline scientifique : celle des écologues, dont la tâche est de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité des divers écosystèmes présents dans la biosphère. L’écologie scientifique se doit de mettre en évidence la logique du vivant au moyen d’analyses systémiques, en étudiant l’ensemble des relations existant entre les êtres vivants (la biocénose) et leurs environnements physiques et chimiques (le biotope).
Elle met bien sûr à profit les résultats de disciplines plus pointues (la génétique, la taxonomie, la climatologie, l’hydrologie, la thermodynamique, la géologie, la pédologie, la biochimie, la biologie, etc.), mais focalise davantage son attention sur les réseaux fonctionnels des interrelations entre les différents éléments constitutifs des écosystèmes que sur la nature et la composition exactes de chacun de ces composants. Et cela à différentes échelles : la cellule, le micro-organisme (virus, bactérie, champignon…), la plante, l’animal, le peuplement végétal (forêt, savane, prairie…), les troupeaux, les terroirs, les territoires, la biosphère, etc.
L’écosystème ne doit pas être appréhendé comme la seule addition de ces constituants internes, mais comme un système au sein duquel existe une multitude d’interactions entre ces derniers. L’écologie accorde notamment une très grande importance à l’analyse des divers flux d’énergie ou de matières entre leurs différents composants et plus encore aux éventuelles relations de concurrence, synergie, symbiose, prédation, parasitisme, ou « effet cocktail », entre ces derniers. Elle révèle ainsi fréquemment une multitude d’interdépendances. Chacun sait par exemple que la croissance et le développement des végétaux sont directement conditionnés par le climat ambiant ; et que ces végétaux peuvent à leur tour contribuer à créer localement des microclimats.
En l’absence de grosses perturbations naturelles ou d’origine humaine, les écosystèmes sont censés pouvoir atteindre un stade de relatif équilibre. Mais l’idée que la nature puisse être immuable est trompeuse. Ne serait-ce que du fait des oscillations dont les climats régionaux font l’objet entre grandes périodes glaciaires et interglaciaires, les écosystèmes ne peuvent qu’évoluer sur le très long terme. Mais le réchauffement climatique global actuel, dont on connaît désormais les causes anthropiques, est bien plus rapide. Il contribue à perturber les évolutions qui étaient en cours, avec un risque de voir une érosion considérable de la biodiversité et de créer des situations d’irréversibilité au sein de très nombreux écosystèmes locaux (voir chapitre suivant).
Les écologues ne renoncent pas pour autant à la notion d’équilibre, mais se réfèrent dorénavant à un équilibre dynamique, à l’image du cycliste qui doit impérativement continuer d’avancer pour ne pas chuter. L’idée est de faire en sorte que la biodiversité puisse être préservée, mais néanmoins pas gelée, en s’adaptant à ce réchauffement inéluctable, sans dommage majeur, de façon à éviter l’effondrement.
L’agroécologie
L’agroécologie scientifique peut être alors considérée comme la branche de l’écologie plus spécifiquement appliquée à l’étude des écosystèmes agricoles (les agroécosystèmes). Elle fut pour une première fois présentée comme telle, en France, en 1986, dans un ouvrage rédigé par Miguel Altieri, professeur à l’Université de Berkeley (USA), et préfacé par René Dumont5. Ce dernier écrivait d’ailleurs qu’en la matière, nous étions « encore très ignorants ».
Les agroécologues considèrent en premier lieu que le travail des agriculteurs ne se limite pas seulement au travail du sol et à la conduite d’une culture ou d’un troupeau, mais consiste plutôt à chaque fois en l’artificialisation et en la mise en valeur d’écosystèmes (qui ne sont donc plus vraiment naturels), de façon à en extraire périodiquement diverses matières utiles et d’éventuels services environnementaux. Cela veut dire qu’il convient de prendre en considération les multiples interactions entre les divers processus physiques et biochimiques en cours au sein même de ces écosystèmes aménagés par les agriculteurs. Et de reconnaître ainsi que chacune des techniques agricoles pratiquées à un moment donné peut avoir un impact sur l’évolution de l’ensemble de l’agroécosystème concerné. L’application d’un fongicide destiné à protéger une plante cultivée contre un champignon pathogène peut éventuellement avoir des effets néfastes sur les champignons utiles des sols et donc contribuer à réduire leur fertilité.
L’agroécologie a donc précisément pour objectif de mettre en évidence la complexité des interrelations existant au sein des agroécosystèmes. En commençant bien sûr par celles qui se sont établies progressivement entre le climat, la roche mère, les sols, et les divers êtres vivants : virus, bactéries, champignons, plantes (cultivées et adventices), animaux (domestiques et sauvages), etc.
Cette discipline met notamment en lumière le rôle essentiel de l’énergie solaire sur la croissance et le développement des plantes cultivées. C’est en effet l’élément moteur de la photosynthèse, processus de conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique, avec biosynthèse d’hydrates de carbone (glucides) fabriqués à partir de l’eau de pluie infiltrée dans les sols et du gaz carbonique de l’atmosphère. L’énergie que nous trouvons dans notre alimentation et que nous dépensons ensuite quotidiennement dans nos déplacements, au travail ou lors de nos loisirs, nous vient ainsi du soleil : une ressource naturelle et renouvelable dont nous pourrions faire un usage plus intensif, car il n’en est pas annoncé de pénurie avant des milliards d’années !
L’énergie solaire joue aussi un rôle plus indirect du fait de la plus ou moindre forte chaleur qui en résulte sur terre, dans les diverses régions du monde et au cours des différentes saisons. Ce phénomène est renforcé par ce que l’on appelle l’effet de serre, dont les principaux agents sont la vapeur et les gouttelettes d’eau. S’il ne gèle pas au cours des nuits froides de l’hiver lorsque le temps est nuageux, c’est bien grâce à celles-ci, puisque ce sont elles qui réémettent vers la terre des rayons infrarouges que la terre leur avait elle-même auparavant renvoyés par réfléchissement des rayons solaires. Mais cet effet est gravement amplifié de nos jours du fait de gaz à effet de serre d’origine anthropique tels que le gaz carbonique, le méthane et le protoxyde d’azote.





























