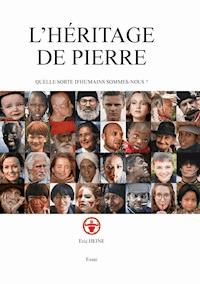Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Cette histoire se déroule dans un petit village. Lequel ? Peu importe. En Occitanie. Dans le Lauragais. Parce que j'y habite. Romantique facilité d'auteur. Dans ce petit village, tout le monde se connait, tous les gosses ont joué ensemble. Tous se sont mesurés, jugés, aidés et combattus. Tous se détestent et s'aiment. Comme dans tous les petits villages. Le centre de ce petit village est un bistrot. Un bistrot où des personnages cabossés par la vie se retrouvent et où chacun tient la béquille de l'autre. Parce que ce n'est facile pour personne. Parce que "quand la vie veut pas", c'est plus facile ensemble. Cette histoire raconte celles de gens coincés dans les rouages du destin, leurs souffrances et leur cheminement pour s'y enfoncer ou s'en extraire, avec leurs espoirs et leur philosophie, leur compréhension et leur responsabilité face à ce destin, face à la solitude, face à l'autre, face à la vie, face à la mort. Comme tout le monde. Et les vrais moteurs de cette histoire sont des femmes. Comme toujours.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
L’Héritage de pierre
Essai - Autoédition Bod 2017
Quelques histoires de Toïdi
Contes philosophiques - Autoédition Bod 2017
Partagez vos impressions sur ma page Facebook Eric Heine
Pour me contacter :
© 2021 - Eric HEINE
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Aux Géraldine.
Aux Dieuses.
Sommaire
Juin 2018.
Le centre du monde
Mars 1965
Juillet 1970.
Mars 2010.
Juin 2013.
Juillet 1977.
Novembre 1970.
Novembre 2012.
Février 2014.
Septembre 1978.
Décembre 1976.
Juin 2013.
Mai 2014.
Novembre 1978.
Juillet 1979.
Mars 2014.
Mai 2014.
Mai 2014.
Avril 1997.
Mai 2014.
Mai 2014.
Octobre 2014.
Juin 1997.
Juillet 2015.
Juillet 2015.
Juillet 2015.
Juin 1998.
Juin 2016.
Juin 2016.
Février 2017.
Septembre 2017.
Septembre 2017.
Mars 2018.
Juin 2018.
Juin 2018.
Juin 2018.
Une douce, rassurante, intemporelle tranquillité parfumée couvrait le versant de la colline qui dévalait vers la large vallée. Sur ce promontoire caillouteux, aride, calcaire, quelques églantiers et des romarins tout aussi sauvages réinvestissaient le lieu depuis que les paysans en avaient arraché les vieilles vignes à piquette. L’endroit était vibrant de toutes ces petites choses invisibles foisonnantes de vie. Pollens et fragrances de saison, bourdonnements et froissements des petites occupations animales, chatoiement des pierres et des herbes se partageaient lumières et ombres de l’instant.
Il avait garé la Triumph sur la corniche. Un peu plus bas, dix pas sous le sommet, étendu sur l’herbe sèche et craquante de ce chaud mois de juin, Tristan contemplait les troupeaux de petits moutons blancs et dodus qui traversaient le ciel. Au gré des caresses régulières du vent d’ouest joueur, les nuages se modelaient dans une surréaliste battle. L’un imitait un cheval galopant, d’autres des fauves rugissants ou des masques grotesques ; toutes sortes de paréidolies aléatoires dont le jeune homme se refusait de figer l’image, préférant les contempler à se fondre lentement l’une dans l’autre. La magie des transformations avait plus d’intérêt que les caricatures éphémères.
Caché près de lui, un grillon en mal d’amour entama sa lancinante rythmique. Le garçon se laissa bercer par les stridulations du petit animal. Tout était léger. La nature avait un gîte là. Le jeune homme se sentait bien, « stabil » comme disait son prof de boxe.
Pour partager cet instant, il dégagea sa main de sous sa tête et vint enlacer la hanche de Lisa assise tout contre lui, le menton posé sur les genoux et, elle aussi, la tête dans les nuages.
Lisa était plus que la meuf de Tristan. Elle était maintenant son amoureuse, sa partenaire de jeux de vie, son égérie. Elle était la main qui pouvait saisir la sienne pour qu’ils soient plus forts, pour qu’ils aillent plus loin. Elle était l’amour tout neuf. Elle était le sourire. Elle était l’aube. Elle était la violette qui annonce le printemps et en même temps la fin de la longue nuit hivernale dont le garçon s’extrayait depuis peu. C’est fou comme une bouffée de bonheur peut éclipser des années d’affliction.
Elle émit un léger ronronnement de plaisir surpris et continua sa contemplation.
– C’est cool, les petits nuages. C’est moins lassant qu’un ciel constamment bleu auquel on finit par ne plus prêter attention. Heureusement qu’on peut encore compter un peu sur les papillons et les oiseaux pour colorer tout ça.
En plus de son charmant petit accent, elle avait une voix douillette, optimiste, rassurante et enjouée en même temps.
Elle devinait les hauts sommets des Pyrénées, là-bas, loin, au sud, au bout de l’horizon. Elle y promena quelques instants ses songeries avant de ramener son regard en contre-bas, sur la plaine, sur la marqueterie de maïs et de tournesols tous bien alignés en rangs militaires, sur des champs déjà mis en sommeil, quelques terres en jachère, et de rares pâturages où des petites taches noires et blanches ruminaient paisiblement à l’ombre d’une haie. Le tout était parsemé presque régulièrement de bosquets en patchwork de verts, de vieilles fermes massives couplées de hangars métalliques couverts de panneaux solaires. Quelques hameaux vieillissants semblaient inoccupés. Hautes dans le ciel, deux buses aux ailes immobiles tournoyaient en larges et lents cercles.
– D’ici, on dirait qu’il n’y a plus personne. Où sont passés tous les gens ?
Elle suivit un moment la longue et double rangée de platanes qui cachait la route serpentesque menant à la ville, s’arrêta un instant sur les bâtiments silencieux de la Malart & Co, et s’apitoya sur la cinquantaine de peupliers gisant encore près de la Donzelle, comme fauchés par un rasoir géant.
– J’aime bien les peupliers, surtout le chant cliquetant des feuilles argentées, dit-elle sans interrompre son cheminement visuel qui se portait maintenant sur les toits de tuiles aux cent teintes de rouge et de rose.
Le clocher marquait le centre du village. Lisa devinait le parvis entouré de ses arcades ombragées. Pour parfaire le décor, les hirondelles menaient leurs courses exubérantes. Le couple pouvait entendre leurs cris stridents.
– C’est beau le monde, hein ? constata-t-elle.
– C’est toi qui es belle, parce que c’est ton regard qui fait la beauté. La beauté que tu vois autour de toi n’est que le reflet de la beauté qui est en toi, philosopha Tristan.
– Ils doivent être sacrément malheureux ceux qui ne voient que la laideur.
– Sûrement. Mais je crois qu’il est toujours possible de découvrir les quelques étincelles de beauté cachées en chacun de nous.
– Et on va souffler sur les braises, l’artiste ?…
N’obtenant pas de réponse, Lisa se pencha, posa un baiser sur les lèvres de Tristan et proposa :
– … Allez, on se move ? Ils nous attendent chez Lulu.
Le centre du monde
Longtemps interdit aux femmes vertueuses plutôt tenues de fréquenter les églises, un vrai bistrot est au-jourd’hui un espace public, un chapiteau où quiconque peut passer le temps à sa guise, parfois plus que de raison. Montres et horloges y sont peu invitées. Le temps s’arrête là.
Il est de plus en plus rare que le rideau de ce théâtre soit une immémoriale façade en bois peint rouge sang de boeuf et aux vitres habillées de macramés brodés, mais quelle que soit sa nature, il s’ouvre toujours sur une scène où évoluent des acteurs naturellement masqués, des premiers rôles aux simples figurants, venant y jouer les beautés et les laideurs, les comédies et les tragédies de notre monde.
Avec un peu d’attention et d’écoute, parmi les cabotins, les bouffons et les histrions qui s’y présentent, il est aisé de reconnaître le philanthrope et le béotien, le Pierrot et la Colombine, le Pan et l’Andromaque. Quelques égocentriques s’auto-élisent dans ce système de démocratie populaire anarchiste aux ministères aussi volatiles que les vapeurs d’alcool qui flottent entre bouches et oreilles. Des idéalistes illustrent ces marins au long cours qui viennent faire le plein de bons sentiments au risque de confondre le calme d’une plage et l’hypocrisie des sables mouvants. Des bien-pensants pointent les hurluberlus de leurs sarcasmes, leur conformisme toujours à la merci d’un Pâris prêt, en retour, à flécher leur talon d’Achille. On y entend des misérables se saouler de contes à boire debout et des bourgeoises agrémenter leurs papotages de beaux et gros mots crus ou cuits.
Ici, chacun-chacune est libre de tout exprimer à condition de respecter un minimum de règles. Pour qui s’abonne à ce club d’initiés aux aléas de la vie, c’est l’endroit de tous les possibles, de toutes les rencontres, de tous les réconforts, de tous les discours enflammés, de toutes les discussions sans fin. C’est la résurgence de tous les passés, l’affirmation de tous les présents, l’innovation de tous les futurs. Et vice versa.
Une fois un bistrot choisi, ou échu, il est judicieux d’y prendre sa place. Il est alors indispensable de connaître et de comprendre la géographie du lieu autant que les rites des habitants séculiers.
Ainsi la salle est tout un univers pour le public aventurier comme pour l’anthropologue curieux de représentants indigènes. S’y rencontre et se retrouvent des êtres de toute nature pour lesquels l’endroit peut devenir l’habitation principale, le foyer réchauffant ou la source rafraîchissante, parfois le vestibule de sombres abîmes.
Dans cette salle se répartissent quelques tables, de boire, de manger, de jeux, et surtout de verbes où gagner et perdre ne sont que prétextes au partage.
Pour des raisons évidemment pratiques, la plus convoitée de ces tables est à égale distance du comptoir et des toilettes. Plus cette position stratégique est proche, plus l’habitué atteint les sommets de la reconnaissance générale. Une invitation à prendre place à cet autel est un adoubement reconnu par tous les prétendants. C’est en général un carrefour d’où les parrains apprécient tout le spectacle : la porte d’entrée, la salle, le comptoir, le côté cour et le côté jardin. Les tables du fond sont réservées aux affaires privées et les alentours de la porte, aux clients pressés. Les beloteurs préfèrent être près des fenêtres.
Pour ceux qui s’adonnent aux délices tabagiques, la terrasse autorise la pipe et la cigarette. Elle offre également un horizon aux claustrophobes. La bonne place est alors le dos au mur, face à une plus vaste représentation, surtout les jours de marché où se pressent les proies excitées et les inévitables petits et gros prédateurs, tous à l’affût de la bonne affaire.
Quant au comptoir, s’il est l’abreuvoir de quelques espèces migratrices, il est surtout l’estrade où, le dos tourné aux verres bien alignés qui scintillent en attendant leur tour, un coude appuyé au zinc et un pied sur la barre en cuivre, la poitrine gonflée à demi tournée vers l’indispensable public obligé mais ravi d’assister au spectacle, le tribun de l’heure, envoûté par quelque Bacchus en mal de refaire le monde par l’intermédiaire de ce porte-parole momentané, dirige un doigt accusateur vers ses propres fantômes descendant du ciel ou remontant des enfers, prenant l’univers entier à témoin de ses infortunes ou poussant d’aucuns à quelque révolution radicale par des harangues mirifiques.
« Chez Lulu » est un de ces petits bistrots de village. Un lieu résistant, hors du temps. Un microcosme où celui ou celle qui ouvre la porte et franchit le seuil fait tinter la clochette comme les trois coups d’un nouvel acte. L’arrivant est alors identifié, reconnu, et, si le rôle et l’acteur sont plaisants, adopté. Car, bien sûr, tout le monde est accepté dans ce bistrot, mais adopté n’est pas si facile, et mal en prendra à celui qui aura l’intention d’imposer une trop triste prestation ou de troubler outre mesure les habitudes établies.
Y consommer de l’eau, du thé ou de la tisane, inspire la méfiance et peut même être considéré comme une offense ; il y a peu d’honneur à jouter contre l’apathique. La bière, naturellement à la pression, est le billet pour les longues tirades en solitaire ou avec barreur. Le vin détient les arguments du discours ; rouge et c’est le terroir que l’on honore, blanc et c’est le système qui dérouille. L’anisette échauffe la convivialité qui s’épanouira sans doute pendant le repas qui doit suivre. Le digestif aide au monologue, poussant le rêveur à s’enfoncer voluptueusement dans les bras de son Morphée préféré. Dis-moi ce que tu bois, je te dirai ce que tu es.
Attention. Chez Lulu, pour participer ou jouir du spectacle, l’obole est inévitable, et, régulièrement, le coup de torchon sur la table vient signaler qu’il est temps de régler le loyer ou que l’un ou l’autre doit « remettre la sienne », jusqu’à la fin d’un cycle mystérieux où c’est « la maison » qui offrira sa tournée sous les silencieux applaudissements consensuels.
Mars 1965
En ce tout début de printemps, les rayons de soleil matinaux perçaient à peine les gros nuages qui couraient au-dessus du village depuis une dizaine de jours. Ils causaient une température bien basse pour la saison mais ils n’étaient pas assez gris et lourds pour étouffer le brouhaha du jeudi matin qui accompagnait les activités du marché hebdomadaire où venaient se côtoyer les divers clans de la petite société.
Les fichus et les foulards, accompagnés de quelques marmots et armés de leurs paniers en rotin ou cabas en osier, zigzaguaient entre les cageots à la recherche de la plus belle endive et du plus beau poireau tout en échangeant allègrement nouvelles et rumeurs. Des informations qui auraient paru tout à fait inconsistantes, voire inutiles, dans une conversation masculine. Tout à leur marché, les femmes confirmaient un ragot, dévoilaient un potin, se passaient le témoin d’une calomnie, d’une jalousie, d’un tracas, cherchant toujours à préciser et compléter leurs indispensables investigations.
– C’est sûr, la fille de la Gabode fricote avec le garçon de Mariette. Pas le brun, non, l’autre, le grand…
– Le petit Jojo a les oreillons…
– … et Étienne la varicelle…
– … et presque tous des poux.
– Tu sais pour le gros Valentin ? On a vu…
– On dit que…
Les pipelettes butinaient tout leur soûl avant de se séparer, le panier plein de légumes et de fruits, pour en rejoindre d’autres autour des fromages ou devant la camionnette du poissonnier. Tout à leur excitation de tisser leurs fils d’Ariane, elles prenaient aussi plaisir à se libérer de leurs hommes, tous attablés à boire et bavasser autour de l’esplanade envahie et grouillante.
La bande de jeunes, qui n’avaient pas encore les cheveux longs, s’excitait au passage d’une première mini-jupe. Les bigotes criaient au scandale et en appelaient à la morale qui foutait le camp. Les vieux râlaient de n’en avoir pas eu autant à contempler quand c’était leur tour. Les riches, qui n’exposaient pas leurs ors, buvaient à la table des pauvres qui n’étalaient pas leurs misères. Les bons trinquaient avec les mauvais. Le curé riait avec le garde champêtre. Tout le monde se reconnaissait en ce qu’il était, chacun à sa place, et tout semblait ronronner sans que ni dieu ni maître s’en mêle.
Sous les arcades de la place de la Halle, les verres tintaient et quelques rires fusaient. Le ciel incertain n’empêchait pas bérets et casquettes de s’éterniser aux terrasses du « Balto », du « Bar des Amis » ou de « Chez Raymond », pendant que le vieux Théophile et son piano à bretelles enjôlaient les oreilles de ses valses musettes.
Dans cette petite commune où les deux tiers des habitants étaient paysans, nombre de conversations tournaient autour des dernières municipales. Comme prévu, Louis Malart, d’« Union pour le renouveau », avait été réélu maire avec soixante-huit pour cent des voix, devançant largement une liste d’« Union de la gauche » menée par un trop jeune estranger débarqué de la ville l’année précédente. Face au poids de ses cent quatrevingts hectares, tous en fermage, personne n’avait eu à coeur ou aurait osé ôter cet honneur à celui que tous respectaient. Riche de ses terres et de son entreprise de bois, Louis Malart était plus qu’un enfant du village, il en était le père nourricier. En d’autres temps il en fut le châtelain.
Né pendant la Première Guerre mondiale, il avait bien failli perdre la vie pendant la Seconde. Il n’y avait laissé que deux doigts de la main droite, l’index et le majeur, emportés par un tir de mitrailleuse. Pour salut militaire, le soldat ne pouvait plus que planter son pouce dans sa tempe et dresser son petit doigt vers le ciel. Il proposait ainsi un effet des plus comiques. Beaucoup devaient réprimer leurs moqueries pendant les célébrations militaires.
Expatrié par les Anglais lors du miracle de Dunkerque, il avait rejoint le général de Gaulle à Londres. Puis il fut arachuté en 44 au-dessus de sa région natale afin de prendre la direction de la résistance locale. Ses succès furent récompensés à la Libération par la médaille militaire et celle de la Résistance française.
Sitôt le nettoyage des festivités guerrières terminées et un système plus républicain réinstauré, c’est en uniforme et paré de ses décorations qu’il s’unit à la jeune Maryse Delacour et à sa modeste mais convenable fortune constituée d’un manoir agrémenté d’une vieille tour moyenâgeuse, des terres et bois alentour, et d’un petit blason baronnial. Un nouveau statut qui apporta largement au bidasse de quoi dilater un orgueil déjà mis en chauffe par la reconnaissance de ses exploits guerriers.
Louis Malart était ce que toutes considéraient comme un « bel homme ». Identifiable à son borsali-no, il arborait fièrement sa belle écharpe tricolore, la moustache chevron fraîchement taillée au-dessus d’un sourire rayonnant. De sa main mutilée volontairement dégantée, il serrait l’une après l’autre celles de ses administrés croisés tout au long de son parcours triomphant. Le maire était aujourd’hui accompagné par celle que chacun appréciait comme « madame la baronne ».
Maryse Delacour était belle. C’était une bonne chrétienne – depuis six générations, l’église abritait les prie-Dieu gravés du patronyme des Delacour –, toujours élégamment vêtue, délicatement maquillée, poliment souriante. Elle se soumettait avec grâce et raffinement à ses devoirs d’épouse honnête et exemplaire. Une rumeur félicitait la patriote pour une supposée participation aux services de renseignement. Les enfants, habitués aux vieilles blouses et aux tabliers sales de leurs mères, admiraient les habits et surtout les chapeaux de Madame. La plupart des autres femelles la jalousaient et essayaient de retenir les excès émotivo-libidineux de leurs mâles qui révéraient cette dame d’exception. Elle n’avait pas le marché à se taper, la baronne. Ni la lessive. Ni la traite des vaches. Ce soir, elle n’allait pas se faire monter dessus par un homme qui banderait pour une autre.
Aucun de ces hommes n’avait jamais pu vérifier, mais tous assuraient que la baronne avait « tout ce qu’il faut là où il faut ». Les mêmes « tous » pensaient que pour qu’une telle femme accepte de prendre votre bras, il fallait pour le moins être un héros, ou un saint. Ce que les « tous » ignoraient, et là où la Maryse aurait perdu beaucoup de points sur l’échelle de la Femme dans l’opinion masculine générale, c’est que la donzelle, ravissante, éduquée, propre sur elle et tout et tout, n’avait aucun goût pour la bagatelle.
Un regard averti l’aurait soupçonné. Le masque trop bien entretenu de la « poliment souriante » cachait une orgueilleuse, une suffisante, une vaniteuse petite châtelaine au coeur froid. De la pointe de ses escarpins à celle de sa mise en plis, elle était tout entière « Madame la Baronne ». Elle était un blason, elle était une histoire, elle était la France. Et la « Mère Patrie » n’était pas une « couche-toi-là ». Maryse avait la monarchie dans le sang, la République dans le faciès, une justice aveugle dans la tête, un missel dans la main, pas grand-chose dans le coeur, et encore moins entre les cuisses. Nul feu n’y brûlait, nulle braise n’y sommeillait, nulle étincelle n’attendait d’y allumer son désir. Les plus pessimistes l’auraient certifiée frigide. Les plus moqueurs l’auraient dite mal baisée.
Malgré son manque d’appétence, après une première fille, prénommée Louise et baptisée – heureusement, merci mon Dieu – juste avant son décès tout aussi prématuré que sa naissance, Maryse Malart offrit à son époux un garçon, Jean, puis, deux ans plus tard, un second, Christian, tous deux éduqués de main ferme mais juste, parce que destinés à reprendre un jour les rênes du patrimoine familial et de l’entreprise du papa.
– Pour un bon château fort, il faut de solides fondations, ne manquait-il pas de rappeler à sa progéniture.
Le notable couple atteignit enfin la terrasse de « Chez Raymond ». Ils passèrent de table en table avant de terminer leur tour d’honneur en s’asseyant près de Marcel en grande et forte conversation avec quelques-uns de ceux qui animeraient le futur conseil municipal. Maryse se trouva la seule femme assise au milieu de bonshommes plus ou moins rasés, plus ou moins peignés, plus ou moins propres. Un lys au milieu des chardons.
Marcel Roussel, toujours couvert de son béret, toujours un bout de cigarette papier maïs au bec, n’était pas un pilier de bar. Pas le temps. Pas envie.
– Les bars c’est pour les fainéants et les voyous ! se plaisait-il à répéter chaque fois qu’il passait prendre ici l’apéro, c’est-à-dire chaque jeudi en amenant sa femme et sa fille au marché avec sa 403 à plateau.
Ses trois grands garçons restaient aux travaux de la ferme. À chacun sa charge. À eux les vaches, à lui la politique.
– Et ne va pas dépenser tous les sous en bêtises ! précisait-il régulièrement à sa Marie-Jeanne qui laissait la petite Lucienne aux soins de son père avant de partir prestement profiter d’une trop courte matinée de relâchement à vaquer aux commissions et papotages.
Ce jour-là, son mari se devait particulièrement de venir au village saluer le triomphe de Louis, son bailleur, qui lui accordait un loyer peu coûteux pour travailler à sa guise une vingtaine d’hectares de son domaine.
Grande gueule, surtout après ses trois ou quatre verres de vin rouge désinhibiteur, Marcel ne manqua pas, une fois encore, de mettre en avant leurs heures de gloire communes en tant que Francs-tireurs pendant cette dernière guerre mondiale dont, à leur grand regret, les souvenirs s’effaçaient déjà, doucement mais sûrement, de l’esprit des nouvelles générations. On n’en voyait plus beaucoup des jeunes pour les commémorations autour du monument aux morts. Qui donc allait se souvenir ? C’est qu’ils en avaient décanillé du boche lui et Louis.
– Diou biban ! Heureusement qu’on était là pour défendre notre beau pays ! brailla-t-il à la cantonade en relevant le menton. Quand les FFI sont arrivées ici, on avait déjà fait tout l’boulot, moi et les copains. Même que le lieutenant m’a fait avoir cette médaille…, rappela-t-il en pointant son doigt vers son couvre-chef poussiéreux où se balançait la breloque.
– … Que vous aviez bien méritée, caporal. Il est vrai que la bataille fut rude et que vous y fîtes preuve d’une grande bravoure. Ça pétaradait de partout et vous n’avez pas reculé. Après la bataille, il nous a fallu reconstruire la vieille mairie dont ils avaient fait leurs quartiers et qu’ils firent exploser en représailles, les bougres, ajouta le maire. Eh oui, malgré tout, ça a été bien utile, la guerre. Ça a offert du travail de reconstruction, et maintenant nous sommes tous fiers de notre nouvel hôtel de ville.
Pendant que Louis vantait l’utilité des massacres et des dévastations, les yeux de Maryse cherchaient l’approbation sur les visages du groupe. Assis à la table commune, Robert Bichet s’immisça dans l’apologie :
– Cette nouvelle mairie en est-elle plus solide ? Abrite-t-elle plus de valeurs morales et d’empathie ?
Il profita de la silencieuse réponse générale pour avaler une gorgée de son Casanis. Puis, se tournant vers Maryse :
– Qu’en pensez-vous, chère Madame ?
Personne d’autre que lui n’aurait jugé bon de demander à cette femme son avis sur ce genre de sujet. À part les dévergondées habituelles, elles n’étaient pas nombreuses à oser s’asseoir avec les hommes, au bistrot, à discuter politique d’égale à égal. La baronne le pouvait.
Robert était le professeur d’histoire du village. Il savait qu’avec le nouveau suffrage universel, les femmes auraient la possibilité de s’exprimer pour les prochaines élections présidentielles et il s’interrogeait. Dans son isoloir, Maryse, comme les autres, se rangerait-elle encore derrière l’avis de son mari ?
– J’en pense que les femmes ont, avec courage et abnégation, assisté les hommes dans ces années difficiles. Je pense qu’elles ont combattu autant qu’eux, et je pense qu’il manque quelques centaines de monuments pour leur en rendre les honneurs. Comme Paris, elles ont été outragées, brisées, martyrisées ! Les mères y ont perdu leurs enfants, les femmes leurs maris, les soeurs leurs frères…
– … Les fiancées leur avenir, les violées leur dignité, les torturées leur joie de vivre, récita Robert.
– Sans doute, sans doute… Mais, en bonnes donneuses de vie, elles ont pardonné et offert à la France plein de nouveaux beaux enfants. Le pays s’en trouve aujourd’hui renforcé.
Un rictus souverain et dédaigneux balaya les visages des témoins de l’agression verbale de ce Bichet.
– Je ne sais pas si le pays en a été renforcé, et je ne sais pas ce que ces nouveaux enfants pensent réellement de tout ça, mais pour moi une chose est certaine, gagnée ou perdue, mairie neuve ou pas, familles nombreuses ou pas, ce n’est pas beau la guerre. La guerre est une fort méchante femme. Quel homme peut en être amoureux, si ce n’est un tailleur de pierres tombales, voulut conclure le philosophe.
– Mais il fallait bien défendre le pays contre le joug nazi, mon cher Robert, et défendre nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, reprit Louis relayant Maryse.
– Et celles de travail, famille, patrie ?
– Ma foi, aussi. Quel honneur à être inutile, quel plaisir à être orphelin ou apatride ? Bon, passons. La période était exceptionnelle. Il est vrai que vous étiez bien jeune à l’époque. Mais vous n’êtes pas sans savoir que depuis la nuit des temps les hommes se font la guerre, et que la vie elle-même est un champ de bataille. N’est-ce pas ce que nous apprend la théorie de l’évolution ? Tout combat est une aventure. Ce fut très dur, mais ce fut une réelle aventure, et toute aventure est un combat.
– Les aventures amoureuses aussi ? Si l’amour est pour vous un combat, si la vie elle-même est un combat, qu’en est-il de ceux qui préfèrent l’entente et le partage ?
– Des rêveurs. Des utopistes. Des enfants en somme.
– Des enfants de la patrie forcés de partir au front sans comprendre et sans échappatoire.
Maryse s’irritait. Elle reprit la parole en montant la note d’une octave :
– À tout homme digne de ce nom de montrer sa vaillance et son abnégation. Sans guerre, pas de général de Gaulle, pas de Jean Moulin.
– Et pas de Pétain, et pas de collabos, insista Robert, n’est-ce pas, Marcel ? La guerre a toujours montré plus d’horreurs que d’honneurs, révélé plus de vices que de vertus, créé plus de veuves que de tombes à fleurir. J’insiste, la guerre, ce n’est pas beau.
– Si, môssieur Je-sais-tout, si c’est beau, parce que la guerre, comme dit madame la baronne, ça fait les héros, reprit Marcel échauffé par les remarques et les sous-entendus du pacifiste ajoutés aux verres ingurgités. Louis m’en est témoin, il m’en a fallu du courage pour dépasser ma peur.
– Parce que t’es un héros, toi ? Arrête de galéjer, Marcel. Vous étiez près d’une quarantaine de Francs-tireurs contre à peine une quinzaine d’Allemands. Même que vous leur vendiez vos oeufs et votre lait. Pas vrai ?… lui rappela le provocateur avant d’ajouter :
– … Et l’Antoinette, cette pauvre gamine qui a été rasée et bannie parce qu’elle était tombée amoureuse d’un gamin d’en face. C’était beau ça aussi, Marcel ?
– Macarel ! hurla le gras matamore en se levant dans un fracas de chaises et de verres avant de saisir l’outrancier par le col, le poing déjà armé mais retenu à temps par les autres attablés, maire compris, habitués qu’ils étaient aux incartades du sous-fifre.
L’accordéon du vieux Théophile s’en tut.
Maryse Malart fut fort perturbée par l’altercation. Mais ses sentiments déjà bouleversés le furent plus encore à la révoltante vision de sa robe tachée. Des hommes, personne ne connait le pire.
Pendant que les grands s’excitaient à l’extérieur et qu’à l’intérieur un beloteur ajoutait à la cacophonie avec un tonitruant « belote, rebelote et dix de der », Raymond junior et la petite Lucienne, assis au chaud dans un coin de la salle, partageaient une unique grenadine et s’amusaient des glouglous que chacun provoquait au bout de sa paille. Alors que le vacarme était à son paroxysme, le garçonnet arrêta subitement le jeu, prit tendrement la main de la fillette, la fixa droit dans ses étincelants yeux verts et lui confia :
– Quand je serai grand, je te marierai.
Juillet 1970.
Solange s’était arrêtée au village pour embrasser ses parents avant de reprendre le train. Elle descendit à la gare de Foix. Le temps était estival et même plutôt chaud. C’est en stop qu’elle rejoignit la petite route qui s’enfonçait sous les feuillages. Il y faisait plus frais et ça sentait bon le sous-bois. Elle glissa ses pouces sous les bretelles de son sac à dos et s’élança avec volonté.
Après presque une heure de marche pentue, elle entendit des bêlements et, cent mètres plus loin, d’abord un peu feutré, puis plus reconnaissable, un morceau des Pink Floyd. Ça devait être là.
Jean lui apparut en premier. Il était installé à peindre sous un gros chêne. Il entendit ses pas et la vit. Elle fut agréablement surprise de son élan un peu excessif.
– Solange ! Super ! Ça fait plaisir de te revoir. Houaou ! Si je m’attendais à ça !
Il posa son pinceau sur le bord du chevalet, se leva, renversa son tabouret et courut presque jusqu’à la jeune fille. Il la prit dans ses bras et l’embrassa sur la bouche, simplement, comme d’autres auraient serré sa main ou posé une, deux, « chez nous c’est trois », bises sur ses joues. Elle fit semblant de ne pas avoir relevé cette effusion de tendresse.
– Oui, moi aussi je suis contente d’être là et de vous retrouver dans ce cadre bucolique.
– Ça faisait longtemps. Tu vas bien ? Pose ton sac là et je te fais faire le tour. Tu vas voir, c’est un chouette coin.
Ainsi, depuis une semaine, Solange vivait avec des garçons chevelus et des filles couronnées de fleurs dans une petite communauté retirée sur les hauteurs ariégeoises. Elle avait décidé de rendre visite aux frères, Jean et Christian, qui avaient investi une ancienne fermette perchée entre bois et nuages, abandonnée par les bergers locaux. Les trois jeunes gens étaient nés dans le même petit village du Lauragais et se connaissaient depuis l’école primaire. En ces temps, les gosses, filles et garçons mêlés, se retrouvaient à jouer ensemble à la balle sur la place de l’église autant qu’à la pêche dans la Donzelle. Un jour, Christian avait chapardé quelques carottes dans le potager du curé pour les offrir à Solange pour qui battait son jeune coeur. Dénoncé jalousement par son grand frère, ce diabolique larcin lui valut trois Notre Père et trois Je vous salue Marie, les trois coups de ceinture de son père Louis, et les puritains reproches apitoyés de sa mère. Mais il ne regrettait rien.
– Solange méritait bien ça ! se vantait-il.
Presque autant que la reconnaissance accrue de ses copains. Tous en pinçaient pour Solange, pour certains sans oser se l’avouer. Il faut dire qu’elle avait toujours été bien jolie. De longs et épais cheveux noirs entouraient un gracieux et avenant visage aux pommettes saillantes et toujours légèrement hâlé. Ses lèvres finement ourlées et aux coins légèrement relevés rappelaient le mystérieux sourire de Mona Lisa. Ses vingt et un ans la rendaient plus attirante encore. De plus, elle était loin d’être sotte. Il n’était qu’à voir le contenu de son sac à dos réduit au strict nécessaire vestimentaire, excluant les produits de maquillage et les fanfreluches inutiles. Elle préférait l’alourdir de plusieurs livres, dont au moins un de philo.
– Ça éloigne les mecs trop entreprenants. Une belle fille, ça attire les regards lubriques, mais une intello, même très belle, c’est ennuyeux et les mecs supposent que ça ne pense pas au cul, expliquait-elle à ses copines.
Elle avait adopté cette option préservatrice mais n’en usait qu’avec modération.
Emportée par l’éruption et les bouillonnements qui suivirent les planétaires mouvements de 68, toute une génération se disait en rupture de ban avec une société vieillissante. En fait, beaucoup refusaient surtout d’aller au boulot. Leurs envies optaient plutôt pour fêter les nouveaux rythmes musicaux, fumer des pétards et pratiquer le sexe avec un minimum de tabous. Des jeunes, étudiants autant qu’ouvriers, retournaient vers quelques supposées racines pastorales. Les paysans locaux rigolaient en voyant débarquer ces gugusses qui voulaient travailler la terre sans rien y connaître. Mais ils étaient bien gentils ces gosses. D’autres étaient poussés par une nouvelle quête spirituelle à partir loin, très loin, vers des pays inconnus où ils espéraient retrouver un savoir ancestral et des vérités oubliées.
Jean et Christian n’avaient pas ces ambitions. Ils suivaient la mode et profitaient simplement de l’élan général pour s’éloigner de l’oppression parentale.
Tous deux étaient grands, fins, cultivés, avec une allure aristocratique résultant sans doute d’une éducation rigoureuse plus que d’une trace de sang bleu dans leurs gènes. De l’espèce de monarchie démocratique instituée par Louis et Maryse Malart, Christian imitait le monarque, Jean copiait le démocrate. S’ils avaient été le soleil, le cadet en aurait été la lumière, l’aîné la chaleur.
Toujours derrière son frère, Jean paraissait timide malgré un regard perçant que l’on devinait entre ses longues mèches de cheveux bruns dont les pointes venaient se mêler à son épaisse barbe. Son regard noir cherchait au fond des choses et des dires, alors que celui de Christian était de ceux qui charment et glissent à la surface de l’essentiel. Le menton arrogant et la main un peu molle, sous une longue mèche qu’il relevait de temps en temps d’un mouvement de doigts aérien, se préservait un prétentieux, un arriviste, un séducteur et un libertin qui profitait allègrement des changements de moeurs de l’époque pour satisfaire les désirs libidineux d’un grand adolescent qui ne craignait rien de son avenir.
Un avenir que Jean ne souhaitait pas envisager. Lui était un idéaliste, un penseur, un artiste, toujours à la merci d’une sensibilité à fleur de peau que son second, ne manquant pas de se venger sur son « dauphin » frère de cet outrage hiérarchique, exacerbait par plaisir.
Au retour d’un service militaire qui ne les séduisit en rien, le lieutenant paternel voulu les initier au pouvoir entrepreneurial. Mais Christian se rebiffa :
– Je vous en prie, père. Pas maintenant. Nous n’avons pas du tout envie de nous enfermer prématurément dans la carrière. Par pitié, laissez-nous un peu profiter de la vie.
– Profiter de la vie ? Il n’y a donc que cela qui vous intéresse. Et vous croyez que ce que j’ai planté pour vous va fructifier tout seul. Savez-vous combien d’entreprises périclitent par incompétence ou mauvaise volonté filiale ? Ne vous ai-je pas assez sermonné sur les dérives engendrées par toutes les tentations et corruptions contemporaines ? Finalement, allez-vous me pousser, comme certains de mes amis, à penser que ce qu’il faut à cette jeunesse dépravée, c’est encore une bonne guerre ?
Le vieux militaire ne voyait pas qu’il l’avait sa « bonne guerre » de jeunes, et que c’étaient tous ces idéaux à lui qui allaient perdre la bataille.
– Bien sûr que non. Mais aujourd’hui vous menez l’entreprise d’une main de maître. Vous êtes encore jeune et tout le monde respecte vos directives. Nous avons juste besoin de dépasser quelques frontières, de découvrir nos forces et nos faiblesses afin de mieux répondre à vos exigences, argumenta Christian.
Parents et fils menaient souvent d’âpres joutes verbales au cours desquelles Jean mettait en avant des considérations affectives autant qu’intellectuelles. Pour atteindre ses fins, Christian préférait l’humour autant que la ruse, la rouerie, la fourberie, le mensonge, et tous les stratagèmes que doit maîtriser un disciple de Machiavel. Cette fois, il misait insolemment sur la flatterie.
Le patriarche resta un moment silencieux, circonspect. Maryse ne dit rien. Comme d’habitude elle laissait à son seigneur et maître le dernier mot. De toute façon elle était toujours d’accord, par principe, par fidélité, par respect. Une femme, ça suit son mari, pour le meilleur et pour le pire.
Finalement, pour des raisons qui restèrent obscures à Jean et totalement indifférentes à Christian, le paternel accepta la requête.
– Bien. Qu’il en soit ainsi. Partez visiter le monde et ses habitants. Je distribuerai vos rôles et responsabilités à votre retour.
Jamais Jean n’aurait osé contredire son père et il fut bien aise de s’en sortir à si bon compte. Tout en reconnaissant à part soi la faiblesse de profiter de l’hypocrisie de son frère.
– Je l’ai bien embrouillé le père, hein, frérot ? se vanta le négociateur après l’entrevue. Tu peux me remercier. Maintenant on va aller rigoler un bon coup.
– Mieux vaut en rire qu’en pleurer.
Forts de la rente allouée par leur père, ils étaient donc à l’initiative de la petite colonie, et, pour tous ici, celui qu’on écoutait béatement, c’était Christian, le beau parleur, celui qui savait, qui affirmait des certitudes que Jean essayait de modérer, toujours à l’affût de l’écart dénoncé par un de ses multiples proverbes dont la liste ne semblait pas avoir de fin.
– Blaise Pascal disait que les hommes se gouvernent plus par caprice que par raison.
Ici, au calme, loin de tout, Solange et les autres vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Les quelques tâches indispensables étaient hebdomadairement attribuées et confirmées à la craie sur l’ardoise accrochée près du vieil évier en pierre. Entre les devoirs de ménage et de cuisine, les soins aux animaux, et un peu de restauration des bâtiments, les activités ne manquaient pas. Mais l’ambiance générale restait plus proche de la colonie de vacances que des travaux forcés.
– Quitte à porter un collier, autant qu’il soit de fleurs plutôt que d’esclave, ironisait Christian.
Blottis dans leurs sacs de couchage près du large foyer toujours entretenu, Kurtz et Kathleen dormaient encore. Ce couple de globe-trotters qui parcourait l’Europe d’une communauté à l’autre était arrivé hier en fin