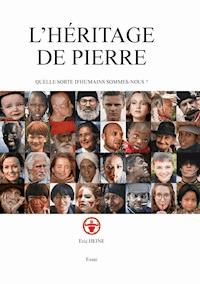Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un recueil d'historiettes, de souvenirs, de pensées et de chansonnettes traités en poésie philosophique.
Das E-Book Toujours vivant wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Toujours vivant,Eric Heine,Poésie philosophique,histoires courtes,Rêves d'amour
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DU MÊME AUTEUR
L’Héritage de pierre
Essai - Autoédition Bod 2017
Quelques histoires de Toïdi
Contes philosophiques - Autoédition Bod 2017
Quand la vie veut pas
Roman - Autoédition Bod 2021
Écrire,
c’est parler
en silence.
À Milly
Parce qu’il n’est pas là et qu’elle me manque.
Parce qu’elle était là et qu’il n’y est plus.
Parce que je les cherche, que je les attends.
Parce que j’espère, encore, et toujours.
Parce que j’oublie
ou que se réveille ma mémoire.
Parce que l’abandon est aisé.
Longtemps mon vase se remplit
De rayons de lave de lune blanche
Et d’éclairs rouges
Avant que joyeusement s’en écoulent
Des larmes de souvenirs.
E.H.
SOMMAIRE
Toujours vivant
L’apocalypse
Le hanneton
Tu seras un homme
La compétition
Le secret
Baiser la mort
Le modèle
Noir et blanc
Mauvais rêves d’amour
Federico
Crabe ou canard
Les allumettes
Un bébé
Mortadelle
Bip-bip
Frontières
Plus haut
T’étais où ?
Monologue au miroir
Annales akashiques
Entracte
Chien ou chat ?
Singer under the full moon
De tout et de rien
Anonyme / Élémentaires
Mieux
Boum, boum / Rides / Un drapeau / La source
Étoiles
Si je veux / Parce que / Égocentrisme / Guerre et paix
Psychose
Feu de joie / Humeur / Enfoirés
Chansonnettes
Putain d’ta mère
Chez Pierrot
Hey John
Les couleurs de l’amour
Voilà. C’est fini.
TOUJOURS VIVANT
Nous avons tous en mémoire des souvenirs qui, sans même prévenir, au détour d’un parfum, d’une mélodie, d’un prénom ou d’un rêve, nous reviennent comme des courts métrages, des instantanés de vie que nous pouvons retrouver avec joie ou mélancolie, ou pour les ruminer avec remords. Ils sont nets ou flous, avec un arrière-goût de madeleines sucrées ou de citrons amers, nourrissants ou répulsifs. Ils sont des coussins mœlleux sur lesquels nous trouvons réconfort ou qui nous étouffent, parfois des cactus ou des poignards qui nous meurtrissent toujours et persistent longtemps après l’atteinte. Ils nous harcèlent comme un moustique ou un papillon de nuit, se voilent et se dévoilent comme la lune derrière les nuages, ou nous reviennent comme une comète antique.
Pourquoi celui-ci flotte-t-il encore entre deux eaux dans notre marmite mémorielle, et pourquoi, ce jour-là ou cette nuit-ci, remonte-t-il à la surface comme une bulle de bouillon ? Pourquoi, lui ou elle, revient à la peine ou à l’amour après tant d’années ? Pourquoi cet autre s’est-il enfoui au plus profond de nos oubliettes ?
Quoi qu’il en soit, tous ces souvenirs sont en nous et leurs latents pouvoirs restent certains. Ils sont nous. Ils sont les grands et petits éléments constructifs de notre personnalité. Ils sont les traces laissées sur les marches de notre escalier de conscience. Ils sont les petites bougies fondues sur le gâteau du temps passé, des clapotis de vague à l’âme. Délices de victoires et dégoûts de défaites, survivances de promesses, de secrets, de non-dits, parfois l’ombre de la mort dont nous avons senti un bref instant le froid nous envahir, sa faux se contentant de nous égratigner pour nous rappeler notre éphémérité.
Tout au long de notre existence, les étapes, les virages, les accidents sont nombreux, et chacun d’eux annihile un avenir possible et donne naissance à une nouvelle destiné.
Qu’avons-nous appris grâce à… ?
Nous serions-nous aimés si… ?
Qui serions-nous et serions-nous encore si… ?
Les réponses à ces questions ne sont qu’imagination.
Les souvenirs, eux, sont toujours vrais.
Vrais comme des souvenirs.
•
I
L’APOCALYPSE
J’étais Esprit. Je suis Apocalypse.
C’était la nuit. C’est le jour.
L’explosion dégoulinante a emporté avec elle le clapotis barbotant. Je m’embrase de l’intérieur, incendié par d’insidieux venins acides qui se répandent en flots réguliers dans ma poitrine qui se gonfle et s’affaisse en douleur.
Recracher la lave dévorante.
Où est le paradis où est l’enfer ?
Parce qu’il y a le paradis et il y a l’enfer ?
Le tambour feutré s’est tu. Ce sont mille hurlements stridents et mille bourdons vrombissants, mille crissements crispants et mille roulements tonitruants qui s’additionnent, se percutent, se mêlent, m’étourdissent, m’assourdissent en douleur.
Où est le silence où est le tonnerre ?
Parce qu’il y a le silence et il y a le tonnerre ?
La douce pénombre s’est muée en arcs-en-ciel de rouges et de verts, de formes informes zigzagantes qui s’agglutinent, s’évaporent, disparaissent en flèches rayonnantes qui percent l’horizon invisible de ma douleur.
Où est l’ombre où est la lumière ?
Parce qu’il y a l’ombre et il y a la lumière ?
Ma peau se détache en gluantes plaques sanguines qui me laissent à nu, corps moulu, distendu, assailli par un vent tempétueux, glacé et brûlant, qui me lacère de pore en pore comme d’infimes insectes grouillants dévorant du haut en bas ma douleur.
Où est le haut où est le bas ?
Parce qu’il y a le haut et il y le bas ?
Du centre de mon tréfonds, tout n’est que souffrance. Je suis saisi, serré, tâté, transporté. Des forces m’oppressent, me coupent, me tournent et me retournent, me frappent. J’étais bien. Je suis douleur.
Où est le bien où est le mal ?
Parce qu’il y a le bien et il y a le mal ?
Seize heure cinquante ou minuit douze.
Mâle et femelle confondus.
Trois kilos cinq de chair en fusion.
Où est l’esprit, où est la matière ?
Parce qu’il y a l’esprit et il y a la matière ?
Un premier cri :
– Toujours vivant ?
•
II
LE HANNETON
J’avais cinq ans.
Un doux mois de mai caressait notre petite école de campagne. Les marronniers ombrageaient la cour et leurs pyramides de fleurs roses et blanches répandaient un parfum verdoyant. Des centaines d’abeilles travailleuses et de hannetons friands voltigeaient entre les rais de lumière prodigués par le feuillage des centenaires.
Pendant que les enfants profitaient de la récréation pour s’ébrouer, éparpillant bruyamment les gravillons par leurs jeux, les maîtresses aux tenues magistrales papotaient en haut des trois marches de l’escalier qui menaient aux classes. Les sourcils froncés sous leurs coiffures bien mises, le regard aux aguets sur les ébats de leurs chers élèves, elles étaient les abeilles soucieuses de la gelée royale qu’elles dispensaient, les gosses étaient les hannetons virevoltant d’un plaisir à l’autre sans soucis des pétales que leurs vols désordonnés disséminaient en légers flocons.
Les doux cerbères de cet îlot édénique se préoccupaient peu du petit couple discret qui, comme chaque jour depuis la fin du premier trimestre, se tenait assis sur le plus écarté des trois bancs de bois alignés dos au muret hérissé d’une grille aux barreaux rouillés qui protégeait du monde extérieur.
Elle se prénommait Catherine. Catherine Lanoix.
Porté par un émoi inconnu, je la trouvais belle à craquer avec ses cheveux désordonnés où pendouillait toujours une barrette bleue comme ses yeux. J’étais charmé par son discret grain de beauté sur la joue gauche et j’espérais que ses petites lèvres roses viennent à nouveau, comme ce jour de la bonne année, poser un léger baiser timide mais claquant sur les miennes. Depuis cette déclaration privilégiée, je ne la quittais plus. Les mômes jaloux nous moquaient d’amoureux. Les adultes souriaient de notre idylle. Nos parents s’interrogeaient sur les lois du destin. Notre innocence ignorait ces autres qui se permettaient des certitudes, des jugements, des interrogations.
Ce jour-là, comme d’habitude, elle s’assit tout contre moi. Je m’assis tout contre elle. Pendant que le monde alentour s’activait sans retenue, nous restions immobiles dans nos blouses, elle bleu ciel et toute propre, moi verdâtre et tachée. Parfois chuchotant quelques secrets espoirs, nous contemplions les circonvolutions des insectes en nous tenant la main, souriants, complices. Tout s’activait de vie, de printemps, de soleil, et nous goûtions ensemble ce bonheur que nous ne savions pas éphémère.
Alors qu’une des maîtresses frappait dans ses mains pour signaler la fin de la récréation, un hanneton vint se poser sur l’épaule de ma petite amie.
Puis un autre. Et un autre encore.
Mon arbre de mai.
– Quand je serais grand je te marierai, lui promis-je.
En septembre, pour la rentrée des classes, elle ne revint pas. Les maîtresses ne parlèrent pas de son absence mais, du haut des trois marches, elles jetaient de temps en temps un regard tendrement amusé vers ce gamin qui avait repris sa place sur le petit banc esseulé.
Un hanneton s’était enfoui dans mon petit cœur.
Il y passe tous les hivers, mais il renaît à chaque printemps d’une nouvelle effervescence amoureuse.
Toujours vivant.
•
III
TU SERAS UN HOMME
Je devais avoir 8 ans.
Les cheveux noués en un lâche chignon qu’elle devait rectifier à chaque nouvelle activité, le devant toujours protégé par un long tablier fleuri, ma mère jardinait, cuisinait, ménageait, lavait, repassait et contrôlait la fratrie composée de quatre fillettes et d’un garçon. Je suis né entre la grande et les trois petites. Un gosse tous les deux ans. Tous sortis au printemps dans le même lit conjugal qui devait cacher un calendrier biannuel. La maisonnée était le royaume dont elle était la bonne et soucieuse gouvernante. Vertueuse, sans cesse occupée, elle menait ses sujets sans jamais proférer un mot plus haut que l’autre.
Quant à mon père, c’était le roi des agriculteurs, fort de ses traditions et de son territoire dont je ne pouvais discerner les frontières.
– Paysan. Ça c’est un métier honorable. Un vrai métier d’homme, proclamait-il.
Je vois encore ses épaisses et calleuses mains reposant sur ses hanches, sa large poitrine gonflée entre des bretelles à boutons qui retenaient un ample pantalon couleur terre, une casquette anglaise par tous temps bien enfoncée jusqu’aux oreilles pour camoufler sa calvitie envahissante, un bout de Gitanes maïs au bec entre deux joues mal rasées. Et j’entends encore sa voix gutturale propre à intimer le silence et l’acceptation.
– Je le fais comme mon père et mon grand-père le faisaient, et même ceux d’avant. Et toi aussi tu feras ça, hein, mon gars ? Parce que, bon Dieu, faudra pas compter sur les donzelles, que ça pense qu’à la toilette et aux fariboles.
Ma mère se rebellait par un doux :
– Hooo, Papa, faut pas dire des blasphèmes et des bêtises comme ça au petit.
Et elle rajustait son chignon avant de retourner à quelque indispensable occupation.
Un beau matin, mon père me laissa conduire son énorme tracteur rouge. Après m’avoir saisi à bras le corps pour me hausser jusqu’à lui, il m’avait coincé entre ses cuisses et avait lancer le moteur de la machine qui pétarada de joie ou de colère. Mes petites mains s’accrochèrent avec héroïsme aux tressaillements de l’immense volant et tout mon corps vibra de concert au rythme de l’engin dont j’inspirais les échappements noirs. Mes pieds atteignaient à peine ceux de mon père qui se chargeait des pédales. De ce piédestal mon regard estimait et bravait crânement le monde qui s’étendait à perte de vue. J’étais grand. J’étais un paysan. J’étais un homme. Maman tortillait nerveusement le bas de son tablier et regardait d’un air perplexe le Massey-Fergusson emporter lourdement son bébé dans le champ déjà cadastré de mon destin. Ma grande sœur rageait de ne pas avoir et de n’avoir jamais ce privilège. La petite pleurait de peur en se bouchant les oreilles. Les deux autres couraient en riant autour de la bête que je semblais avoir domptée.
– C’est grâce à tes labours que les gens de la ville pourront toujours manger des patates et du pain.
Alors j’aimais les patates et le pain. Même s’il était parfois dur.
– Faut pas gâcher, disait mon père. Le pain c’est sacré, et le sacré ça se respecte.
Pendant qu’il s’enfilait un autre verre de son mauvais vin, ma mère coinçait la grosse miche entre ses seins et nous en coupait une tranche plus tendre.
– Les enfants aussi c’est sacré, ajoutait-elle dans un angélique chuchotement qu’elle nous destinait.