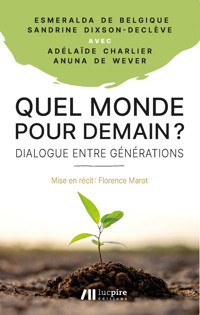
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Renaissance du livre
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Französisch
Engagées contre le dérèglement climatiques, nos quatre intervenantes ont choisi de se réunir pour partager leur expérience et leur conscience des risques qui pèsent sur l'humanité. Ensemble, elles dressent le constat de la lutte, depuis les années 60 au premier rapport du Club de Rome et jusqu'aux grèves étudiantes de 2019. Au fil de leurs discussions, elles interrogent les concepts de croissance, de transition juste, de gouvernance et de responsabilisation face à un système à bout de souffle. Si aujourd’hui, les questions écologiques ne peuvent plus être niées, force est de constater que les réponses à y apporter clivent les générations. Pourtant, au-delà du «à qui la faute», il apparait nécessaire de se lancer dans un mouvement commun et solidaire pour construire le monde de demain et trouver de vraies solutions.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quel monde pour demain ?
Éditions Luc Pire [Renaissance SA]
Drève Richelle, 159 – 1410 Waterloo
Éditions Luc Pire
www.editionslucpire.be
Quel monde pour demain ?
Édition : Morgane De Wulf
Corrections : Astrid Legrand
Mise en pages : CW Design
Impression : IMPRS
e-ISBN : 9782875422477
Dépôt légal : D/2021/12.379/08
© Éditions Luc Pire, 2021
Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans une banque de données ni publié sous quelque forme que ce soit, soit électronique, soit mécanique ou de toute autre manière, sans l’accord écrit et préalable de l’éditeur.
Esmeralda de Belgique Sandrine Dixson-Declève
avec
Adélaïde Charlier Anuna de Wever
Quel monde pour demain ?
Dialogue entre générations
Mise en récit : Florence Marot
Préface
Nos enfants nous accusent. Ils lancent des phrases assassines : « Vous avez bien vécu sans vous souciez des conséquences, épuisant les ressources naturelles, déréglant le climat. Tout cela au détriment de notre futur. Et maintenant, vous prétendez que nous trouvions toutes les solutions pour sortir de la crise ! »
Ces reproches des jeunes, immortalisés par l’expression OK, boomer !, sont une réplique cinglante à l’inaction et au déni climatique tout comme aux critiques paternalistes de leurs aînés. La colère et le sentiment d’être une génération sacrifiée risquant, selon certains, de nous plonger dans une guerre entre jeunes et vieux.
Dans ce livre, nous avons pris le parti de confronter les points de vue de manière sincère et honnête. Cette conversation, mise en musique avec talent et sensibilité par Florence Marot, est aussi une belle aventure humaine. Toutes lesquatre nous avons découvert notre histoire personnelle, nos parcours et nos engagements. Avec des moments alternant émotion, colère, rire et surtout espoir. Nous les aînées, nous avons été éblouies par la détermination, la clarté et le courage de ces deux jeunes femmes, Anuna et Adelaïde, qui sacrifient des mois de leurs plus belles années pour combattre la crise climatique et écologique. Radicales, sans compromissions, décidées à changer le modèle de société qui nous a conduits au bord du précipice. Comme tant de membres de la génération z, elles refusent de renoncer à leurs valeurs, de s’accomoder, et pourraient s’approprier la déclaration de Martin Luther King : « Je suis fier de ne pas m’adapter ». Entre critiques et injures sur les réseaux sociaux, mais aussi starification de la part de certains médias, elles demeurent lucides.
Nous les remercions chaleureusement de s’être prêtées au jeu et d’avoir rendu ce dialogue si enrichissant et inspirant.
Elles ne savaient sans doute pas que nous, les aînées, avions déjà mené tant de combats similaires depuis plus de trente ans. Les manifestations contre le danger nucléaire – qui reste bien réel aujourd’hui –, contre les guerres, l’Apartheid, la dégradation de l’environnement et la pollution et puis la crise climatique. Elles ne percevaient pas vraiment que leur mouvement avait ses fondations dans les écrits de Rachel Carson, les révoltes étudiantes de 1968, le rapport Meadows, toutes les protestations contre l’injustice et l’inégalité et, plus récemment encore, le printemps arabe ou la manifestation Occupy Wall Street.
Nous avons échangé notre expérience et notre cheminement avec leur fougue et leur créativité. Nous avons partagé la même révolte devant le foisonnement de belles paroles et le manque d’actions concrètes. Mais aussi un immense espoir. Tout est encore possible si nous agissons maintenant et si nous construisons une coalition intergénérationnelle. Les jeunes ne sont pas en guerre contre les plus âgés : ils veulent qu’on les écoute, qu’on les associe aux prises de décisions, mais demandent aussi à être épaulés, conseillés, soutenus. Ils savent bien qu’ils n’arriveront pas tout seuls à changer le système. Cette révolution, ils veulent la mener avec le plus de monde possible parce qu’elle nous concerne tous. Il s’agit de notre survie.
Rejoignons cette alliance, prenons comme devise la déclaration de Naomi Klein : « Plus le feu aura d’étincelles, plus il sera flamboyant. Je vous invite tous à ajouter votre étincelle. »
Voilà notre challenge pour assurer un monde meilleur pour demain !
Plus de questions, mais une certitude !
Esmeralda de Belgique & Sandrine Dixson-Declève
Bousculer notre monde ne veut pas dire le faire disparaître. Se saisir, maladroitement, imparfaitement peut-être, des enjeux plus grand que nous-mêmes pour marquer notre temps : c’est justement ça grandir. Il est alors temps d’ouvrir le dialogue intergénérationel, de sortir de cette opposition « boomer » vs « millenials » et de comprendre que sauver l’humanité et la bonne partie du vivant qu’elle entraine dans sa chute ne peut pas être l’apanage de quelques-uns.
Camille Étienne (jeune militante écologiste, membre du duo Pensée sauvage)
Au travers d’un récit captivant, quatre femmes d’âge différent nous démontrent que le changement climatique est aussi une question transgénérationnelle. En fait, ce livre nous rappelle avec force que c’est uniquement en travaillant tous ensemble – comme jamais auparavant – au sein des entreprises, du monde politique, de la société civile, de la communauté scientifique et bien sûr, toutes générations confondues, que nous construirons un monde plus résilient pour demain.
Connie Hedegaard (Commissaire européenne à l’Action pour le climat et ancienne ministre de l’Environnement du Danemark)
Quatre femmes belges, deux générations, une seule lutte : la Terre. Ce livre témoigne non seulement de l’engagement extraordinaire d’Anuna, d’Adelaïde, de Sandrine et d’Esmeralda, il se lit également comme une excellente introduction aux plus grands défis auxquels l’Humanité a jamais dû faire face : la survie de la Vie. Dans un langage clair et limpide, elles nous expliquent ce qui est en jeu et nous invitent à joindre leur combat.
David Van Reybrouck (scientifique, historien de la culture, archéologue et écrivain)
Un magnifique livre écrit par quatre femmes engagées ! Un quadrilogue émouvant et fécond, au-delà des barrières entre générations, qui montre à quel point l’avenir de l’humanité est entre nos mains. Un plaidoyer pour que l’action citoyenne et celle des décideurs économiques et politiques s’allient au service de toute la vie sur Terre.
Jean-Pascal van Ypersele (climatologue, professeur à l’UCLouvain, ancien directeur du GIEC)
Ce livre est un compte-rendu unique et intergénérationnel établi par quatre femmes engagées pour le climat. Leur histoire personnelle captivante, leurs idées, craintes et espérances nous donnent un aperçu en profondeur des défis et des opportunités à travers le passé, le présent et le futur. Une analyse essentielle concrète de l’avenir et une exhortation inspirante à agir pour bâtir, dès maintenant, un lendemain meilleur pour les êtres humains et la planète !
Sharan Burrow (secrétaire générale de la Confédération syndicale Internationale)
À travers mes cinquante ans d’engagement, je me suis rendu compte que les héros de l’écologie étaient souvent des femmes. À l’heure où nous avons urgemment besoin d’une révolution spirituelle pour bâtir une société plus responsable, Quel monde pour demain ? nous rappelle, à travers un échange captivant mêlant les générations, le pouvoir des femmes qui s’engagent.
Yann Arthus-Bertrand (photographe, reporter, réalisateur et écologiste)
Introduction
La Terre se réchauffe sous la pression des activités humaines. C’est une certitude. Depuis les premières alertes scientifiques des années 1970 jusqu’à nos jours, cinquante ans se sont écoulés sans que nous soyons parvenus à enrayer la hausse du mercure.
L’année 2019, troisième au palmarès des années les plus chaudes, après 2020 et 2016, aura toutefois secoué les consciences. Alors que l’Europe a subi inondations et vagues de chaleur successives avec des températures records dépassant 40 °C, des feux de forêt d’une intensité inédite ont dévoré des pans entiers de Californie, de Sibérie, d’Amazonie, d’Australie… Partout, les flammes ont libéré d’immenses réserves de carbone stocké dans les arbres, dévasté les habitats naturels d’une biodiversité unique et contraint les populations locales à quitter leurs foyers détruits. L’Inde a essuyé la mousson la plus intense des vingt-cinq dernières années et l’Arctique a vu fondre sa banquise à une vitesse spectaculaire. Un scénario qui se répétera en 2020.
En parallèle, des centaines puis des milliers de jeunes ont envahi les rues d’un bout à l’autre du monde. Les grèves scolaires lancées en Suède par l’activiste Greta Thunberg se sont répandues comme une traînée de poudre. Le 20 septembre 2019, à la veille d’un sommet des Nations unies dédié au climat, quatre millions de manifestants à travers le globe criaient leur colère et leur désarroi face à l’indolence politique sur ce défi majeur de l’humanité.
En tête des cortèges à Bruxelles, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, 18 ans à l’époque, ont façonné le mouvement Youth for Climate de part et d’autre du pays, et emmené dans leur sillage des milliers d’élèves et d’étudiants inquiets de leur avenir sur une planète qui se consume à petit feu. « Notre maison brûle », « Il n’y a pas de planète B », « Changer le système, pas le climat », tonnaient-ils chaque jeudi sur les grands boulevards de la capitale.
Leurs préoccupations, brandies sur des pancartes et scandées par une jeunesse indignée de New York à Sydney, en passant par Buenos Aires ou encore Kyoto, ne sont pourtant pas neuves.
En 1972 déjà, le Club de Rome, un cercle de réflexion international mêlant industriels, économistes, dirigeants et scientifiques, attirait pour la première fois l’attention du grand public sur les risques d’une expansion économique et démographique exponentielle. Son premier rapport, intitulé TheLimits to Growth, publié en français sous le titre Halte à la croissance ?, soulignait le paradoxe entre une croissance économique infinie et des ressources naturelles limitées. Ses principaux auteurs, le couple de chercheurs américainsDonella et Dennis Meadows du Massachusetts Institute of Technology (MIT), y prédisaient ni plus ni moins l’effondrement de l’espèce humaine dans le scénario le plus pessimiste.
Près de cinquante ans après sa parution, alors que la Terre exploitée jusqu’à la moelle se réchauffe, cet ouvrage reste d’une actualité brûlante. Les enjeux n’ont pas changé. Ils se sont aggravés :pollution, extinction massive des espèces, creusement des inégalités, multiplication des catastrophes naturelles, épidémies, pandémies… La crise est devenue systémique.
Pourquoi les premiers avertissements ont-ils été sous-estimés, voire ignorés ? Que s’est-il passé, au cours de ces cinq dernières décennies pour qu’une armée pacifique de jeunes monte au front afin d’exhorter les décideurs à agir ?
Pour le comprendre, il faut remonter le temps, dénouer les fils entremêlés d’un monde complexe au sein duquel nous, les humains, avons fini par mépriser les équilibres naturels qui conditionnent pourtant notre vie sur Terre.
Deux générations se parlent
Sandrine Dixson-Declève est la première femme et la première Belge à coprésider le Club de Rome. Conseillère spéciale de la Commission européenne en matière de recherche et d’innovation pour la transition économique et énergétique ainsi que conseillère des Nations unies pour l’énergie durable et la résilience du système alimentaire, elle agit en coulisses des législations européennes et internationales depuis plus de trente ans. Au cours de sa carrière, elle a travaillé pour le vice-président américain Al Gore, assuré la mise en place de normes environnementales dans l’industrie nucléaire, pétrolière, chimique et automobile, et présidé le Prince of Wales’s Corporate Leaders Group, un réseau d’entreprises visant la neutralité carbone, parrainé par le prince Charles d’Angleterre. Créer des ponts entre les mondes politique, de l’industrie et de la société civile a toujours été son cheval de bataille.
La princesse Esmeralda de Belgique, fille cadette du roi Léopold III, défend, elle, la protection de la biodiversité et les droits des peuples indigènes depuis près de quarante ans à travers le Fonds Léopold III pour l’exploration et la conservation de la nature, créé par son père. Journaliste, auteure et activiste, elle milite en faveur d’une action urgente face aux crises climatique et de la biodiversité. En 2019, son investissement de longue haleine pour l’environnement lui a valu d’être nommée ambassadrice d’honneur du WWF. Un titre honorifique qu’elle concilie, entre autres, avec celui de présidente de Friendship Belgium, une ONG qui vient en aide aux populations victimes des désastres climatiques au Bangladesh.
À travers cet ouvrage, toutes deux, interrogées par Anuna De Wever et Adélaïde Charlier, mettent leur expertise en commun pour répondre aux questions de la jeunesse :comment en sommes-nous arrivés là, cinquante ans après les premières alertes scientifiques ?Quels enseignements la jeune génération peut-elle tirer de la précédente pour parfaire son combat? Pourquoi les femmes semblent-elles plus concernées ? L’économie et l’écologie sont-elles compatibles ? Qu’est-ce qu’une société résiliente et une transition juste ? Quelles sont les pistes de solution pour y parvenir ensemble ? Quels sont les nouveaux terrains d’action collective à arpenter ?
Cet essai est l’aboutissement de leurs longs entretiens,nourris par la conviction partagée que l’avènement d’une sociétéplus inclusive et respectueuse de la planète est indispensable et urgent pour le bien-être et la survie de l’humanité.
Une décennie pour agir
Notre modèle économique fondé sur la surconsommation des ressources naturelles et le culte de l’abondance illimitée rend la Terre de moins en moins hospitalière. Ces dernières années, la convergence de multiples crises a accéléré la prise de conscience collective.
Outre que le réchauffement planétaire se vit désormais à fleur de peau, près d’un million d’espèces animales et végétales risquent de disparaître, décimées par la déforestation, l’agriculture intensive, la surpêche, l’urbanisation galopante et la pollution. À cela s’est ajoutée, en 2020, la pandémie de Covid-19 qui a fait des centaines de milliers de morts et provoqué une crise économique mondiale. L’irruption de cette énième zoonose – ou maladie infectieuse de source animale – après le VIH, Ebola, Zika ou les différentes grippes aviaires, a sonné comme un ultime rappel : l’emprise des activités humaines sur la nature met notre civilisation en péril.
Sur le front climatique, les diagnostics sont posés. Fin 2018, trois mois avant les toutes premières grèves scolaires à Bruxelles, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un rapport retentissant sur les différents impacts attendus d’un réchauffement planétaire de + 1,5 °C à + 2 °C d’ici la fin du siècle par rapport au climat de la période préindustrielle.
Ce rapport, étayé par quelque 6 000 références scientifiques, montre qu’une hausse moyenne de la température du globe de + 1,5 °C ou supérieure augmentera graduellement la puissance des cyclones, les risques d’inondations, de chaleur extrême et de sécheresses, affectant la vie de centaines de millions d’êtres humains.
Depuis la révolution industrielle, il y a environ cent cinquante ans, la surface de la Terre a déjà gagné environ 1 °C en moyenne. Mais certaines régions comme l’Arctique, dont la banquise fond plus vite que prévu, et les zones équatoriales connaissent un réchauffement accéléré, parfois deux fois plus rapide.
D’après les modélisations climatiques, à + 1,5 °C, les mers enflées par la fonte des glaces engloutiront de 26 à 77 centimètres des côtes d’ici 2100. À + 2 °C, les marées grimperont de 10 centimètres supplémentaires. Renforcées par la puissance des ouragans, elles forceront les habitants des petites îles, des zones côtières inondables et des deltas à migrer en l’absence de stratégies d’adaptation adéquates.
Les océans, vastes poumons de la planète, seront moins impactés par un réchauffement de + 1,5 °C que de + 2 °C. Mais les récifs coralliens, éblouissants de vie et de couleurs, ne résisteront pas. De 70 % à 90 % d’entre eux perdront leur éclat en cas de hausse des températures de + 1,5 °C, et la quasi-totalité s’éteindra à + 2 °C, entraînant une perte irréversible de nombreux écosystèmes marins et des services qu’ils rendent à l’humanité.
Au large de l’Australie, la Grande Barrière de corail offre déjà un spectacle désolant. Le gigantesque récif, qui attire chaque année plus de deux millions de touristes venus s’extasier devant l’une des sept merveilles naturelles du monde, a subi au cours de l’été austral 2019-2020 son troisième épisode de blanchissement massif en l’espace de cinq ans. Sa destruction signifierait non seulement la perte d’un joyau mondial de biodiversité, mais aussi de près de 70 000 emplois et de six milliards de dollars de revenus annuels pour l’île-continent.
Sur la terre ferme, une variation moyenne de température de + 1,5 °C affectera les champs de maïs, de riz, de blé et potentiellement d’autres cultures céréalières, indispensables à la survie de milliards de personnes. Mais les dégâts seront moindres à + 1,5 °C qu’à + 2 °C, dit le rapport, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique centrale et du Sud, où vivent les populations les plus pauvres de la planète.
Car si l’écart d’un demi-degré de réchauffement paraît minime, toute poussée du mercure, aussi infime soit-elle, a son importance, précise le rapport du GIEC. À mesure que la Terre se réchauffe, la pauvreté et les préjudices subis par les populations vulnérables, dépendantes de l’agriculture de subsistance ou des ressources côtières augmentent. C’est pourquoi maintenir le réchauffement sous la barre de + 1,5 °C permettrait de réduire de plusieurs centaines de millions le nombre de personnes menacées par les déchaînements du climat.
Cela s’applique aussi bien sous nos latitudes. L’été 2019 – dont le mois de juillet a été le plus chaud jamais mesuré à l’échelle planétaire – l’a parfaitement illustré en Europe. Sous le soleil brûlant, le nombre de décès liés à la chaleur a grimpé en flèche par rapport aux moyennes estivales des années précédentes.
En Belgique, l’Institut de santé publique Sciensano a enregistré une surmortalité au cours des trois épisodes de canicule qui se sont succédé, avec un pic de 35 % de décès supplémentaires à Bruxelles lors de la deuxième quinzaine de juillet. « Une explication possible pourrait être un effet d’îlot de chaleur urbain », avait avancé Sciensano. Dans la capitale, les rues étroites et asphaltées, bordées d’immeubles en hauteur et laissant peu de place à la végétation et la circulation du vent, ont piégé les rayons du soleil et favorisé une surchauffe. Ce phénomène bien connu dans les villes – qui abriteront deux tiers de l’humanité d’ici 2050 – amplifie l’impact des vagues de chaleur.
Selon les experts du GIEC, pour ne pas franchir le cap de + 1,5 °C et protéger les millions d’êtres humains les plus exposés aux emballements du climat, il faut modifier sans délai, radicalement et de manière inédite tous les aspects de notre modèle de société. Chaque année qui passe, chaque choix que nous faisons est capital.
Toute passivité ne fera qu’aggraver le problème. En témoigne le rapport choc de l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Nicholas Stern. Commandé par le gouvernement britannique et publié en 2006, ce rapport évaluait le coût de l’inaction contre le réchauffement climatique entre 5 % et 20 % du PIB mondial, contre… 1 % pour celui de l’action.
Pourtant, les États et industries tardent à prendre le virage. Malgré les signes désormais tangibles du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre continuent de s’accumuler dans l’atmosphère. Si les tendances actuelles persistent, le seuil de + 1,5 °C sera franchi entre 2030 et 2052 et la Terre pourrait atteindre de + 3 °C à + 5 °C d’ici la fin du siècle, soit bien au-delà de l’objectif de contenir le réchauffement à + 2 °C, voire + 1,5 °C, comme s’y sont engagés près de 200 États à travers l’Accord de Paris en 2015.
Pour le Giec, maintenir la hausse du mercure à + 1,5 °C impose de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d’environ la moitié d’ici dix ans et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Du point de vue des lois de la physique et de la chimie, qui régissent l’effet de serre, ce renversement est possible. Mais comme l’ont montré les scientifiques, il implique des« transitions rapides et de grande envergure »pour décarboner complètement les secteurs de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’agriculture, et procéder aux adaptations nécessaires pour limiter les effets du réchauffement climatique dans les pays et territoires les plus à risques.
Les décisions prises au cours de la décennie seront cruciales. À entendre les multiples artisans de la transition, il existe de nombreuses solutions pour sortir de cette situation d’urgence, à commencer par la sortie des énergies fossiles, l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, la restauration des écosystèmes, le développement de l’économie circulaire et l’introduction d’une fiscalité verte dans une perspective socialement juste. Ce n’est ni la technologie ni les finances qui font défaut. Ce qu’il manque – et doit être activé d’urgence –, ce sont l’adhésion collective et la volonté politique de mobiliser les moyens disponibles pour mettre ces solutions en œuvre.
L’avenir des milliards d’êtres humains et des générations suivantes en dépend, tout comme l’exercice de leurs droits fondamentaux à la vie, à l’eau, à l’alimentation, à la santé, au logement et à l’autodétermination.
Repenser notre façon d’habiter la planète
Dans cet essai, Esmeralda de Belgique, Sandrine Dixson-Declève, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier partagent les visions de deux générations, depuis les perspectives tracées par les aînés jusqu’aux horizons ouverts par une jeunesse étonnamment consciente des enjeux et décidée à réparer un monde abîmé.
Lepremier chapitreembrasse cinquante ans d’histoire : de la découverte de l’origine humaine du réchauffement planétaire au terreau fertile du climatoscepticisme, en passant par les échecs et les avancées des négociations climatiques internationales.
Nos quatre interlocutrices reviennent ensuite, dans le deuxième chapitre, sur les expériences et rencontres qui ont nourri leur engagement personnel, bien souvent au-delà des frontières belges. Leurs discussions se poursuivent sur les privilèges occidentaux de « penser climat », les ressorts des mobilisations citoyennes comme caisse de résonance des combats sociaux et environnementaux amorcés des décennies plus tôt et l’entrée en puissance des femmes dans la lutte.
Au cours de l’année 2020, la pandémie de Covid-19 a ébranlé nos sociétés et charrié d’immenses espoirs de transformation. Esmeralda de Belgique et Sandrine Dixson-Declève en débattent avec les jeunes dans le troisième chapitre et tentent de définir les termes d’une société résiliente et d’une transition juste. L’économie est-elle compatible avec l’écologie ? Que signifie revenir à l’essentiel ? Ensemble, elles proposent de nombreuses pistes de solutions pour repenser nos modes de vie à la lumière des besoins humains et des limites planétaires.
Enfin, dans le quatrième chapitre, toutes les quatre font valoir le pouvoir des citoyens face à l’inertie politique. La communication des enjeux et le rôle des médias y tiennent une place essentielle. Comment construire une vision d’avenir positive face aux résistances des structures en place et des mentalités ? Quels sont les nouveaux terrains d’action collective à explorer et les raisons de garder l’espoir ?
Les jeunes l’ont rappelé aux aînés : où qu’ils habitent sur Terre, ils sont devenus témoins des dérèglements climatiques. Pour eux, le réchauffement ne constitue plus une menace lointaine, comme le percevaient les générations précédentes, mais une réalité vécue dont les vicissitudes se renforceront en l’absence de réaction.
Le choc planétaire provoqué par la pandémie de Covid-19 a fait surgir l’espoir de reconstruction d’un monde meilleur et ouvert une fenêtre d’opportunité unique pour mettre la transition écologique sur les rails. Elle a également montré que des nations comme la Nouvelle-Zélande, l’Islande et l’Écosse, qui n’érigent pas la croissance du produit intérieur brut (PIB) en valeur cardinale mais valorisent le bien-être sur base d’autres indicateurs, sont sortis plus fortes de la crise.
À l’heure où cette fenêtre se referme à grande vitesse, actant un retour de nombreux États au business as usual, moteur d’une croissance destructrice et aliénante, ce livre est un vibrant appel à ne pas revenir en arrière, exiger une mutation profonde de notre modèle de développement et placer la vie, la santé, l’alimentation, l’eau et l’harmonie avec la nature au cœur de nos préoccupations collectives et des responsabilités politiques.
L’humanité se trouve à un carrefour historique. C’est le moment de choisir la bonne voie.
CHAPITRE 1 Comment en sommes-nous arrivés là ?
Voilà près de cinquante ans que les scientifiques nous alertent sur le réchauffement climatique. Presque un demi-siècle que nous savons que les émissions humaines de gaz à effet de serre, issues principalement de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon, sont vouées à modifier profondément le climat.
Pourtant, le dioxyde de carbone (CO2





























