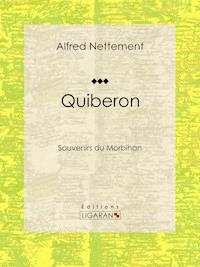
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Extrait : "Lorsqu'au commencement du mois de septembre 1850, je me rendis pour la première fois en Bretagne, la voie ferrée qui relie aujourd'hui Paris à Nantes et à Vannes s'arrêtait encore à Angers. Arrivé de grand matin dans cette ville, après un trajet de dix heures, je jetai un rapide coup d'œil sur le magnifique hôtel des ducs d'Anjou; puis je m'embarquai, à six heures du matin, sur le bateau à vapeur qui descendait la Loire..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335048025
©Ligaran 2015
Il y a près de vingt ans déjà qu’une dette de reconnaissance, dont je chercherai à m’acquitter tous les jours de ma vie sans croire jamais l’avoir payée, m’amena, pour la première fois, dans le Morbihan. Étranger à ce noble pays, dont j’avais toujours admiré, dans l’histoire, la foi profonde, les simples et mâles vertus, j’avais reçu de lui une marque de confiance et un titre qui équivalaient à des lettres de grande naturalisation. Le Morbihan était devenu pour moi cette patrie locale inscrite dans le cercle plus étendu de la grande patrie ; je devais une visite à la contrée qui m’avait adopté : je partis. Ce sont les notes prises à vol d’oiseau dans les pérégrinations successives que j’ai faites dans le Morbihan, en 1850 et en 1851, puis en 1860 et en 1868, et les lettres écrites à quelques amis, qui me fournissent les documents à l’aide desquels je vais essayer de retracer mes impressions et mes souvenirs. On verra, dans le cours de mon récit, comment je subis peu à peu l’attraction de ce triste et terrible nom de Quiberon, qui rappelle tant de sang et de larmes versés ; comment, après avoir bien souvent erré sur cette plage homicide, je prolongeai dans l’histoire l’étude commencée sur le théâtre des évènements, et de quelle manière, après avoir remué tous les problèmes historiques que soulèvent cette expédition et son désastreux dénouement, je fus amené à donner pour titre à mon livre le nom de QUIBERON.
1er avril 1869.
Lorsqu’au commencement du mois de septembre 1850, je me rendis pour la première fois en Bretagne, la voie ferrée qui relie aujourd’hui Paris à Nantes et à Vannes s’arrêtait encore à Angers. Arrivé de grand matin dans cette ville, après un trajet de dix heures, je jetai un rapide coup d’œil sur le magnifique hôtel des ducs d’Anjou ; puis je m’embarquai, à six heures du matin, sur le bateau à vapeur qui descendait la Loire, et je trouvai à bord quelques voyageurs dont le nom ou la personne m’étaient connus : le prince de Lucinge, MM. de Monti et de Mirabeau. Ceux qui ont fait par eau le voyage d’Angers à Nantes savent combien ce fleuve est, à cet endroit, magnifique de largeur, et combien, lorsque les eaux sont hautes, il présente un aspect imposant et majestueux. En même temps, les deux rives nous renvoyaient les souvenirs de la Vendée militaire, dont MM. Muret et Crétineau-Joly ont raconté les fastes glorieux. Voici que, sur la rive gauche de la Loire, au-dessous d’Angers, dans un pays qui s’est appelé autrefois les Mauges, et qui a conquis dans l’histoire, par des prodiges d’héroïsme, un nom aujourd’hui immortel, la Vendée, nous voyons s’élever sur un monticule escarpé, appelé le mont Glonne, la petite ville de Saint-Florent.
Là Bonchamp mourant sauva la vie à cinq mille prisonniers républicains que les Vendéens, exaspérés par les cruautés des bleus, voulaient mettre à mort. « Mon ami, avait dit à d’Autichamp le héros chrétien qui sentait venir la mort, c’est sûrement le dernier ordre que vous recevrez de moi, laissez-moi espérer qu’il sera exécuté : grâce pour les prisonniers ! » À l’instant plusieurs officiers sortirent de la chambre, et, montant à cheval, ces hérauts de la miséricorde et du pardon, qui portaient le testament de clémence dans lequel Bonchamp mourant venait d’écrire sa suprême et sublime volonté, allèrent répéter, de proche en proche, à la foule émue, ces mots qui sauvaient cinq mille vies : « Grâce aux prisonniers ! Bonchamp mourant le veut, Bonchamp mourant l’ordonne ! grâce aux prisonniers ! » À ces paroles, les paysans sentirent leur colère tomber. La plupart d’entre eux faisaient partie de l’armée de Bonchamp, et le vénéraient comme un père : ils n’avaient rien à refuser à cette agonie suppliante. Et puis la grandeur de l’action imposée à leur obéissance filiale, par le héros mourant, leur apparaissait dans toute sa splendeur : la Vendée, à cette heure de défaite et de revers où l’on implore la pitié du vainqueur, ne demandait point grâce, elle pardonnait.
Nous voyions en même temps s’étendre cette vallée en amphithéâtre dans laquelle se pressaient, dans les journées du 17 et du 18 octobre 1793, quatre-vingt-dix mille personnes, soldats, femmes, enfants, vieillards, blessés, fuyant le meurtre et l’incendie, et apercevant derrière eux la fumée qui s’élevait de leurs villages brûlés par les républicains. Le passage de la Loire par les Vendéens devant Varades, le passage de la Bérésina par notre armée dans la retraite de Moscou, deux échos douloureux qui se répondent dans l’histoire ! Ce fut à Varades, que nous apercevons sur la rive droite, que Lescure, blessé à mort, fit rassembler autour de son lit de douleur le conseil de la grande armée, et proposa de nommer général en chef Henri de la Rochejaquelein. M. Henri, comme l’appelaient les paysans, s’était caché dans un coin et pleurait à chaudes larmes. Ce brillant général d’avant-garde qu’on chargeait de conduire, une retraite représentait qu’il n’avait que vingt et un ans et qu’il ne savait que se battre, et il demandait que l’on confiât à un autre un honneur dont il ne se reconnaissait pas digne. Mais il y avait déjà plus de six mois qu’il avait prononcé son immortelle harangue : « Si j’avance, suivez-moi ; si je recule, tuez-moi ; si je meurs, vengez-moi ! » Et il marchait si bien et si vite en avant, le noble jeune homme, que les paysans avaient peine à le suivre. Il fallut donc qu’il se résignât à ce commandement en chef, qui devait achever d’immortaliser son nom.
Le bateau fuit en déployant au-dessus de nos têtes son blanc panache de fumée, et nous nous séparons de la grande armée vendéenne, que nos souvenirs voient remonter vers Ingrande, tandis que nous descendons vers Ancenis. À mesure que nous continuons notre route, et surtout quand nous approchons de Nantes, le lit du fleuve s’élargit. À peu de distance de la grande ville, qui ne compte pas moins de cent huit mille habitants, au nord l’Erdre, au sud la Sèvre, se jettent dans la Loire, qui grossit de plus en plus. Lorsqu’enfin Nantes apparaît à nos regards, nous nous rendons compte, en voyant les nombreux bras de la Loire et la largeur de son cours principal, de la difficulté que présentait l’attaque de la ville, située sur la rive droite du fleuve, et de l’échec qu’éprouva l’armée vendéenne lorsque Cathelineau, qui avec son impétuosité ordinaire avait pénétré jusqu’à la place Viarmes, fut atteint d’un coup de feu.
Il semble que la Providence, qui a dessiné le cours des eaux sur la terre que nous habitons, et qui a élevé les coteaux et creusé les vallées, ait prédestiné l’emplacement où s’élève Nantes à recevoir une grande ville. En effet, la cité, construite dans cette situation, domine le cours et les deux rives du grand fleuve de la France de l’ouest, et les deux rivières, qui, coulant en sens opposés, lui apportent le tribut de leurs eaux, augmentent encore l’importance politique, militaire, commerciale de cette situation. Napoléon, dans ses dictées de Sainte-Hélène, a exprimé ce jugement : « Maîtres de Nantes, a-t-il dit, de cette grande ville qui leur assurait l’arrivée des convois anglais, les armées royales pouvaient sans danger manœuvrer sur les deux rives de la Loire et menacer Paris. Si, profitant de leur étonnant succès, Charette et Cathelineau eussent réuni leurs forces pour marcher sur la capitale, c’en était fait de la république. » Hélas ! Cathelineau avait à alléguer devant l’histoire une excuse, trop valable à laquelle n’a pas songé Napoléon ; suivant le mot sublime d’un paysan, son parent : « Le bon Cathelineau avait rendu à Dieu la grande âme que celui-ci lui avait donnée pour venger sa gloire ! »
La ville de Nantes, qui a pour armes un « navire équipé d’or aux voiles d’argent, au chef aussi d’argent semé d’hermines, l’écu couronné d’un cercle comtal, avec la devise : Favet Neptunus eunti, » est une belle et grande cité, quoiqu’elle ait bien quelques plaintes à élever contre Neptune, qui accumule les sables dans le lit de la Loire trop large en cet endroit pour que son cours soit assez rapide. Le sol de l’ancienne cité ne s’élève pas beaucoup au-dessus du fleuve, qui l’inonde à l’époque des grandes crues. Mais les nouveaux quartiers, bâtis sur les pentes douces qui descendent vers la Loire, sont plus sains que les anciens, et les maisons construites en pierres blanches qui se prêtent facilement aux fantaisies de la sculpture, à l’exclusion du granit employé dans le reste du département, donnent à cette charmante cité un aspect pittoresque et riant qui contraste avec les scènes de mort dont ces lieux ont été témoins. Là, tomba Cathelineau, le Saint de l’Anjou, ce glorieux paysan sorti du rang sous le drapeau blanc, comme un élu de Dieu et de la victoire, pendant qu’à la frontière d’autres jeunes victorieux, d’une origine aussi humble, sortaient du rang sous le drapeau tricolore. C’est encore sur la place Viarmes que, quelques années plus tard, l’illustre Charette fut fusillé après avoir répondu aux juges, qui lui demandaient pourquoi il avait repris les armes : « Pour ma religion, pour mon roi et pour ma patrie. » Je demandai à voir cette place où Carrier avait établi le quartier général de ses meurtres, d’où partirent les ordres homicides qui envoyèrent sur les bateaux à soupapes tant de victimes destinées à être englouties dans la Loire, qui charriait chaque jour des cadavres à la mer. C’est à cette époque que l’armée révolutionnaire de Brutus, composée de trois compagnies : les volontaires de Marat, au nombre de soixante hommes seulement ; les éclaireurs de la montagne, et les hussards américains, composés de nègres et de mulâtres, se forma à Nantes pour aider l’exterminateur révolutionnaire dans son effroyable besogne. Quand la religion et le sens moral se retirent du cœur de l’homme, il va plus loin que la bête fauve dans le goût du meurtre et la soif du sang. L’homme qui peut s’élever jusqu’à l’ange peut descendre jusqu’à Satan, et il y a vraiment quelque chose de diabolique dans la figure des monstres révolutionnaires de cette époque : Marat, Carrier et leurs émules avaient le génie du mal, comme saint Vincent de Paul avait le génie du bien.
Un de mes amis de l’Ouest, M. Edouard de Kersabiec, que j’étais allé voir, voulut bien m’indiquer aussi la maison qu’habitaient les demoiselles du Guigny, ces deux loyales Vendéennes qui donnèrent asile à la duchesse de Berry, en 1832 ; la sœur de M. de Kersabiec, mademoiselle Stylite, était la fidèle compagne de la princesse. Deux humbles servantes, Charlotte Moreau et Marie Boissy, se trouvèrent au-dessus de toutes les séductions d’un gouvernement qui disposait d’un budget d’un milliard. Si l’esprit court les rues à Paris, l’honneur court les routes en Vendée. MADAME, aussi heureuse que Charles II dans son malheur, trouva plus d’un Pendrill parmi les paysans de l’Ouest, et cette terre de fidélité lui offrit plus d’une fois le chêne de Boscobel, célébré par Joubert, l’ami de Fontanes et de Chateaubriand. Ce fut dans la maison de mesdemoiselles du Guigny que MADAME, en sortant avec ses vêtements à demi consumés d’une cachette placée derrière la plaque d’une cheminée rougie par le feu, dit au général Dermoncourt, qui l’avait poursuivie dans toute la Vendée :
– Général, je me remets à votre loyauté.
– Madame, répondit le général, vous êtes sous la sauvegarde de l’honneur français.
Mes moments étant comptés, je me contentai de jeter un coup d’œil sur le reste des vitraux de l’église de Saint-Nicolas, au nombre des plus beaux qui fussent en France, et sur l’admirable monument qu’avec l’aide du ciseau du célèbre Michel Columb Anne de Bretagne éleva à son père François II. Ce tombeau, sur lequel l’image de marbre du duc François II est couchée, est un remarquable spécimen de la sculpture au xve siècle. Les statues de femmes adossées aux quatre coins du monument, les anges qui soutiennent les oreillers sur lesquels repose la tête du duc dormant son dernier sommeil, et jusqu’à la levrette de Bretagne et au lion accroupi aux pieds du trépassé, concourent à l’expression de morne majesté de ce beau morceau. Le temps vole, il faut partir ; à sept heures, j’étais dans le coupé de la petite diligence qui conduisait, en dix heures environ, de Nantes à Vannes.
Je serais tenté de croire que les chemins de fer ont diminué la patience humaine en raison directe de ce qu’ils ont ajouté à la vitesse de la locomotion. Les enfants gâtés de la vapeur voudraient qu’on attelât des chevaux de course aux diligences, et je n’oserais affirmer qu’il ne se rencontre pas des gens disposés à trouver la vapeur paresseuse depuis l’avènement du télégraphe électrique. « Marche ! marche ! » c’est le cri de notre temps, et Dieu sait pourtant où l’on arrive et comment on arrive ! On est moins pressé en Bretagne, et notre attelage cheminait assez lentement. À la pâle lueur de la lune, qui éclairait la route de ses rayons douteux, j’apercevais quelques échappées du paysage, et un de mes compagnons de voiture voulait bien me fournir les explications que je lui demandais. La lune, sortie de dessous un nuage, donnait en plein quand nous arrivâmes à la Roche-Bernard. Au moment où nous allions nous engager sur le pont immense, aux arches gigantesques et étroites, qui domine de cent pieds au moins les plus hautes marées, j’aperçus le cours de la Vilaine, roulant vilainement ses flots sombres et tristes à travers un paysage de rochers. J’ai rarement vu de paysage aussi désolé que celui-ci ; on dirait que ce lieu a été le théâtre d’un cataclysme de la nature, et l’imagination placerait volontiers, sur les bords maudits et déserts de la Vilaine aux flots noirs, le souvenir de quelqu’un de ces grands crimes qui effrayent l’humanité.
Ordinairement on descend de voiture pour passer le pont de la Roche-Bernard ; le mouvement d’oscillation, que les grands vents qui viennent de la mer impriment au tablier de ce pont gigantesque, effraye beaucoup de voyageurs et surtout de voyageuses, et je me hâte d’ajouter que leurs appréhensions ne sont pas tout à fait sans motif. Il y a quelques années, en effet, le pont sur lequel j’ai passé en 1850 et 1851 fut emporté par un coup de vent. J’ai entendu depuis raconter, par un bon et respectable prêtre de la province, que, se trouvant dans une voiture publique, par le plus beau temps du monde, sur le pont de la Roche-Bernard, il eut toutes les peines du monde à se défendre contre les instances d’une voyageuse que la peur avait jetée dans une crise nerveuse, et qui voulait absolument qu’il lui donnât l’absolution, sauf à entendre plus tard sa confession. Cette furie de dévotion s’apaisa au bout du pont et ne dépassa pas la dernière arche. Ne rions pas trop de cette femme ; combien y en a-t-il parmi nous qui n’aient pas à se reprocher quelque bonne résolution prise au milieu du péril, et, dès qu’il vient à disparaître, oubliée ?
À peine avions-nous fait quelques pas au-delà du pont, que j’entendis un bruit de voix qui chantaient sur un rythme lent et mélancolique des paroles dont je ne comprenais pas le sens ; des pas cadencés marquaient la mesure de ce chant grave et monotone. « Qui peut chanter à cette heure, et que chante-t-on ? demandai-je à mon compagnon de voyage. – Ce sont, me répondit-il, des pèlerins bretons qui n’ont pu se trouver à Sainte-Anne le jour du grand pardon, et qui se rendent, en chantant des cantiques, à ce sanctuaire révéré pour faire leur pèlerinage particulier. Nous sommes en Morbihan. »
Je demeurai pensif et silencieux, et, quelques minutes après, je vis passer les pèlerins. Les hommes et les femmes marchaient par bandes séparées, et on pouvait juger, au pas allègre et allongé des marcheurs, qu’ils arriveraient vite au but de leur pèlerinage ; la foi leur donnait des ailes. Je me souvins involontairement des vers au mètre rapide de Brizeux :
Ce fut ma première émotion en entrant dans le Morbihan, cette terre de foi et de prière. Voici quelle fut la seconde : le crépuscule commençait à se lever ; j’aperçus dans la campagne un de ces calvaires rustiques si communs dans ce pays, qui aime tout ce qui lui rappelle que nous devons vivre pour le Dieu qui mourut pour nous. Un paysan, avant de se rendre au travail de la journée, s’était agenouillé devant ce calvaire et priait de tout son cœur. Le bruit de la diligence qui passait ne le troubla pas, et il ne détourna pas la tête pour nous regarder : il avait mieux à faire. Ce recueillement me rappela le trait raconté par madame de la Rochejaquelein, au sujet des soldats vendéens qui, trouvant sur leur chemin un calvaire, au moment où ils s’élançaient contre les bleus, s’agenouillèrent par un mouvement spontané. Un officier, qui ne connaissait ni cette population ni cette guerre, voulut les rappeler au sentiment de la situation. « Laissez-les prier, dit Lescure, qui s’y connaissait, ils ne s’en battront que mieux après. » Quelques minutes après, en effet, ces paysans héroïques inventaient, un demi-siècle à l’avance, la tactique des zouaves, et prenaient à la course une batterie, sans lui laisser le temps de tirer une seconde volée. La vie aussi est un combat, et le travail est une lutte pour ces laborieux agriculteurs, obligés d’arracher à la terre la moisson fécondée par leur sueur. La prière est donc bonne pour qui tient le manche de la charrue comme pour qui tient la crosse du mousquet.
En Bretagne, tous travaillent et tous prient. On voit les femmes, en revenant du marché, continuer vaillamment leur tricot, soit à pied, soit à cheval, quand leurs doigts ne tiennent pas les grains de leur chapelet. Le tricot et la quenouille se partagent, avec les soins à donner aux bestiaux, les journées des femmes. Nous étions presque à la porte de Vannes, lorsque j’aperçus, près d’une haie, une jeune femme qui, debout, filait une quenouille, tandis qu’un jeune garçon tenait la vache qu’il allait sans doute conduire sur la lande. La prière d’abord, le travail ensuite ; le rude travail du labour, puis l’élève des bestiaux ; enfin le travail manuel des femmes, le plus ancien dans la province ; car du Guesclin disait déjà fièrement, il y a trois siècles, au prince Noir, qu’il n’y avait pas de fileuse en Bretagne qui ne filât une quenouille pour contribuer au payement de sa rançon ; n’est-ce pas la Bretagne presque tout entière ? n’est-ce pas surtout le Morbihan ?
Quelques mots seulement sur la situation, les limites et l’aspect général du Morbihan, ce département formé d’une partie de la basse Bretagne. Il est situé dans la région N.-O. de la France, et il doit son nom à sa position sur le golfe du Morbihan, en langue celtique la Petite Mer. C’est une contrée, maritime, dont les limites sont : au nord, le département des Côtes-du-Nord ; au sud, l’océan Atlantique ; à l’est, les départements d’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure ; à l’ouest, celui du Finistère. Il y a peu de départements en France dont l’aspect soit aussi pittoresque. La partie septentrionale se dessine en collines couvertes de landes et tapissées de bruyères, dont l’inclinaison générale se porte vers le sud ; là, elles viennent expirer sur des plaines fertiles et des vallées plantureuses arrosées par de nombreux cours d’eau, la Vilaine, le Blavet, l’Auray, et leurs affluents, l’Oust, le Larhon, le Lié, le Ninian, la Claye, l’Aff et l’Artz, qui se jettent dans la Vilaine ; la Sar, l’Evel, le Ligan, le Tarun, le Scorff, qui se jettent dans le Blavet ; la Sale, qui se jette dans l’Auray. La superficie du Morbihan est de 679 781 hectares, et sa population de 486 804 habitants, ce qui donne à peu près 72 habitants par kilomètre carré. Sur cette superficie, il y a 260 600 hectares de terres labourables, 63 500 de prairies naturelles, 1 700 de vignes, 274 000 de pâturages, landes, bruyères et pâtis, et 73 500 de bois, forêts et terres incultes. On arrive ainsi au chiffre de 673 300 hectares ; le reste est occupé par les routes et les chemins. La propriété y est morcelée en deux millions de parcelles, possédées par 120 000 propriétaires. On compte dans le Morbihan 47 000 chevaux de race bretonne, 315 000 bêtes à cornes, 220 000 moutons, 69 000 porcs, 84 000 ruches d’abeilles, 8 000 boucs, chèvres et chevreaux. Les principales essences de ses forêts sont le chêne, le hêtre ; il y a, dans le voisinage de Vannes, quelques châtaigneraies. Le Morbihan fabrique en moyenne 441 000 hectolitres de cidre, et récolte 130 000 hectolitres de pommes de terre. L’agriculture y est en progrès. Depuis le commencement du siècle, sa population s’est accrue de 99 000 âmes, et de 14 000 depuis le recensement de 1860. Rien de plus curieux que sa côte, bizarrement découpée en baies, en rades et en ports, et hérissée de caps et de promontoires. La presqu’île de Quiberon fait une saillie de douze kilomètres dans la mer, et les presqu’îles de Rhuys et de Crac, en étendant comme des grands bras leurs pointes rapprochées, ont formé cette petite mer que les Celtes ont nommée le Morbihan. Au-delà, le grand océan Atlantique, poussé par les vents du sud-ouest, vient déferler sur la côte dentelée qui s’étend de l’embouchure de la Vilaine jusqu’à Lorient.
J’ai ajouté à mes observations personnelles l’étude des documents historiques, écrits ou restés inédits, qui pouvaient compléter les notions que j’avais recueillies. C’est ainsi qu’en grossissant ma gerbe de tous les épis que pouvait m’offrir le passé, j’ai été amené à composer cet écrit, dont les trois points culminants, assez semblables à ces grands menhirs qui dominent mélancoliquement la côte morbihannaise, sont Sainte-Anne d’Auray et son pèlerinage, Quiberon, et enfin le Champ des Martyrs.
Quand on se place sur la butte de Kérino, qui s’élève au bout du port, pour embrasser d’un coup d’œil la ville de Vannes, située à l’extrémité septentrionale et à seize kilomètres de l’embouchure du golfe du Morbihan, cette ville, dont les édifices apparaissent groupés en amphithéâtre sur le sommet et le versant méridional d’une colline au bas de laquelle coule une petite rivière, et qui se prolonge dans la vallée où l’on a construit deux quartiers dont la plupart des maisons, à cause de l’humidité du terrain, sont bâties sur pilotis, présente un aspect agréable et pittoresque. Vannes, semblable à ces personnes qu’il faut voir par leur bon côté pour les apprécier, mérite alors le nom de Gwenet (la blanche), ou de Vennet (la belle), que l’amour filial de ses enfants lui a donné. L’impression est moins favorable quand, en arrivant comme nous par la diligence, on s’engage dans la ville. Des rues tortueuses et humides, des carrefours sombres sur lesquels donnent de gothiques maisons hâlées par le temps et le vent qui souffle de la mer, disposent l’âme à la mélancolie. La vieillesse a par elle-même quelque chose de grave et de sévère, et Vannes est une vieille cité. Elle remonte si haut dans l’histoire, qu’elle eut l’honneur, – redoutable honneur ! – d’avoir César pour ennemi et pour historien. Je sais qu’un litige s’est élevé sur la situation de Vannes antique, que les uns placent au bourg de Locmariaker, qui est comme encombré de débris d’antiquités romaines, tandis que d’autres veulent que la capitale des Vénètes, Dariorigum, ait été bâtie sur l’emplacement de Vannes, ou à peu de distance.
Je ne possédais pas l’érudition géographique et archéologique nécessaire pour résoudre ce problème ; d’ailleurs, ce n’était pas précisément pour découvrir la position de l’antique Oppidum des Vénètes que j’étais venu dans le Morbihan. Il me suffisait de savoir que les Vénètes étaient un peuple vaillant et tenace qui, réfugié dans ses lagunes, comme, à une autre extrémité de l’Europe et sur une autre mer, les Vénitiens, avait énergiquement lutté contre la fortune de Rome. Habitant quelques points fortifiés situés au milieu de vastes et profonds marais produits par les inondations de l’Océan, les Vénètes, entourés de ces lagunes de l’Ouest, rendaient leur pays presque inaccessible en coupant les routes et les chaussées. Quand la mer était basse, ni armées ni flottes ne pouvaient arriver jusqu’à eux ; à la marée haute, les navires arrivaient ; mais, comme les Vénètes étaient les plus hardis marins du monde et qu’ils possédaient des bâtiments de haut bord construits en chêne, aux flancs épais, aux poupes et aux proues hautes comme des forteresses, ils méprisaient les légères trirèmes des Romains. Le génie de César surmonta cependant tous ces obstacles. Les Romains, armés de longues faux emmanchées dans des perches immenses, coupaient les agrès des navires, et, après leur avoir ainsi ôté tout moyen de gouverner, ils entouraient de leurs légères galères ces masses immobiles comme des forteresses au milieu de l’Océan, et ils les prenaient d’assaut ; ces faux remplaçaient l’artillerie, et ces galères étaient les canonnières du temps. Les Vénètes furent donc vaincus et traités en ennemis, selon l’énergique expression de César ; c’est-à-dire que l’élite de leurs marins fut précipitée dans les flots ou passée au fil de l’épée ; « le reste de la population, vendu à l’encan, dit M. Amédée Thierry, alla, sous le fouet des marchands d’esclaves, garnir le marché de la province et de l’Italie. » Bien des siècles plus tard, le néo-paganisme de la Révolution française devait se montrer, aux mêmes lieux, aussi inhumain que le paganisme antique et l’impitoyable génie de Rome, contre les Morbihanais, restés aussi fiera et aussi inflexibles que leurs lointains aïeux.
La position de Vannes offrait des avantages naturels qui lui assignaient un rôle important dans tous les siècles. Aussi voyons-nous les Anglais, dans les longues guerres que nous eûmes avec eux, attacher un grand intérêt à la possession de Vannes. Édouard III, ce terrible Édouard qui gagna contre nous la bataille de Crécy, une de ces blessures qui saigneront éternellement dans notre histoire, écrivait au prince de Galles, ce redouté prince Noir qui devait gagner contre nous la bataille de Poitiers, cet autre désastre qui forme, avec Azincourt, une trilogie fatale, une lettre pour lui annoncer la résolution de mettre le siège devant Vannes. Voici un passage de cette curieuse lettre, dont le style annonce que la langue française, comme la France elle-même, était encore à cette époque en voie de formation : « Très chier filtz, sachiez qe par l’advis et conseils des plus sages de nostre ost, avons mys nostre siege à la cité de Vanes, qu’est, la meillour de Bretaigne après la ville de Nauntes, et plus poet (peut) grever et restreindre le païs à nôtre obéissance, qar il nous estoit advis que si nous eussoms (eussions) chivaché plus avaunt, sauns (sans) etre seur de la dite ville, le païs qu’est renduz à nous, ne pourroit tenir devers nous en nulle mannèrre (manière). La dite ville est seur la mear (mer), et est bien fermiez ; qe si nous la puissoms aver (pouvons avoir), il serra greaunt esploit à nostre guerre. Le païs est assez pleniteouse des blés et de char. » Édouard III n’eut point Vannes, dont les habitants repoussèrent l’armée anglaise.
Quand j’arrivai à Vannes, la ville était sous l’émotion de la présence du conseil général, qui, dans une proportion réduite, donne à la cité dans laquelle il se rassemble un peu du mouvement et de la vie des anciens états. Je descendis à l’Hôtel du Dauphin, situé sur la place, et où plusieurs de mes collègues, membres du conseil, se trouvaient réunis. Le luxe et le confort, ces corrupteurs de notre temps, n’avaient pas obtenu, lors de mon premier voyage, droit de cité à Vannes, qui n’a rien de commun, Dieu merci ! avec Capoue. Je ne pense pas que l’Hôtel du Dauphin pût avoir du temps où Édouard III mettait le siège devant la ville un mobilier très différent de celui que j’y trouvai en l’an de grâce 1850. Notez que c’est un fait que je constate, et non une plainte que j’exprime : quand on trouve dans une hôtellerie bon lit et bon visage, nourriture saine et soins suffisants, a-t-on le droit de demander quelque chose de plus ? Les tentures de soie, les tapis soyeux, les glaces, les pendules et les bronzes, se payent comme le reste, quoiqu’on ne les porte pas sur la carte, et je ne suis pas de ceux qui croient à la nécessité de ce superflu. Je vois encore d’ici ma modeste chambre, dont l’ameublement se composait de deux immenses lits à baldaquins de serge verte, où l’on aurait pu coucher en travers comme en long, d’une commode et d’un secrétaire en bois de noyer, qui n’avaient pas attendu pour être façonnés les immortelles idées de 1789, et de quelques chaises de paille avec un seul fauteuil. Une petite table en bois blanc pour écrire, accessoire nécessaire pour l’hôte qui habitait cette pièce à cette époque, complétait le mobilier ; car je ne parle pas d’une espèce de trépied destiné à recevoir la malle du voyageur. Point de cristaux, de bronzes, de porcelaines : un gobelet et une carafe en verre, un chandelier en cuivre sur lequel s’élevait un laminaire que l’on appelait naïvement à Vannes une chandelle, et que la langue parisienne aurait baptisé du nom de bougie, sans pour cela lui ôter l’odeur du suif ; un pot à eau et une cuvette de terre blanche ; mais du linge beau et épais qui faisait honneur à la quenouille des fileuses de Bretagne, des couvertures en riche laine, et des draps qui répandaient une bonne et fraîche odeur de lessive.
Après quelques heures de sommeil, dont j’avais besoin pour me reposer de ma course rapide, je m’habillai à la hâte, et j’eus quelques mains amies à serrer. Je ne prétends pas faire ici, comme de raison, l’histoire de la députation du Morbihan en 1850 ; je crois pouvoir seulement affirmer que, dans cette province comme dans un grand nombre de provinces de France, le bon sens populaire avait cherché dans tous les rangs des hommes de bonne volonté et de convictions fortes. Il y avait parmi nous des gentilshommes honorés et aimés, un prêtre d’un esprit juste et vif, d’un caractère sûr et ferme dans son inébranlable douceur ; un homme de la bourgeoisie, intelligence studieuse et ornée, cœur honnête, pur, religieux et fervent, M. Monnier, qui avait professé autrefois avec distinction au collège de Vannes, et que je nomme et que je loue en toute liberté, parce que, dès la première année de la Législative, il mourut à Paris, en demandant que son corps fût transporté dans son cher Morbihan, où il voulait dormir son dernier sommeil. Enfin je représentais dans la députation cette puissance vague et indéfinie qu’on appelait, à cette époque, un quatrième pouvoir dans l’État, la presse, pouvoir qui, après avoir contribué à tant de déchéances, n’est plus, à son tour, au moment où j’écris, qu’un pouvoir déchu.
Après quelques bonnes paroles échangées, nous convînmes d’aller, le jour même, à Auray, pour nous rendre de là à Sainte-Anne. Pour quiconque vient dans le Morbihan, ce pèlerinage est un devoir de piété et de cœur. J’avais en outre, en m’y rendant, une dette de reconnaissance à payer. Le petit séminaire du Morbihan est situé dans le lieu même du pèlerinage, et il était alors sous la direction d’un homme qui m’avait, malgré sa jeunesse, inspiré autant de respect que d’affection ; c’était un de ces jeunes prêtres dans lesquels la grâce de Dieu semble se presser d’agir, parce qu’il n’entre pas dans la volonté de sa providence de les laisser longtemps sur la terre. Je réclame, à l’égard de M. l’abbé Le Blanc, comme tout à l’heure à l’égard de M. Monnier, la liberté de la louange, parce que cette louange ressemble ici à ces fleurs qu’on effeuille sur un tombeau. L’épi mûrit si vite, que le céleste moissonneur n’attendit pas, pour le cueillir, le temps ordinaire de la moisson. C’était ce jeune prêtre qui, renonçant aux assemblées politiques où il aurait pu briller par la solidité et la clairvoyance de son esprit comme par la fermeté pleine de douceur de son caractère, m’avait désigné pour son successeur, en préférant à l’éclat de la position qu’il abandonnait les services obscurs mais inappréciables qu’il pouvait rendre, en formant ceux qui sont appelés à former les autres. Je remis donc à mon prochain retour les visites que j’avais à faire à Vannes et les courses que je projetais dans cette ville, et je me mis en route pour Auray dans un de ces cabriolets traînés par un des chevaux du pays qui ont quelques-unes des qualités de leur province : car ils mangent peu, réclament peu de soins, et marchent vite et longtemps. Un jeune gars de quatorze ans, assis sur le brancard, était notre cocher ; M. l’abbé Lecrom, le collègue dont j’ai parlé plus haut, et moi, nous remplissions le cabriolet dans lequel nous roulions vers Auray.
La route de Vannes à Auray se déroule, sur une étendue de seize kilomètres, en partie à travers des bois profonds et touffus, dans lesquels, à plus d’une époque, et même sous le gouvernement de Juillet, les réfractaires ont cherché un asile. La connivence que trouvaient dans le pays ces hommes, la plupart doux, religieux et honnêtes, mais qui ne pouvaient se résoudre à servir un pouvoir qui blessait tous leurs sentiments et tous leurs souvenirs, les dérobait presque toujours aux poursuites de la gendarmerie. Point de chaumière, de métairie, point de château où on leur refusât l’écuelle de soupe, le morceau de pain et le verre de cidre dont ils avaient besoin pour soutenir leur vie errante. Un d’entre eux s’était créé une industrie dont j’emportai un spécimen à Paris. Dans les heures longues et solitaires qu’il passait dans les bois, il s’était exercé à tailler avec son couteau des ustensiles de buis, en demandant préalablement à un grand propriétaire, – car pour être un réfractaire on n’est pas un voleur, et les forêts du Morbihan n’ont rien de commun avec la forêt de Bondy à la mauvaise renommée, – la permission de prendre dans ses propriétés la matière première de son travail. Le propriétaire dont il s’agit s’était hâté de donner la permission demandée, et j’emportai à Paris un couvert de buis ; sans être un chef-d’œuvre de sculpture, c’était vraiment une œuvre remarquablement ornementée par le couteau de cet artiste rustique, qui, à côté de quelques arabesques de fantaisie et des premières lettres de son nom signant son œuvre, avait gravé trois signes cabalistiques, vœu fervent sorti d’un cœur dévoué et plus habitué à prier pour le malheur que pour la prospérité, pour l’exil que pour les gouvernements établis. Cette position d’outlaw dans une société civilisée ne laissait pas cependant d’avoir des inconvénients. Mon compagnon de voyage me montra, chemin faisant, un carrefour boisé et profondément encaissé dans une vallée arrosée par un petit cours d’eau, où plusieurs réfractaires surpris avaient récemment fait le coup de feu avec les gendarmes : car, s’ils ne tiraient jamais les premiers, ils rendaient coup pour coup. De retour à Paris, nous fîmes, avec nos autres collègues, des démarches pour faire cesser cette situation anormale et dangereuse, et nous fûmes assez heureux pour réussir.
À une lieue de Vannes et à deux lieues d’Auray, nous rencontrâmes, au milieu d’un petit village, une antique et pauvre chapelle consacrée à la sainte Vierge, et à laquelle se rattache une légende restée chère aux souvenirs populaires. À l’époque de la dernière croisade, dit la légende, qui n’est fondée, il faut en convenir, sur aucun document authentique, un chevalier du Garo, seigneur du château du même nom, dont on aperçoit les vastes ruines à peu de distance, fut sauvé par un miracle qui rappelle celui de Notre-Dame-de-Liesse. Fait prisonnier à Bethléem, avec son écuyer, par les mécréants, le sire du Garo avait été enfermé, ainsi que lui, dans un coffre en bois, et ils devaient subir ensemble, le lendemain, le supplice du pal. Les longues heures de cette suprême nuit, attristée par l’attente d’un horrible lendemain, s’étaient passées pour ces deux infortunés dans une fervente prière ; le rosaire n’avait pas quitté leurs doigts, et le nom de la sainte Vierge leurs lèvres : « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort ! » répétaient-ils ; et leur accent devenait plus pressant et plus vif à mesure que l’heure de cette mort cruelle et inévitable approchait. Les premiers rayons du soleil commençaient à pénétrer à travers les fissures des planches du coffre, et ils étaient dans l’agonie de l’attente, lorsque l’écuyer, appliquant son œil à une de ces fissures, s’écria avec un étonnement dans lequel perçait un mouvement de joie, qu’il apercevait une verte campagne toute pareille à celle de son pays. Le sire du Garo l’interrompit par un gémissement, et le supplia de ne pas lui rappeler des souvenirs qui amolliraient son courage, si près du moment où il allait avoir à affronter le martyre. Mais l’écuyer, dont l’œil était resté attaché sur la fente du coffre, répéta avec plus d’assurance que jamais :
– Monseigneur, je ne me trompe pas ; c’est bien la campagne de notre chère Bretagne, et, je l’affirmerais presque, c’est celle qui entoure votre noble château du Garo.
C’est alors qu’il aurait fallu voir le sire du Garo s’irriter et tout à la fois se lamenter ! Il pleurait, le bon chevalier, au souvenir de son vieux manoir, de sa jeune femme et de ses petits enfants qu’il y avait laissés. Pourquoi avoir prononcé ce nom qui lui avait rendu la vie si douce et qui allait lui rendre la mort plus amère, en lui rappelant tout ce qu’il perdait ? Et les larmes du bon chevalier coulaient, coulaient, et les grains du rosaire continuaient de rouler entre ses doigts, et le doux nom de Marie, la Mère des douleurs et la consolatrice des affligés, revenait sans cesse sur ses lèvres. Tout à coup un bruit de voix retentit.
– Allons, dit le chevalier, préparons-nous, ce sont les bourreaux qui arrivent.
– Par la grâce de Dieu et de sa sainte Mère, vous vous trompez, monseigneur, ce sont les femmes du village, du Garo qui vont porter leur lait à la ville de Vannes.
Quelques minutes après, le coffre s’ouvrait, et le sire du Garo, accompagné de son écuyer, allait, entouré de ses vassaux ivres de joie, rendre grâce à Dieu du miracle qu’il avait fait en sa faveur, et faisait le vœu de bâtir dans ce lieu une chapelle à Notre-Dame.
Voilà la légende qui se rattache à la chapelle de Notre-Dame-de-Bethléem. Pendant que mon compagnon de voyage me la racontait, notre cheval breton continuait sa course rapide, et bientôt nous entrions dans la charmante petite ville d’Auray, gracieusement assise sur la rivière du même nom.
Au moment où nous entrions à Auray, deux noces, sortant de l’église, commençaient à former sur la promenade de la ville, au son national du biniou, qui accentue si vivement la mesure, ces rondes bretonnes qui plaisaient tant à madame de Sévigné. Il y avait un moment, en effet, où ces rondes prenaient un caractère plein d’intérêt, et qui n’était pas sans grâce. Ces danseurs aux longs cheveux, aux larges chapeaux et aux vastes braies, tenant par la main les jeunes femmes et les jeunes filles, aux bonnets plus blancs que la neige, qui, assez semblables aux bonnets des filles de Saint-Vincent de Paul, descendent sur le cou et sur les épaules, et abritent le visage contre les rayons du soleil et le vent cuisant qui souffle de la mer, tournaient quelque temps, tantôt d’un pas lent, tantôt d’un pas rapide ; puis, tout à coup, la ronde s’arrêtait, et, sans que les mains se quittassent, les deux moitiés du cercle se rapprochaient vivement avec un élan rythmique, par un avant-deux plein d’entrain et de verve, dont le biniou, gonflé par le musicien, donnait le signal en accentuant plus vivement son appel. Déjà, en 1850, le petit bonnet coquet que portent nos lingères faisait concurrence à la coiffure nationale des jeunes filles d’Auray. Je regretterais, dans l’intérêt de l’art comme dans celui des femmes d’Auray, dont les traits sont généralement réguliers et agréables, que ce nouveau venu, qui n’a ni caractère ni raison d’être dans ce climat sujet au vent et à la pluie, remportât la victoire ; mais, dans ce temps où tout passe, comment les bonnets ne passeraient-ils pas ?
Je rencontrai chez le respectable curé d’Auray, qui avait l’honneur de recevoir son évêque à dîner dans son nouveau presbytère, construit en granit, selon l’usage du pays, plusieurs de mes collègues, entre autres MM. de Saint-Georges et de Kéridec. M. le comte de Saint-Georges, père du représentant et lui-même ancien député de la Restauration, demeuré debout au milieu de la société de notre temps, comme un de ces types d’honneur et de loyauté sur lesquels les révolutions n’ont pas de prise, occupait, à côté de monseigneur, la place d’honneur qui lui appartenait à tant de titres. M. l’abbé Le Blanc, que je venais chercher de Vannes, était là avec un grand nombre d’ecclésiastiques ; M. de Gouvello de Kérantré, M. Doré, maire de la ville et habile et intelligent constructeur de navires, M. Georges de Cadoudal, qui arrivait avec nous de Vannes, étaient au nombre des convives. Le dîner fut long, comme tous les dîners bretons : des poissons magnifiques, pêchés dans l’Océan ; le cidre, qui est la boisson nationale du pays ; le vin de Bordeaux, que la mer améliore en le portant sur les côtes de la Bretagne ; le vin de Malaga, que l’Espagne lui envoie, faisaient de ce dîner une sorte de banquet, animé par une conversation tout à la fois vive et amicale ; car tous ceux qui étaient assis à cette table étaient unis d’esprit comme de cœur.
Après le repas, nous fîmes une courte promenade dans la ville, et M. de Saint-Georges père voulut bien me conduire à la tour de la Croix, position élevée du faîte de laquelle on aperçoit un magnifique panorama. La petite ville d’Auray, qui a assez de mérites réels pour ne pas avoir de prétentions, a pourtant celle d’avoir été fondée par le roi Artus, si célèbre par les récits de la Table ronde. Tout ce que je puis dire, c’est que si elle doit à l’enchanteur Merlin les avantages de sa position, la beauté de son site et le charme de son paysage, la baguette du célèbre enchanteur l’a admirablement douée. Lorsqu’on gravit les pentes conduisant au Loch, cette promenade publique qui domine l’Auray, rivière d’un cours peu étendu qui, prenant sa source à Plaudren, longe la ville à laquelle elle a donné son nom, avant de se précipiter dans la mer, on est étonné de la beauté du spectacle qu’on a sous les yeux, et que le R.P. Martin a si bien décrit dans son petit livre sur le pèlerinage de Sainte-Anne. Au nord apparaissent la Chartreuse, le bourg de Brech, et, plus loin, la jolie flèche de Pluvigner, dominant les forêts de Camors, de Floranges et de Lanvaux ; plus à droite, les châteaux de Treulan, de Kerso et de Kermadio, le bourg de Pluneret, le campanile de Sainte-Anne, ce pèlerinage aussi cher à la Bretagne que celui de Saint-Jacques de Compostelle l’est à l’Espagne, comme l’a écrit M. Rio ; enfin Grand-Champ à l’extrémité de l’horizon. Au levant, la route de Vannes se déroule comme un ruban, et, au-delà des larges landes à la couleur dorée, l’œil découvre les clochers de Plœren, Plougoumélen, Baden, enfin Vannes, l’antique cité ; puis Port-Navalo, Sarzeau et Saint-Gildas-de-Rhuis, où l’on visite les ruines de l’église du monastère, un moment gouverné par Abailard, qui était allé chercher la paix sur les bords d’une mer toujours agitée et au milieu d’une population « dont la langue barbare lui était, disait-il, inconnue. » Au midi, le bras de mer d’Auray se déploie sous les yeux du spectateur avec un tableau mouvant, animé par les chaloupes, les péniches, les chasse-marées, les bricks, les goélettes, enfin les navires de toute espèce : les constructeurs d’Auray lancent des bâtiments de cinq cents tonneaux, il y en a qui vont jusqu’à huit cents. Les deux rives, fortement accidentées, laissent apparaître, à travers des rochers battus par les flots, des bouquets de pins et de sapins fouettés par les vents d’ouest, qui sont terribles dans cette région, le pavillon de Haute-Folie, et les châteaux de Plessis-Kaer, de Kerisper-Montaigu et de Kérantré-Gouvello. La vue s’étend, de ce côté, sur l’île aux Moines, l’île d’Arz et les groupes de rochers semés dans le golfe du Morbihan, la petite mer, comme l’appellent les Bretons à cause du voisinage de la grande. Le panorama continue à se développer jusqu’au phare de Belle-Isle et aux rochers menaçants d’Houat et d’Hoëdic. En remontant vers le couchant on voit apparaître Crach et les ruines pittoresques du château et de la chapelle de Locmaria ; plus loin, Carnac et cette armée de pierres blanches qui se dressent comme des géants pétrifiés dans la plaine, en posant, comme le sphinx égyptien, une énigme dont les archéologues cherchent encore le sens. Derrière Garnac, se cache Quiberon, Quiberon, dont le nom gémit dans notre histoire en évoquant un éternel souvenir de sang et de deuil, et que je retrouverai à la fin de ce récit dont il sera le couronnement ! La gentille ville d’Auray, après avoir été une position militaire importante, que Charles de Blois et Montfort se disputèrent, après avoir perdu cette importance avec son château fort, que Henri II fit démolir en 1558, et dont les pierres furent employées à la construction du fort de Belle-Isle, après avoir été un moment privée de sa richesse commerciale, a retrouvé la prospérité à laquelle sa position lui donne des droits ; l’activité règne dans son port, sur ses quais ; la construction, la pêche de la sardine, le grand et le petit cabotage, le commerce des grains, des fruits, du beurre, du miel, des bestiaux, des chevaux, une fabrique de dentelle, des tuileries, des briqueteries, répandent partout le travail et l’aisance.
La petite ville d’Auray, que je devais souvent revoir, m’a laissé, comme à tous ceux qui l’ont visitée, un agréable souvenir. Le charme de son site, la fraîcheur de ses eaux que le flux de la mer vient grossir, son port vivant et animé, l’aspect agreste de sa promenade du Loch, les splendeurs pittoresques du paysage dont elle est entourée, la grâce de ses femmes dans leur costume national, la mâle beauté de ses hommes, qui ont fourni à la chouannerie ses types les plus vigoureux, son église gothique et ses couvents à la flèche aiguë, les restes de son vieux château du Moyen Âge, enfin les souvenir évoqués de tous côtés par l’histoire, donnent à ces lieux un attrait si vif, qu’on souhaiterait d’y vivre, et qu’en les quittant on leur dit : Au revoir !
Nous partîmes de bonne heure d’Auray, le 6 septembre 1851, pour nous rendre à Sainte-Anne, où l’abbé Le Blanc nous avait donné rendez-vous. La distance est si courte, – une lieue à peu près, – que nous avions préféré, l’abbé Lecrom, plusieurs ecclésiastiques, quelques autres personnes et moi, faire le trajet à pied : pour un voyageur à qui le pays est inconnu, c’est la meilleure manière de le voir. Une belle journée d’automne favorisait d’ailleurs cette promenade, et la mer, qui n’est pas loin, nous envoyait de temps à autre une fraîche brise qui tempérait la chaleur du jour. Chateaubriand a écrit quelques pages délicieuses sur le printemps en Bretagne ; à en juger par trois des quatre voyages que j’ai faits dans le Morbihan, tous trois au mois de septembre, l’automne de la Bretagne vaut presque son printemps, car j’ai été continuellement favorisé par une température agréable et douce, et le soleil ne s’est pas caché pendant mon séjour sous ces brumes épaisses qui assombrissent les vers de Brizeux.
Nous partîmes vers dix heures du matin. Dans la soirée précédente, j’avais lu, avant de m’endormir, l’intéressant petit livre du R.P. Arthur Martin, de la Compagnie de Jésus, sur le Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray, et, la tête pleine des merveilles qui avaient fait établir cet oratoire, j’étais intarissable en questions auxquelles mes compagnons de route répondaient avec une inépuisable complaisance. « Il me semble, leur disais-je, que, sans admettre légèrement les miracles, nous ne devrions pas nous montrer trop difficiles à croire à de nouvelles preuves de la bonté de Dieu. Ne sommes-nous pas ses enfants ? N’est-il pas le meilleur des pères ? Un fils comblé de bontés par son père a-t-il le droit de se montrer incrédule quand on lui annonce que ce bon père vient de lui accorder une nouvelle faveur ? Il y a des esprits que le surnaturel choque : pauvres esprits forts qui mesurent à leur faiblesse et à la sécheresse de leur âme la puissance et la miséricorde de Dieu ! Esprits faibles et arrogants qui disent à la bonté infinie, cet autre océan, ce que la puissance infinie a seule le droit de dire à la mer : « Tu n’iras pas plus loin ! » Comme si ce qui est au-dessus de notre intelligence était au-dessus de la puissance et de la bonté divines ! Comme si l’ordre naturel que nous voyons presque exclusivement sur la terre ne faisait pas partie d’un ordre plus général, et comme si Dieu pouvait cesser d’être infini en puissance et en bonté parce que nous sommes petits par l’esprit et le cœur ! Pour moi, cette histoire me ravit. Je reconnais dans le bon Nicolazic, comme l’appelle le P. Martin, cette pureté, cette humilité et cette simplicité que la tradition nous montre dans les instruments dont Dieu aime à se servir pour répandre de nouvelles grâces sur la terre. C’est le David de la Bible que Dieu va chercher au milieu de son troupeau pour abattre le Philistin Goliath et pour remplacer l’infidèle Saül sur le trône d’Israël ; c’est cette Marie que l’ange salue en l’appelant pleine de grâce, sous l’humble toit du charpentier de Nazareth ; c’est, dans notre propre histoire, Jeanne d’Arc, à laquelle les anges et les saintes apparaissent en lui annonçant que Dieu ne veut pas que notre France, destinée à remplir une glorieuse mission sur la terre, soit écrasée par l’orgueilleuse Angleterre, et qu’il lui ordonne, à elle, simple bergerette des champs, de ceindre l’épée et d’aller délivrer Orléans aux abois, pour mener ensuite sacrer à Reims le gentil Dauphin de France. »





























