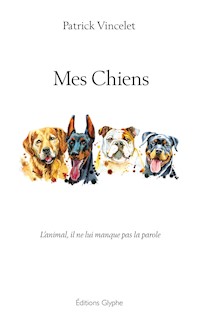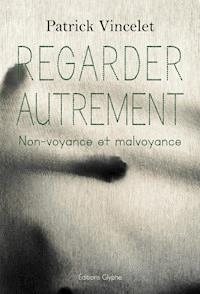
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Glyphe
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Patrick Vincelet bouscule les préjugés sur la cécité et propose un nouveau regard sur les non-voyants
Patrick Vincelet a consulté à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris, à l'Hôpital des Quinze-Vingts, à l'association Valentin Haüy et à l'école de chiens-guides de Paris. S'appuyant sur sa pratique, ce professeur d'université a formé de nombreux professionnels. Son enseignement sur la cécité et le regard, la sociologie du vu et du voir, l'œil et l'hystérie fut remarqué, et il a exposé sa position originale dans de nombreux colloques.
Il nous invite à regarder le handicap autrement et propose aux non-voyants et aux malvoyants des chemins d’autonomie. – Le regard partagé du non-voyant ou du malvoyant avec le voyant mérite une autre considération que celle de la bonne norme. On veut aider, il faut accompagner ; on veut comprendre, il faut écouter. Rien d'extraordinaire dans le talent de l’aveugle, rien d'exceptionnel dans l'attitude dite généreuse du voyant ; que de l'ordinaire pour poser un profond regard.
Un ouvrage complet et riche en références, adressé à tous.
EXTRAIT
La cécité n’est pas le noir ! Ce noir n’est noir que pour celui qui voit. Voilà déjà un décalage sérieux dans l’expression et l’imprécision des termes. Ce décalage est une source importante de l’incompréhension que soulignent de nombreux non-voyants aux voyants. De là à ne pas utiliser un vocabulaire commun, il y a un fossé et un sectarisme inadmissible. Ainsi, dire « voyez-vous ceci ou cela » à une personne qui ne voit pas est de l’ordre du bon sens, de la convivialité et du respect. Aucun mot de la langue, aucune expression ne doivent être tabous par peur de choquer ou de faire mal. Éviter les mots de la vue et du regard revient à tronquer la communication et l’échange, et même à différencier au-delà du handicap. Ce noir reste une énigme que l’on connaît dans les propos des personnes qui sortent du coma et des personnes opérées des yeux qui recouvrent une petite vision. Dans ces situations il n’est jamais question de noir. Certains parlent d’abîme, de trou, d’ailleurs, de voile… et même d’un autre monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Celui qui ne voit pas nous regarde autrement. Celui qui voit peut, à son tour, le regarder autrement.
Ce qui vient au monde pour ne rien perturber ne mérite ni égards ni patience.
René Char
À Benoît,
À Monique Petit, directrice de l’Institut national des jeunes aveugles
INTRODUCTION
HORS DES CHEMINS PARCOURUS et des sentiers battus par les nombreux exposés, les analyses, les articles et les ouvrages des professionnels du handicap visuel qui scindent, découpent, décomposent et dissèquent avec souvent bien du talent et de la constance, les divers temps d’apparition de la perte de la vue et les comportements en écho, j’ai voulu ici proposer un « autre regard ». Naître ou acquérir précocement, ou tardivement, la cécité ou la malvoyance, avec ce qui peut s’associer et s’ajouter à ce drame, mérite une réflexion contemporaine philosophique et sociétale. Empruntant à la médecine, à l’expérience et à la psychanalyse, les éléments de connaissance, enrichis de mes nombreux échanges avec les intéressés, cet ouvrage en est l’illustration. La voie originale du Sens de la vie se confronte à la perte d’un sens. Elle se conforte par un regard qui se pose en interaction, ouvrant, l’un à l’autre, le voyant et le non-voyant, le monde de ceux qui voient et le monde de ceux qui ne voient pas, ou avec ceux qui voient très peu.
L’acuité visuelle
En France, selon la législation, est « aveugle » la personne dont l’acuité visuelle est inférieure à 1/20. Est malvoyante, dite amblyope, la personne dont l’acuité est inférieure à 3/10 dans le meilleur œil avec la meilleure correction. Dans la vie quotidienne nous devons tenir compte de la façon dont chaque personne « utilise » ce qu’elle voit et ce qu’elle ne voit pas, nommés par ces mauvais termes : les « restes visuels ». (P. Vincelet in L’Ophtalmologiste Praticien 1976, n° 17)
« Quoi de plus fondamental que de comprendre avec notre Être de Chair et de Sang, notre Esprit, notre Âme, ce que sont les atouts de notre humble vie qui fait sienne les manques et les surplus ? » comme l’écrit Georges Bataille.
Je n’ai jamais considéré que le handicap fait le handicapé. Certainement de par mon éducation, reçue d’une mère professeur de philosophie, tolérante, généreuse, ouverte, et d’un père médecin, historien, ouvert aux cultures des différences.
La rencontre avec des personnes non-voyantes et très malvoyantes souffrant de troubles psychiques fut à l’origine de mon intérêt personnel et de ma compassion. Deux intrigues humaines : ne pas voir et ne pas entendre le raisonnable. Ma réflexion a été guidée par le souhait de comprendre et de transmettre. La psychanalyse m’a permis cette distance avec une affectivité très vive par un éclairage de langage structuré par la pensée. Enfin le regard est certainement pour moi la plus belle des fonctions de l’homme.
Ainsi mon expérience professionnelle auprès de personnes non-voyantes et très mal voyantes dans les établissements scolaires, les associations d’aide, les centres de consultation, les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, révélant autant de femmes et d’hommes, de jeunes et d’enfants, différents, de toutes origines et conditions, à l’affection acquise ou innée, accidentés ou malades, me permet ce modeste travail. J’ai pu enseigner à l’université que l’atteinte visuelle n’était pas leur originalité. Une histoire de jeunesse bien ordinaire est la mienne, dans un milieu culturel et non argenté. La chance est pour moi la rencontre avec des figures intellectuelles de notre diaspora des lettres et de la psychanalyse. Mon attrait pour ce qui se dit, se voit, se regarde et une passion pour la nature et le beau, le simple et l’amitié m’ont toujours habité. J’ai partagé quelquefois cela avec des non-voyants et je me suis surpris en regardant leurs yeux à saisir la palette des sentiments. La seule originalité est l’histoire propre de chacune et de chacun : une, unique, incomparable. L’affection ne peut réduire l’individu à une appellation de handicap.
En regardant le handicap d’une personne comme signe particulier le définissant, on risque de brouiller le regard sur la personne elle-même. On peut cacher et obturer la vraie personnalité d’autrui, interprétant à qui mieux mieux son comportement avec cette « grille » de compréhension. On peut aussi « passer à côté de soi », alors que la rencontre avec l’Autre aurait bien fait changer notre pensée : stigmatiser et caricaturer trop souvent obture l’œil de celui qui voit.
Le handicap
Le handicap est l’écart à la norme. Le pas qui se trouve entre l’idée que l’on se fait de soi et ce que l’on est réellement. Entre l’imaginaire propre et le réel. (P. Vincelet in Journal d’Ergothérapie 1980, 2. Masson)
Cet ouvrage s’adresse donc à celles et ceux qui s’interrogent sur la vue et sur le regard ; à celles et ceux qui se posent la question de l’atout que nous apporte la cécité ou la très mauvaise vue, dite « malvoyance. » Atout, oui, car avec son lot de fragilité, de peine, de douleurs, de contraintes pour vivre, qui mérite et exige le respect, et souvent la protection, j’affirme que le bonheur se partage entre tous ! À ceux qui veulent balayer les clichés de normalité et de pitié, ce livre est le leur.
Nous sommes à la recherche du Sens. Inspiré par la lecture de Cosmos, de Michel Onfray, j’oserai écrire en le citant : « Découvrir l’immensité du temps et la petitesse de nos vies, c’est apprendre le sublime, le découvrir, y tendre et vouloir y prendre place. » Le ciel étoilé est à chacun. Ainsi, il est une expérience commune que l’on peut partager alors que rien n’indique le « possible ». En l’absence de vue, l’étoile Polaire et toute la voûte étoilée prend sens et l’on observe le ciel avec une infinie sagesse. À titre d’exemple, un astronome de l’Observatoire de Paris a souvent décrit à ses deux parents non-voyants le ciel et la constellation des étoiles la nuit. Quelle belle sublimation de la rencontre de ces regards !
Je vous invite à partager la lecture de mon livre avec une personne dont il est ici question, à savoir celle qui ne voit pas ou très peu. On pourrait envisager une édition en braille ou en gros caractères : ce serait encore « cliver »… L’édition viendra peut-être après, partageons !
Je souhaite que ces propos s’inscrivent à la suite, et au renvoi à la très fameuse Lettre aux Aveugles de Denis Diderot, et au Monde des Aveugles de Pierre Villey et Les Aveugles et la société de Pierre Henry, qui conclut : du point de vue psychologique comme du point de vue social, « un aveugle égale un aveugle » est aussi faux qu’« un voyant égale un voyant » ; la cécité laisse subsister toutes les raisons de diversité individuelles.
Je dédie ce travail à tous les enfants non-voyants et malvoyants que j’ai rencontrés et qui m’ont nourri d’espoir.
Il fallait passer de la théorie à l’application, ne pas se laisser aller vers un traité méthodologique habituel et provoquer notre réflexion.
LA CÉCITÉ
QUELQUES CONSIDÉRATIONS
LA CÉCITÉ N’EST PAS LE NOIR ! Ce noir n’est noir que pour celui qui voit. Voilà déjà un décalage sérieux dans l’expression et l’imprécision des termes. Ce décalage est une source importante de l’incompréhension que soulignent de nombreux non-voyants aux voyants. De là à ne pas utiliser un vocabulaire commun, il y a un fossé et un sectarisme inadmissible. Ainsi, dire « voyez-vous ceci ou cela » à une personne qui ne voit pas est de l’ordre du bon sens, de la convivialité et du respect. Aucun mot de la langue, aucune expression ne doivent être tabous par peur de choquer ou de faire mal. Éviter les mots de la vue et du regard revient à tronquer la communication et l’échange, et même à différencier au-delà du handicap. Ce noir reste une énigme que l’on connaît dans les propos des personnes qui sortent du coma et des personnes opérées des yeux qui recouvrent une petite vision. Dans ces situations il n’est jamais question de noir. Certains parlent d’abîme, de trou, d’ailleurs, de voile… et même d’un autre monde.
Le noir
Noir est le nom que donnent les utilisateurs de l’écriture braille, les braillisants, à notre écriture. Les voyants évoquent l’idée du « noir » pour ce que vivrait un aveugle réduit à l’obscurité totale.
La cécité est un manque organique de l’appareil visuel dont les causes sont nombreuses, tout comme les formes de vision partiellement existantes. Elle oblige et conduit la personne à rassembler les éléments d’observation, à recenser les indices, à récupérer les signaux, à entendre les alertes sur un mode compensatoire des autres sens en complément d’une aide qui peut être apportée. Plus que jamais, l’homme a besoin de l’homme : c’est la grande leçon de fraternité enseignée.
NOTRE RAPPORT À LA CÉCITÉ
LA CÉCITÉ conduit à une absence partielle dans la relation avec autrui, altère l’échange visuel réciproque, interactif dit-on aujourd’hui. La personne qui naît ainsi va développer sa propre façon d’appréhender le monde. Trouver dans la privation de la vue un espace de liberté revient à dire : ne pas voir avec les yeux permet un regard différencié et affiné sur bien des choses de la vie. Car, si nous admirons le comportement des non-voyants, en le magnifiant parfois, c’est bien qu’il relève de la transcendance. Prévoir et anticiper les freins, les obstacles, en marquant une différence fondamentale toute sa vie dans une liberté que le voyant possède dans sa vision et ses conséquences fait que ce qui n’a jamais été vu laisse libre. Ne pas voir un paysage, un tableau, un corps, un plat, une couleur, un film… le voyant l’imagine ; le non-voyant, dans sa parole, peut dire : je vois. Comment ? Avec les images mentales qu’il s’est construites, sa sociabilité et son contact avec des personnes voyantes. Alors il défie l’image du handicapé isolé, triste, parqué dans sa solitude et à l’aise uniquement avec ses semblables. « Ils sont si bien entre eux » dans les établissements scolaires spécialisés, dans les foyers, les associations typhlophiles, peut-on entendre. Image surannée du XIXe siècle, à laquelle s’ajoute la peur, enseignée par les voyants, l’attachement à l’hyper-protection, la possession de la personne, et, pour compléter ce tableau des bonnes intentions : la pensée unique ! Tout cela risque de pourfendre cette liberté qui n’est autre que le droit de vivre.
« Attention ! Tu vas tomber ; ne touche pas ; ce n’est pas possible pour vous, etc. » Ces alertes doivent nous rappeler qu’elles bordent la vie de dépendance et sont une atteinte à l’autonomie des personnes. Très vite nous croyons savoir à sa place, pour son bien ; mais je dirais pour sa sécurité. On l’emprisonne dans une normalité organisée par l’entourage des voyants, les dits clair-voyants !
Mon propos fait le pari que doivent faire la femme et l’homme aveugles éduqués, enseignés, formatés à la société de l’image de se libérer pour retrouver leur faculté à percevoir. Il ne s’agit pas d’un point de vue rousseauiste ou libertaire, mais d’une reconnaissance de l’être dans l’aspiration à vivre avec sa différence comme richesse de partage entre le monde des valides et celui dit des invalides.
La cécité est vécue par le voyant comme un voile noir qui tombe sur la personne. Elle est ressentie comme une violence accidentelle et psychologique… Cette histoire lui tombe dessus ! Le pauvre ; l’injustice. Une seule réponse : protection et assistance. Existe-t-il d’autres réponses ? Nous sommes à notre tour face à un voile, comme une impossibilité à penser d’autres « possibles. » Cette violence psychologique, pour nous qui voyons, va naître de notre propre choc à la vue de celui ou de celle qui ne voit plus ou pas. Violence dans la fuite ou l’évitement ; violence dans l’abandon total ou l’impasse sur l’événement ; violence dans une réponse de savoir absolu qui va se manifester par un pouvoir dévorant ; violence encore dans la peine et les pleurs qui ne cesseront jamais. La cécité fait violence.
Il reste la culture populaire et son panier garni de dictons : « Il vaut mieux être sourd qu’aveugle », parole de voyant et d’entendant, « C’est terrible de ne pas y voir », « Il y a des situations où il ne faudrait pas avoir la vue »… L’espace de la pensée et de l’action laissée à celui qui ne voit pas peut s’avérer restreint pour lui et faire l’objet d’un combat permanent aux seules fins de vivre libre et autonome.
LÉGENDE ET PSYCHANALYSE
QUANT À LA MYTHOLOGIE et à la culture des mythes, elles transportent une image de punition : Œdipe se crève les yeux après avoir, sans le savoir, commis le meurtre du père et épousé sa propre mère. Le mythe d’Œdipe est une histoire de fous : ce n’est ni l’inceste, ni le crime mais « l’ignorance » qui en est la cause. Tyrésias, aveugle lui-même, tirera les fils du destin : Œdipe, privé de vue, connaît la lumière qui éclaire ses actes : il sait que Jocaste est sa mère et que son père est le manant qu’il a tué.
La psychanalyse souligne cette cécité qui frappe et permet la lucidité de l’œil qui voit derrière l’œil mort. Dans le fantasme et la symbolique, cherchons à y voir clair. Dans l’Ancien Testament, les vieux aveugles, dont Tobit, attendent un fils : il représente la lumière de la vue. Tobie rend la vue à son père en se rendant visible. Sans l’œil, il y a le regard. Derrière, devant, au-delà de la cécité, de l’absence de vision, il y a la Vue ; celle de l’affect, du fantasme et de la puissance.
Le mauvais œil est un fait culturel bien vivace en Afrique du Nord exprimant la punition chez l’infidèle qui a fauté : elle pourra donner naissance à un enfant aveugle. Dans de nombreuses consultations autour d’un enfant aveugle, bien des parents évoquent un mariage défendu, un sort lancé à une femme, une dot non remise ou un adultère qui conduisent à priver de la vue un enfant à naître. Ainsi mère, père, enfant seront dans le malheur.
Quant à Tyrésias, il est devenu aveugle pour avoir vu les secrets des dieux. Doit-on tout connaître, tout voir, tout savoir ? Le regard sur l’intimité d’autrui sans son accord, la captation de l’autre, la possession, la jalousie maladive, la trahison par le dévoilement du secret ou sa révélation impudique créent des blessures graves. La scène primitive, première représentation fantasmatique de l’accouplement de ses parents pour l’enfant est marquée dans son inconscient comme un rapport violent, faisant trace et empreinte de l’origine de notre conception et de notre naissance. L’enfant va élaborer un pouvoir imaginaire qui se suffit : « il n’y a rien à voir. » Ce sera un secret personnel bien gardé et bien enfoui ; aujourd’hui connu de tous les psychanalystes. Vouloir savoir est violence car c’est aller au viol de l’intime.
En grandissant, le petit d’homme transforme cette scène primitive d’un œil interdit posé sur l’acte d’amour en regard sur l’Amour. C’est la transformation du mauvais œil, qui rejoint celui de la « faute », au bon œil… Un langage de l’intime qui construit notre personnalité.
Ainsi, l’œil magique qui lit en deçà ou au-delà de la vue, l’œil divin ou divinatoire n’est autre que celui de l’intelligence et de l’affectivité qui comprend et aime. L’impossible n’est qu’apparence et se dévoile le regard perçant et le regard aimant avec ou sans yeux fonctionnels (fonctionnant). Le Magicien qui se produit sur scène, l’astrologue qui fait parler les astres, la liseuse dans la boule de cristal, le rebouteux ou le toucheux qui ressent par son magnétisme les forces du corps, participent à la puissance de l’œil, dans un réel chargé de fantasmes, de rêves et d’illusions. On ne peut donc ignorer le « culturel » de la vue et de la cécité.
Victor Hugo écrit dans L’homme qui rit : « Fermez vos yeux si vous n’avez pas le bonheur d’être aveugle » ou encore « Oculos non habet et videt » qui veut dire « la cécité donne des leçons de clairvoyance ». Si être aveugle et amoureux, c’est être deux fois aveugle, on est alors maître de l’illusion, du songe, du rêve.
L’œil
L’œil, petit organe pair, si puissant, si mystérieux, organe viril, « l’œil du maître » revendique 14 colonnes dans le Littré.
La naissance d’un enfant aveugle porte les germes de la réminiscence et du souvenir de tout ce qui s’est joué dans les relations parentales avant et pendant la grossesse. Un voile se lève sur l’inconscient des parents. L’union, l’amour, la conception sont passés en revue avec une obligation de réponse. Or, bien souvent, pas d’autre réponse qu’une à caractère médical qui, croit-on, dans son rationnel, va nous apaiser. L’innocent deviendra vite un coupable dans sa naissance imprévue, pas programmée par les parents ; où l’acte intime peut-être fautif. Le choc va retentir dans ce fruit de l’amour gâché pour les géniteurs : ai-je démérité ? De quoi suis-je responsable ? La culpabilité envahit parents et enfant à parts égales. Je cause de la peine à mes parents, à mes proches. Qu’en pensent les autres ? Les silences autour de moi ont un sens, mais lequel ? Je devine : comment vont faire ces parents face à ce drame ?
Sens et devenir passent par la prise en compte de cette cécité comme une valeur d’amour et de construction, la transformation de ce drame paralysant en quotidien de vie. Ce passage tient de la prouesse et de l’exception pense-t-on ! C’est l’élaboration d’une Renaissance : un acte d’amour qui a nécessité un temps de silence, de peine, de douleur, avant que l’écho renvoie son fil de bonheur et sa force de conquête qui nous habitent tous.
Philosophie idéaliste
Diderot s’est intéressé au cas de Nicolas Saunderson, mathématicien né aveugle, inventeur de « l’arithmétique palpable », ouvrant la porte au combat contre la philosophie idéaliste. Nos idées font écho à notre corps et l’abstraction reste difficile pour un aveugle, souligne le philosophe. Ce qui sera confirmé par les psychologues du vingtième siècle.
Pour l’enfant, la période de dépendance à l’adulte est celle des premières années, et il faudra en tirer la bonne substance nécessaire : une caisse à outils qui lui permettra de comprendre la vue de ceux qui voient.
Les figures littéraires représentant « L’Aveugle » sont nombreuses. Dans la littérature médiévale, de nombreux écrits portant le nom de « Mystère » évoquent « L’Aveugle » tantôt hypocrite, lâche, tantôt obscène, avant de le retrouver dans des fables, telle celle de « l’Aveugle et le boiteux ».
Dans le Bon Petit Diable, la comtesse de Ségur nous convie à une cécité maîtresse de sagesse, indispensable à la maturité. Ainsi, Juliette, âgée de 15 ans, aveugle, va former et adoucir le caractère du jeune Charles, véritable petit diable, terrorisé par sa cousine la mère Mac Miche. Juliette est belle, veut se montrer mais doit se replier sur elle et son monde intérieur, posant son regard sur la spiritualité. L’aveugle, la jeune fille aveugle est initiatrice du voyant.
Baudelaire place l’aveugle dans son regard intérieur : regarder, voir, contempler. Il fait des Fleurs du Mal un des plus beaux textes sur la vision. Seul Beckett peut lui ravir la première place, son œuvre fourmille de personnages non-voyants et malvoyants. Le non-voyant est présenté en victime chez Flaubert, conforté chez Kipling, comme le pire des sorts qui peut conduire au suicide. À l’opposé, pour Shakespeare c’est la lucidité issue de la cécité qui est enfant de la sagesse.
Je ne peux conclure cette petite revue que par le fameux roman de Wells, The Country of the Blind, and Others Stories, qui associe la cécité au monde de l’étrange. L’extraordinaire, le divinatoire, le sobre et les ténèbres : ainsi en va l’œil qui nous regarde !