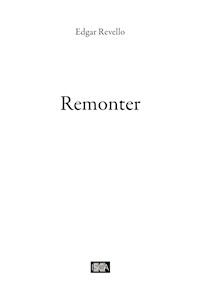
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Isca
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
On l’appelle la station, parce qu'on y a skié. Elle ne ressemble pourtant en rien à une vraie station, comme dans les vallées voisines, avec magasins et appartements à louer, vides quarante-cinq semaines par an. On peut y accéder par la longue petite route sinueuse à travers les alpages, mais de préférence par le téléphérique. Le Lac Noir s'étend là. On semble y plonger en descendant de la gare supérieure en direction de la buvette, là où je travaille, avec Claude, Nat, Boris et Angèle. La station, j'en viens, puis j'en suis parti sans vraiment vouloir la quitter, plutôt dans l'idée d'aller voir ailleurs. J'y suis remonté, pour essayer de retrouver Manon, pour deux saisons, sans doute davantage.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edgar Revello
Remonter
© 2022, Edgar Revello.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.Tous droits réservés pour tous les pays.
ISBN 9782940723461
À Marie-Noëlle
Dans une semaine, Manon sera là. Écrire me vient maintenant de l’euphorie de la revoir. Je pars en conjectures sur la manière dont cela va se passer, entre Manon et moi, quelle sera la distance qu’elle aura choisi de mettre entre elle et moi. Si tout va bien, je pourrai revenir sur ma bêtise de l’année passée qui a saboté nos retrouvailles. Pour qu’elle fasse le choix de m’aimer à nouveau, je devrai prouver, convaincre, lui expliquer et lui montrer qui je suis, maintenant. Je pourrais lui raconter les années qui se sont écoulées, ce dont je n’ai pas réussi à parler la dernière fois mon retour aux études, la manière dont j’ai été obnubilé par les voyages. Et puis je lui expliquerai, depuis nos retrouvailles avortées l’année dernière, comment et pourquoi j’ai déserté cette année. J’assume, mon profil professionnel actuel improbable, et, de l’autre, je tourne la page au niveau des voyages. En tous cas la manière dont j’ai voyagé et vécu jusqu’à présent, c’est fini. Il n’y a de sens désormais que d’être là. Je bougerai probablement à l’avenir car nous sommes résolument devenus des êtres mobiles, mais avec sobriété. Et peut-être avec elle.
Lui proposer un tel exposé relève de l’idéal. Peut-être qu’on ne va que discuter froidement de l’objet formel de notre rencontre, la situation du lac, de la station, de La Buvette, de la pétition de l’association qu’elle défend face au projet immobilier, comme si on ne se connaissait pas. Je crains l’échange avec une Manon décidée à rester droite dans ses bottes, comme font les gens qui ont décidé de ne plus se laisser porter par leur cœur ou d’autres organes viscéraux, mais de donner les pleins pouvoirs à leur raison. Le lac, La Buvette, la fréquentation et la pétition me tiennent également à cœur et méritent une approche objective, mais c’est différent. Ils gardent le goût du prétexte, malgré mon implication.
Le lac et le reste ont habité mon année. Pour mettre tout ça à plat, et parce que j’ai ce temps à tuer, je vais poser ces choses sur le papier maintenant, les jours qui viennent, d’ici vendredi.
Taper son nom sur le clavier matérialise mes espoirs, mes illusions peut-être. J’écris, je nomme, je fais exister, je prends acte. Le sentiment de transgression se révèle encore plus fort qu’au moment où j’ai fait le choix de rester ici, à La Buvette, comme de tout faire pour essayer de la reconquérir. Je ne veux plus vivre ici comme entre deux voyages, comme avant. Tout a changé, savoir que je vais rester, que je vais faire de mon mieux pour accomplir des choses, qu’ici c’est chez moi et que cela a du sens. De le penser ouvertement et de l’écrire, j’ai l’impression d’un acte éminemment transgressif, qui me parait, dans le même temps, une évidence, un minimum. Je me le suis avoué, comme ça, comme si j’étais arrivé à la fin d’un jeu vidéo sans le savoir, que j’étais devenu le chevalier de l’ordre du Rien à un moment banal, que cette récompense n’avait aucune signification pour personne, si ce n’était pour moi. Un tel changement prendra sa valeur lorsque Manon en aura connaissance.
Il y a dû avoir un déclic dans ma tête au moment où m’est venue l’idée d’écrire, pour passer le temps. C’était il y a presque deux heures, en tournant la clé de porte de La Buvette, tandis qu’une vingtaine de centimètres de neige s’accumulaient déjà sur la terrasse.
On était le 13 mars, il n’avait pas autant neigé de toute la saison, c’était absurde, 19 h et il faisait encore grand jour, et il neigeait à gros flocons. On a fini l’inventaire et les nettoyages, cette fois tout était bouclé, jusqu’à quand, ça, on ne sait pas. Et dix minutes avant que je finisse de tout fermer, elle m’envoie un message, le message inespéré, pour me voir. Je me suis assis au bar, j’ai fermé les yeux un moment assez long pour que ce réel soit assuré quand je les rouvre : elle voulait parler avec moi. Du projet immobilier de la Magnebin, mais parler avec moi. J’ai éteint les lumières, je suis sorti par la porte de derrière et j’ai marché jusqu’à la gare du téléphérique, allumé la machine, pour descendre à la maison, au garage, à Villaret.
De la neige avait soufflé jusque devant la porte de la cabine. Je l’ai grossièrement déblayée, comme l’aurait fait Jean. Il vivait une sorte de symbiose avec l’infrastructure — il fait partie des meubles. Après avoir observé mes jeunes années de fascination continue pour les cabines et la machinerie, il m’avait autorisé et appris à utiliser le téléphérique, dans le respect de celui qui l’utilise après, comme quand on utilise des w.-c., comme il disait. C’était un vieux et donc petit téléphérique, 1964, quinze places, révision et nouveaux postes de commande en 2002 déjà. J’ai refermé derrière moi, appuyé sur le bouton vert du départ. La sonnerie a retenti dans le bâtiment vide et la cabine a bougé dans la nuit qui commençait quand même à tomber. Le silence de la nature de l’hiver régnait, dans la nuit. J’avais éteint la lumière de la cabine, les flocons énormes venaient d’abord s’étaler sur la fenêtre qui fondait les nuages. La petite route qui permet aussi de rejoindre la station depuis Villaret n’était pas déblayée. Elle fait huit kilomètres de nids-de-poule. Lorsqu’il n’y a pas de neige, les propriétaires de 4 × 4 peuvent enfin y solliciter la fonctionnalité de leur engin de transport surmotorisé, surdimensionné, tape-à-l’œil et désormais terriblement banal. Malgré et peut-être grâce à l’état de la route donc, le téléphérique reste peu utilisé, hormis en cas de neige — les gens aiment parquer leur bagnole le plus près possible du lieu qu’ils décrètent comme le départ de leur randonnée, même si conduire sur les petits lacets troués peut être pénible. D’en haut, je devinais la route, ses quatre virages serpentant dans le terrain accidenté d’épicéas et de blocs calcaires qui commencent par fermer la vallée par le bas. Ensuite la forêt, les premiers alpages, celui de Bernard, deux séries de bovi-stop, et les virolets entre les blocs de calcaires qui signalent l’altitude atteinte au moment d’arriver sur le plateau du lac et d’apercevoir le téléski, les quelques constructions et la buvette. Ça m’a amusé encore quelques fois ces dernières années de monter à moto, mais en téléphérique, c’est plus rapide et moins bruyant. Au début, quand je laissais la moto, j’avais l’impression de me trahir moi, papa, la terre entière. Monter par la route présente surtout l’avantage de me rappeler de bons souvenirs. J’en ai rêvé tellement longtemps, de ce trajet à moto, comme des autres. Depuis cet été, je n’ai plus de peine à considérer ma moto comme un objet de musée quasiment. Le fait est que désormais j’assume non seulement d’être là, et de prendre le téléphérique, même en été.
Je l’écris ici car j’aimerais lui faire savoir, puis le lui faire vivre, à Manon. J’aime ouvrir la fenêtre, fermer les yeux, et sentir le vent du sommet ou de la vallée autour de moi, selon que je monte ou que je descende. J’imagine que Manon est là, et aussi ce que je pourrais faire ou lui raconter. Je pourrais si nécessaire meubler en parlant du téléphérique, de la sécurité, ou du charme, de l’architecture des gares, de la carrosserie de la cabine, du vent latéral qui la fait danser et le relatif qui s’engouffre et siffle dans les oreilles, couvre le cri des marmottes mais laisse s’installer l’odeur des rouages huilés quand on s’arrête en gare. C’est comme rouler en old timer, la mécanique se fait ressentir. Ici, sans casque, et en ne décidant de rien, en se laissant littéralement porter. Ça transporte mais c’est fixe dans le paysage, et dans le temps. Ni les gares ni la cabine n’ont changé depuis le début. Depuis ces années, elles n’ont pas enflé, comme la plupart des remontées mécaniques (ou des voitures, ou des motos) dans lesquels les trajets sont bien stables, trop stables, le passage des pylônes qui ne font même plus tanguer la cabine, et dans lesquelles on sursaute moins en bout de course, lors de l’engouffrement à tâtons, la cabine ricochant contre les parois des guides à la sortie et à l’entrée des gares.
On n’en parlait pas du téléphérique, avant, quand j’ai connu Manon. On le prenait, il nous emmenait là où on voulait aller, skier. C’était un moyen de transport, et me voilà que je le considère comme une relique charmante. Le moi d’il y a quinze ans trouverait ça ridicule. Aujourd’hui, avec la neige, il n’a pas perdu de son utilité, même si le plaisir du trajet se fait ressentir jusqu’à ce que j’y mette des mots, et qu’ainsi il existe pour toujours.
Une fois à Villaret, suite à son message, la question de comment meubler une longue semaine s’est posée, alors que la buvette est maintenant fermée, et que je n’ai pas actuellement de contrat en cours avec Interconsult pour un mandat. La première option consistait à faire comme je faisais avant, c’est-à-dire passer ce temps seul et sans contrainte, à jouer, console ou poker en ligne, selon l’humeur, et lire. Mais ce temps n’est pas un temps comme les autres, avec Manon quasiment tangible à l’horizon. Mettre sur le papier la manière dont j’en suis arrivé là, ce qui s’est passé cette année, ça m’est venu comme un plan certes sérieux, voire intello ou prétentieux, mais finalement pourquoi pas, à défaut de pouvoir m’en remettre à mes habitudes.
Manon m’avait dit d’écrire, quand on était ensemble, il y a déjà longtemps. Elle lisait mes disserts pour savoir comment j’avais fait pour avoir de meilleures notes qu’elle, elle qui aimait tant lire. Je ne faisais rien de spécial. D’ailleurs, je préférais les maths, mais surtout ceux dont on ne nous parlait pas assez à l’école, les fractales, la magie du nombre d’or. Elle avait cité un poète, m’avait dit : si tu peux vivre sans écrire, alors n’écris pas, mais si le jour où tu ne peux plus vivre sans écrire vient, alors n’hésite pas. Je n’ai jamais pensé qu’un tel jour puisse arriver. Mais quand je me suis retrouvé seul, ma manette me tombant des mains devant ma télé, et incapable de me plonger dans une lecture, ça a remonté dans mes souvenirs comme pour pouvoir venir confirmer que cette solution de remplissage était la seule. Il se trouve que c’est aujourd’hui, dans la nuit à travers toute cette neige. À cause de Manon, du lac, de La Buvette, de la Magnebin et de son projet, de Nat, à cause de Claude aussi, de l’Australie et de Claire, de papa et de Béa, parce que je sais maintenant ce que je fais là, qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour moi, que c’est Manon qui fait vibrer ma vie.
Quand j’ai ouvert la porte du garage, j’ai vu les motos se refléter dans les vitres et donner ainsi l’impression de flotter sur la neige jaune à l’extérieur. Je suis passé derrière le comptoir, j’ai vissé le robinet qui gouttait. Je suis ensuite monté dans l’obscurité jusqu’à l’appartement en réalisant à quel point mon corps pouvait se mouvoir si facilement dans cet espace. Maintenant assis à mon bureau, je réalise que le lieu est aussi le bon pour écrire, pour me souvenir de quand tout a commencé à changer, lorsque je suis rentré de mon dernier voyage, il y a un an, lorsque j’ai revu Manon, quand tout a failli marcher de nouveau mais quand tout a foiré, le même jour où j’ai fini par dire à Claude que je restais bosser à la buvette, au moins pour la saison d’été.
I
Je suis rentré d’Australie le 4 avril dernier, après trois mois de voyage. C’était un vendredi, c’était il y a un an. Dans le train, depuis l’aéroport, j’ai croisé Stéphane, un copain d’enfance, qui faisait partie des gamins du ski-club dont j’étais, ceux qui, de novembre à avril, dès qu’on pouvait, montaient au Lac Noir, à la station. Manon n’a pas connu Stéphane. Lorsqu’on a eu 11 ou 12 ans, Stéphane a déménagé de Villaret à Saint-François. Il aurait pu rester membre, et simplement continuer à skier, mais il s’est tourné vers le basket, des loisirs urbains, c’était la mode, la toute fin de la vague Michael Jordan, le skate. Il a posé ses skis pour le snowboard, ça a achevé notre amitié. Parce que nous, les gamins de Villaret, on faisait de longue date de la résistance, on restait attachés par principe à nos skis, à l’époque où apparaissaient les premiers « carvings » sur le marché. Enfin on avait notre revanche, notre joujou à nous, de quoi justifier notre attachement à nos lattes, et pourfendre encore davantage ceux qui, comme Stéphane, avaient trahi.
On s’était perdus de vue, mais on s’était déjà recroisés, devenus adultes, peut-être trois ou quatre fois depuis, surtout avant que je commence à partir en voyage et que je passe moi aussi finalement beaucoup de temps en ville, à Saint-François.
Dans le train, on se parlait comme des amis proches. Chaque point de la conversation nous faisait réaliser nos similitudes, là dans ce train, à 30 ans passés. On a principalement parlé de voyages, une des grandes motivations dans sa vie également. On avait parcouru pas mal d’endroits en commun, visité les mêmes sites, peut-être tiré les mêmes clichés, publié des mêmes posts. On aurait pu se croiser en voyage — mais cela nous aurait peut-être fait moins plaisir de nous croiser quelque part dans le monde qu’ici. Lui aussi trouvait que, quand on croisait une connaissance à l’autre bout du monde, il n’y avait rien de tel pour casser le charme du dépaysement et nous ramener à notre triste réalité qui faisait finalement de nous un touriste comme un autre. Le même sentiment de rejet qui provoquait instinctivement un changement de direction immédiat survenait au moment où on entendait parler français. Si on était déjà installé dans un backpacker et qu’on en croisait, punaise !, on devait faire avec, mais on préférait éviter, quitte à faire semblant et cacher notre identité francophone en imitant un accent british impossible. Mais ça ne marchait en principe pas, malgré les années, surtout après une série de bières, et lui aussi s’était fait prendre à ce jeu-là. Je m’étais déjà rendu compte que ce genre d’expériences, que je croyais très personnelles, relevaient en réalité d’une effroyable banalité. Certes, il y avait aussi ceux qui courraient presque vers leurs compatriotes ou du moins des personnes ayant une langue maternelle commune, et les autres, comme nous : le monde des voyageurs se réduisait à deux seules catégories, dont tout le monde connaissait les codes.
Je savais que papa avait son entraînement hebdomadaire ce soir-là avec Béa, que je serais seul à Villaret, alors j’ai proposé à Stéphane qu’on se retrouve plus tard en ville à Saint-François.
À Villaret, au garage, papa et Dany, son employé, buvaient leur bière du vendredi soir quand je suis arrivé. On a parlé un peu, mais ils n’avaient pas l’intention d’écouter pendant des heures mon histoire de voyage dont ils connaissaient les grandes lignes. Quelques anecdotes et c’était bouclé. Papa a été davantage intéressé par Stéphane, il se souvenait bien de lui.
Je suis descendu ensuite à Saint-François. Sur cette route encore plus qu’au garage, j’ai eu le sentiment d’être à la maison, la moto bien sûr mais aussi le trajet, la ligne droite, les virages, la pente même, et la circulation du vendredi soir à l’entrée de la petite ville, dans laquelle j’ai peu slalomé en me souvenant de Hô Chi Minh, sans la multitude autour et avec l’impression de pouvoir conduire les yeux fermés.
Au pub, je racontais à Stéphane que l’appartement de mon enfance était devenu de fait le mien, papa ayant pris ses quartiers chez sa compagne. Il s’en souvenait. Je lui ai raconté aussi que peut-être je ferais la saison à la buvette. Il savait de quoi je parlais. Il se souvenait, et cela l’intéresse m’a-t-il dit, de remonter. Le chalet du ski-club, on l’appelle « La Buvette », probablement parce qu’on y a toujours effectivement pas mal bu. Depuis qu’il y a davantage de monde, depuis que Claude a pris la gestion de la buvette, certains clients l’appellent « Le Restaurant ». Pour Stéphane, comme pour nous, ça reste La Buvette.
J’avais bu la moitié de ma bière, il était en train de me demander des nouvelles d’autres copains de l’époque, quand je l’ai vue.
Manon est un amour unique, de jeunesse peut-être et, pour cette raison sans doute, c’est un être qui me paraît fondamentalement vrai, authentique, auquel je me sens lié, au-delà de ce qu’il en est factuellement. Je l’ai aimée infiniment, surtout au début de nos six années, mais le reste de la vie m’a intéressé aussi, trop. À Noël l’année de nos 21 ans, elle m’a quitté pour aller voir ailleurs. Cette décision aurait pu être la mienne. J’aurais pu continuer comme ça longtemps si elle n’avait rien fait. Sans porter le choix de la rupture, je pouvais aller voir ailleurs. Elle allait entrer dans son une école d’art, je venais de terminer mon diplôme, j’avais un poste d’employé de bureau, j’allais pouvoir voyager davantage.
Au pub, elle m’a ignoré un moment, j’ai essayé de faire pareil. Ma bière diminuant, Stéphane me voyait la regarder et peut-être qu’il a compris.
J’ai posé mes pieds au sol comme parfois lorsque je descendais de l’avion, décidé à une nouvelle aventure, dans une attitude ouverte vers les autres et le monde avec la confiance en soi qu’il faut. Je suis allé lui parler. Laisser filer cette occasion en attendant qu’elle montre son intérêt constituait un risque que je savais ne pouvoir assumer. J’ai eu rapidement l’impression que la magie réopérait. Ça a marché au-delà de mes espérances. Je flottais de la revoir, incroyablement comme avant. Et ivre. Je lui ai parlé un peu de l’Australie, elle me posait des questions superficielles, une petite heure a dû passer. Le pub fermait. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. J’ai commandé un taxi et on est allés à Villaret. Ça a été très facile, trop facile, mais je planais, et, comme quand on picole à ne plus s’arrêter, je n’en étais pas à me poser des questions, seuls l’instant et l’euphorie comptaient. La nuit a été magnifiquement extraordinaire et naturelle. Comme avant, mais dans un futur présent à moitié réel.
Le lendemain matin, malgré ou à cause du décalage, ou surtout à cause de la merveille qui s’était retrouvé là, j’étais réveillé, et je la regardais. Et je n’en revenais pas. À ce moment-là, je n’ai pas pensé que cela pouvait foirer, j’étais littéralement submergé. Pourtant, de l’état absolument paisible dans son sommeil, elle a eu dès le réveil l’air soucieux et absent. Elle s’en voulait, elle regrettait, je l’ai su tout de suite. Mais elle n’est pourtant pas partie en courant, alors l’espoir demeurait. J’étais absolument mal, et en même temps infiniment heureux.
Contrairement à la veille où l’ivresse a aidé, le lendemain c’était impossible, tout sonnait faux parce qu’elle n’avait rien envie d’écouter, et moi je ne savais pas comment agir, comment être, quels mots ou phrases prononcer et même quels gestes effectuer, non seulement à son égard mais aussi la manière de me mouvoir dans l’appartement. Je ne savais plus comment être, quoi dire, et elle semblait satisfaite de cette situation bizarre. Elle m’a laissé patauger toute la matinée comme face à une devinette dont elle connaissait la réponse, dont elle se réjouissait de me balancer avec mépris la solution au dernier moment. Elle laissait une porte entre-ouverte mais érigeait moult barrières infranchissables pour y accéder.
Elle ne me posait plus de questions sur mon voyage, n’alimentait pas la conversation, donc je ne disais rien. Elle regardait l’appartement et l’extérieur davantage que moi, pourtant au contraire de l’appartement j’étais le même mais j’avais beaucoup changé entre-temps. Je n’ai pas réussi à faire en sorte qu’elle s’en rende compte, je ne savais pas comment m’y prendre. Je ne l’intéressais pas vraiment. Elle n’avait pas besoin de moi, comme avant et dans l’absolu, mais uniquement envie d’être là, d’observer ce lieu comme le temps qui passe. J’ai eu la sensation qu’elle me prenait un peu de haut. J’ai compris que je n’étais plus sa bouée d’affection à laquelle j’avais l’habitude qu’elle s’accroche pour sortir la tête de l’eau de sa vie dont je trouvais qu’elle avait l’art et la manière de la voir de manière trop compliquée. Je ne me rendais pas compte de cette réalité à l’époque, quand bien même je la dénigrais. J’étais un peu son héros. J’avais été. Elle n’avait plus besoin de moi, et je ne suscitais pas davantage sa curiosité. Je n’étais rien.
Comme elle regardait la vallée à travers la fenêtre de ma chambre, attendant que les feux d’une voiture éclairent la route trempée, dans le silence pesant, je suis machinalement allé sur le terrain qui puisse la toucher, l’enfance. Je lui ai raconté l’échange de nos chambres avec papa, pour que je puisse avoir celle-ci qui donnait sur la route. Je ne crois pas que je lui avais parlé de ça un jour. Peut-être qu’elle avait cru que j’avais toujours eu la chambre qui donnait sur la route, ou peut-être qu’elle n’avait rien imaginé. Il lui avait fallu du temps je crois, à papa, davantage pour accepter que pour comprendre, malgré et peut-être d’autant plus pour un motard, qu’un gamin n’en est plus vraiment un, quand il veut voir et entendre la route depuis sa chambre, pour regarder les voitures, les motos, et donc les gens, qui passent. Le Derby, l’ancienne boîte de nuit mythique de la région juste de l’autre côté de la route, en face du garage, avait fermé depuis longtemps déjà. Je l’ai toujours vu à cette époque comme une friche à l’abandon. On l’explorait avec les copains, en en faisant un vaisseau spatial ou un repaire pirate. Il y avait dû avoir une forme de renoncement heureux de la part des parents au silence, quand je suis né, pour me donner le calme de la chambre qui donne à l’arrière sur le pré, là où dès le mois de mai il y avait les vaches souvent, et plus loin la forêt abrupte qui grimpe le long du versant éclairé l’été seulement, surtout le matin, qui fait se réveiller parfois les coucous. Le calme effectivement régnait, trop pour moi à un moment donné, ces étages de vert qu’on peut voir de ce côté-là, et les sons de la campagne qu’on entend si bien. Voir, entendre, le pré et la forêt, comptait moins pour un gosse comme moi de 12 ans, que pour des parents qui projetaient que le son des voitures sur la route sur l’asphalte serait un moindre mal pour leurs nuits que ceux des pleurs d’un bébé sensible au bruit. Quand j’ai repris la chambre de papa d’alors, celle qui donnait sur la route, il a donc récupéré celle du côté verdure, et un silence sur lequel il avait sans doute oublié qu’il pouvait compter.
Peut-être n’auraient-ils même pas eu besoin de me déplacer lorsque je suis né, et on aurait évité ce déménagement de chambre. En effet, c’était absurde, parce qu’un bébé n’aurait jamais été dérangé par les bruits de la route. C’est qu’on se disait avec Manon, qui, à mon grand soulagement et peut-être par pitié, avait finalement mis le pied dans cette conversation. Elle a suggéré que, peut-être, avoir voulu m’éloigner de la route, pour bien faire, cela avait conduit à ce jour où j’avais voulu récupérer la vue sur elle. Cela m’avait peut-être conduit à ce que je m’intéresse à elle, de ne pas la voir, la route. Manon la regardait.
Juste en face, Le Derby avait fini par devenir un lieu improbable grâce à Béa, et papa, qui en ont fait un crossfit. Il amenait désormais à Villaret son va-et-vient d’êtres vivants adultes assoiffés de mettre leur corps à l’épreuve. Son devenir dépassait de loin tout ce qu’on avait pu imaginer, gamins. La reconversion n’avait pas touché l’extérieur. L’enseigne rose invitait toujours chaleureusement à la visite, les lettres en italique semblaient maintenant piquer du nez plutôt, après avoir évoqué les corps dans le vent. Entre les dalles en béton devant l’entrée, l’herbe poussait, le blanc de la façade d’origine virait au vert. La friche en restait visuellement une, le délabrement participait du succès de la box. Ça faisait destroy. Manon l’avait photographiée, un peu avant qu’on se quitte, je n’avais pas compris la démarche. Peut-être que je n’avais pas écouté, ou qu’elle n’avait déjà plus la patience ni l’envie de m’expliquer. Depuis, pourtant, j’ai remarqué qu’il n’y en avait plus beaucoup, des friches. Dans les villes, celles des usines ou des hangars de chemins de fer sont la plupart souvent détruites, ou transformées. Là, la friche paraissait dans son jus. Je n’osais pas lui demander de parler de photo ou de son intérêt pour ce genre de lieu sans donner ouvertement l’impression de vouloir me rattraper, ou rattraper le temps perdu. Alors elle est passée à autre chose.
Comme si elle visitait un musée, et puisque j’en avais parlé, elle m’a demandé qu’on aille voir la vue depuis la chambre de papa, de l’autre côté. Elle pouvait bien se l’imaginer car elle connaissait la maison, les alentours. Mais elle voulait voir, comme elle m’a dit, la perspective, les étages de vert, entendre le calme relatif quand on ouvrirait la fenêtre. On a entendu les gamins du quartier de villas carrées multicolores à toits plats qui avait poussé entre-temps dans une partie du pré entre le garage et la forêt. Elle a compté les trampolines qu’on pouvait repérer à l’horizon. Quand on a entendu le voisin le plus proche gueuler sur ses enfants, elle m’a regardé comme si elle avait entendu le Loch Ness gronder au fond de son lac, confirmant ainsi la présence de redoutables rustres néo-ruraux en façades roses. Elle ignora finalement le con et regarda la forêt.
Dans la chambre de papa, la fenêtre grande ouverte, la vue nous ayant amenés là, elle a scruté un peu la chambre, propre en ordre, sobre, le mobilier daté, le lit fait. C’était un de ses traits de caractère, cette manie du rangement que papa avait attrapée, à cause de son statut de père célibataire, comme il se justifiait parfois et comme je me justifiais pour lui alors, encore que, au garage, la manie du rangement était un prérequis indispensable pour qui voulait y travailler. Heureusement, Manon n’avait ni fait de papa ni de ma mère le sujet d’une nouvelle conversation.
Elle a pris le cadre avec la photo de moi où je souris, morveux, devant la Dent Grise, floue en arrière-plan. J’avais 7 ans, j’étais à la station, devant La Buvette, quelques années avant qu’on y passe tant de temps ensemble. Cela pouvait l’amener à évoquer nos meilleurs souvenirs, à la station. On l’appelle la station, parce que ça a toujours été d’abord le lieu où on skie. Mais ça n’est pas une vraie station, comme dans les vallées voisines, avec magasins et appartements à louer, vides quarante-cinq semaines par an. La station est située sur le plateau au-dessus de Villaret, là où il y a le lac, le Lac Noir. Le plateau est protégé par un cirque formé de longues crêtes, ponctuées de trois sommets, la Dent Grise, le Tsermont et le Pic de Narogne, clouant là presque hermétiquement la vallée du reste du monde. Les croix qui les couronnent témoignent si ce n’est de l’esprit, du moins de la tradition religieuse des vieux et de ceux d’avant, comme la chapelle et la grotte au bord du lac dans lesquelles s’alignent en désordre les ex-voto, cloués là suite à un sauvetage d’avalanche ou autre catastrophe naturelle. À part la chapelle, on y trouve uniquement La Buvette, et deux chalets, le tout à cent mètres du parking et de la gare d’arrivée du téléphérique. Le long téléski donne accès à trois pistes officielles, plus ou moins préparées, entre lesquelles un pays de trajectoires hors-pistes parsemé de sapelots se tient potentiellement à notre disposition, au bon vouloir de la saison, de qui on attend toujours, mais on reçoit toujours moins. On peut monter avec le téléphérique toute l’année. Par la petite route, auparavant ce n’était qu’en été, mais désormais presque toute l’année, les chutes de neige n’étant plus ce qu’elles étaient. Le Lac Noir pourtant, c’est un vrai lac, pas un étang de retenue créée pour faire tourner des canons à neige. Il n’y a pas de canons pour les pistes, et c’est aussi ce qui maintenant ne fait pas du Lac Noir une vraie station. De l’autre côté du lac, face à La Buvette, des pâturages de lande grillés par le soleil, jaunies des saisons passées à refléter ce dernier, ainsi que les nuages blancs par temps maussade, et la lune, la nuit. Des étendues de myrtilliers, genévriers et rhododendrons contrastent, rayent ces petites bosses qui se succèdent, entailles après entailles, plongeant dans la gorge, puis dans le lac. Je maintiens que pour skier c’est le rêve, lorsque la couche comble les petits fossés, recouvre les myrtilliers, bombe ces grosses bosses sur lesquelles on montait et descendait, comme sur des montagnes russes, sans rails, mais sauvagement confiants sur nos lattes. Des poissons rendent, contre toute évidence, l’intérieur du lac vivant. On s’en doute surtout si on le côtoie en été, profond, aussi profond que la gorge qu’il devait y avoir avant qu’un éboulement ou un tremblement de terre ne referme le goulet vers Villaret, en des temps lointains mais qui devaient bien avoir existé. On en fait le tour en une heure à pied, sur les hauteurs, le sentier est le plus escarpé à cette embouchure accidentée, à côté des quelques constructions, au nord.
Manon m’avait proposé, à l’époque où elle ne voyait que moi et que j’ignorais l’importance et la rareté de la symbiose entre elle et moi, de répertorier tous les Lac Noir (y compris les Schwarzseeet les Lago Nero) du pays, de faire le tour de tous. Je crois que je n’avais même pas répondu à la proposition, considérant peut-être que c’était une idée en l’air, un rêve alimentant la conversation, mais qu’elle ne pensait pas réellement à ce que je passe autant de temps avec elle à consacrer à une activité aussi inutile. J’avais snobé la proposition et pourtant je m’en souviens, parce que j’aurais dû dire oui, parce que j’avais peut-être cru que refuser la proposition comme toutes les autres ne changerait rien puisqu’elle m’aimait ! Même d’un point de vue esthétique, pour des photos, je ne voyais pas l’intérêt, il me semblait que davantage d’exotisme se justifiait, plutôt que des lacs probablement assez identiques, le fond sombre des sapins ou des pentes qui s’y reflètent, les berges abruptes mais vaseuses. Maintenant je donnerais tout pour partir faire les tours des lacs dits noirs du pays et du monde avec Manon, de même que je vois le potentiel esthétique de ces lieux que je considérais à tort, en comparaison d’idées que je me faisais de lieux autre part, comme trop banals : je suis convaincu que la découverte de chacun d’eux m’emballerait, surtout si c’est un jour où peu d’autres personnes ont eu l’idée de se rendre dans le même lieu, et un jour où la météo colle avec la saison. Davantage que des plans d’eau voire des paysages, j’y verrais aussi leurs histoires de chèvres enfouies et de diables qu’il faut craindre pour éviter la répétition d’une tragédie du même acabit. Et puis en faire des photos, je vois déjà le cadrage, moitié lac, moitié reste, pentes ou ciel, selon la taille du lac, l’encaissement. À la fin, on pourrait les imprimer, les mettre les unes à côté des autres, en faire une expo, pour nous ou pour d’autres. Peut-être que ce souvenir s’était aussi invité chez elle, là en regardant ma photo.
Je me damnerais pour que Manon puisse s’imaginer que c’est le genre d’idées qui me passent maintenant par la tête, que j’ai changé, que je suis peut-être moins con mais seul, que je suis prêt désormais à assumer être avec elle plutôt que de la mépriser comme j’ai pu le faire, comme le font tous les jeunes hommes, Dieu sait pour quelle raison, même et surtout la suivre dans ses idées que je trouvais à l’époque bizarres, et maintenant incroyablement originales. Je continue à y croire, elle pourra peut-être s’en rendre compte la semaine prochaine, et on le fera un jour, le tour des tours des fameux lacs noirs. Mais je n’en étais pas là, dans cette chambre, dans cet air frais, c’était il y a un an mais j’ai l’impression que c’était il y en a dix. Elle avait, dans les mains, la photo de moi édenté.
Je ne me posais même pas la question, lorsqu’on était plus jeunes, si Manon aimait vraiment skier, même si avant qu’on soit ensemble je ne l’avais jamais vue à la station. C’était mon quotidien, alors il me semblait que cela devait bien être le même pour tout le monde. Pourtant elle se trouvait bien dans le coin, avant, mais elle vivait dans un autre monde, à quinze minutes de chez moi, depuis toujours. À partir du moment où elle était avec nous, elle était entrée dans ma réalité, et je ne me préoccupais pas pour autant de la sienne.
On a grandi à sept kilomètres de distance — elle à Saint-François, la petite ville, moi à Villaret, premier village de cette vallée latérale, qui finit d’un côté au village, au téléphérique, ou par la petite route qui monte de l’autre côté, au sud, contourne la Dent Grise pour monter derrière vers le col et la frontière.
Quand elle ne disait rien et qu’elle regardait la photo de moi édenté, ou dans le vague, droit devant, cela invitait à penser à cela, au passé, au mystère qui a fait que, un jour, elle a accompagné sa mère pour des courses de l’autre côté de la frontière, qu’elles se sont arrêtées au garage prendre de l’essence. J’étais à la pompe, j’ai fait le plein. Je l’ai vue me regarder, et à partir de là elle était dans ma tête, et probablement elle n’en sortira jamais. Le lundi suivant à l’école, je l’ai cherchée, je l’ai trouvée, dans le couloir de la bibliothèque, à l’étage des deuxièmes années. On a été de ces couples d’ados, de ceux qui vont de soi, pour soi comme pour les autres, qui ne se défont pas aussi rapidement qu’ils ont pu se faire. J’aimais l’extérieur, le ski, la route, les trucs qui vont vite. Et peut-être qu’elle n’aimait pas ça autant que moi, mais je ne me posais pas la question, puisqu’elle était là. Elle était tout le temps là, avec mes copains qui, parfois, avaient aussi une copine avec eux, en hiver à la station comme en été, entre le garage et Saint-François. Maintenant que j’y repense, peut-être qu’il y avait d’autre raison que moi, qu’elle soit tout le temps là, à l’époque.
Quand Manon parlait de chez elle, de sa ville, de sa famille, de son quartier, elle se montrait très dure, critiquait le conformisme du mode de vie de ses parents, sa mère au foyer, trop toujours là d’après ce qu’elle s’en plaignait à l’époque, et son père toujours ailleurs. Depuis la veille, elle n’avait pas parlé de ses parents, je n’avais pas osé demander. Je lui avais simplement demandé la veille si elle habitait toujours à Saint-François, mais j’ai ramené le sujet là pour savoir si elle s’y plaisait. Elle a dit oui, mais elle n’a pas dit où elle habitait. Elle ne voulait pas que je lui demande. Elle ne voulait pas que je sache. Je ne me souviens pas qu’elle m’en ait parlé, de sa grande-tante, à l’époque. Depuis je me demande où elle est, cette maison, mais je m’efforce de ne pas parcourir Saint-François en long en large et en travers pour tenter de la croiser, sortant de chez elle.
Se retournant et posant le cadre, elle a parlé du développement trop rapide de la ville, dont les quartiers commerciaux et résidentiels sortaient de terre puis se remplissaient de nouveaux habitants comme par magie, mais faisaient disparaître les prés, les vaches, les quelques champs de maïs et les arbres. Comme d’autres, elle pouvait dire ouvertement qu’elle préférait la campagne, ce qui chez nous revenait à préférer la montagne. J’ai acquiescé, soulagé qu’elle parle un peu d’elle, de sa réalité. La ville, nous, on l’avait toujours vue, en tant que gamins depuis Villaret, comme la ville d’à-côté. Cette petite ville résumant l’idée qu’on se faisait des villes en général. On savait qu’il en existait ailleurs de plus grandes, mais on n’osait même pas encore rêver qu’on puisse un jour y déambuler comme si c’était chez nous. Ce petit espace urbain déjà nous comblait, un terrain excitant en comparaison de Villaret, avec ses gens nombreux dont la masse pourvue nous rendait presque anonymes, dans plein d’endroits, de magasins, où se perdre et découvrir quelque chose, de nouvelles voitures, les plongeoirs de la piscine, les filles.
Je l’ai contredite dans sa critique de Saint-François. Non parce que ses arguments n’avaient rien d’original, tout le monde était de cet avis. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, et surtout elle, étaient si durs avec leur ville, comme s’ils attendaient davantage d’elle que n’importe quelle autre ville, l’impossible, qu’elle soit une ville sans en être une, comme si en étant une porte de la montagne elle aurait dû conserver davantage son esprit villageois et arrêter de grandir — ce qui est profondément contradictoire pour une ville, qui tend irrémédiablement à s’étendre, pour peu que le temps ne se soit pas arrêté quelque part.
En y repensant, j’ai réalisé qu’elle avait toujours eu ce regard, et que cela va dans le sens de son engagement pour l’association. Je me souviens que, un jour, on se promenait sur l’une des portions de remparts de la ville, dont quelques dizaines de mètres subsistent de chaque côté de la porte au nord. De mauvaise foi, elle appliquait une lecture du monde contemporaine à la réalité médiévale, idéalisait la paysannerie, romantisait. Comme j’avais aimé comme d’autres enfants en apprendre plus sur le Moyen Âge, je lui avais fait remarquer que la ville méritait son statut de par le potentiel de protection qu’elle offrait au monde alentour, qui venait se réfugier à l’intérieur des murs lorsqu’il le fallait bien. Et qu’aujourd’hui, en s’étendant bien au-delà des murs, la ville témoignait d’une société plus sûre. Dans ce genre de situation, elle commençait par se réjouir mais aussi, dans le ton, se ficher de moi parce que je parlais non pas comme un dictionnaire, mais comme une personne autre que celle qui traînait avec ses copains à longueur de journée. C’était vrai mais à cette époque je prenais cette double personnalité comme un problème, je n’assumais pas mes intérêts pour les choses dont je pensais probablement à juste titre qu’elles n’intéressaient pas les copains en question. Elle désespérait peut-être de me voir m’entêter à n’être qu’un type parmi les autres. Pourtant je me souviens précisément de ce moment, comme une preuve que je savais temporairement déjà à l’époque conjurer le sort du conformisme que je me suis longtemps auto-infligé. Je lui avais montré là où se promenaient les sentinelles, les chèvres, au milieu des vieillards de 45 ans, manquant de dents, les mamans de quatorze, des chevaliers balafrés, des paysans crève-la-faim venant quand ils avaient quelque chose à vendre au marché. Dépaysée, réalisant qu’elle vivait bien dans la réalité de notre monde plutôt que dans le passé, elle avait consenti qu’elle avait tendance à idéaliser la nature, le passé, beaucoup de choses en réalité. Mais elle avait dit aussi que je finirais par voir à quel point c’était important, de laisser sa place à la nature. Je n’avais pas l’impression d’avoir besoin d’être convaincu, mais c’était vrai que cette question de la nature, et de ce qu’on en fait, je n’y pensais pas vraiment à l’époque. Mais je n’excluais pas de le faire un jour. Je ne voyais juste pas ça comme une activité, comme une chose à accomplir. Je n’étais pas encore parti, et revenu, remonté. Je ne réalisais pas encore la fin de la neige, la station davantage vivante en été et suscitant pourtant l’appétit des investisseurs. C’était avant.





























