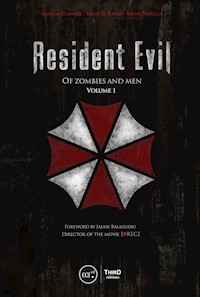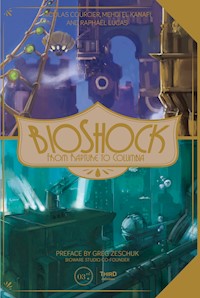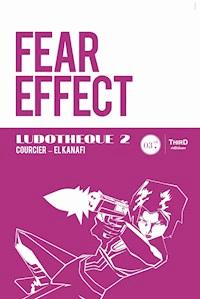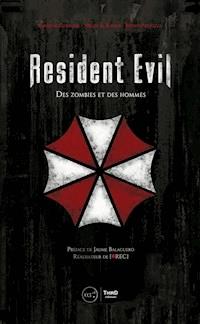
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Third Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Resident Evil
- Sprache: Französisch
Les coulisses de développement, le gameplay, le scénario, l'univers : plus de 200 pages pour tout savoir sur Resident Evil !
La figure du mort-vivant fascine la littérature depuis près de deux siècles. Le plus emblématique de ses représentants, le zombie, est aujourd’hui plus que jamais au cœur de la pop culture... La Nuit des morts-vivants, 28 Jours plus tard, Shaun of the Dead, The Walking Dead : au cinéma, à la télé comme en bande dessinée, difficile d’échapper à ces créatures avides de chair humaine. Le jeu vidéo n’est évidemment pas en reste, auquel on doit l’initiateur d’un véritable renouveau de l’horreur, la série Resident Evil.
Pénétrez les bas-fonds de Raccoon City à la rencontre des héros ayant combattu la maléfique multinationale Umbrella. Découvrez la genèse de chaque épisode et le portrait de ses créateurs, l’analyse de leurs inspirations comme des évolutions de gameplay.
Replongez au cœur de cette grande saga de Capcom !
EXTRAIT
C’est en 1979 que Kenzô Tsujimoto décide de prendre en main son avenir. Le 30 mai de cette même année, il décide de créer sa propre société, spécialisée dans la production et la distribution de jeux électroniques. IRM Corporation est née. Dès 1981, la filiale Japan Capsule Computer est mise sur pied. Trois années plus tard, cette division se substitue à la maison mère et devient « Capcom », contraction du nom original (Capsule Computer). Basée à Ôsaka, la société va vite se spécialiser dans le jeu vidéo et commencer par proposer des titres destinés surtout au marché de l’arcade, au Commodore et à la NES de Nintendo. Le premier jeu de la firme est un shoot them up s’intitulant Vulgus, qui débarque dans les salles enfumées en 1984. Ce premier essai, bien que peu reluisant, ouvre les portes du succès à la société de Tsujimoto, aujourd’hui encore PDG de l’entreprise. L’année 1984 voit se produire un second événement décisif pour l’avenir de Capcom. Remercié par le voisin Konami, le jeune Yoshiki Okamoto vient grossir les rangs de l’éditeur d’Ôsaka. Le premier jeu qu’il signera chez son nouvel employeur sera 1942, shoot them up à défilement vertical qui marquera les esprits.
À PROPOS DES AUTEURS
Passionné depuis l’enfance par la presse papier, Mehdi El Kanafi n’a pas tardé à lancer avec Nicolas Courcier son premier magazine, Console Syndrome, au cours de l’année 2004. Après cinq numéros à la distribution limitée à la région toulousaine, il décide de créer avec Nicolas une maison d’édition du même nom. Un an plus tard, la petite entreprise sera rachetée par Pix’n Love, éditeur leader sur le marché des ouvrages consacrés au médium du jeu vidéo. Depuis 2015, il poursuit sa démarche éditoriale articulée autour de l’analyse des grandes sagas du jeu vidéo au sein de la nouvelle maison d’édition cofondée avec Nicolas : Third.
Féru de jeux vidéo et de cinéma fantastique depuis sa plus tendre enfance, Bruno Provezza a occupé de 2002 à 2006 la fonction de rédacteur en chef du site officiel du magazine Mad Movies, avant d’intégrer la rédaction du mensuel papier. Il y a également dirigé le numéro hors série consacré aux jeux vidéo. Collaborateur de Gameblog.fr de 2008 à 2014, il œuvre par ailleurs en qualité de traducteur pour le compte des éditions Flammarion et Pix’n Love.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Resident Evil Des zombies et des hommesde Nicolas Courcier, Mehdi El Kanafi et Bruno Provezza est édité par Third Éditions 32 rue D’Alsace-Lorraine, 31500 TOULOUSE [email protected] suivre : @ThirdEditions – Facebook.com/ThirdEditions
Tous droits réservés. Toute reproduction ou transmission, même partielle, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation écrite du détenteur des droits.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit constitue une contrefaçon passible de peines prévues par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la protection des droits d’auteur.
Le logo Third Éditions est une marque déposée par Third Éditions, enregistré en France et dans les autres pays.
Édition : Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi Textes : Nicolas Courcier, Mehdi El Kanafi et Bruno Provezza Chapitre « La musique dans Resident Evil » : Damien Mecheri Relecture : Thomas Savary Mise en pages et couverture : Julie Gantois Couverture First Print : Johann Blais
Cet ouvrage à visée didactique est un hommage rendu par Third Éditions à la grande série de jeux vidéo Resident Evil.Les auteurs se proposent de retracer un pan de l’histoire des jeux vidéo Resident Evil dans ce recueil unique, qui décrypte les inspirations, le contexte et le contenu de ce volet à travers des réflexions et des analyses originales.
Resident Evil est une marque déposée de Capcom. Tous droits réservés. Les visuels de couverture sont inspirés des artworks des jeux de la série Resident Evil.
Édition française, copyright 2015, Third Éditions. Tous droits réservés.
ISBN : 979-10-94723-00-5
Ce livre est dédié à tous les passeurs d’imaginaire.
Préfacede Jaume Balagueró
JOUER, c’est imaginer des mondes et se convaincre qu’on en fait partie, que l’on soit autre ou soi-même, dans un environnement inventé et différent. Créer et vivre des aventures, souffrir, savourer, fouiner, découvrir, combattre, vaincre ou être vaincu, mais toujours s’amuser.
C’est ce que je faisais enfant : je construisais des mondes imaginaires autour de moi et j’y vivais. L’expérience est fascinante, je vous assure, mais présente un point faible : toute surprise en est exclue, puisque que c’est celui qui s’y livre qui a tout inventé. C’est son imagination qui a créé l’univers et en a fixé les règles. On contrôle soi-même le destin, on le connaît, le manipule. Et c’est pour cela que le résultat conserve un côté imparfait.
C’est alors qu’est apparu ce jeu qui allait tout changer. Il s’agissait d’un univers de fiction présentant des règles nouvelles, d’une expérience unique où nous les joueurs serions assignés à jouer un rôle inconnu jusqu’alors.
La toute première fois que nous avons été confrontés à ce jeu, nous sommes entrés dans une atmosphère et un univers pour nous tout à fait inconnus. Le défi était différent cette fois-ci, il nous fallait nous-mêmes avancer, partir en quête et découvrir chaque nouveau lieu terrifiant, chaque volte-face de l’intrigue. Et mieux encore, c’est nous qui contrôlions le déroulement de l’histoire, à condition d’oser. C’est là qu’il fallait s’armer de courage, combattre la peur et aller de l’avant. Puisque la peur était bien réelle...
Désormais, il ne s’agissait plus seulement d’avancer et de combattre ; pour la première fois, nous étions contraints de gérer nos ressources tout au long de l’aventure : collecter des munitions, des armes, des herbes curatives, des rubans encreurs de machine à écrire pour rester en vie, de mystérieux objets pour résoudre des énigmes... Notre succès dépendait en grande partie de notre capacité à gérer tout cela. Tout, pour la première fois, dépendait de nous. Dorénavant, nous étions considérés comme partie active et fondamentale de cette histoire d’horreur. Une histoire qui existait réellement parce que nous en faisions partie. Un sentiment d’implication et d’autonomie qui allait captiver des millions de joueurs.
Le jeu s’intitulait Resident Evil, bien sûr ; il a permis de jeter les bases définitives d’un nouveau genre, le survival horror. Sans doute d’autres propositions similaires l’avaient-elles précédé, mais c’est bien celui qui aura su transcender toutes les idées antérieures jusqu’à les transmuer en une parfaite et fascinante expérience.
Les sujets traités continueraient de fasciner le public encore bien des années : une épidémie inconnue d’origine virale, des complots à grande échelle, de mystérieuses sociétés aux horribles secrets, des hordes d’ennemis ultraviolents dénués de conscience.
Depuis lors, ce jeu prodigieux a vu naître nombre de séries et d’adaptations littéraires, une saga cinématographique ainsi qu’une multitude de produits dérivés. Resident Evil sera considéré comme l’un des titres les plus influents dans l’évolution de l’industrie vidéoludique ; ce jeu reste une légende indissociable de la culture populaire moderne.
Mais, surtout, il aura permis à de nombreux adultes ayant comme moi gardé leur âme d’enfant de continuer à jouer et à vivre de terrifiantes aventures et de combattre de monstrueux ennemis sans trop attirer l’attention. Et rien que pour cela, voilà qui en aura vraiment valu la peine.
Jaume Balagueró
Jaume Balagueró a grandi à Barcelone, où il a étudié la photographie et le cinéma. Diplômé en sciences de la communication en 1991, il travaille d’abord en tant que journaliste de cinéma et animateur radio, avant d’embrasser la carrière de cinéaste avec La Secte sans nom, premier long-métrage qui le consacre d’emblée comme l’un des grands espoirs du cinéma fantastique espagnol. En 2002, Jaume Balagueró réalise Darkness, une coproduction internationale, avant de diriger trois ans plus tard Fragile, puis de coréaliser en 2008 avec Paco Plaza le film d’horreur[REC], tourné à la manière d’un reportage télévisé, amené à rencontrer un grand succès à travers le monde. Le duo récidive en 2009 avec [REC]2, avant que Jaume Balagueró ne reprenne seul les rênes de la série en 2014 en écrivant et réalisant [REC]4, après un aparté en 2011 avec le film d’épouvante Malveillance.
Avant-propos
ALORS que s’achevait la génération dorée des consoles 16 bits, sa 2D enchanteresse, ses souvenirs doux et colorés – enfantins, diront certains – , le jeu vidéo préparait sa mue. Coïncidant avec l’arrivée des consoles PlayStation et Saturn, le média allait entamer son entrée fracassante dans l’adolescence, avec des titres plus matures, aux contenus et thématiques plus élaborés, plus sombres et à l’écrin très cinématographique. Aux côtés de Tomb Raider, la saga Resident Evil s’est rapidement imposée comme l’un des symboles de cette vague de renouveau, popularisant au passage un genre dont l’invention remontait alors pourtant à quelques années, avec Alone in the Dark : le survival horror.
Devenu l’un des genres rois sur la génération de machines 32 bits, le survival horror comptera quantité de descendants, calqués dans leur très grande majorité sur le jeu fondateur créé par Shinji Mikami. Car oui, au même titre que la saga Metal Gear par rapport à Hideo Kojima, les Resident Evil restent infailliblement associés au nom de leur créateur, à la personnalité complexe, connu autant pour son exigence absolue que pour son franc-parler caractéristique. Le premier épisode de Resident Evil et ses suites ont relancé l’engouement pour la figure mythique du zombie, ce mort-vivant putride devenu depuis incontournable, aujourd’hui plus que jamais, qu’il s’agisse du jeu vidéo, du cinéma, de la bande dessinée ou de la télévision (preuve en est le succès incroyable de la série The Walking Dead). La saga de Capcom a acquis le statut de véritable phénomène de la pop culture, dépassant largement le cadre du jeu vidéo, comme nous aurons l’occasion de le voir dans cet ouvrage ; c’est dire si la série a marqué les esprits.
Comme tout phénomène culturel, Resident Evil n’en est plus en outre à un paradoxe près. Alors que la série a donné ses lettres de noblesse au survival horror et enfanté quantité d’héritiers, son attrait auprès des joueurs a fini par décroître d’épisode en épisode, le genre tout entier connaissant même alors un déclin aussi fulgurant que l’avait été son ascension. Si aujourd’hui les prémices d’un retour en force du survival horror paraissent poindre discrètement, autant à travers la foisonnante production occidentale indépendante que par le renouveau créatif japonais (le futur Silent Hills de Kojima et Del Toro), Resident Evil est, pour une fois, parfaitement étranger à cette résurrection. En attendant la prochaine étincelle ?
Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi
Passionnés depuis l’enfance par la presse papier, Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi n’ont pas tardé à lancer leur premier magazine, Console Syndrome, au cours de l’année 2004. Après cinq numéros à la distribution limitée à la région toulousaine, ils décident de créer une maison d’édition du même nom. Un an plus tard, la petite entreprise sera rachetée par Pix’n Love, éditeur leader sur le marché des ouvrages dédiés au médium du jeu vidéo. Au cours de ces quatre années dans le monde de l’édition, Nicolas et Mehdi auront édité plus de vingt ouvrages consacrés à des séries phares, dont ils auront eux-mêmes rédigé un grand nombre : Zelda. Chroniques d’une saga légendaire, Metal Gear Solid. Une Œuvre culte de Hideo Kojima et La Légende Final Fantasy VII et IX. Depuis 2015, ils poursuivent leur démarche éditoriale articulée autour de l’analyse des grandes sagas du jeu vidéo au sein de la nouvelle maison d’édition qu’ils ont cofondée : Third.
Bruno Provezza
Féru de jeux vidéo et de cinéma fantastique depuis sa plus tendre enfance, Bruno Provezza a occupé de 2002 à 2006 la fonction de rédacteur en chef du site officiel du magazine Mad Movies, avant d’en diriger le numéro hors-série : Quand le jeu vidéo fait son cinéma et d’intégrer définitivement la rédaction du mensuel papier. Ancien collaborateur occasionnel de Gameblog.fr entre 2008 et 2013, il œuvre également en qualité de traducteur pour le compte des éditions Flammarion et Pix’n Love.
CHAPITRE PREMIER
Capcom, Shinji Mikami et la naissance du survival horror
PARMI les sociétés mythiques du jeu vidéo, Capcom occupe une place à part. La firme d’Ôsaka possède près de trente ans d’expertise dans le domaine vidéoludique, et son portfolio abrite des licences parmi les plus importantes de notre secteur. Comment cette firme s’est-elle façonnée ?
Des débuts enthousiasmants
C’est en 1979 que Kenzô Tsujimoto décide de prendre en main son avenir. Le 30 mai de cette même année, il décide de créer sa propre société, spécialisée dans la production et la distribution de jeux électroniques. IRM Corporation est née. Dès 1981, la filiale Japan Capsule Computer est mise sur pied. Trois années plus tard, cette division se substitue à la maison mère et devient « Capcom », contraction du nom original (Capsule Computer). Basée à Ôsaka, la société va vite se spécialiser dans le jeu vidéo et commencer par proposer des titres destinés surtout au marché de l’arcade, au Commodore et à la NES de Nintendo. Le premier jeu de la firme est un shoot them up s’intitulant Vulgus, qui débarque dans les salles enfumées en 1984. Ce premier essai, bien que peu reluisant, ouvre les portes du succès à la société de Tsujimoto, aujourd’hui encore PDG de l’entreprise. L’année 1984 voit se produire un second événement décisif pour l’avenir de Capcom. Remercié par le voisin Konami, le jeune Yoshiki Okamoto vient grossir les rangs de l’éditeur d’Ôsaka. Le premier jeu qu’il signera chez son nouvel employeur sera 1942, shoot them up à défilement vertical qui marquera les esprits.
Premières armes, premiers succès
La firme va alors enchaîner les hits, aussi bien dans les salles d’arcade que sur la Famicom de Nintendo. Au cours de ces premières années d’expansion, des jeux aussi mythiques que Commando ou Ghosts’n Goblins viennent enchanter les joueurs japonais. Ghosts’n Goblins sera même le premier jeu à se voir porter sur console par Capcom. En 1987, le premier Street Fighter voit le jour, sans véritablement attirer l’attention. Non, le public de l’époque lorgne plutôt la NES et son Megaman. Ce titre que l’on doit à Akira Kitamura propose un robot en guise de personnage principal : reconnaissable entre mille, ce héros ne va pas tarder à devenir l’emblème de la société. Au fil des années suivantes, de nombreux autres jeux tout aussi connus verront le jour (Final Fight, Strider, Son Son...), le marché de l’arcade restant le centre névralgique de l’éditeur. Les nostalgiques se souviennent certainement, parmi les systèmes les plus utilisés, des fameux Capcom Play System (ou CPS), affublés d’un numéro croissant avec l’évolution technologique. C’est d’ailleurs sur CPS I que sera programmé le beat them all de 1991 Captain Commando, dont l’abréviation, à la japonaise, reprend le nom de la marque. On notera un événement symptomatique en août 1985 : la firme nippone décide alors de créer la filiale Capcom USA. Ce souci d’ouverture sur le monde deviendra une marque de fabrique de la firme d’Ôsaka et lui permettra de continuer à prospérer pendant près de trente ans.
Sweet Home, un jeu d’horreur
En 1989, Capcom sort sur Famicom un RPG horrifique baptisé Sweet Home, inspiré du film éponyme réalisé par Kiyoshi Kurosawa. Le gameplay du jeu est proche de ce que l’on trouve dans le RPG d’Enix Dragon Quest : combats aléatoires en vue subjective, tour par tour, inventaire d’objets à gérer intelligemment pour bien progresser... Il évoque également par certains aspects le jeu d’aventure de LucasArts Maniac Mansion, sorti en 1987 : le joueur se voit proposer de constituer une équipe en choisissant parmi de nombreux jeunes personnages ; il est possible d’enclencher des discussions entre eux, d’observer les environnements au moyen de commandes dédiées ; plusieurs fins sont en outre proposées, en fonction de la composition du groupe de héros qui parvient à terminer la quête. L’aventure de Sweet Home se déroule dans un manoir hanté et possède déjà quelques attributs que l’on retrouvera plus tard dans le premier Resident Evil : l’ouverture de chaque porte est représentée par une cinématique ; de nombreuses notes laissées dans le décor renseignent sur les événements en cours ; l’inventaire est limité ; chaque personnage possède certaines capacités propres, qui lui permettent d’effectuer des actions spécifiques. Lorsque l’on se penche sur la genèse de Resident Evil, Sweet Home apparaît à n’en pas douter comme la première influence manifeste.
L’éditeur d’Ôsaka prend de l’ampleur
Nous sommes en 1991 et Capcom semble avoir déjà réussi son pari de s’imposer dans le domaine du loisir vidéoludique. Pourtant, une bombe se prépare à éclater dans les salles d’arcade, et quelque temps après sur Super Nintendo. Il s’agit bien entendu de l’arrivée du mythique Street Fighter II, véritable titre-culte ayant donné ses lettres de noblesse au genre du jeu de combat. Pourtant, l’éditeur ne s’arrête pas en si bon chemin ; toujours sous l’égide d’Okamoto, la production se diversifie. On peut noter que de nombreux partenariats avec Disney auront contribué à élargir la base de fans de la firme, des joueurs les plus férus d’arcade aux petits écoliers japonais. Le titre le plus représentatif de cette période est sans nul doute le jeu de plates-formes Aladdin, sorti sur Super Nintendo. En 1993, la société à la capsule s’attaque même au marché du RPG classique en signant le très réussi Breath of Fire. Ce jeu de rôle typiquement nippon engendrera quatre descendants, au centre desquels gravite toujours un héros nommé Ryû, capable de se métamorphoser en dragon.
Alone in tne Dark :le survival horror à la française
En 1992 débarque sur PC un jeu réalisé par Frédérick Raynal, édité par Infogrames. Son titre ? Alone in the Dark. Même si le terme n’avait pas encore été inventé à l’époque (par le service marketing de Capcom), on considère généralement qu’il s’agit là du tout premier survival horror. Alone in the Dark est un jeu d’aventure avant tout, proposant bien plus d’énigmes que de combats. D’ailleurs, la plupart des affrontements avec les zombies qui peuplent l’environnement (au nombre de quelques dizaines) peuvent être évités pour peu que l’on fasse fonctionner sa matière grise. Le jeu surprend également d’un point de vue technique : si les personnages sont modélisés en 3D, chose déjà peu courante à l’époque, les décors, eux, sont en 3D précalculée. Cette technique permet un placement de caméra judicieux, de proposer des angles de vue étudiés, propres à susciter et à entretenir la sensation de stress. S’agissant de l’ambiance, on découvre un contexte proche de l’œuvre de Lovecraft, le projet initial devant d’ailleurs s’inscrire dans la licence officielle de cet univers si particulier. Bien que Shinji Mikami ait longtemps affirmé ignorer l’existence d’Alone in the Dark à l’époque où il a conçu le premier Resident Evil, une récente interview parue le 14 octobre 2014 sur le site LeMonde.fr voit le créateur admettre pour la toute première fois l’influence du jeu de Frédérick Raynal : « Quand Sony a annoncé les caractéristiques techniques et le nombre d’éléments en 3D que l’on pourrait afficher à l’écran, on était sceptiques, se souvient-il. J’ai repensé le jeu en partant du principe que la console serait 50 % moins puissante qu’annoncé. J’ai donc opté pour un jeu de tir en vue subjective, car cela permettait de faire l’économie d’un personnage à l’écran. Il n’y avait plus qu’à afficher les décors et les ennemis en 3D. [...] C’est alors que j’ai joué à Alone in the Dark, qui se composait de décors fixes. C’était très intéressant, car il y avait une expressivité plus importante. L’étape suivante a consisté à adapter Resident Evil à ce modèle. [...] Sans lui, reconnaît Mikami, Resident Evil serait probablement devenu un jeu de tir en vue subjective1. » On comprend ainsi qu’il avait été convenu d’un arrangement entre Infogrames et Capcom, dans le but pour ce dernier de garder secrète l’influence du jeu français sur Resident Evil. Mikami n’en persiste pas moins à répéter que sa principale influence issue du jeu vidéo est à chercher du côté de Sweet Home, et que, en ce qui concerne l’ambiance, les films de George A. Romero, tout particulièrement son Dawn of the Dead (sorti en 1978 sous le nom de Zombie en Europe), auront été sa plus grande source d’inspiration.
Doctor Hauzer
Un autre jeu japonais paraît également avoir exercé une influence dans la création de Resident Evil, il s’agit de Doctor Hauzer, sorti sur 3DO en 1994. Développé par Riverhill Soft, et édité par Panasonic, réalisé par Kenichirô Hayashi, ce jeu tient pour l’essentiel du plagiat pur et simple de celui de Frédérick Raynal. Il s’agit donc là encore d’une aventure à l’ambiance oppressante qui voit le héros évoluer seul dans un manoir. Cette fois, cependant, pas d’ennemis à combattre, seulement de nombreux pièges à éviter. Le scénario place le protagoniste dans la demeure du docteur Hauzer, archéologue réputé ayant mystérieusement disparu. Les angles de caméra sont ici également très étudiés, mais le joueur peut choisir à tout moment de changer de point de vue : vision subjective, caméra zénithale (au-dessus du personnage) ou enfin alternance d’angles de vue fixes. Le point essentiel sur lequel Doctor Hauzer s’éloigne de son modèle Alone in the Dark concerne la réalisation technique : l’intégralité du jeu est ici en 3D temps réel. Le visage du héros est en outre animé, ce qui lui permet d’afficher quelques expressions. Même si le procédé est encore assez rudimentaire, le traitement visuel évoque ce que l’on nommera bien des années plus tard le cel shading. Au bout du compte, le titre aura surtout marqué par sa maniabilité délicate... et son extrême lenteur. On retrouve quoi qu’il en soit de nombreux éléments du jeu de Hayashi dans Resident Evil : la même mise en scène lorsque le joueur ramasse quelque chose (un zoom, et l’objet tourne sur lui-même), certains types d’énigmes (dont l’une associée à une horloge cachant une clef) ainsi que l’association d’une cinématique à l’ouverture des portes – même s’il est vrai que ce procédé remonte en fait à Sweet Home.
À l’heure de la transition : le CD-ROM débarque
1994. En ayant donné naissance à pléthore de titres-cultes dans tous les secteurs du marché (en arcade, chez SEGA comme chez Nintendo), Capcom a définitivement marqué de son empreinte le fameux « âge d’or du jeu vidéo japonais ». Alors que commence à pointer le bout de son nez la génération de consoles suivante, les spécialistes de l’époque parlent d’une révolution dans l’architecture des machines 32 bits (PlayStation et Saturn), qui participeront à l’avènement de l’ère du CD-ROM. Encore une fois, l’éditeur nippon va répondre présent, en sachant anticiper ce changement à travers la production de jeux qui répondront à ce que souhaitent les joueurs de cette fin du XXe siècle. Avec la PlayStation, le marché s’ouvre en direction d’un public encore plus large, plus adulte et adepte de nouvelles expériences. C’est alors que Capcom, en 1996, livre au monde le premier volet de ce qui deviendra la saga des Resident Evil. Réalisé sous la conduite de Shinji Mikami, ce jeu propulse la PlayStation sur le devant de la scène et contribue à façonner l’image « rebelle » de la console de Ken Kutaragi.
Shinji Mikami, père du survival horror, connaît une enfance agitée
Shinji Mikami est né le 11 août 1965 à Yamaguchi, préfecture à l’ouest de Honshû, près de Kyôto. Son enfance est bercée par les films d’action, et plus particulièrement par les longs-métrages mettant en scène Bruce Lee ; sur ce sujet, Mikami a pu raconter : « Gamin, quand je regardais les films de Bruce Lee, j’étais excité comme un fou, j’avais envie de donner des mandales à tout le monde2 ! » La violence, le jeune Shinji Mikami y est hélas confronté au quotidien : « Mon père était assez effrayant. Il me frappait à peu près tous les jours. Je me souviens d’un soir où j’étais allé au lit sans avoir fait mes devoirs. Énervé par mon comportement, il m’a chassé de ma chambre au milieu de la nuit et m’a ordonné d’aller dehors. En pyjama et sans chaussures, je suis donc sorti dans le froid. Mon père m’a alors demandé de rester devant la voiture, tandis qu’il se mettait au volant et commençait à avancer. J’ai dû courir devant lui sur environ cinq ou six kilomètres, jusqu’à atteindre la côte. Sans dire un mot, il a alors fait demi-tour. J’ai compris qu’il me fallait rentrer à pied. Avec le recul, je me suis dit que si la police avait vu ce garçon pieds nus en pyjama, poursuivi par un gars dans une voiture, elle l’aurait sans aucun doute arrêté3. »
Malgré une vie de famille compliquée, Mikami persévère dans les études et obtient son diplôme à l’université Dôshisha de Kyôto, après avoir échoué aux examens d’entrée deux années de suite. Joueur d’arcade invétéré, ce n’est qu’à cette époque que le jeune homme découvre les jeux Capcom avec Ghosts’n Goblins et 1942 : un véritable coup de foudre. La façon dont il va bientôt entrer en contact avec l’éditeur est somme toute originale : « L’un de mes amis avait trouvé un prospectus pour un buffet organisé par Capcom dans le cadre de la recherche de nouveaux employés. Mon ami me l’a donné parce qu’il savait que j’aimais les jeux vidéo. À la base, je m’y suis rendu uniquement parce que j’avais envie de manger à l’œil ! Sur place, après quelques échanges avec des employés de Capcom, j’ai trouvé les postes proposés tout à fait convenables. J’ai donc postulé à la fois chez Capcom et chez Nintendo ; mais il a fallu que la deuxième série d’entretiens se déroule le même jour pour les deux sociétés, j’ai dû alors faire un choix... et ce fut Capcom4. »
Des débuts tranquilles
Nous sommes en 1990 et Shinji Mikami commence son activité chez l’éditeur par un petit jeu Game Boy intitulé Capcom Quiz : Hatena ? no Daibôken. Les délais de production sont très serrés : ses supérieurs ne lui ont octroyé qu’un mois pour réaliser le jeu. Cependant, perfectionniste déjà, le jeune Mikami veut absolument peaufiner son travail jusqu’au moindre détail. Achevant le jeu sous pression, il lui aura finalement fallu trois mois pour rendre sa copie. Il craignait même l’annulation pure et simple de la sortie du jeu à cause du retard accumulé.
L’année suivante, on confie à Shinji Mikami l’adaptation pour Game Boy du film de Disney Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Si le succès est au rendez-vous en Europe comme aux États-Unis, le jeu passe inaperçu au Japon, de sorte que la cote de popularité du concepteur stagne dans son pays natal. Capcom le charge alors de développer un jeu de Formule 1 destiné au marché occidental. Mikami est dans un premier temps ravi par cette nouvelle tâche, car il adore les jeux de course ; mais, rapidement, le chantier se transforme en cauchemar : voulant créer un jeu de grande qualité, il pousse ses collaborateurs à bout, se montre extrêmement exigeant et leur en demande toujours plus. Sans surprise, le développement prend du retard. Les programmeurs finissent par admettre qu’ils ne peuvent faire mieux, ce qui met Mikami dans une colère noire. Il menace alors ses collaborateurs de tout annuler, et c’est bien ce qui finit par se produire après huit mois de développement, du fait de ces retards répétés. Mikami confesse aujourd’hui avoir manqué de maturité à l’époque ; il admet n’avoir pas su reconnaître les limitations techniques des machines sur lesquelles travaillaient son équipe et lui.
Les années Disney
En 1993, Shinji Mikami se voit de nouveau confier l’adaptation d’un film de Disney. Cette fois, c’est Aladdin qui va faire escale sur Super Nintendo. Le concepteur s’acquitte de cet office haut la main ; toutefois, à la même époque, son jeu doit faire face à la version Megadrive du même titre, mise au point par un certain David Perry. Le jeu américain reçoit un meilleur accueil que celui de Mikami, qui accuse visiblement le coup et se trouve privé du succès qu’il méritait pourtant – il aura fallu attendre 2014 pour que le fier développeur admette tout de même, dans un entretien donné au site Polygon, la supériorité du titre de Perry. Mikami enchaîne néanmoins avec le développement d’un nouveau jeu tiré d’une licence Disney : Goof Troop (1994). Le concepteur – qui déplore à l’époque le manque d’ambition du titre – voit dans cette tâche une véritable punition. Même si elles ne lui auront en définitive apporté ni la gloire ni la reconnaissance, ces « années Mickey » auront un impact sur la suite de la carrière du game designer, comme il le confiera plus tard : « Je crois que je peux remercier Disney pour ces adaptations, car la frustration accumulée pendant cette période a contribué à la création de Resident Evil. » Malgré ses succès modérés, Mikami commence à se faire remarquer en interne pour son perfectionnisme, sa persévérance et les efforts qu’il déploie pour mettre au point des jeux sans accrocs. Ce caractère bien trempé et ses qualités de game designer lui vaudront la visite de Tokurô Fujiwara5, venu l’entretenir d’une licence inédite qu’il souhaite mettre en production pour la nouvelle console de Sony, la PlayStation. Ce titre serait une « suite spirituelle » de Sweet Home. Fujiwara raconte avoir demandé à Mikami si ce dernier détestait être effrayé. Ce à quoi le jeune homme allait répondre à celui qui deviendrait bientôt son mentor par un franc « Oui ! »6. Fujiwara poursuit en affirmant qu’il n’aurait pas confié le projet à Mikami dans le cas contraire. C’est de cette discussion qu’allait naître la plus grande œuvre de Shinji Mikami.
1http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/10/14/shinji-mikami-aux-sources-du-jeu-d-horreur45024004408996.html.
2http://www.gamekult.com/actu/tgs-interview-shinji-mikami-A87569.html.
3http://www.giantbomb.com/shinji-mikami/3040-32999/.
4http://www.giantbomb.com/shinji-mikami/3040-32999/.
5 C’est à Fujiwara, chez Capcom depuis 1983, que l’on doit entre autres la saga Ghosts’n Goblins.
6http://www.glitterberri.com/developer-interviews/tokuro-fujiwara/.
CHAPITRE II
Genèse des jeux
LA GENÈSE de la saga Resident Evil tient véritablement du roman, tant la réalisation de chacun des jeux aura été émaillée de difficultés, de revirements et de conflits internes. Bien entendu, la personnalité volcanique de Shinji Mikami ainsi que son perfectionnisme légendaire entrent pour une large part dans ces gestations compliquées. Sans lui, toutefois, il est certain que la saga n’aurait jamais atteint une telle qualité, avec la popularité qui en a découlé.
Les origines de l’horreur
Shinji Mikami accepte immédiatement la proposition de Fujiwara de donner une suite spirituelle à Sweet Home. Néanmoins, il émet quelques réserves sur le succès que pourrait rencontrer le jeu à venir, au vu des ventes moyennes du titre originel. Son supérieur le rassure en lui avouant que Capcom n’escompte pas en vendre plus de cent cinquante mille exemplaires, un chiffre très faible en comparaison des résultats des autres productions de la marque à l’époque. L’important pour l’éditeur n’est pas en l’occurrence de sortir un jeu de grande envergure, mais plutôt d’explorer de nouveaux horizons. C’est du reste la modestie de cette ambition qui a fait que Mikami ait pu se retrouver ainsi à la tête du projet alors qu’il ne jouissait guère d’une grande renommée à l’époque.
Le concepteur prend le temps d’identifier les mécanismes du jeu Sweet Home, d’en analyser et d’en assimiler les rouages. N’ayant guère reçu d’indications de la part de son éditeur – hormis de créer un jeu dans la veine de ce modèle – il est donc très libre, en définitive. Il passe les six premiers mois seul sur le projet, à définir précisément la direction dans laquelle il souhaite le conduire. Mais Capcom avait à cette époque des préoccupations immédiates bien différentes. L’éditeur exigeait en effet un scénario complet avant de passer à la phase de développement. Mikami, lui, trouvait cela complètement inutile ! Le game designer ne souhaite qu’une chose : faire peur ! Ainsi son désir était-il de planter le décor de son jeu dans une maison hantée. Pas besoin à ses yeux d’une intrigue complexe pour faire frissonner le joueur. Persistant dans cette idée, Mikami va présenter à Capcom un scénario comprenant simplement un début, une fin et quelques actions intermédiaires, rien de plus. Finalement, le jeu aura conservé comme base ces bribes jetées par Mikami : des membres d’une unité d’élite pris au piège dans un manoir peuplé de monstres génétiquement modifiés. Si Mikami s’inspire effectivement de Sweet Home, il décide néanmoins de ne pas retenir la composante fantastique et surnaturelle de son modèle. Pour lui, les fantômes font moins peur que les monstres dérivés d’animaux ou d’humains. De son propre aveu, Mikami ne voulait pas d’un jeu de fantômes : il fallait que la menace fût tangible et clairement définie, « à la manière d’Alien ou des Dents de la mer » (cf chapitre 7). C’est sur ce principe que le zombie s’impose rapidement. Précisons qu’au cours de ses études Mikami avait vu et apprécié Zombie, le film célèbre de George Romero. Il avait été profondément marqué par son argument simple : que ferait-on si des zombies venaient envahir notre vie quotidienne ? Romero affirmait d’ailleurs également : « La chose la plus effrayante, c’est nous-même. » Mikami estime qu’à chaque fois qu’un spectateur regarde un film d’horreur, il ne peut s’empêcher de trouver les réactions des personnages incohérentes, pour finir par se dire : « Si j’avais été dans cette situation, je n’aurais pas agi comme ça. » Son objectif avec Resident Evil était donc de créer un film d’horreur au sein duquel le joueur pourrait réagir comme il l’entendrait. Dans la première version de Resident Evil, il avait donc été envisagé de mettre en scène toutes sortes de zombies, et même des enfants ! Mais Shinji Mikami n’allait pas tarder à se raviser : il trouvait que cette idée pouvait choquer – posture qui détonne quelque peu avec le souci qu’il avait de mettre en place un récit crédible.
La nouvelle licence horrifique de Capcom prend forme petit à petit. Une fois tracée la ligne directrice, Mikami s’entoure d’une vingtaine de personnes, qui vont travailler au projet un an durant à tester les diverses approches imaginées par le concepteur. Dans sa première mouture, le jeu adopte les contours d’un FPS1 : : le développement débute donc, mais les premiers essais ne sont guère convaincants. Si, techniquement, c’est superbe, la vue subjective ne permet pas d’insuffler la sensation de peur. On s’est trop éloigné de l’ambition première, et le game designer va demander à ce que le développement soit repris à zéro. Les programmeurs sont abasourdis par cette décision, qui revient ni plus ni moins à jeter tout le travail accompli ! Fous de rage, ils réclament la désignation d’un nouveau chef de projet, menaçant de tout arrêter si Mikami n’est pas rapidement remplacé. Ce dernier va alors toutefois user de tous ses charmes pour convaincre certains de ses plus fidèles collaborateurs de lui faire confiance. Soutenu dans sa démarche de tout reprendre à zéro, Mikami réussit à mettre en chantier une nouvelle version du jeu. Cette fois, son idée est de créer des décors en 3D précalculée où évolueront des personnages en 3D temps réel (il s’agit là de la première expérimentation de la société dans le domaine !). L’usage de la 3D précalculée (une brillante idée dont nous connaissons à présent l’origine) autorise en tout cas l’affichage de textures de qualité et, surtout, en grand nombre. Le tout sera exploité à travers des angles de caméra fixe permettant des cadrages maîtrisés, très cinématographiques, propices à engendrer l’angoisse chez les joueurs, comme nous le verrons au chapitre 7.
Néanmoins, le perfectionnisme de Mikami va encore faire des siennes et son degré d’exigence dépasser les capacités de la PlayStation – console pourtant choisie pour la puissance offerte, censément capable de restituer l’expérience voulue. Ce qui hante Shinji Mikami et le rend irritable, ce sont les temps de chargement nécessaires lors des changements de salle. Malgré la technologie utilisée pour les décors, constitués donc d’images fixes, il n’y a rien à faire, ces chargements restent extrêmement longs. Mikami va alors se souvenir de son modèle initial, Sweet Home : pour permettre au joueur de patienter en même temps que pour faire monter la pression, chaque ouverture de porte se faisait sous la forme d’une petite saynète. Il décide d’adopter le même procédé. Ainsi la vidéo va-t-elle servir à couvrir le temps de chargement. Les emprunts au jeu de 1987 n’allaient pas s’arrêter là : lors des premiers mois de développement, Mikami souhaitait aussi intégrer un système de coopération. À l’instar de celui de Sweet Home, le héros du premier Resident Evil devait toujours être accompagné par un autre personnage, dirigé par l’intelligence artificielle de la console ; l’idée, cependant, fut rapidement abandonnée.
Une histoire de réalisme
Dans un premier temps, l’apparence des héros du jeu s’inspirait nettement de l’imagerie des mangas. D’ailleurs, dans la toute première ébauche, le protagoniste se battait avec un katana en lieu et place d’une arme à feu ! L’un des personnages, nommé Gelzer, était même carrément un vétéran de guerre à la force herculéenne, doté d’un œil bionique ! Il était prévu que ce dernier, pour sauver la vie d’un de ses coéquipiers, soutînt un plafond sur le point de s’écraser. En définitive, il fut remplacé par Barry et la scène dut être réaménagée. Un autre personnage, afro-américain et maigre, devait apporter une touche humoristique au jeu, à la manière des faire-valoir des films américains (sidekicks). Lui non plus ne fut pas conservé dans la version définitive. Ce recadrage plus réaliste, autant au niveau de l’aspect des héros que dans la mise en scène, sert à pallier le manque d’identification des joueurs aux personnages et à mieux les effrayer, en les mettant face à des ennemis à l’aspect réaliste, mais complètement difformes. Jun Takeuchi, à l’époque graphiste en chef du projet, s’appuie sur cette nouvelle orientation pour commencer à élaborer l’aspect des ennemis à partir d’animaux et insectes effrayants, comme les araignées ou les scorpions. Il reçoit toutefois des retours mitigés de la part de ses collègues, estimant qu’il serait ennuyeux de n’avoir à combattre que des insectes ou de petites bestioles. Takeuchi a alors apporté de l’originalité aux traits de ses monstres, et les Hunters, par exemple, se sont vu doter par l’artiste de grandes griffes menaçantes. Faut-il rappeler aux joueurs de la première heure que cet ennemi peut tuer le héros d’un seul coup en lui tranchant la tête ? Ce monstre devenu très célèbre traumatisa nombre d’entre eux !
Cette quête de crédibilité pousse Mikami à réaliser l’introduction de son jeu sous la forme d’un véritable film. Le jeune game designer voulait étonner le joueur dès le lancement du disque, mais la puissance de la PlayStation ne lui permettait pas de faire ce qu’il avait réellement en tête. Mikami souhaitait une séquence forte qui fût en mesure de transmettre un sentiment d’angoisse palpable. Avec les moyens à disposition, cependant, impossible de réaliser cela en images de synthèse. C’est alors qu’il prit la décision d’engager des acteurs pour tourner la scène lui-même. Mikami raconte : « Ce tournage bon marché, nous l’avons effectué à Tamagawa au Japon. Je n’avais pas beaucoup d’argent ni de temps pour faire quoi que ce soit de correct, et je ne sais pas pourquoi, mais j’ai choisi les acteurs uniquement parce qu’ils ressemblaient aux personnages et non sur la base de leur curriculum vitœ. Jill, par exemple, était jouée par une simple étudiante, qui durant tout le tournage s’est plainte des piqûres de moustique et n’avait qu’une envie : rentrer chez elle ! Maintenant, je pense que je ferais beaucoup mieux, mais c’est évidemment bien trop tard ! »
Le doublage japonais des personnages, là encore, allait être réalisé par des acteurs peu qualifiés. Le travail fourni n’était pas à la hauteur des exigences de Mikami, qui trouva le résultat tout simplement ridicule. Décidé à ne plus faire de concessions, le père de la future saga renvoya tous les acteurs, de sorte que la version nippone dut se passer des doublages japonais ! Les ambitions internationales du jeu poussèrent toutefois Mikami à intégrer des voix en anglais. C’est sous sa supervision que les doublages furent enregistrés au Japon. Il avait demandé aux acteurs de s’exprimer très lentement et de veiller à bien articuler. Le concepteur ne s’en rendait pas compte, mais, à cause de ses directives maladroites, la bande-son qui en résulta s’avéra des plus étranges. Elle marqua en tout cas les joueurs, d’autant plus que la version américaine du jeu ne possédait même pas de sous-titres ! Notons qu’au sein de la série, les doublages sont restés en anglais jusqu’à l’épisode Revelations, où pour la première fois nous avons eu la chance d’avoir des voix en français (et plutôt de bonne facture, de surcroît).
La dernière ligne droite
Les mois de production s’écoulent, et la date de sortie approche. Pourtant, des problèmes subsistent. Malgré de nombreux efforts, le maniement des personnages est resté trop rigide, ce qui inquiète beaucoup Okamoto, manager en chef des studios de Capcom, auparavant responsable du département arcade. Ce dernier va jusqu’à prédire que neuf joueurs sur dix haïront le gameplay s’il reste en l’état. Son constat alarmiste concerne aussi d’autres points comme la quantité de rubans encreurs, essentiels pour sauvegarder sa partie. Pour Okamoto, si le nombre de ces rubans n’est pas suffisant, le joueur va focaliser sur leur collecte la plus grande partie de son attention par crainte de perdre sa progression, ce qui reléguera l’histoire au second plan. Globalement, Okamoto estime que le jeu regorge de bonnes idées, mais qu’elles sont mal agencées. Au mépris de ces avertissements, Resident Evil restera tel quel et remportera un triomphe exceptionnel. Malgré ce succès, Okamoto persistera en déclarant que Capcom aura eu de la chance que les joueurs se soient concentrés sur l’ambiance en oubliant ainsi la jouabilité, ou en tout cas en ne la sanctionnant pas.
Au bout du compte, il aura fallu pour mener à bien ce projet plus de deux ans à l’équipe, composée de vingt à trente personnes, d’ailleurs très jeunes dans l’ensemble (il s’agit pour la plupart du premier jeu auquel elles aient travaillé).
Le jour J
Le 23 décembre 1995, c’est le jour tant attendu de la présentation de Resident Evil. Toute l’équipe est en émoi, la tension est à son comble. Pourtant, devant un parterre de journalistes conviés à la conférence de presse, l’enthousiasme des membres de Capcom va bientôt retomber. En effet, peu de journalistes ont fait le déplacement, l’ambiance est morne, l’engouement modéré et l’accueil du jeu s’avère en fin de compte assez timoré... Mikami est quelque peu déboussolé : ce projet dans lequel il a tout investi ne semble pas trouver l’écho escompté. Et le doute plane encore dans son esprit jusqu’au 22 mars 1996, date de sortie du titre au Japon. Ses interrogations ne vont alors plus tarder à trouver des réponses concrètes, et ce de façon littérale : dans la boîte du jeu, Capcom avait glissé un formulaire à remplir pour évaluer la satisfaction du public (pratique très courante dans les années quatre-vingt-dix), et Mikami attendait énormément de ces retours. Okamoto le sait et décide de lui faire une bonne blague : il ne va en remettre que trois à son collègue. Le lendemain, ce dernier découvre qu’en fait le secrétariat croule sous des montagnes de lettres de joueurs, tous plus satisfaits les uns que les autres !
La plaisanterie d’Okamoto sera rapidement oubliée quand Capcom annoncera à l’équipe que Resident Evil est le premier jeu PlayStation à dépasser le million de ventes au Japon. Au total, toutes versions confondues, les ventes culminent aujourd’hui à quasiment 5,1 millions d’exemplaires (comprenant donc les versions Director’s Cut et Dual Shock Edition – dont nous parlerons plus loin – , les ventes de la version originale pour la première génération de PlayStation atteignant à elles seules les 2,75 millions d’exemplaires). L’équipe est folle de joie. Pourtant, Mikami reste très critique vis-à-vis de son jeu. Il souligne la faiblesse du film d’introduction, trop amateur à ses yeux. Il blâme aussi la mise en scène de l’arrivée dans le manoir, au moment où l’équipe se trouve séparée. Pour ce passage, Mikami ne savait pas comment forcer le joueur à commencer son aventure par le rez-de-chaussée. Il savait pertinemment que certains allaient vouloir monter par l’escalier central pour se rendre immédiatement au premier étage. Il avait alors décidé de faire retentir un coup de feu, qui obligeait les personnages à aller inspecter l’endroit d’où le bruit provenait – une situation que Mikami juge avec le recul un peu « nulle ». On le constate, le père de la série se montre très dur avec son œuvre, il n’hésite pas à remettre en question le travail de ses collaborateurs de même que le sien. C’est de ce perfectionnisme et, il est vrai, de ses quelques coups de sang qu’est née sa réputation de chef de projet intransigeant et autoritaire.
La suite pour Mikami
Conséquence du succès phénoménal de Resident Evil, Mikami est promu producteur et prend la tête de la destinée de la saga qu’il vient d’entamer, avec notamment pour tâche la gestion financière du studio. À ce poste, il s’éloigne petit à petit de la création. Alors que Hideki Kamiya, déjà membre de l’équipe du premier Resident Evil en tant que planificateur et à la gestion des caméras, sera désigné par Mikami lui-même pour lui succéder, ce dernier ne se plaît pas vraiment dans ses nouvelles fonctions. Selon lui, la production se limite à tenir des comptes : « J’ai rejoint Capcom en vue de créer. En devenant producteur, je n’étais plus directement impliqué dans ce processus. Ce fut un moment très difficile : pour moi, m’éloigner du développement a été contre-productif. Un temps, j’ai même voulu quitter Capcom à cause de cela. » À ce moment de sa carrière, Mikami déclare : « J’espère qu’un jour je pourrais revenir à la conception d’un jeu. »
Anecdotes
Shinji Mikami est un vrai joueur passionné. Pour preuve, c’est un grand fan des jeux Derby Stallion (Ascii), du Gradius arcade, mais aussi des sagas Mario, Zelda, Final Fantasy et Dragon Quest.
Pour des questions de droit, le nom japonais de la saga, Biohazard, restera confiné aux frontières de l’Archipel. En effet, un groupe de metal américain se nommait déjà de la sorte. C’est Chris Kramer, directeur de la communication chez Capcom, qui suggéra alors le titre Resident Evil.
Le premier RE comporte huit fins différentes (quatre par personnage), en fonction du nombre de héros secondaires sauvés par le joueur (dans le scénario de Chris par exemple, ce dernier peut achever l’aventure seul, accompagné de Rebecca ou de Jill, voire des deux).
Pour fêter les dix ans de la série, ce premier RE se verra porter sur Nintendo DS en 2006. Une version assez fidèle à l’original, mais bien moins immersive en raison de la petite taille de l’écran de la portable. Cette adaptation proposera tout de même quelques nouveautés permettant une maniabilité plus souple (rechargement rapide, demi-tour instantané, mode multijoueur local), notamment au travers du mode de jeu Renaissance, plus facile, qui permet quelques interactions tirant parti des fonctionnalités de la console (faire du bouche-à-bouche en soufflant dans le micro de la machine, séquences en vue subjective où le joueur doit balayer l’écran tactile pour déclencher des coups de couteau, etc.).
La transition Resident Evil Dash
Capcom souhaite maximiser sans tarder le profit lié à l’immense succès de Resident Evil.