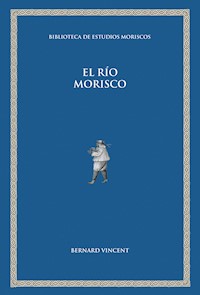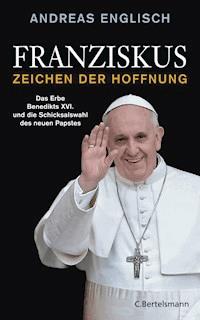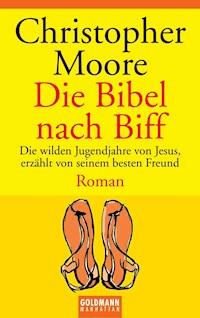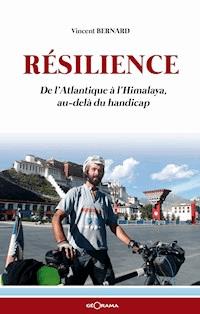
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Géorama Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Une volonté de vivre à toute épreuve malgré le handicap
Au départ, Vincent est un enfant comme les autres : une enfance sans réels problèmes, une aptitude aux études, un goût prononcé pour le sport. Mais à 18 ans, une première épreuve vient enrayer son évolution. Atteint d’un lymphôme d’Hodgkin, il consacre son énergie à vaincre la maladie. Tout en poursuivant des études d’ingénieur, Il se tourne vers la haute montagne et décide de tenter le concours de guide. Tout s’enchaîne plutôt bien jusqu’au jour où il dévisse d’une paroi et chute de 80 mètres ! S’il s’en sort miraculeusement, les dégâts sont considérables. Coma, rééducation, Vincent est brisé. Il lui faudra près de deux ans d’efforts pour retrouver une vie « normale » et assumer son « statut » de personne handicapée traumatisé crânien et une nouvelle position dans la société. Ses rêves d’altitudes s’envolent à jamais. Il reprend ses études et le vélo mais le destin s’acharne : à 28 ans, une violente chute, tête la première sur un plot de béton, le plonge dans un nouvel abîme. Sa force mentale hors du commun l’aidera, une fois de plus, à s’en sortir. Persuadé que son expérience peut servir d’exemple, il se lance le défi « Résilience » dont le but est de rejoindre, seul, le Népal à vélo au départ de Brest. En porte-parole de tous ceux qui doivent affronter l’épreuve du handicap et de la maladie, son aventure se veut un message d’espoir. De l’Europe à l’Asie centrale, du Tibet au Népal, ce voyage fleuve témoigne d’une force et d’une volonté de vivre à toute épreuve. Un parcours difficile que Vincent affronte jour après jour, pour atteindre enfin son but qui, plus qu’un aboutissement, résonne pour lui comme un nouveau départ dans la vie…
Ce témoignage touchant démontre que le voyage peut être une réelle thérapie
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "Son marathon hors-norme en Asie reste un exemple pour beaucoup, mais surtout le signe qu'on peut résister au handicap et accomplir ses rêves."
(France bleu)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Vincent Bernard est né en 1980 à Mâcon. Diplômé de L’ENSTA Bretagne, il est ingénieur océanographe. Il a fondé l’association Résilience 29 dont le but est de favoriser l’insertion des personnes handicapées et des traumatisés crâniens.
EXTRAIT
Tout peut arriver en montagne, on le sait, on l’entend, on rencontre des alpinistes qui en témoignent… Mais tout cela semble lointain, abstrait, tant que la montagne vous épargne.
Je faisais partie de ces privilégiés-là jusqu’au 14 février 2004. À 23 ans je vivais avec la montagne comme avec la plus fidèle des maîtresses, je l’arpentais, la caressais, m’y agrippais, persuadé que rien ni personne ne pourrait nous arracher l’un à l’autre. Je la pensais incapable de me trahir, certain d’en connaître chaque relief, chaque danger. Pourtant ce jour-là, alors que toute ma semaine d’escalade s’était déroulée dans des conditions optimales, que j’étais prêt pour devenir guide de haute montagne, rien ne se passa comme prévu…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mes parents,
à ma famille,
à Bir et Santos,
à tous ceux qui connaissent l’épreuve de la maladie,
à tous ceux qui vivent le handicap,
à ma Marcelita, mon bonheur de tous les jours…
« La résilience est un phénomène psychologique
qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme,
à prendre acte de l’événement traumatique
pour ne plus vivre dans la dépression.
La résilience serait rendue possible grâce à la réflexion,
à la parole, et à l’encadrement médical
d’une thérapie, d’une analyse. »
De Brest au Népal
CARTE GÉNÉRALE DE L’ITINÉRAIRE
Données cartographiques SAT-VIEW by Sierra Echo - Google 2013 © IGN France - www.resiliencevincent.fr
Première partie
LES PRÉMICES DE RÉSILIENCE
Chapitre I
La chute
Tout peut arriver en montagne, on le sait, on l’entend, on rencontre des alpinistes qui en témoignent… Mais tout cela semble lointain, abstrait, tant que la montagne vous épargne.
Je faisais partie de ces privilégiés-là jusqu’au 14 février 2004. À 23 ans je vivais avec la montagne comme avec la plus fidèle des maîtresses, je l’arpentais, la caressais, m’y agrippais, persuadé que rien ni personne ne pourrait nous arracher l’un à l’autre. Je la pensais incapable de me trahir, certain d’en connaître chaque relief, chaque danger. Pourtant ce jour-là, alors que toute ma semaine d’escalade s’était déroulée dans des conditions optimales, que j’étais prêt pour devenir guide de haute montagne, rien ne se passa comme prévu…
Le gros, l’immense bloc de calcaire cannelé miroitant au soleil, c’est la falaise du Sapey en Haute-Savoie ; et la voie que nous venons de gravir porte le célèbre nom de « Octopussy ». Au premier plan, le Mont-Lachal, et loin derrière, mais distinct tant le grain de cette journée d’hiver est fin, se dresse magistralement le massif du Mont-Blanc. Quand bien même il possède un niveau supérieur au mien en escalade sur falaise rocheuse, François est aussi heureux que moi d’avoir passé toutes nos courses d’alpinisme hivernal avec autant de plaisir. Nous sommes conscients d’être bénis des dieux avec un temps idéal : sec, froid et ensoleillé.
Dernier jour, dernier rappel, dernière minute, alors que nous sommes gorgés d’excitation et de bien-être, la tension se relâche d’elle-même.
Je deviens un point infime sur la montagne, un colibri sans plume qui tente de battre des ailes pour la première fois de sa vie ; ridicule et impuissant, je tombe sur 40 mètres de falaise, puis sur 40 mètres de plus, en forte pente enneigée. Rebonds insupportables de mon squelette contre les blocs rocheux, mon coude gauche est pulvérisé, les ligaments sont arrachés. Abominable lenteur, foudroyante arrivée, c’est finalement un arbre qui arrête ma chute. Mon crâne percute les roches éparses emmaillotées de neige. Il se fissure, se déstructure. La cloison médiane entre les deux hémisphères est déchirée : le sang se disperse. Mon corps est si douloureux, comme happé par une horde de carnassiers ivres de violence, que mon esprit s’en échappe. Côtes enfoncées, poumons distordus, poinçonnés, l’occiput broyé : mon enveloppe est immobile, enroulée autour du tronc assassin.
François assiste à la scène, alors qu’il n’a pas encore fait le dernier rappel. Il doit descendre la dernière longueur, catastrophé, seul et sans corde car je suis tombé avec, pour atteindre la voiture au plus vite et appeler les secours. Ne pas céder à la panique, à l’effroi et remonter coûte que coûte la vertigineuse falaise pour indiquer le lieu de l’accident à l’hélicoptère.
Je suis rapatrié en Suisse, à Genève exactement, car c’est la plus grande ville proche de l’accident. Dans un coma profond – Glascow 4 –, je ne me rendrai compte que de peu de chose, de la ville où l’on m’emmène peut-être, de l’accent suisse qu’ont les gens qui m’entourent, des voix lointaines de mes parents qui ont accouru pour venir me voir à mon chevet.
Mais il y a autre chose qui m’appelle…
Chapitre II
Flash-back
Les gens qui me connaissent disent que lorsque je fais les choses, je les fais jusqu’au bout. En effet, cela a commencé dès le plus jeune âge avec la musique. Malgré ma forte implication, je me suis heurté à une difficulté incontournable : l’oreille musicale me faisait défaut, sans compter que je n’avais pas la patience, à cette époque, d’écouter ce que je jouais… Avant de me résigner à changer d’activité, j’ai passé un temps infini sur mon violoncelle, à n’en sortir que de piètres sons.
En parallèle il y avait la pêche que j’ai pratiquée pleinement également. Là encore j’ai passé des heures à bricoler ma canne, à démêler les nœuds, à patienter évidemment sur les bords de Saône, où je testais de nouvelles techniques inspirées des revues spécialisées que je collectionnais. J’ai même fait un stage de pêche dans le Lot, une expérience humainement malheureuse, sans doute en raison de mon trop jeune âge au milieu d’adolescents. Pour moi, il n’y avait que la pêche, alors que pour eux il y avait mille autres choses. Un décalage que je n’ai pas su gérer…
Après cette déconvenue, j’ai réalisé que j’aurais bien le temps de pêcher quand je serais plus âgé. Cette expérience m’avait initié à la pratique du « positivisme ».
Alors que je faisais ce sage constat, est apparu un complexe d’adolescent : je n’aimais pas devenir rondouillard et encore moins qu’on me le fasse remarquer. Pour y remédier, je me suis mis à pratiquer l’activité qui me semblait la plus accessible et la plus efficace : la course à pied. Alors, j’ai couru, avec la forte envie d’arriver à de bons résultats. Malgré la pleine croissance, mes longues jambes m’ont permis d’accomplir des performances honorables aux 1 000 mètres, suffisantes pour me permettre d’être sélectionné dans les épreuves scolaires. À force de m’entraîner dans les vignes, comme dans tous les endroits où j’ai vécu pendant une dizaine d’années, mes résultats devenaient de plus en plus honorables. J’aimais cette discipline qui semblait être une base ouverte à d’autres sports. C’est ainsi que, grâce à ma corpulence et à ma rapidité, j’ai pu intégrer l’équipe de rugby de l’école avec, en prime, de bons résultats en compétitions, ce qui me rendit extrêmement fier et m’incitât à intégrer le club de l’AS.Mâcon où je pus évoluer à un bon niveau.
De jeune garçon joufflu, j’étais devenu un grand type athlétique et j’avais de surcroît développé un solide mental. Rien ne pouvait m’arrêter ; j’avais le goût de l’effort et de la performance et m’investissais à fond dans mes activités sportives, me partageant désormais entre le rugby et l’athlétisme.
Mon gabarit et mon endurance, devenus hors normes pour mon âge, m’ont ouvert les sélections d’élite, d’abord départementales, puis j’ai gravi les échelons et de succès en succès, j’obtins ma plus belle sélection pour un stage franco-allemand de Rugby à Vichy. Le stage éveilla cependant des doutes sur ma réelle envie de poursuivre le rugby de façon professionnelle. Le sport devait rester pour moi un plaisir et un jeu, tout comme la voile et l’escalade, mes deux loisirs de pleine nature favorites.
Je fis ainsi le choix d’un virage assez radical en intégrant les classes préparatoires d’ingénieurs. En délaissant le sport de haut niveau pour les études – avec l’approbation convenue de mes parents – je posai les jalons d’une nouvelle étape de ma vie.
Syndrome d’Hodgkin
À Dijon, je vivais ma vie d’étudiant, sans trop savoir où j’allais, en prenant la vie du bon côté. Malgré l’importante charge de travail, je n’avais aucun scrupule à cumuler les soirées. Alors que tout semblait facile, que la vie était douce et sans obstacles, le sol se craquela sous mes pieds…
En revenant d’un match de rugby, mes parents remarquèrent une grosseur dans mon cou et m’envoyèrent passer des examens médicaux pour en comprendre l’origine. L’échographie ne donna aucune explication. On me fit donc une biopsie dont l’étude révéla la présence d’un lymphome d’Hodgkin. Si ce nom ne m’évoqua rien, je compris rapidement la gravité de la situation. On m’expliqua clairement que j’allais devoir interrompre ma prépa, pendant au moins une année, pour subir une chimiothérapie suivie d’une radiothérapie. Pas encore 19 ans et un cancer du système lymphatique !
Ce fut mon premier coup de massue.
Totalement sonné, je n’étais pas mort pour autant. La vie m’imposait un combat alors j’allais me battre et affronter l’épreuve étape par étape. Tout d’abord la chimio, que je savais lourde, à l’hôpital de Macôn, impliquant un retour à Leynes, au domaine viticole de mes parents pour un an minimum. Ayant goûté durant quelques mois à l’indépendance, ce retour dans le nid familial était frustrant mais je m’y résignai. Rapidement j’ai cherché à comprendre les causes de cet événement et sans m’apitoyer sur mon sort, j’abordai la maladie en y puisant une force positive qu’il me fallait assumer. Je savais que je devais être fort psychologiquement et j’étais bien conscient d’avoir la chance que ce syndrome ait été découvert suffisamment tôt pour en espérer une issue heureuse. Dans le cas contraire, le cours de mon histoire n’aurait pas été le même. Cette étape fut la première du projet Résilience…
Seul, le chemin peut s’avérer aride, astreignant et peu gratifiant ; en cela j’avais besoin d’interlocuteurs dotés d’une solide expérience de vie pour avancer sur cette voie de la guérison qui demande une ressource psychologique hors normes. Il y eut d’abord mon professeur de philosophie, Monsieur Jay, qui me reçut chez lui et m’aida à aborder les questions existentielles ; il m’apprit à relativiser.
Il y eut aussi le Docteur Maréchal, en charge de ma chimiothérapie, qui m’accorda le temps nécessaire à chaque injection. Clairvoyant, il m’a aidé à combattre le mal qui me rongeait. Je ne prétends pas avoir parfaitement déterminé les causes de ma guérison, mais je suis sûr que les longues discussions avec les médecins m’ont fortement aidé à positiver et à mener mon combat. Cet accompagnement moral fut primordial pour passer les épreuves de la chimiothérapie, si difficile à supporter. Comme de nombreux malades, ce n’était pas le cancer qui me faisait souffrir mais tous ces produits que l’on m’injectait dans le corps toutes les trois semaines, me laissant malade et affaibli jusqu’à la séance suivante. Ce rythme endiablé ne devenait surmontable que si le mental était assez puissant ; c’est alors le psychologique qui entrait en jeu dans le processus de guérison. Je me souviens que les injections étaient dans mon esprit tellement liées au mal-être physique que lors de ma dernière séance, j’en ai vomi, avant même la prise du traitement – c’est dire la force du subconscient !
Durant ma convalescence, n’ayant pas l’énergie de faire du sport ou de travailler, je devais trouver de nouvelles motivations pour avancer. Grâce à une amie de mes parents, j’ai découvert la peinture. Par la couleur, et la possibilité de créer, j’ai pu matérialiser l’énergie que je déployais pour guérir. Les formes arrondies et les surfaces très colorées exprimaient ma vision d’un monde qui ne serait jamais rectiligne, où tout s’enlacerait pour en démultiplier la force. La peinture m’apportait la sérénité et la certitude que la vie allait au-delà de l’horizon limité des sorties nocturnes et des performances sportives que je poursuivais jusque-là. Je réalisais simplement qu’il était possible de vivre intensément d’une autre façon…
À la fin de ma convalescence, je saisis l’opportunité d’un stage de voile aux Glénans, en Bretagne. Bien qu’ayant déjà pratiqué cette activité, je ne retrouvai pas cette vigueur des temps passés, et pour cause ! J’allai pourtant de l’avant sans prêter attention à la diminution de mes capacités. Le grand air m’aida à réfléchir sur le sens de ma vie. La maladie était peut-être un signal m’informant que je ne suivais pas le bon chemin ; il fallait par conséquent en modifier le tracé, ou plutôt l’adapter.
J’ai aussi réalisé combien la vie réservait d’énormes surprises et qu’elle pouvait être joueuse. Il me fallait donc, en conscience, considérer mes objectifs avec le paramètre que des événements incontrôlables, pouvaient en modifier le cours. Je devais reconsidérer mes objectifs, conscient qu’à tout moment des événements incontrôlables pourraient les contredire.
Vaincre la maladie fut pour moi une première victoire…
Après dix mois, je pus réintégrer les classes préparatoires, me consacrant essentiellement aux études et délaissant le rugby faute de temps. Je tentai, un peu plus tard, de reprendre mais malgré une détermination toujours intacte, je compris que j’étais passé à autre chose…
Brest
À l’issue des concours pour les écoles d’ingénieurs, je devais choisir entre deux villes aux attraits concurrents : Grenoble pour l’alpinisme ou Brest pour la voile. Je me suis finalement tourné vers le large et l’ENSTA Bretagne*. Quelques étudiants avaient fait le même choix, notamment des surfeurs.
Je n’avais goûté aux joies des vagues qu’une fois, en vacances avec mes parents. Devant l’enthousiasme de mes camarades, je me suis essayé au bodyboard, sortant dès que les conditions le permettaient, c’est-à-dire plusieurs fois par semaine en fonction des marées, de la houle et du vent. J’adorais cette communion incroyable avec les éléments, parfois impressionnants sur les côtes du Finistère. La pratique de la glisse imposait une bonne maîtrise de la météo et de la cartographie, des matières que j’aimais étudier en cours. Comme à mon habitude, je me donnais à fond, conscient qu’il me faudrait faire des choix entre toutes mes activités, la voile et l’escalade restant mes sports de prédilection.
Je pratiquais la voile depuis mon plus jeune âge, multipliant les expériences et les stages, me confrontant à la rudesse du milieu marin. Comme en cet été 1997, sur l’archipel des Glénans, où j’étais devenu moniteur, découvrant au passage l’aspect pédagogique de ce sport. L’année suivante, j’obtins le niveau A2C à Marseillan, sur l’étang de Thau, une autre base des Glénans en Méditerranée. En parallèle, je partis en croisière pendant l’été, sur un voilier appartenant aux parents de François, un ami de collège. Le premier été, nous avions navigué avec des amis, dont Étienne – ami d’enfance et compagnon d’escalade – sur la Méditerranée, avant d’entreprendre, l’été suivant, une traversée jusqu’en Corse. Cette première expérience du grand large m’avait initié à la notion d’immensité et la plénitude des nuits, quand je me retrouvais seul à la barre. Sur la route du retour, nous avions essuyé une tempête avec un fort vent de face nous donnant l’impression de faire du surplace, voire de reculer. La taille des vagues, la mer blanche d’écumes… La nature nous donna ce jour-là une leçon d’humilité. J’aimais ce rapport à l’élément, poursuivant les stages jusqu’à obtenir le diplôme fédéral de monitorat me permettant désormais d’encadrer les jeunes moussaillons. L’aspect technique et scientifique du monde de la mer me plaisait également, école d’ingénieur oblige !
Au cours de la deuxième année d’école, je mettais à profit mon expérience en montant un équipage avec des élèves ingénieurs pour participer aux régates de la rade de Brest. En parallèle, je participais au SPI Ouest-France ou encore à la coupe de l’Armorica, où je représentais l’ENSTA.
À cette époque, je pratiquais la voile sous deux aspects : les régates pour la compétition et les traversées hivernales sur la Manche, pour l’endurance et le frisson du large. C’est vraiment loin des côtes que je ressentais les sensations les plus intenses.
Au niveau des compétitions, la coupe de l’Armorica était vraiment un temps fort de ces années-là. Ce championnat universitaire se déroule sous forme de duel entre deux bateaux de même catégorie. J’ai eu la chance d’être sélectionné dès ma première année avant d’être désigné skipper l’année suivante. Fort de toutes ces belles expériences, je profitais également de la période estivale pour faire le tour de France à la voile. Le sport faisait partie intégrante de mon existence. Quand je n’étais pas sur l’eau, je partais grimper les parois rocheuses de la région ou les murs d’escalade de Brest. J’avais pour compagnon de cordée Julien, un ami brestois – qui me donna l’intuition d’aller en Inde – avec qui nous aimions nous confronter aux falaises sauvages de Pen Hir, haut lieu de l’escalade en Bretagne. Je profitais des vacances familiales à Mâcon pour me rapprocher des Alpes et poursuivre mes envies d’altitude en milieu montagnard.
Fusion de la voile et de la montagne
J’ai commencé l’escalade grâce à Étienne et son père Philippe, passionnés d’alpinisme. Nous nous exercions d’abord sur la Roche de Solutré – escarpement calcaire situé à 8 km de Mâcon – et à Vergisson – une autre falaise de calcaire qui regarde Solutré, sa jumelle. J’ai rapidement investi dans mon propre matériel pour escalader plus régulièrement, avec quelques amis.
Puis Philippe nous emmena faire une grande voie qui révéla mon goût grandissant pour la haute montagne. En constatant cette passion, mes parents m’encouragèrent vivement à faire un stage pour que j’acquière des bases solides, comme je l’avais fait pour la voile. C’est ainsi qu’en me rendant dans le Massif des Écrins, je fis la connaissance d’un guide dont la vie consistait à parcourir les montagnes en exerçant professionnellement sa passion. Le rêve ! Dès que j’avais un moment libre, je me plongeais avec délice dans la lecture des Frison-Roche et dévorais Premier de cordée, Retour à la montagne et tous les ouvrages de montagne qui me tombaient sous la main. L’appel des cimes commençait à prendre une place prépondérante dans mon existence.
À la fin du lycée, Étienne décida de partir en formation pour devenir moniteur de ski au domaine des Deux Alpes. J’étais aussi heureux pour lui que pour moi ! Cette nouvelle devenait synonyme de pied à terre au bord des Écrins, tout près de hauts lieux d’escalade comme La Bérade où j’allais passer beaucoup de temps.
L’amour
Juste après m’être remis de mon traitement contre le cancer, j’avais rencontré Clarence, monitrice au centre de formation de voile. Évidemment notre passion commune pour la navigation nous avait beaucoup rapprochés. Pendant nos deux ans de relation amoureuse, nous avions réalisé plusieurs croisières hivernales. De plus, sa famille habitant Grenoble, nous profitions de la montagne durant les week-ends ; un bienfait inouï qui me permettait de souffler après les semaines intenses de classes préparatoires. Notre rupture fut un moment difficile à passer. Je comblais le vide par une pratique sportive intense, notamment l’escalade. Je décidais de mettre en second plan ma vie sentimentale. En deuxième année d’école d’ingénieurs, j’ai bien rencontré Ingrid, passionnée comme moi de voile et heureuse de m’accompagner en montagne mais notre relation n’a pas résisté à mon acharnement sportif. Étais-je vraiment apte à aimer une fille ? Étais-je vraiment disponible pour une relation amoureuse ? Cela me rendait-il heureux ? Je n’en étais plus vraiment sûr. La montagne me laissait penser qu’elle me donnerait moins de déconvenues et que je pourrais l’aimer plus librement.
Devenir guide de haute montagne
Cette idée a germé dans mon esprit dès le début des classes préparatoires. J’ai alors beaucoup travaillé pour adapter mon ancien physique de rugbyman à celui de grimpeur.
J’ai eu la chance de rencontrer Nicolas, avec qui je suis parti régulièrement escalader dès la fin de deuxième année. Une fois nos concours passés, nous avons rejoint Étienne en Haute Montagne. Ce fut notre premier 3 000 !
La suite logique était de commencer à réaliser la liste des courses du probatoire pour devenir guide. À la fin des classes préparatoires, tandis que j’avais choisi Brest, Nicolas avait intégré une école à Grenoble. Je profitais donc de toutes les vacances pour le rejoindre et faire ces parcours obligatoires. Lorsqu’il n’était pas disponible, je trouvais des partenaires par internet, même si cela me plaisait beaucoup moins : l’escalade est un sport qui exige une totale confiance dans son partenaire.
Brest n’étant évidemment pas la ville idéale pour l’alpinisme, je travaillais exclusivement mon physique grâce à la course à pied et plus précisément la course d’orientation, une discipline passionnante qui nécessite plusieurs compétences dont la navigation. Je me suis ainsi licencié au club de course d’orientation de Brest et après un an d’entraînement, j’ai pu participer au championnat de France de raid d’orientation : le raid ATO. Parallèlement, je me suis qualifié pour le championnat de cross national à Bordeaux. J’y ai obtenu des places honorables. Ma meilleure réussite reste cependant le championnat de France universitaire de raid orientation où je suis monté sur la deuxième marche du podium après un raid de deux jours dans la forêt de Fontainebleau. À l’ENSTA, Damien, le professeur de sport, m’aidait à programmer tous mes entraînements. Quant à la direction de l’école, en dépit de mes absences, elle suivait mes exploits, fière de me voir porter haut les couleurs de l’école.
Un nouveau compagnon de cordée
Tout en étudiant à Brest, j’enchaînais depuis deux ans toutes les courses sur un rythme effréné. Chacune avait des critères de dénivelé et un niveau minimum à respecter. Je les faisais toutes ! Du fait de l’éloignement, il m’était plus difficile d’accomplir celles en ski de rando, pourtant les plus faciles à réaliser. Pour déjouer ce problème, j’avais trouvé un PFE (Projet de Fin d’Études) à Grenoble pour avoir des chances, après l’été, de trouver un premier emploi d’ingénieur là-bas et réaliser, l’hiver venu, les sorties de ski de randonnée qu’il me manquait.
Nicolas commençait à décrocher et abandonnait peu à peu l’idée de réaliser les 55 courses nécessaires au probatoire de guide. Il me fallait trouver un nouveau compagnon. Mes premiers partenaires m’aidèrent en ce sens et me permirent de rencontrer François, un moniteur d’escalade dont le profil était idéal. Nous avons profité de l’hiver pour nous rendre une semaine à Chamonix. On ne pouvait rêver meilleures conditions : une neige superbe et un temps sec et ensoleillé. Nous nous sommes lancés dans des randonnées à ski de plus de 1 500 mètres de dénivelé et avons grimpé de fabuleuses cascades de glace – une de mes disciplines favorites. Nous avons également réalisé l’une des courses les plus dures de la liste, le Rognon du Plan, (TDinf mixte 4 + glace, sur 700 m de dénivelé) près de l’Aiguille du Midi. Et en guise de dessert, François m’a proposé de faire une voie de falaise, sa spécialité. Face sud, la paroi était sèche. C’était pour moi une excellente opportunité car François avait un niveau très supérieur au mien. Je n’avais qu’à me laisser guider en le laissant ouvrir la voie si je ne m’en sentais pas capable. L’un comme l’autre nous nous sentions forts et nous venions de vivre l’une des semaines les plus fabuleuses qui soit. Toutes les courses de la liste étant belles et s’étant bien passées, la tension était redescendue, nous pouvions profiter avec décontraction du moment présent.
Dernier jour, dernière heure, dernière minute, dernier rappel, ni mes mains ni mes pieds n’ont plus touché la paroi, Octopussy m’a lâché !
* École Nationale Supérieure de Techniques Avancées de Bretagne
Chapitre III
Coma & rééducation
Je ne vis pas la surprise que me réservaient mes parents, un camion type Volkswagen que je convoitais tant et que je pensais m’offrir dès la fin de cette semaine d’escalade. J’avais considéré ce séjour comme un test pour affronter les prochaines périodes dans le froid extrême de ma future formation. À la place de cette surprise, c’est un bus que je vis arriver dans une sorte de semi-réalité nébuleuse. Certains parlent d’un tunnel lorsqu’ils témoignent de leur coma, pour moi il s’agit d’un bus immense dans lequel je monte et au sein duquel je retrouve d’autres personnes qui sont comme moi, coincées entre la vie et l’au-delà. C’est drôle, je reconnais les paysages : nous partons du village de mes grands-parents, dans les plaines de Beauce, pour rendre visite à l’une de mes cousines qui vit en Suisse, pour enfin revenir en France, aux Correaux dans le domaine de mes parents, parmi les vignes et plus précisément au pied du massif de roses, celui qui m’inspirait tant lorsque je peignais pendant ma convalescence.
Heureusement, je ne suis conscient de rien, ni de ma fracture ouverte du coude gauche, ni de mon traumatisme crânien, ni des douleurs qui m’assaillent ; je ne vois pas non plus la tristesse de mes parents, les premiers présents à mon chevet à Genève ; je les entends seulement d’une façon lointaine. Je ne vois pas non plus ma tête tuméfiée, ni mon corps recouvert d’hématomes, ni ma trachéotomie. Habité de souffrances insoutenables, mon être tout entier s’est mis en veille. Seule ma famille voit ce spectacle navrant et entend les discours pessimistes des médecins. Ils insistent sur la gravité de mon cas, sur l’importante hauteur de ma chute, les multiples lésions visibles au scanner. Mes parents vivent un enfer ! Les jours s’enchaînent et chacun me rend visite malgré la distance : mes deux frères, Germain et Philippe, mon ami Étienne, des cousins, des oncles et tantes. Tous me parlent, me demandent de revenir, de m’accrocher, tandis que je reste les yeux clos, secoué de temps à autre par des toux violentes. Quinze jours plus tard, mes proches vivent des moments heureux lorsqu’ils me voient bouger un orteil, ou entrouvrir les yeux, tous croient alors à mon retour à la vie, mais il n’en est rien, en tous les cas pas pour le moment.
Après trois semaines de profond coma, je suis transféré en France, à l’hôpital de Villefranche-sur-Saône…
Oui j’ai encore envie de vivre, oui je reconnais ma terre, celle qu’ont cultivée mes aïeux depuis plus d’un siècle ; je suis la huitième génération des viticulteurs de la famille Bernard.
Il est temps de sortir du bus à présent, de quitter tous ces gens en transit entre la vie et la mort. Moi, je choisis cette vie, parce que je l’aime, parce que j’y ai mille projets à réaliser ! Mon retour est lent, on ne sort pas aussi facilement des ténèbres du coma.
Soyez patients, je reviens.
Mes nuits sont encore très agitées, on m’attache pour éviter que je tombe, ou pour empêcher que j’arrache tous ces tubes qui me perforent le corps pour le garder en vie : trachéotomie, gastrique, perfusions…
Puis, j’arrive enfin à répondre aux sollicitations désespérées de mon entourage et lorsque je cligne trois fois de suite de l’œil, le 16 mars, je provoque un feu d’artifice ! Mes grands-parents et ma mère sont aux anges ! Une messe est dite à Lourdes pour moi.
Je n’ai aucun souvenir de l’hôpital de Villefranche, cependant je sais que c’est ici que je suis lentement sorti du coma.
Hauteville
Le 24 mars 2004 je suis transféré à 100 km de chez moi, à Hauteville (01), dans un centre de rééducation. Ici reprend le cours de mes souvenirs et surtout, plus tard, mes premiers kilomètres additionnés sur le compteur du vélo de salle !
Si physiquement, je peux retrouver un peu de mouvement, je me sens intellectuellement déboussolé. Mon traumatisme crânien et ma longue période de coma profond ont laissé des traces ! Tel un nouveau-né, je dois réapprendre certains fondamentaux comme par exemple cesser de faire pipi au lit, ce qui me demande un effort terrible. Je m’applique à ne me lever qu’une seule fois dans la nuit pour aller aux toilettes.
Pendant les six ou sept mois de rééducation physique, j’ai la sensation de suivre machinalement l’un des programmes d’entraînement que je suivais avant mon accident. Je dois pousser mon corps vers la performance… Même si dans ces circonstances les repères sont totalement bouleversés. Tout est plus long : mon élocution terriblement lente et hachurée, mon coude gauche bloqué, mon équilibre perturbé. Mais heureusement, je n’en ai pas vraiment conscience, ce qui me permet d’estimer ce combat surmontable. Il est clair que j’ai perdu toute souplesse mais une chose est certaine je suis vivant et je vais pouvoir remarcher !
Des amis de l’ENSTA, dont Romain Charaudeau, ont pris la responsabilité de m’emmener avec eux quelques jours à Samoens, dans les Alpes du Nord, le premier été après mon accident. J’ai vécu cette première sortie comme un jour béni, un cadeau inoubliable orchestré par mes amis. Ils savaient l’intense bonheur d’être là avec eux, au cœur des montagnes, même si nos promenades n’avaient rien de comparable avec nos courses d’antan. À l’issue de ces quelques jours, j’ai commencé à faire quelques pas, seul. Le long processus de rééducation s’est déroulé en plusieurs étapes. Au début, la douleur m’empêchait de coopérer, mais j’ai rapidement positivé et mobilisé mon mental de sportif pour faire au mieux les exercices imposés, voulant bêtement, parfois, aller trop vite au risque de réactiver la douleur et de ralentir la guérison. Il me fallut huit mois d’efforts intenses pour marcher sans canne. La nuit, je portais encore une attelle pour étendre ma jambe gauche. Malgré la douleur et les nuits blanches qu’elle me provoquait, je prenais mon mal en patience, voulant guérir au plus vite et repartir…
Saint-Hilaire
Ma passion pour la montagne ne faiblissait pas, au contraire… Ayant entendu parler d’un centre de rééducation près de Grenoble, je fis mon possible pour y être transféré. Toujours l’appel des cimes !
Ainsi, en novembre 2004, j’intégrai Saint-Hilaire, un centre de rééducation universitaire, situé en pleine montagne ! Le rêve ! Il me fallait tout réapprendre, à commencer par le français, les maths et la culture générale. À la vie scolaire, s’ajoutaient bien sûr les activités sportives : ski et randonnée. Je partais trois ou quatre fois par semaine. Les problèmes d’équilibre persistaient, mais je pensais qu’ils disparaîtraient avec le temps et qu’un jour je pourrais reprendre les courses du probatoire… Je recontactais un ancien partenaire pour qu’il m’accompagne escalader en salle. Mes performances n’étaient pas brillantes, mais j’avais de bons restes, et surtout l’envie d’y croire.
Autour du centre de rééducation, je réalisais même des sorties pour la liste du probatoire d’accompagnateur en moyenne montagne. Je ne m’avouais pas forcément, à cette époque, que si les résultats étaient encourageants, le style, lui, laissait à désirer et les clients potentiels seraient certainement effrayés par mon équilibre précaire. Mais je m’accrochais et poursuivais avec opiniâtreté mon objectif. Je revoyais également Étienne, devenu moniteur de ski, qui tenait un discours positif sur mon état. Je profitais de mon séjour à Saint-Hilaire, pour rendre visite, avec mes parents, à Jean-Philippe, un guide que j’avais eu en stage d’alpinisme à La Bérarde. Sachant bien qu’il ne pourrait tempérer mon optimisme, il m’expliqua simplement :
— La vie te montrera le chemin. Tu le vérifieras par toi-même… Il avait raison.
À la fin de la période de rééducation, j’étais convaincu que je pourrais être accompagnateur de moyenne montagne. Mes parents avaient accepté cette idée et, à leur habitude, m’encourageaient en m’orientant vers la découverte de l’habitat montagnard, sa faune et sa flore ! Durant chaque sortie à Saint-Hilaire, je me donnais comme objectif de reconnaître les fleurs de montagne. J’apprenais à les différencier pendant ce second printemps de ma troisième vie déjà !
Les épreuves techniques au probatoire pour la moyenne montagne sont dans cet ordre : une randonnée à la journée à effectuer dans un temps imparti, un parcours en terrain varié, une épreuve d’orientation, une interrogation orale sur sa liste de randonnées et ses motivations pour devenir accompagnateur. Si la première et la troisième épreuve ne me faisaient pas peur, la seconde, en revanche, constituait une grosse difficulté et je m’étais bien préparé pour la quatrième. Mais peu importait que cela me paraisse facile ou non, une vilaine entorse contractée sur un mur d’escalade me fit rater l’épreuve et repoussa fatalement mon complet rétablissement…
Psychologiquement je vécus difficilement de ne pouvoir passer ce fichu examen, de ne pas être évalué sur mes compétences réelles. Pour la première fois, je me fis la réflexion qu’il fallait peut-être que j’abandonne l’idée de devenir un jour accompagnateur de moyenne montagne et que je reconsidère mon avenir professionnel. Cet incident ne fit que retarder l’échéance. Bien que de nature optimiste, je me mis à broyer du noir en m’imaginant condamné à retourner chez mes parents pendant l’été. J’adore mes parents, mes frères et ma terre, mais je n’avais pas imaginé cette issue après un an et demi de rééducation et d’efforts intenses.
Peu à peu, mes idées devenaient plus claires ; je retrouvais mes esprits au point de penser à l’amour… Comment aurait été mon combat si Ingrid était toujours dans ma vie, si je ne l’avais pas quittée ? Je regrettais d’avoir agi comme je l’avais fait. Prenant conscience de ma situation, je me trouvais idiot de lui avoir préféré le sport ! J’eus la tentation de la recontacter mais j’abandonnai vite l’idée ; compte tenu de mon état, je ne voulus pas lui infliger une peine de plus…
L’hiver venu, il avait été convenu, avec mon éducateur, de reprendre le ski de randonnée. Ce fut une terrible désillusion ! Mes problèmes d’équilibre eurent raison de mon obstination et me rappelèrent à la réalité. De rage, je décidai de vendre mes skis dès mon retour !
Plus le temps passait, plus je comprenais que mes chances de devenir guide s’amoindrissaient. Je devais penser différemment, transposer ma fougue et mes passions dans d’autres secteurs, pour ne pas devenir aigri. La peinture aurait pu devenir un parfait exutoire. Je tentai de peindre des formes, mais mon syndrome cérébelleux m’avait enlevé toute la fluidité de mon geste.
Heureusement, pour mon grand bonheur, celui que je surnommais « Mon Romain » venait me rendre visite dans le domaine familial, comme il l’avait fait lors de ma chimiothérapie sept ans plus tôt, quand nous pêchions dans la mare de Leynes avec le même plaisir et les mêmes scènes de rire. Nous repensions à ce poisson rouge qu’il m’avait offert pour mon anniversaire, deux mois avant ma chute et qu’il m’avait livré dans un sac en plastique de la marque Douglas ! Le poisson fut ainsi baptisé et lâché dans la mare. Notre grand jeu, pendant toute ma convalescence, était de repêcher Douglas et de se dire, en fonction de la taille du poisson pêché : « Tiens on a pris Douglas ! Tu as vu comme il est devenu grand ! » Ou encore : « Voilà un bébé de Douglas ! » Et en le relâchant, nous riions tant, que rien ne pouvait altérer notre légèreté.
Retour à l’ENSTA
En théorie, au moment de mon accident, j’avais fini les cours, il ne me manquait qu’un stage à accomplir. L’école, sensibilisée par mon histoire, me proposa de différer le stage et de reprendre une année complète de cours afin de me remettre à niveau. J’acceptai bien volontiers cette proposition. Il me fallut travailler avec acharnement pour valider le semestre mais j’y parvins, avec les félicitations de l’école pour ma persévérance, et un stage au Brésil en perspective. Un ami m’avait en effet recommandé à un institut, où il avait lui-même travaillé. Je ne connaissais pas le Brésil et ce stage fut pour moi une révélation. D’abord, je travaillais dans un domaine qui me plaisait – la météo – et je découvrais, avec un vif intérêt, le portugais que j’appris vite à maîtriser. Moi qui me croyais nul en langues, je me découvris d’un seul coup une véritable aptitude. L’immersion me convenait mieux que les cours théoriques des bancs d’école et mes rapides progrès me redonnèrent cette confiance dont j’avais besoin. Je découvris également la vie communautaire, la diversité culturelle et la vie étudiante avec les Brésiliens et je m’y sentis bien.
À la fin du stage, mon frère Philippe me rejoignit et nous partîmes trois semaines en Bolivie. Cela rassurait ma famille de me savoir « accompagné ». Connaissant mon esprit d’aventure, mes proches craignaient que je ne me lance dans des projets insensés. Le voyage fut merveilleux. Philippe s’en retourna en France ; il me restait dix jours, seul dans les Andes. Sans rien dire à personne, je décidai de partir sept jours en trekking sur les chemins Incas. Les choses sérieuses commencèrent le troisième jour avec le passage d’un col assez impressionnant et un dénivelé de 700 mètres. En montée, mes problèmes d’équilibre ne se firent pas trop sentir, ou plutôt, étant seul, je les ignorai. La visibilité étant très mauvaise, je n’avais que la boussole pour m’orienter. La météo continuait de se dégrader. Après une heure de marche, je pris la décision de revenir sur mes pas. La neige, qui s’était mise à tomber de plus en plus fort, recouvra rapidement mes traces et je dus me résoudre à planter la tente et attendre dans la tourmente, sans savoir où j’étais. Le seul autochtone que je croisai s’exprima en aymara et je ne pus comprendre un seul mot. Rien d’autre à faire que garder son calme et se protéger au mieux sur ce pan de montagne très incliné ! Je relativisais ; j’étais vivant et tant pis pour la nuit bruyante sous la tempête, c’était habituel dans ces régions.
Le lendemain, une plaque de glace s’était formée tout autour de ma tente. Je me dégageai comme je pouvais et repris le chemin du col, que j’atteignis sans trop de difficultés. Il me fallut deux jours pour retrouver La Paz. La dernière nuit, en plantant ma tente sur l’herbe inca, un jeune garçon vint me demander asile dans ma tente. À cette époque j’avais encore l’odorat pour sentir que le gamin n’avait pas dû se doucher depuis plusieurs jours. Nous avions bien ri ! Ces deux jours d’aventure furent pour moi un grand moment de bonheur.
C’était plus fort que moi, mes rêves de haute montagne étaient toujours présents. En pleine confiance et ne voulant pas sacrifier un seul instant qu’il me restait à passer en Bolivie, je décidai de grimper le Huyana Potosi (6 088 m) avec un guide. Je pus atteindre le sommet car ma détermination et ma force physique étaient toujours là. Mais les problèmes d’équilibre étaient évidents, surtout dans la descente, où la présence du guide fut malheureusement indispensable.
Je devais l’admettre.
J’avais la confirmation que je devais faire mes adieux à la haute montagne. C’était un constat douloureux, mais il fallait être raisonnable, je ne pouvais plus réaliser le destin que je m’étais tracé. Mes rêves d’altitude s’évaporaient même si dans un coin de ma tête je conservais une minuscule fenêtre d’espoir… Mon équilibre reviendrait peut-être…
Chapitre IV
Naissance d’un projet
À mon retour du Brésil, diplôme en poche, je retrouvai le domaine familial de Bourgogne pour les vendanges. Assigné au travail de la cave, je réalisai que je préférais nettement œuvrer à l’extérieur, dans les vignes, au contact de la nature ! Depuis tout gosse j’ai aimé ce métier. Je me souviens d’ailleurs combien j’appréciais, lorsque j’étais lycéen, diriger l’équipe de vendangeurs pour que mes parents puissent se reposer. Côtoyant depuis toujours différents milieux sociaux et participant aux différentes tâches du domaine viticole, j’aimais également être parmi les ouvriers et participer avec eux aux petits défis physiques du rendement. Cette polyvalence aux travaux de la vigne me plaisait bien.
J’avais toujours en tête de devenir guide de moyenne montagne. Cette stupide histoire d’entorse m’en avait empêché mais je sentais l’objectif à ma portée. J’avais bien assimilé la partie théorique concernant la faune et la flore ; restait la partie physique. Il me fallait savoir où j’en étais réellement et pour cela placer la barre très haut. Mon choix d’entraînement se porta sur le Népal, avec comme environnement rien de moins que les plus hautes montagnes du monde ! Un rêve de jeunesse…
L’expérience brésilienne avait éveillé ma curiosité pour les cultures différentes, et cette nouvelle perspective de découverte m’excitait follement. Je me donnai six mois.
Mon programme de trekking débuta par deux circuits importants avec des passages de cols à 5 600 mètres d’altitude, le tour des Annapurnas en trois semaines et le Langtang Helambu en douze jours…
N’ayant rien perdu de mon endurance, je pus mener les marches à un rythme soutenu. Aux plaisirs permanents d’évoluer dans des paysages dépassant l’entendement se mêlait l’enfer des descentes en raison de mon équilibre toujours aussi défaillant. À la désillusion s’ajoutaient les moqueries des Népalais qui devaient penser que j’étais drogué ou saoul, ce qui avait don de m’énerver et de me blesser profondément.
Déçu et humilié, agacé par la fréquentation massive des trekkeurs étrangers, je décidai de fuir la zone et mettre le cap sur Chitwan, dans la jungle népalaise. Là encore, je trouvai l’endroit trop fréquenté. Ayant besoin de m’isoler, je m’installai dans un lodge tenu par la famille Srestha, l’Eden Jungle Resort, dont la simplicité me valut d’être le seul touriste, ce qui me convenait parfaitement. J’avais besoin de recul, d’analyse et de trouver un sens à mon avenir. Il m’apparaissait que c’était le lieu idéal pour mener mes réflexions. Rapidement je sympathisai avec Rajendro, le fils aîné de la famille Srestha qui faisait ses débuts au lodge. Maîtrisant l’anglais l’un et l’autre, nous avons passé de longues soirées à discuter ; il me racontait la vie dans son village et cela me passionnait. J’aimais cette simplicité caractéristique des zones rurales éloignées. Nous sommes devenus satis, « amis ». Il m’expliqua que Bir, son père, était en train de construire une nouvelle maison et que je pourrais peut-être les aider… Il me restait quelques jours avant l’expiration de mon visa. Sans perdre de temps, j’anticipai et lui demandai de passer une nuit dans sa famille. Je voulais connaître la vie népalaise de l’intérieur et partager le quotidien de ces gens. Rajendro sourit et accepta – ce n’était pas tous les jours qu’un touriste lui faisait ce genre de proposition. Pour me rendre chez lui, à Jhuwani, il me fit réaliser un troc astucieux en me faisant louer deux vélos, un pour chacun. Nous étions joyeux et je commençais à comprendre ce dont je n’avais pas conscience avant mon accident : un plaisir est bien plus intense lorsqu’il est partagé.
Je fus présenté à son père. Bir parlait un très bon anglais, sans accent népalais, car il avait été guide dans la jungle. Le courant passa tout de suite avec Bir. Il me montra le chantier de la maison en construction et m’expliqua les différences au sein de sa fratrie. En sa qualité d’aîné, son grand frère avait hérité de l’Eden jungle Resort ainsi que du logement attenant. Quant à Bir, n’étant ni le plus jeune, ni le plus âgé des frères, il devait se construire son propre logement. Le chantier semblait en suspend. À mon interrogation, il répondit que l’argent leur manquait pour poursuivre les travaux.