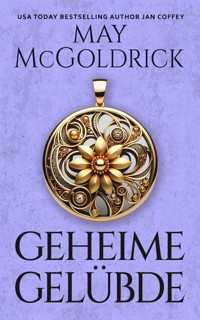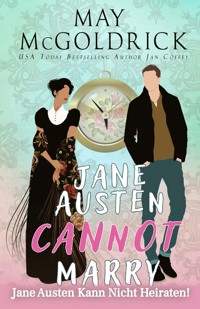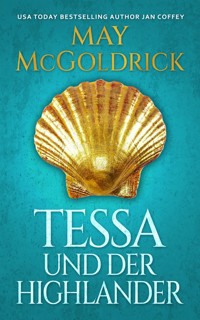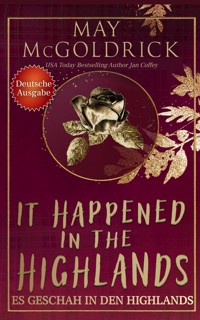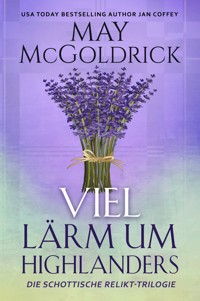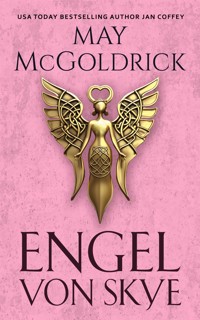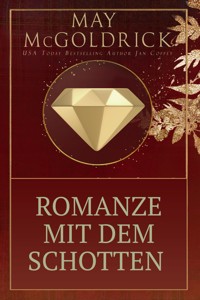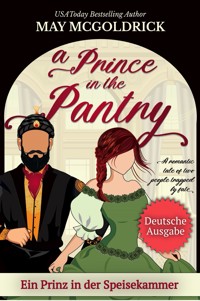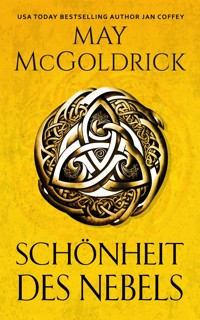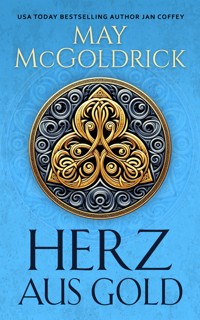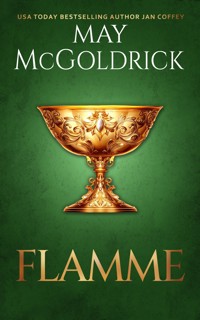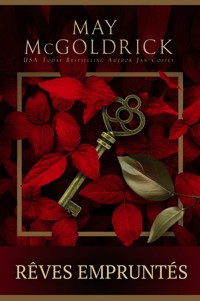
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: LA TRILOGIE DES RÊVES ÉCOSSAIS
- Sprache: Französisch
LA TRILOGIE DES RÊVES ÉCOSSAIS Série Famille Pennington Gagnant du Holt Medallion pour la meilleure romance historique Lauréat du Romantic Times Award pour la meilleure romance historique britannique LA PROPOSITION Poussée à réparer le mal causé par son défunt mari, Millicent Wentworth doit trouver un moyen de sauver son domaine et de libérer les innocents qu'il réduit en esclavage. Son seul espoir est un mariage - de nom seulement - avec le célèbre veuf, le comte d'Aytoun. LE MARIAGE Dévasté par le tragique accident qui a tué sa femme et l'a laissé gravement blessé, Lyon Pennington, quatrième comte d'Aytoun, est tourmenté par les accusations qui le rendent responsable de la catastrophe. Désespéré, il laisse sa mère l'entraîner dans un mariage de convenance - pour le bien d'une femme de cœur au bord de la ruine. LE DÉSIR Sous le regard bienveillant de Millicent, Lyon commence à reprendre des forces et son cœur blessé commence à guérir. Et Millicent découvre bientôt que, sous sa barbe indisciplinée et son air sinistre, Lyon est peut-être l'homme le plus beau et le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Pour la première fois de sa vie, elle se rend compte qu'elle est vivante - vivante avec un désir brûlant pour le seul homme qu'elle aimera pour toujours...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rêves Empruntés
Borrowed Dreams
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Droits d'auteur
Merci d'avoir lu. Dans le cas où tu apprécierais ce livre, pense à partager le(s) bon(s) mot(s) en laissant une critique, ou à entrer en contact avec les auteurs.
Rêves empruntés (Borrowed Dreams) Copyright © 2011 par Nikoo K. et James A. McGoldrick
Traduction en Langue Française © 2025 par Nikoo et James McGoldrick
Tous droits réservés. À l'exception de l'utilisation dans toute revue, la reproduction ou l'utilisation de cet ouvrage, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, par tout moyen électronique, mécanique ou autre, connu actuellement ou inventé ultérieurement, y compris la xérographie, la photocopie et l'enregistrement, ou dans tout système de stockage ou de récupération de l'information, est interdite sans l'autorisation écrite de l'éditeur : Book Duo Creative.
AUCUNE FORMATION EN IA : Sans limiter en aucune façon les droits exclusifs de l'auteur [et de l'éditeur] en vertu du droit d'auteur, toute utilisation de cette publication pour « former » des technologies d'intelligence artificielle (IA) générative à la génération de texte est expressément interdite. L'auteur se réserve tous les droits d'autoriser l'utilisation de cet ouvrage pour la formation en IA générative et le développement de modèles linguistiques d'apprentissage automatique.
Publié pour la première fois par NAL, une marque de Dutton Signet, une division de Penguin Books, USA, Inc.
Couverture par Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Table des matières
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Chapitre 33
Épilogue
Note d'édition
Note de l'auteur
A propos de l'auteur
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
À Judy Spagnola Merci pour tout
ChapitreUn
Londres, janvier 1772
— Ce n’est pas la bonne direction !
Au lieu de tourner vers l’ancien temple, l'attelage avait pris vers l’ouest, sur Fleet Street, et le cocher se frayait avec peine un chemin pour ses chevaux dans l’intense circulation de la City. L'avoué leva sa canne afin d'en frapper le plafond, mais la main gantée de Millicent sur la sienne l'en empêcha.
— Il va où je le lui ai indiqué, sir Oliver. J'ai un problème urgent à régler au débarcadère.
— Au débarcadère? Mais... n'oubliez pas votre rendez-vous, madame.
— Il n’y en aura pas pour longtemps.
Il s’appuya à la banquette, soulagé.
— Alors, j’aimerais en profiter pour vous poser quelques questions sur l’entretien auquel nous avons été convoqués ce matin.
— Je vous en prie, sir Oliver, dit calmement Millicent, pourriez-vous attendre un peu ? Je crains d’avoir l’esprit ailleurs, pour l'instant.
L’avoué ravala ses questions, tandis que lady Wentworth se tournait vers la vitre. Ils ne tardèrent pas à passer devant la cathédrale Saint-Paul avant de descendre par les rues malodorantes jusqu’à la Tamise. Lorsqu'ils croisèrent Fish Street et ses entre- pots, Oliver Birch ne put tenir sa langue davantage.
— Pourriez-vous au moins me dire de quoi il s’agit, lady Wentworth ?
— Nous nous rendons à une vente aux enchères.
L’homme regarda la foule d'ouvriers, de pickpockets et de prostituées.
— J’espère, madame, que vous resterez à l’abri dans la voiture, et que vous me permettrez de charger un employé d’aller chercher ce que vous voulez acquérir.
— Je suis désolée, monsieur, mais je dois voir par moi-même.
L’avoué s’accrocha à la poignée de la portière comme la voiture pénétrait en cahotant dans la cour d’un bâtiment en ruine de Brook’s Wharf. Élégants gentilshommes et marchands en tenue négligée se mêlaient curieusement pour assister à cette vente, qui semblait déjà bien avancée.
— Expliquez-moi au moins ce que vous venez faire ici, lady Wentworth.
Birch sauta à terre le premier. Malgré l’air vif, l’odeur était pestilentielle.
— J’ai eu connaissance de cette vente ce matin dans La Gazette, répliqua Millicent en rabattant sa capuche avant d’accepter la main que lui tendait l’avoué. On liquide les biens d’un défunt médecin nommé Dombey. Ruiné, il est rentré de Jamaïque le mois dernier, et il a succombé à une maladie il y a une dizaine de jours, au moment où il allait être jeté en prison pour dettes. r
Birch avait du mal à suivre la jeune femme qui se frayait un chemin jusqu’au premier rang.
— Et puis-je vous demander ce qui vous intéresse dans la succession du Dr Dombey ?
Elle ne répondit pas, et il vit le regard gris de sa cliente survoler les objets exposés sur une estrade de fortune.
Millicent se tourna, anxieuse, vers les vastes portes qui menaient à l'intérieur du bâtiment. L'huissier traînait au-dehors une Africaine décharnée, enroulée dans une vieille couverture, sous laquelle elle ne portait qu’une chemise maculée. On posa une caisse sur l’estrade, et la vieille femme aux chevilles et aux poignets entravés y fut rudement poussée. Birch ferma un instant les yeux afin de contrôler le dégoût que lui inspirait ce honteux et barbare commerce, encore en usage dans leur pays.
— Voyez, m’sieurs-dames, cette esclave était la femme de chambre personnelle du Dr Dombey! annonça le directeur de la vente. C’est la seule négresse que le toubib ait ramenée avec lui de la Jamaïque. Pour sûr, elle est pas belle avec toutes ses rides, et elle est plus vieille que Mathusalem ! Mais, mes amis, c’est une véritable reine africaine. Alors, même si elle vaut bien une trentaine de livres, on va commencer les enchères à... une livre !
Des rires gras s’élevèrent parmi la foule.
— Allons, allons, que diriez-vous de dix shillings ? reprit le crieur par-dessus les quolibets. Elle a de bonnes dents, je vous assure !
Il ouvrit brutalement les lèvres gercées de la malheureuse.
— Dix shillings ? Qui en veut pour dix shillings ?
— À quoi elle peut servir? cria un homme.
— Cinq, messieurs. Qui ouvre à cinq?
— Cette femme n’est rien qu’une vieille esclave inutile, rétorqua un autre.
Inquiet, Birch se tourna vers Millicent : des larmes brillaient dans ses yeux.
— Ce n'est pas un endroit pour vous, madame, dit-il doucement. Il n'est pas bon que vous assistiez à cette scène. Ce pour quoi vous êtes venue est sans doute déjà vendu...
— La réclame disait que c'était une belle fille ! s’écria un homme en lançant un exemplaire de La Gazette sur la vieille Africaine.
— Cinq livres ! déclara Millicent d'une voix haute et claire.
Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le crieur lui-même fut un instant déconcerté. Birch vit les paupières fanées de la femme s'ouvrir une fraction de seconde et son regard se poser sur Millicent.
— Bien, m’dame. Les enchères commencent à...
— Six livres !
Cette seconde enchère laissa encore une fois le crieur sans voix. Les assistants se tournèrent vers l’homme, au fond, qui avait parlé.
— Sept ! insista Millicent.
— Huit!
L’homme sur l’estrade eut un large sourire, tandis que la foule s'ouvrait devant un individu bien vêtu qui tenait un journal roulé à la main.
— Ah, je vois que le secrétaire de M. Hyde est parmi nous. Merci pour votre enchère, Harry.
— Dix livres ! reprit Millicent d'un ton déterminé.
Birch laissa courir son regard sur les voitures garées dans la cour, en se demandant depuis laquelle Jasper Hyde donnait ses ordres. Propriétaire d’une vaste plantation aux Antilles, celui-ci n’avait pas perdu une minute pour faire main basse sur les possessions de son prétendu ami Wentworth aux Caraïbes, après sa mort, en paiement de ce qu’il lui devait. Comme si cela ne suffisait pas, depuis qu’il était rentré en Angleterre, M. Hyde s’était posé en ennemi de lady Wentworth et avait raflé tout ce qui restait de lettres de change et de billets simples que le défunt avait laissés derrière lui.
— Vingt !
Il y eut un murmure général d’incrédulité, et la foule s'agita.
— Trente.
L’avoué se tourna vers Millicent.
— Il se joue de vous, madame. Je ne crois pas qu'il serait sage de...
— Cinquante ! annonçait le secrétaire le plus froidement du monde.
Un groupe de marins fustigea ouvertement l’homme qui faisait ainsi monter les enchères.
— Je ne peux pas le laisser faire. Le Dr Dombey et cette femme ont passé beaucoup de temps dans les plantations de Wentworth à la Jamaïque. D'après Jonah et quelques autres à Melbury Hall, elle est devenue un personnage important pour eux.
Elle adressa un signe de tête au crieur.
— Soixante livres.
L’employé de Jasper Hyde sembla un peu embarrassé. Il regarda du côté des voitures, puis le journal roulé s’éleva avant que le directeur de la vente ait eu le temps de répéter l’enchère.
— Soixante-dix.
La foule s’insurgeait contre l’obstination du secrétaire. Quelques marins s’avançaient vers lui, menaçants, marmonnant des injures.
— Tout ça n’est qu’un jeu pervers pour M. Hyde, murmura Millicent. Bien des histoires couraient sur ses brutalités en Jamaïque. Et c'était encore pire après qu’il a pris possession des terres de mon mari et de ses esclaves. Il ne rend de comptes à personne et se moque des lois. Toutefois, cette femme a assisté à ses atrocités. Il va lui faire du mal - la tuer, peut-être.
Elle serrait les poings.
— Je dois cet acte à mon peuple, après tout le tort qu’a causé Wentworth, sir Oliver. Je ne pourrais pas, en bonne conscience, tourner le dos quand j’ai la possibilité de sauver cette femme. Pas alors que j’ai échoué avec les autres.
— C’est bon, madame ? demanda le crieur. Vous renoncez ?
— Quatre-vingts, lança-t-elle d’une voix un peu tremblante.
— Vous n’avez pas les moyens, madame, dit Birch d’un ton calme mais ferme. Songez aux reconnaissances de dettes de votre époux que Hyde détient encore. Vous avez pu reculer une fois l'échéance, mais vous devrez payer le mois prochain.
— Cent livres !
L’annonce du secrétaire fut noyée sous les protestations de la foule, et il recula de quelques pas en direction des attelages.
— Cent dix, madame? s’enquit le crieur, tout excité.
— Vous ne pouvez pas sauver tout le monde, Millicent, chuchota Birch avec autorité.
Lorsque le comte et la comtesse de Stanmore l’avaient chargé, un an auparavant, de s’occuper des intérêts de lady Wentworth, il avait été informé de sa grande compassion pour les esclaves de son défunt époux. Mais il n’avait pas imaginé à quel point !
— Je le sais, sir Oliver.
— Peut-être possède-t-il déjà cette femme. Il a acquis toutes les reconnaissances de dettes de votre époux, il a pu en faire autant avec Dombey. Ce serait seulement un moyen de vous priver de ce qui vous reste de liquidités.
Millicent, la tête basse, les larmes aux yeux, se dirigea vers la voiture. Cependant, au milieu de la cour, elle fit volte-face et leva la main.
— Cent dix !
Il y eut une exclamation générale, et la foule s'ouvrit devant la jeune femme qui marchait droit sur le secrétaire. Celui-ci, très pâle, avait déjà battu en retraite. Il secoua la tête en direction du directeur de la vente.
— Lady Wentworth peut avoir sa négresse pour cent dix livres.
Devant le ton ironique du secrétaire ainsi que son air méprisant, les marins perdirent leur sang-froid et se précipitèrent sur lui. L'homme sortit de la cour à toute vitesse. En le regardant fuir, Birch eut envie de le poursuivre, lui aussi. Il était certain que tout avait été soigneusement manigancé. Quelques minutes plus tard, les marins revinrent bredouilles.
Millicent posa la main sur le bras de l’avoué.
— En dehors de toutes les vilenies de M. Hyde, il fallait que je sauve cette femme, sir Oliver.
On n’aurait pu dire de Millicent Gregory Wentworth quelle était belle, ni élégante selon les critères de la bonne société londonienne. Mais ce qui lui manquait dans ces domaines, elle le rattrapait en dignité, en humanité, malgré toute une vie d’oppression et de malchance.
Birch inclina la tête avec déférence.
— Pourquoi n’iriez-vous pas attendre dans la voiture, madame, pendant que je m’occupe des formalités ?
On venait de placer un bonheur-du-jour sur l’estrade à la place qu’avait occupée l'Africaine, et plusieurs personnes s'approchèrent, beaucoup plus I intéressées par le petit meuble que par l’être humain qu’on avait vendu quelques minutes auparavant.
Millicent vit un homme entraîner la femme à travers la cour, sir Oliver sur les talons. Elle se fraya un passage jusqu’à la voiture.
— On la conduira à mon bureau cet après-midi, annonça Birch un peu plus tard en la rejoignant. Comme vous ne voulez pas la recevoir dans la maison de votre sœur, je m’arrangerai pour lui trouver un endroit où dormir en attendant que vous soyez prête à partir pour Melbury Hall.
— Je vous remercie. Nous prendrons la route dès demain matin.
— Soyez assurée, madame, que tout se passera dans la plus grande discrétion.
— Je n'en doute pas, dit-elle calmement en regardant la porte du hangar où l’on avait conduit l’Africaine.
Elle se demandait combien d’humiliations la malheureuse allait encore devoir subir avant qu'on l'emmène chez l’avoué.
Tandis qu’ils roulaient à travers la ville, Millicent songeait à l’argent qu’elle venait de dépenser. Cent dix livres représentaient sept mois de salaire pour les vingt domestiques quelle employait à Melbury Hall, sans compter les ouvriers agricoles. L’achat de cette femme creusait un grand trou dans son budget. Encore refusait-elle de penser à ce qu’elle devrait payer à Jasper Hyde le mois suivant. Elle massa ses tempes douloureuses en se consolant grâce à la bonne action quelle venait de faire.
Ils approchaient de leur destination quand sir Oliver brisa le silence.
— Nous ne pouvons plus longtemps éviter de parler du motif de ce rendez-vous avec la comtesse douairière Aytoun. J’avoue que je suis dans le noir le plus complet à ce sujet...
— Nous sommes deux, sir Oliver, répondit Millicent avec lassitude. La lettre qu’elle m’a envoyée pour me convoquer - enfin, m’inviter - est arrivée il y a trois jours à Melbury Hall, et son valet a attendu pour lui apporter ma réponse. J’étais censée venir chez le comte d’Aytoun, à Hanover Square, aujourd’hui à onze heures avec mon avoué. Sans commentaire.
— C’est plutôt sec ! Connaissez-vous la comtesse ? Millicent secoua la tête.
— Non, mais l'année dernière, je ne connaissais pas non plus M. Jasper Hyde. Ni la demi-douzaine de créanciers qui se sont mis à me harceler tous les trois mois depuis la mort de Wentworth. Si j’ai appris une chose en un an et demi, c’est qu’il m'est impossible de me cacher de ceux à qui mon mari devait de l'argent. Il me faut les affronter un par un, et essayer de trouver un arrangement raisonnable pour les rembourser.
— J’admire sincèrement votre courage, vous savez, mais ni vous ni moi n’ignorons que l’état de vos finances est catastrophique.
Il marqua une légère pause.
— Vous avez de très généreux amis, lady Wentworth, reprit-il. Si vous me permettiez de leur faire comprendre la situation dans laquelle...
— Non, monsieur, coupa-t-elle vivement. Je n’ai pas honte de ma pauvreté, mais je trouve indigne de mendier. Je vous en prie, ne parlons plus de ça.
— Comme vous voudrez, madame.
Millicent lui adressa un signe de tête reconnaissant. Sir Oliver avait toujours été honnête envers elle, et elle savait qu’il ne la trahirait pas.
— Pour vous rassurer quelque peu, dit-il, la comtesse douairière jouit d’un statut social bien différent de celui de M. Hyde ou de feu votre époux. Elle dispose d’une vaste fortune, mais on prétend qu’elle est excessivement... «près de ses sous». On raconte même que ses domestiques doivent se battre pour toucher leurs gages. Bref, je ne l’imagine pas prêtant de l'argent à M. Wentworth.
— Cela me soulage, je vous remercie. Connaissant votre souci du détail, j’aurais dû me douter que nous n'arriverions pas à cet entretien sans préparation.
Qu'avez-vous appris d’autre à son sujet, sir Oliver?
— Lady Archibald Pennington, comtesse d’Aytoun, a pour prénom Béatrice. Son mari est mort il y a un peu plus de cinq ans. Écossaise de naissance, elle a du sang de Highlander dans les veines. Elle est issue d’une très ancienne famille et s’est mariée au- dessous de sa condition.
— A-t-elle des enfants ?
— Trois fils. Tous adultes. Lyon Pennington, l’aîné, est le quatrième comte d'Aytoun. Le second, Pierce, semble avoir fait fortune dans les colonies américaines, malgré l'embargo. Quant à David, le cadet, il est officier dans l’armée de Sa Majesté. La comtesse menait une vie paisible jusqu’au scandale qui a déchiré sa famille l’été dernier.
— Un scandale?
— Oui, madame. Plus ou moins causé par une jeune femme du nom d’Emma Douglas. Si j’ai bien compris, les trois frères s'en étaient entichés, mais elle a épousé l’aîné et elle est devenue comtesse d’Aytoun voilà deux ans.
Tout ceci ne sentait guère le scandale. Cependant Millicent n’eut pas le temps de poser davantage de questions, car la voiture s’arrêtait devant un élégant manoir de Hanover Square. Un valet de pied en livrée gansée d'or vint ouvrir la portière, et un autre les escorta sur les marches de marbre du vaste perron.
Un autre serviteur les accueillit dans le hall, et Millicent lui remit sa cape tout en admirant l'alcôve semi-circulaire, au fond de la pièce, ainsi que les rosaces et les volutes dorées qui ornaient le plafond. Par les portes ouvertes des pièces de réception, elle aperçut des meubles Chippendale harmonieusement disposés, ainsi que des tapis de soie sur les planchers lustrés.
Un majordome d'un certain âge vint les informer que la comtesse douairière les attendait.
— De quel genre de scandale s’agissait-il ? parvint à murmurer Millicent tandis qu’ils montaient le grand escalier.
— Des rumeurs laisseraient entendre que le comte a tué sa femme, chuchota Birch.
— Mais...
Elle s’interrompit comme on ouvrait les portes du salon.
Il y avait quatre personnes dans la confortable pièce : la comtesse douairière, un homme pâle debout près d’un secrétaire sur lequel était ouvert un registre, et deux soubrettes.
Lady Aytoun semblait en mauvaise santé. Assise sur un sofa, appuyée à des coussins, une couverture sur les genoux, elle observait ses visiteurs par-dessus ses lunettes.
Millicent fit la révérence.
— Excusez-nous, madame, pour notre retard.
— Vous avez gagné, à la vente ?
Surprise, Millicent se tourna vers sir Oliver qui paraissait aussi étonné quelle.
— L’Africaine, vous l'avez eue? insista la comtesse.
— Je... Oui, balbutia Millicent. Mais comment êtes-vous au courant ?
— Combien?
Millicent trouvait cette inquisition déplacée; cependant, elle n’avait pas honte de ce qu’elle venait de faire.
— Cent dix livres. Toutefois, je ne vois pas en quoi cela vous...
— Ajoutez cela à la liste, sir Richard, ordonna la comtesse à l’homme qui se tenait au bureau. Une cause intéressante.
Sir Oliver fit un pas en avant.
— Puis-je préciser, madame...
— Ne gâchez pas votre salive, jeune homme. Asseyez-vous, tous les deux.
L’avoué, que l’on n’avait pas appelé «jeune homme» depuis plusieurs décades, en resta un instant bouche bée. Puis, comme Millicent et lui obtempéraient, la comtesse congédia les caméristes d’un geste de la main.
— Très bien. Je vous connais, tous les deux, et vous me connaissez aussi. Ce sac d’os au teint de papier mâché est mon avoué, sir Richard Maitland.
Elle haussa un sourcil en direction de l’homme qui esquissa un salut et s’assit.
— Maintenant, poursuivit-elle, venons-en à la raison de mon invitation.
Millicent aurait été incapable de deviner ce qui allait suivre !
— Des gens à ma solde me renseignent sur vous depuis déjà un certain temps, lady Wentworth. Vous dépassez de loin ce que je pouvais espérer.
Lady Aytoun ôta ses lunettes.
— Mais assez tergiversé. Vous êtes là parce que j’ai une proposition à vous faire.
— Une proposition ?
— Absolument. Je veux que vous épousiez mon fils, le comte d’Aytoun. Par autorisation spéciale. Aujourd’hui même.
ChapitreDeux
Millicent bondit sur ses pieds, jetant au vent toute bonne éducation.
— Vous avez commis une erreur, lady Aytoun...
— Je ne le crois pas.
— Votre valet a dû délivrer le message à la mauvaise adresse.
— Asseyez-vous, lady Wentworth.
— Je regrette, je ne peux pas.
Millicent jeta un coup d’œil à son avoué qui s'était levé, lui aussi.
— Je vous en prie, lady Wentworth, il n'y a aucune raison de vous effrayer, reprit la douairière plus doucement. Je devine votre angoisse, car je sais ce que vous avez souffert durant votre mariage. Mais ce que je vous propose n’a rien à voir avec la terrible situation que vous avez dû endurer sous la tyrannie de votre premier époux.
Millicent ne comprenait pas comment la vieille dame pouvait être au courant de sa mauvaise fortune. Elle en parlait comme si sa vie était publiquement connue, et elle eut soudain envie de s'enfuir en courant.
Pour Millicent, être mariée signifiait appartenir à un homme. Elle avait subi les chaînes de cet état «béni» pendant cinq interminables années. Les épouses ne bénéficiaient d'aucune protection, et leurs maris abusaient d’elles mentalement autant que physiquement. Point à la ligne.
Les vœux du mariage n’étaient qu'un moyen pour les hommes de contrôler les femmes, et après la mort de Wentworth, elle s’était juré de ne plus jamais tomber dans ce piège.
Elle fit un pas vers la porte.
La douairière eut un geste pour l’arrêter.
— Laissez-moi au moins aller jusqu'au bout. Je sais, j’ai parlé trop vite. Si vous avez la bonté de me permettre de vous expliquer dans quelle triste situation se trouve ma famille, vous comprendrez mieux la raison de mon offre.
— C’est tout à fait inutile, madame. Puisque vous connaissez tout de moi, vous devriez savoir que mon horreur du mariage n'a rien à voir avec ce que vous pourrez me raconter sur votre famille. Ce sujet me répugne, lady Aytoun, et en aucun cas je ne suis disposée à...
— Mon fils est infirme, lady Wentworth, coupa la comtesse. Depuis un terrible accident, l’été dernier, il est privé de l’usage de ses jambes, et l’un de ses bras a perdu toute force. Il est tombé dans une dépression dont il ne peut sortir. Je remercie Dieu pour la fidélité et le dévouement de son valet de chambre, ainsi que d’une demi-douzaine de personnes qui veillent à tous ses besoins, car j'ignore comment je me serais débrouillée sans eux. J’aurais sans doute été obligée de faire interner mon fils dans une maison de fous. Je vous avoue qu’une telle éventualité m’aurait tuée.
Le désespoir qui perçait dans sa voix alla droit au cœur de Millicent.
— Je compatis sincèrement, madame, mais je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider.
Les mains de la douairière tremblaient lorsqu’elle rajusta la couverture sur ses genoux.
— Malgré mon air bravache, lady Wentworth, je suis gravement malade. Pour parler franc, je suis mourante. Et mes médecins, le diable les emporte, se font une joie de me rappeler chaque jour que je risque de ne pas me réveiller le lendemain.
— Franchement, madame, je...
— Ne vous méprenez pas, je me moque comme d'une guigne de ce qui va m’arriver. J'ai eu une vie bien remplie. Mon principal souci, actuellement, est de savoir ce qu'il adviendra de Lyon quand je ne serai plus là. C’est pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui.
— Mais... vous avez sûrement d’autres possibilités ! Des amis, de la famille, des gens qui ne soient pas de parfaits inconnus. Lord Aytoun est pair du royaume, il existe des endroits, des traitements...
— S’il vous plaît, lady Wentworth, asseyez-vous. Je vais vous expliquer. .
Millicent constata que Birch, à quelques mètres, attendait de voir si elle décidait de rester ou de partir. Elle contempla la vieille comtesse. Le masque énergique était tombé, laissant place à une simple femme. Une femme malade. Une mère qui essayait d'assurer l’avenir de son fils.
Elle s’assit enfin, sans grande conviction. La douairière fut immédiatement soulagée.
— Merci. Vous avez parlé de membres de la famille. Eh bien, ceux qui restent croient que, s'il m’arrivait quelque chose, il faudrait interner Lyon dans une maison de fous. Mais le comte d’Aytoun n’est pas fou ! lança-t-elle, une lueur de colère dans ses yeux bleus. Je refuse qu'on l'attache, qu’on le torture, qu’on le r saigne, qu’on le purge, qu’on le drogue à l’opium, qu’il devienne un sujet de ragots pour la bonne société !
— Il doit tout de même exister d’autres soins. Il semble que la médecine fasse des progrès tous les jours, quelles que soient les maladies à traiter.
— J’ai essayé toutes les méthodes, j'ai dépensé une fortune, et je ne vois aucune amélioration à son état. La semaine dernière encore, j'ai lu une publicité dans La Gazette. Un certain M. Payne affirmait que les gens qui souffrent de « perte de mémoire ou de distraction » pouvaient, pour deux shillings six pence, acheter un pot de « bienfaisant électuaire » qui leur permettrait de « se rappeler les plus petits détails de leurs affaires en un rien de temps ». Je l'ai administré à Lyon, espérant une ombre de réponse. Rien.
« J’en ai assez des charlatans et des bouffons qui vantent les mérites de leur poudre de perlimpinpin. J’en ai assez de donner à mon fils des pilules de toutes les couleurs qui ne lui font aucun bien. Vous voyez, il a eu les jambes et le bras cassés, mais ils sont guéris, et pourtant il ne peut pas les bouger. Il ne marche pas, il ne lève pas le bras droit. Ces fichus médecins prétendent qu’il doit avoir quelque maladie cachée. Quant aux professeurs de l’université, ils ont une seule réponse : "Saignez-le, et saignez-le encore.” Mais cela ne donne aucun résultat.
— Je suis navrée, madame...
— Moi aussi ! répondit carrément la douairière. Mais c’en est fini de tout cela, et je refuse de mettre mon fils dans une maison d’aliénés. Je refuse aussi les décoctions de crottin de cheval, de chouettes bouillies et de vers de terre. Terminé !
— Je sais qu’il existe d’innombrables charlatans, mais il doit bien y avoir également des médecins sérieux.
— En effet. Mais les médecins «sérieux», comme vous dites, ne savent plus à quel saint se vouer. Hormis les saignées et les purges, leur recommandation est de le maintenir sous sédatif.
— Pourquoi? Est-il violent?
— Certes non, assura la comtesse. Mais il a été terriblement malheureux à Baronsford, la demeure ancestrale des Aytoun près d’Édimbourg. C'est là qu’a eu lieu l’accident. En fait, l'automne dernier, Lyon est allé jusqu’à insister pour que son frère Pierce prenne le contrôle de toutes ses propriétés. Pierce n’est pas en Angleterre pour l’instant, et il ne s’intéresse aucunement au domaine familial. En outre, c’est Lyon l’héritier du titre. C’est vers lui que se tournent les gens qui dépendent de nous et...
Elle agita une main impatiente.
— Mais Baronsford est le cadet de mes soucis. Je vous en ai parlé pour vous faire comprendre pourquoi je tiens à l’en éloigner. Il faut que je trouve à mon fils un endroit où rien ne lui rappelle son passé, ni la perte qu’il a subie.
Millicent, durant cette tirade, avait eu le temps de se calmer. Personne ne pourrait la forcer à agir contre son gré, elle était maîtresse de ses décisions comme de leurs conséquences.
— Je ne vois toujours pas en quoi votre proposition pourrait améliorer la vie de votre fils. Je ne suis pas médecin, et je ne serais pas capable de...
— Il a besoin d’une nouvelle demeure, de personnes qui prennent soin de lui. Je sais que, depuis la mort de votre mari, vous avez accueilli chez vous ses anciens esclaves. Mais, précisa la comtesse après une courte pause, sachez que j'ai l’intention de rendre cet arrangement aussi avantageux pour vous que pour mon fils.
Sans attendre la réponse de la jeune femme, elle fit signe à son avoué de lui donner une feuille qui ressemblait à une liste comme en rédigeaient les employés de banque.
— Voici, ma chère, un résumé de toutes les dettes que vous a laissées votre défunt époux. Nous avons eu un mal fou à les rassembler, et peut-être en manque- t-il quelques-unes. Votre homme d'affaires ici présent les examinera à loisir et nous donnera ses commentaires. Vous le savez, bien des gens se réjouissent de dévoiler publiquement les dettes de leurs semblables, pour le simple plaisir d’assister à leur déconfiture.
Millicent prit la feuille et la parcourut rapidement avant d’arriver au total, qui représentait une somme énorme. Toutefois, elle refusa de montrer sa détresse. Elle tendit la liste à sir Oliver.
— Que proposez-vous exactement, lady Aytoun ? demanda-t-elle d'une voix blanche.
— Une entente qui n’aura de mariage que le nom. Un contrat d'affaires pur et simple. Si vous êtes d’accord sur les termes, le comte d’Aytoun viendra vivre avec vous à Melbury Hall, mais il arrivera avec son valet personnel et ses domestiques. Nous avons un médecin qui est prêt à venir régulièrement lui rendre visite. Vous n’aurez qu’à trouver de la place pour ces gens. En échange, Maitland, mon avoué, réglera toutes vos dettes et vous recevrez chaque mois une somme confortable qui vous permettra d’entretenir Melbury Hall. Vous aurez aussi largement les moyens de poursuivre vos bonnes œuvres.
Millicent était tout étourdie. Elle avait passé d’interminables nuits éveillée, à s’agiter dans son lit en se demandant comment rétablir ses finances. Les six derniers mois avaient été particulièrement pénibles. Or lady Aytoun lui offrait la possibilité de se libérer une fois pour toutes des dettes de son mari. Mais le prix à payer la terrifiait. Le mariage, encore.
— Que deviendrait notre arrangement, madame, si le comte d’Aytoun guérissait ?
— Je crains que ce ne soit sans espoir. Aucun des médecins qu’il a vus récemment ne pense...
La douairière s’interrompit afin de raffermir sa voix :
— Aucun médecin ne pense qu’il y ait une chance de guérison.
— C’est tout de même une possibilité.
— J'envie votre optimisme !
— Je souhaite qu’il existe une clause garantissant que le divorce ne sera pas contesté, au cas où le comte retrouverait ses facultés.
La douairière jeta un coup d’œil à sir Richard, qui se leva.
— Considérant la nature du mariage et l'état du comte, un divorce ou une annulation ne poserait aucun problème.
— Sa condition actuelle est un argument suffisant pour une annulation, renchérit sir Oliver.
Millicent n'en revenait pas d’être allée si loin dans la discussion. Elle pesait le pour et le contre, mais déjà la balance penchait d’un côté.
— Autre chose ? Vous avez encore des hésitations ?
A la question de la vieille dame, elle releva le menton.
— Oui, madame. Pourquoi moi? Vous ne me connaissez pas. Qu’est-ce qui vous a poussée à me choisir?
— Nous ne l'avons pas fait au hasard. Face à mes exigences, mon avoué avait une lourde tâche à assumer. Mais je dois avouer que votre histoire, votre réputation de bonté et l’état de vos finances faisaient de vous la candidate idéale... J’espère que vous n’êtes pas blessée par les investigations que nous avons effectuées. Au bout du compte, je connais presque tout de vous.
Millicent haussa les sourcils. Elle avait toujours mené une vie fort discrète, et elle se demandait ce que l'on avait bien pu découvrir sur elle.
— Je suis fort surprise, madame, et j’aimerais avoir un échantillon de ce que vous avez appris.
— Volontiers. Vous êtes Millicent Gregory Wentworth, vous avez vingt-neuf ans, vous êtes veuve depuis un an et demi, c'est votre famille qui avait arrangé le mariage.
— Ce sont des renseignements faciles à obtenir, et ils ne disent rien sur ma personnalité.
— Certes. Cependant, mon entretien avec vous aujourd’hui me renforce dans ma décision. Hormis une nuit passée chez eux de temps en temps lors de voyages à Londres, vous ne voyez pratiquement pas les vôtres. Non que je vous en blâme. Votre famille se compose de deux sœurs aînées et d’un oncle en qui vous n'avez pas confiance, puisqu’il vous a remise entre les mains de Wentworth sans s’être auparavant enquis de son caractère.
La comtesse lissa la couverture sur ses jambes.
— Vous correspondez rarement avec les gens de votre famille. Durant les cinq années de votre mariage, jamais vous n’avez avoué à l'un d’entre eux les mauvais traitements que vous infligeait votre mari. Vous avez peu d'amis proches, et votre orgueil vous empêche de faire appel à eux, même lorsque vous êtes au bout du rouleau. Quoi d’autre ? Oui, vous affranchissez vos esclaves...
— Les esclaves de mon défunt mari, rectifia Millicent.
— Bien sûr. Et c’est en partie à cause de cela que vous êtes sur le point de crouler sous les dettes.
La douairière dévisagea un instant la jeune femme.
— Sur un plan plus terre à terre, vous semblez vous contenter de votre apparence naturelle et ne vous souciez pas de coquetterie. En fait, vous ne vous êtes jamais mêlée à la bonne société londonienne et, depuis votre veuvage, vous vous êtes réfugiée dans votre propriété à la campagne.
— Je n’ai rien manqué d'important en vivant sur mes terres, madame.
— Exact ! Et cette attitude est l'un des éléments que j’apprécie en vous. Les soirées de la saison mondaine ne vous manqueront pas, et vous ne reprocherez pas à votre époux de ne pas vous emmener à Londres, à Bath, ou au dernier endroit à la mode. De plus, vous êtes intelligente, douée d’une profonde compassion. Vous venez de découvrir la valeur de l’indépendance, et vous tentez de profiter du pouvoir quelle confère. Mais, pour réussir, vous auriez bien besoin de la présence d’un mari qui tiendrait les loups éloignés de votre seuil.
La lutte faisait rage dans la tête de Millicent. En effet, un mari lui serait fort utile pour atteindre ses buts. Elle s’était déjà rendu compte qu'il lui était impossible d’engager et de garder un régisseur de qualité pour Melbury Hall. Même pour se rendre à une vente aux enchères sur les quais, il lui était indispensable d'être accompagnée par un homme, puisque la gent masculine était tellement plus intelligente que le sexe faible !
Millicent, afin d’apaiser la colère qui montait en elle, pensa à l’histoire de sa meilleure amie à Philadelphie. Sous le nom de Mme Ford, Rebecca avait dû faire croire qu’elle était veuve pour être acceptée dans cette ville.
— Que pensez-vous de mon offre, lady Wentworth?
Elle s’ébroua et croisa le regard direct de la vieille dame.
— Pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi si vite ?
— Vous ne restez jamais bien longtemps loin de Melbury Hall. Un jour ou deux, guère plus. À mon avis, vous repartirez demain matin.
— C’est vrai.
— Si j’ajoute à cela le peu d'aurores qui me restent à vivre, je ne veux pas tenter le sort en attendant davantage. C’est trop important.
— Que pense Sa Seigneurie de votre grand projet?
La douairière prit une profonde inspiration, relâchant lentement son souffle.
— Je ne savais pas si je parviendrais à vous convaincre, mais j’ai expliqué à mon fils que ce mariage serait considéré comme une aide financière pour vous, et non comme de la charité de votre part. Alors il a accepté. Il refuse la pitié. Il ne lui reste plus grand-chose, mais sa fierté est intacte.
* * *
Lyon Pennington, quatrième comte d’Aytoun, était assis devant la fenêtre. Les muscles de son visage étaient tendus sous la barbe hirsute, ses yeux fixaient un point imaginaire au-delà du triste paysage de Hanover Square.
Deux valets avaient préparé une redingote de brocart, un gilet de soie, une cravate noire, une culotte, des bas et des souliers à boucle pour le mariage. Toutefois ils n’osaient approcher et, sur le seuil, échangeaient des regards nerveux.
— Elle est là, murmura une jeune femme qui arrivait avec le plateau de thé.
Elle se hâta de le poser sur une petite table près du comte, puis elle fit la révérence et alla rejoindre les deux hommes.
— La comtesse douairière pense que la visiteuse voudra voir Sa Seigneurie avant la cérémonie, reprit-elle à voix basse.
Une autre servante apportait des pâtisseries, et le valet de chambre personnel du comte, Gibbs, pénétra à son tour dans la pièce.
— Qu’attendez-vous? gronda-t-il. Sa Seigneurie devrait déjà être habillée !
Les deux jeunes gens se hâtèrent de s’exécuter. Le valet de chambre du comte était aussi large et haut que les chênes de Baronsford, et ils savaient ce qu'il en coûtait de le contrarier. L'un d'eux prit la culotte de peau, l'autre la chemise, mais tous deux hésitaient à approcher le comte.
— Sa Seigneurie n’avait pas très envie de s'habiller, ce matin, chuchota celui qui s’appelait John.
Les deux caméristes se sauvèrent vivement.
— Oui, monsieur Gibbs, renchérit l’autre. Lord Aytoun a bien failli nous trucider tous les deux parce qu’on essayait de le bouger. C'est seulement quand on lui a donné le médicament du nouveau médecin qu’il s’est calmé.
— Sa Seigneurie avait déjà pris sa potion, ce matin ! rétorqua Gibbs d’une voix contenue. Vous n’avez pas à lui en administrer chaque fois que l’envie vous en prend !
— Oui, monsieur, mais il n’en avait pas eu assez.
— Si j’avais le temps, je vous tordrais le cou, je vous botterais le train...
Gibbs tenta de se ressaisir.
— Vous vous en tirez bien pour cette fois, reprit-il. Tout le monde est en bas et le comte n’est toujours pas habillé.
— Il s’est calmé il y a seulement quelques minutes.
L’air féroce, Gibbs leur fit signe de le suivre jusqu'au fauteuil du comte.
— Milord ?
Lyon ne cilla pas. Il n'était ni endormi ni éveillé.
Gibbs ferma les persiennes et vint se planter devant son maître.
— Nous devons vous préparer, milord.
Les traits figés, le comte leva enfin les yeux vers les trois hommes.
— Lady Wentworth et son avoué sont arrivés, monsieur, dit le valet en prenant la couverture sur les genoux du comte. L’évêque patiente depuis une heure dans la bibliothèque. On vous attend.
L'un des serviteurs se pencha pour déboutonner la robe de chambre du comte, mais un regard de son maître le fit reculer.
— Mettez-moi au lit, marmonna le comte.
— C’est impossible, milord. Madame votre mère insiste pour que nous vous habillions.
Sans songer à ses jambes inertes qui ne l’avaient pas supporté depuis des mois, le comte s'appuya à l’accoudoir du fauteuil pour se lever. Avant que ses serviteurs affolés n'aient eu le temps de le retenir, il s’affala au sol.
— Seigneur!
— Il est tombé sur son bras droit !
— Aidez-moi à le relever, ordonna Gibbs qui était déjà à genoux.
— Le médecin a dit que, s’il se cassait de nouveau le bras, il faudrait l’amputer!
Gibbs fusilla le domestique du regard, tout en retournant doucement le comte.
Lyon n'était pas moins robuste que son valet. Des mois d’immobilité l'avaient quelque peu affaibli, néanmoins il fallait plusieurs hommes pour le bouger. Surtout quand il était dans de mauvaises dispositions.
— Si je puis me permettre, milord, dit Gibbs en faisant fonctionner le bras qui ne semblait pas brisé, vous avez accepté le projet de la comtesse douairière.
— Remettez-moi au lit, grinça le comte, les dents serrées.
De son poing valide, il frappa le plancher.
— Tout de suite !
— Votre mère a eu une crise cette nuit, insista Gibbs. Nous avons dû appeler le médecin...
Il se tenait prudemment à quelques pas de son maître, sachant qu’il ne fallait pas le toucher lorsque sa colère menaçait d’exploser.
— La seule chose qui l'ait fait sortir de son lit ce matin, poursuivit-il, c’est votre promesse d’accéder à ses souhaits. Si elle apprend que vous avez décidé d’y renoncer, cela risque de lui être fatal. Je vous en prie, milord, accordez-lui un peu de paix pour les quelques jours qu’il lui reste sur cette terre.
Était-ce le sédatif administré par les domestiques, ou bien le comte réalisait-il qu’il n’avait pas le choix ? Gibbs n’aurait su le dire. Quoi qu’il en fût, les valets furent soulagés que Lyon Pennington ne se débatte pas quand ils le hissèrent dans son fauteuil.
— Et cette femme, Gibbs,' marmonna-t-il. Vous croyez que ma toute nouvelle épouse aura un seul moment de paix, avec moi ?
ChapitreTrois
Jasper Hyde sortit sa montre de gousset. Presque trois heures de l’après-midi, et toujours aucune nouvelle de ce satané secrétaire, ni de Platt, d’ailleurs.
Le White’s était bondé, comme tous les jours, et Hyde jeta un coup d’œil autour de lui. Il commençait à reconnaître certains messieurs parmi les joueurs ou les gens qui buvaient simplement en regardant les autres perdre des fortunes. Quelle que soit l’heure, il y avait toujours du monde aux tables de jeu, l’après- midi. Ensuite, la clientèle se ferait plus rare, car on partirait pour des dîners, des soirées, ou bien d’autres distractions typiquement londoniennes.
Hyde observait le cornet de dés que tenait le comte de Winchelsea. Lui-même avait perdu plus que de raison, cependant c’était nécessaire pour lui permettre de fréquenter des gentilshommes.
— Les jeux sont faits, annonça le croupier d’un ton morose.
Derrière lui, près d’une vaste cheminée, jouaient un harpiste et un corniste, tandis que le directeur de l’établissement houspillait un serviteur trop lent.
Lord Winchelsea secoua de nouveau les dés afin de tenter la chance.
— Sept.
Des gémissements se mêlèrent aux cris de joie, et Hyde vit Winchelsea sourire avec arrogance.
— Il faut fêter ça ! dit-il au comte de Carliste, assis à sa gauche.
Celui-ci eut un petit reniflement contrarié, et Winchelsea se tourna vers Jasper.
Hyde constata que sa pile de jetons diminuait à vue d’œil. Le jeune comte avait perdu largement trois cents livres dans la semaine, cependant la chance lui semblait à présent favorable.
— Si cela ne vous ennuie pas, milord, je vais parier comme vous.
— Sage décision, Hyde. Au fait, j’ai réservé un salon privé au restaurant Clifton, avant que nous allions à Drury Lane. Voulez-vous vous joindre à nous ?
— Avec plaisir.
Enchanté de cette proposition, Hyde doubla sa mise.
— Vu la bonne nouvelle de la journée, vous devriez tous nous inviter à dîner! lança lord Carliste.
— Bon sang, vous avez raison, Carliste. Allez, vous êtes tous conviés !
Winchelsea secoua tes dés.
— Puis-je vous demander de quelle bonne nouvelle il s'agit, milord ? s’enquit Hyde.
Ce fut Carliste qui répondit.
— Il paraît que l'ennemi principal de notre compagnon file à la campagne à la première heure, demain matin.
— Aytoun quitte Londres ? s’étonna quelqu’un à l’autre bout de la table.
— On l’emporte, pour être exact, rétorqua Carliste.
— On l’envoie à Bedlam chez tes fous, finalement?
— Non, malgré ma chaude recommandation, dit Winchelsea en agitant 1e cornet. Mais il est quand même condamné à la prison à vie. Il se remarie cet après-midi.
— Les jeux sont faits, marmonnait le croupier.
— Qui serait assez stupide pour lui accorder la main de sa fille ? demanda l’un des joueurs. N’a-t-il pas tué sa première épouse?
— Ce n’était qu’une rumeur infondée, protesta Carlisle.
— Je ne suis pas de cet avis, déclara Winchelsea en posant le cornet sur la table. Je connais le tempérament ombrageux de cet individu, et je le crois parfaitement capable d'assassiner quelqu'un.
— Vous connaissez son tempérament ombrageux parce que vous badiniez avec sa femme, pouffa Çarlisle. Et vous dites cela parce qu'il a été le seul homme à vous provoquer en duel. Naguère, vous ne cessiez de vous plaindre de la blessure qu’il vous avait faite à l’épaule. Si c’était vous qui l’aviez battu, vous ne le calomnieriez pas ainsi.
— C’est une accusation? gronda Winchelsea, échauffé.
— Non... Et vous ne me persuaderez pas de me battre avec vous à l’aube au coin d’un bois, mon ami. Continuons donc à jouer, et qu’Aytoun et sa nouvelle épouse aillent au diable !
Il y eut un murmure d’agrément, et Winchelsea lança les dés.
— Six ! annonça le croupier.
Carlisle eut un sourire suffisant.
— J’espère que cela ne veut pas dire que votre chance a tourné.
— Charmante pensée de votre part.
— Bientôt, nous apprendrons que votre tailleur fait le siège de votre demeure pour être payé.
— Vous êtes le diable en personne, Carlisle !
Sans se soucier de l’échange aigre-doux, Hyde regardait les dés. Perdre cinq cents guinées sur un seul coup paraissait sans doute insignifiant pour tous ces aristocrates, mais pour lui c’était un nouveau coup du sort dans une longue série de malchances.
Il retint son souffle comme une violente douleur lui transperçait la poitrine et les épaules. Il attendit que la crise passe, sans attirer l’attention sur lui. Les attaques se produisaient inopinément et de plus en plus souvent, ces derniers temps, le privant de toute énergie. Il s'appuya à la table.
Le cornet passa à lord Carlisle, et l’on misa. En- se retournant, Hyde fut soulagé d’apercevoir enfin son homme d'affaires sur le seuil. Il s'excusa et se dirigea vers Platt. Sans un mot, celui-ci l'emmena au rez-de-chaussée où l’attendait son secrétaire, Harry, l’air embarrassé.
Un valet tendit à Hyde sa canne et son chapeau, l’aida à enfiler son manteau. La douleur de sa poitrine s’atténuait quelque peu, pourtant il avait encore du mal à respirer.
Il fit signe à ses deux employés de le suivre dans un petit salon proche de l’entrée. Quelque chose n’allait pas," c’était évident.
— Où est-elle ?
Platt ferma la porte avant de répondre :
— Harry n’a pas pu acheter l’esclave.
La rage s’empara de Hyde, comme un ouragan. Le secrétaire recula contre le mur, tandis que son patron lui enfonçait douloureusement le bout de sa canne dans le ventre.
— Vous aviez des ordres. Il vous suffisait de surenchérir jusqu’à ce que vous ayez le dernier mot !
— C’est ce que j'ai fait, monsieur, mais le prix continuait à grimper.
Lady Wentworth assistait à la vente, expliqua Platt qui se tenait à distance respectable.
— Elle a déboursé une fortune pour cette bonne à rien.
Jasper Hyde, hors de lui, frappa violemment le secrétaire à la tête.
— C’est vous, le bon à rien ! Je devrais vous renvoyer sur-le-champ. Vous n’avez pas compris ce que je vous ai dit? Les instructions étaient pourtant claires : enchérir et gagner l’Africaine. Que vous importait le prix ?
— Mais elle est partie à cent dix livres, patron ! s’excusa Harry en se frottant le crâne, prêt à parer un nouveau coup. Et les gens étaient contre moi. Ils ont pensé que je faisais monter le prix exprès, alors ils ont pris la défense de lady Wentworth. J’ai cherché votre voiture, mais vous n’étiez pas là, ni M. Platt. Je n’imaginais pas une minute que vous vouliez monter au-delà de cinquante livres, pourtant je suis allé jusqu’au double et...
La canne frappa le secrétaire au poignet, lui arrachant un cri.
— Cela ne résout rien, intervint Platt, nerveux. Il y a d'autres moyens de récupérer cette esclave.
La respiration pénible, Jasper Hyde se laissa tomber dans un fauteuil et s’agrippa des deux mains à sa canne, afin de lutter contre la douleur qui l’oppressait.
— Heureusement que c’est lady Wentworth qui a acheté l’esclave, le raisonna Platt. Elle vous doit une fortune, or elle n’a plus d’argent. Elle a proposé cinq fois trop cher pour l’Africaine, et elle n’a sans doute pas de quoi payer. Que ce soit par l'intermédiaire des créanciers de Dombey ou par celui de l’avoué de lady Wentworth, je me fais fort de vous amener l’esclave avant la fin de la semaine.
Hyde réfléchit un instant, puis se leva. Le secrétaire se colla au mur.
— Alors, je compte sur vous, dit le planteur à son homme d’affaires. Nous n’avons plus beaucoup de temps.
* * *
Les objets étaient placés sur l'âtre de briques. Ohenewaa n’avait pu en cacher beaucoup, dans les manches de sa chemise déchirée. Quelques cailloux, une écorce d’arbre, des feuilles séchées, un petit sachet contenant des mèches de cheveux. La vieille femme versa plusieurs gouttes d’eau sur le foyer et posa un quignon de pain en offrande près des grigris. Elle avait beaucoup de remerciements à adresser, et elle savait que les esprits l’entendaient comme elle s’agenouillait près de l’autel improvisé.
Elle prit une poignée de cendres dont elle se barbouilla le visage, les mains, les bras. Le chant ancestral monta tout doucement dans sa poitrine. En se balançant d’avant en arrière, elle remercia l’Être suprême, Onyame, de l’avoir délivrée de Jasper Hyde. Elle chanta sa reconnaissance d’être libérée de ses fers.
Ce qui allait lui arriver à présent demeurait un mystère. On l’avait amenée au bureau de l’avoué, sir Oliver Birch, en début d'après-midi. Peut-être ce grand Anglais avait-il une âme, après tout.
Il lui avait dit que la dame du port avait déjà signé les papiers qui l’affranchissaient de son état d’esclave. Elle était une femme libre, avait-il précisé. Elle n’avait pas bien compris. Une femme libre?
Il avait dit aussi que la dame, lady Wentworth, serait ravie de l'emmener avec elle à la campagne. L’avoué avait expliqué que de nombreux esclaves affranchis vivaient à Melbury Hall, et qu’il y avait de grandes chances pour qu'Ohenewaa en ait connu quelques-uns à la Jamaïque.
Ohenewaa se rappelait fort bien le nom de Wentworth. Elle se souvenait de la joie que tous avaient éprouvée en apprenant sa mort. Mais c’était avant que le poing d’acier de Jasper Hyde ne se referme sur leurs gorges.
On frappait à la porte, et elle se tut. Une jeune femme jeta un coup d’œil prudent à l'intérieur.
— Puis-je entrer?
Les yeux bleus fixaient les objets dans l’âtre avec curiosité.
— Je m’appelle Violet, dit-elle doucement.
Elle portait un plateau, mais n'alla pas plus loin que le seuil.
— Je suis la camériste de lady Wentworth. Elle m’a envoyée vous demander de quoi vous aviez besoin avant que nous partions pour Melbury Hall, demain matin. Puis-je entrer? répéta-t-elle.
Ohenewaa contempla la jolie robe de la jeune femme. Elle hocha la tête sans se relever.
— Il paraît que vous avez du pain et de l’eau, mais je vous ai apporté quelque chose de chaud. Madame dit que, malgré toute sa bonté, on ne peut pas faire confiance à un vieux célibataire comme sir Oliver...
Elle posa le plateau sur l’étroite couchette et regarda autour d’elle. Il y avait une cruche et une cuvette sur la table de chevet, près du lit.
— Je suis désolée, je n'ai pas pensé à vous apporter des vêtements propres, mais je vais vous laisser mon manteau, et nous serons à Melbury Hall dès demain après-midi. Là, lady Wentworth, ainsi que Mme Page et Amina, s'occuperont de vous.
Elle se frotta les bras.
— Cela vous ennuierait si j’allumais un feu dans la cheminée ? Il fait un froid !
Ohenewaa fut surprise quelle lui demande la permission !
— Comme vous voudrez.
La vieille femme se releva en se massant les poignets et alla s’asseoir au bord du lit. La camériste contourna soigneusement - presque respectueusement - les objets posés devant la cheminée avant de mettre quelques bûches dans l’âtre.
— Vous étiez en train de prier, dit-elle.
Elle regarda Ohenewaa par-dessus son épaule, qui répliqua :
— Cela ne vous dérange pas, en tant que catholique ?
— Non, je vous admire, au contraire. Ceci est un autel, n’est-ce pas? Je sais que vous considérez l'autel comme le seuil du paradis, comme « le visage de Dieu», en quelque sorte.
— Où avez-vous appris tout cela ?
— J’ai beaucoup d’amis africains à Melbury Hall, et je passe de nombreuses heures en leur compagnie. Pour certains, leurs croyances sont bien plus fortes que les miennes.
— Vraiment ?
— D’abord, ils croient qu'ils ne sont jamais seuls, même si on les a séparés de leur famille, ce qui est le cas. Ils sont certains que l’esprit de leurs ancêtres est toujours avec eux.
— Vous n’aimez pas être seule.
— Non. Franchement, non, dit Violet en se levant. Je suis heureuse que vous veniez avec nous... Je reviens dans un instant. Je vais chercher une boîte d’amadou.
La servante partie, Ohenewaa fixa la porte ouverte. Pour la première fois en soixante ans d’existence, elle était libre.
Toutefois, cela ne lui apporta guère de joie. Elle savait combien le monde était dur, cruel. Elle était libre, certes, mais sans aucun endroit où aller, sans argent pour acheter du pain, sans travail pour gagner de l’argent. Elle demeurait esclave de la société.
La seule chose qu’on ne lui eût pas demandée, c'était si elle acceptait de partir avec ces gens à la campagne. Ils pensaient sûrement quelle devait être reconnaissante de cette chance qu'ils lui offraient. Et peut-être devait-elle l’être.
Elle se lava les mains, le visage. Elle était enfin une femme libre, mais l’univers n’avait pas changé pour autant.
Comme Violet revenait et allumait le feu, Ohenewaa songea au geste de lady Wentworth. Elle avait envoyé une servante veiller à ses besoins...
Peut-être trouverait-elle à Melbury un nouvel espoir. Ou peut-être pas. Pour une esclave, rien n’était certain, hormis la mort.
ChapitreQuatre
— Je sais que c’est inattendu, et veuillez m’excuser auprès de notre personnel pour ce surcroît de travail, mais lord Aytoun peut arriver n’importe quand, et j'ai vraiment besoin de l'aide de tout le monde.
Millicent se tenait devant la cheminée de la bibliothèque, en compagnie de la gouvernante et du majordome. Le voyage depuis Londres avait été pénible. Violet et l'Africaine étant dans la voiture, elle avait été obligée de suivre à cheval en compagnie d’un valet, et le vent d’hiver l'avait glacée de la tête aux pieds. Toutefois, l’inconfort du trajet n’était rien comparé à l’angoisse qui l’habitait. Faire d’un simple manoir campagnard comme Melbury Hall une demeure digne d’un comte, était un véritable défi qu’elle n’était pas certaine de pouvoir relever avec succès.
Durant les instants passés en compagnie de la comtesse douairière, elle avait entendu beaucoup parler de Baronsford, le château de la famille Aytoun. Elle avait même vu un tableau le représentant, accroché au mur. Après la splendeur de la maison londonienne, elle imaginait à quoi pouvait ressembler le château à la frontière écossaise. Elle avait le tournis devant la tâche qui l'attendait !
— Mais enfin, madame ! protestait le majordome. Vous voulez que nous fassions tout cela en une journée ? C'est absolument irréalisable ! Nous sommes déjà au milieu de l’après-midi et nous n’aurons pas le temps de...
— Monsieur Draper, coupa Millicent, nous aurons encore moins de temps si nous nous perdons en discussions. Ayez la bonté de transmettre mes ordres aux garçons d’écurie, afin qu’ils fassent de la place pour le carrosse du comte, ou peut-être ses carrosses, et ses chevaux. Ensuite, communiquez mes instructions à Jonah pour le reste du personnel. Mme Page et moi- même devons prendre des dispositions immédiates pour loger tout le monde.
Le domestique releva légèrement le bout de son nez et se dirigea, raide, vers la porte. Millicent espéra qu’il était assez intelligent pour comprendre qu’il lui faudrait changer d’attitude en présence de lord Aytoun.
Draper s'immobilisa sur le seuil.
— Et la femme africaine ? Elle refuse de parler. Même ses compatriotes n’ont pu la faire entrer dans la cuisine. Et elle ne veut pas se séparer de cette guenille qui lui sert de châle. Voulez-vous qu'elle reste là, plantée devant la porte, à gêner le passage ?
Millicent se reprocha en silence de ne pas s’être occupée plus tôt de l’ancienne esclave. Violet lui avait dit qu’elle avait refusé de se nourrir, la veille, et qu’elle n’avait pas voulu non plus du manteau quelle lui proposait.
— Je m’occuperai d’elle dès que j'en aurai terminé avec Mme Page.
— Avant que vous déménagiez tout le monde, madame, répondit vertement le majordome, je vous informe qu’il n’y a plus une chambre de libre au deuxième étage. Avec tous les ouvriers agricoles qui ont quitté les cabanes des bois pour envahir les quartiers des domestiques, il ne reste plus de place pour l’Africaine. Je vous recommanderais donc de revoir votre décision de ne plus utiliser les cabanes. N’importe laquelle lui paraîtra un palais, comparée à ce qu’elle a connu jusque-là.
Le long de la rivière, au-delà du vallon, se dressaient les huttes décrépies dans lesquelles Wentworth logeait la plupart des Africains qu'il retenait comme esclaves à Melbury Hall. Après sa mort, l'une des premières actions de Millicent avait été de les faire déménager de cette partie du domaine que l’on appelait le Grove.
— Je vous répète que je m’occuperai moi-même de cette personne, monsieur Draper. Vous pouvez disposer.
Les deux femmes se turent jusqu’à ce qu’il ait fermé la porte derrière lui.