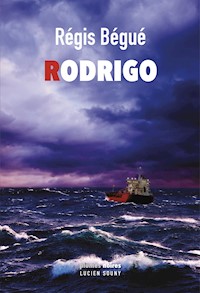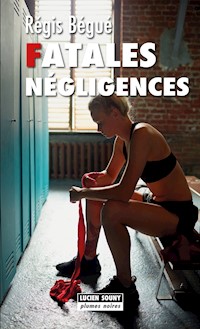Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Sylvie est la principale suspecte de la mort de son ami, assassiné après s'être enrichi sur la débacle de la S.N.O.W.
Sylvie déambule de la manière la plus naturelle qui soit dans le merveilleux jardin de cette grandiose demeure du 7e arrondissement de Paris. Toutefois, elle sait qu’elle n’est pas la bienvenue. L’élégante, la délicieuse, la charmante Caroline, la veuve de Jean-Baptiste, a eu la singulière attention de convier sa rivale à la réception donnée à la suite de la messe anniversaire de la mort de son époux. Sylvie a accepté l’invitation, n’ignorant pas que, dans l’esprit des convives, elle est la principale suspecte de l’assassinat de celui qui s’est honteusement enrichi sur la débâcle de la S.N.O.W. N’avait-elle pas menacé Jean-Baptiste de tous les maux dans un mail de triste mémoire ? Elle le jure, pourtant : malgré la colère et la rancune, elle n’a pas tué son ami, spéculateur habile. Mais le laborieux commandant Papadakis n’a pas l’air convaincu de son innocence. Il l’arrête et la place en garde à vue à la sortie de la garden-party.
Qui est le meurtrier de Jean-Baptiste ? Quel est le véritable rôle de Sylvie dans cette affaire ? Découvrez ce nouveau polar à l'intrigue haletante dans le monde des affaires parisien.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Voici donc un petit polar sympathique, truffé de piquantes et ironiques réflexions, pour un moment récréatif agréable et tout sauf bête, que j'ai quitté avec le sourire et le sentiment d'avoir appris deux ou trois choses. -
Cannetille, Babelio
L'écriture est simple. La narration ne manque pas de rythme, grâce notamment aux nombreux flash back. C'est donc un bouquin dont l'intrigue est astucieusement conduite, avec lequel on passe un bon moment de lecture détente. -
Giraud_mm, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Formé aux mathématiques, à l'économie et au commerce, c’est par hasard que
Régis Bégué entre dans la finance, en 1994. D'abord courtier, il est aujourd'hui gestionnaire dans une grande institution. Un détail d’importance puisque ce nouveau polar prend corps sur fond d’intrigue financière et de spéculation boursière. Ce métier exigeant nécessite des soupapes d'aération et d'oxygène. Il les a trouvées avec l'écriture, mais également le piano, la peinture, le théâtre, le chant ! En 2000, il s'est attelé à son premier roman,
Les cimes ne s’embrassent pas, dans lequel il a créé le village imaginaire de Saint-Ravèze, que l’on retrouve dix- huit ans plus tard dans S. N. O. W.. Entre les deux, il n'a jamais vraiment posé la plume ni abandonné le clavier. Et tant qu'il aura des histoires à raconter et qu’il y aura des gens pour les lire et les aimer, il continuera ! Il est né, a grandi et réside en région parisienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À Laurent S.
Paris, mercredi 29 juin 2016
Comme son père et son grand-père le lui avaient vivement recommandé, Jean-Baptiste s’était résolu à n’être pas l’homme d’un seul livre. Après Les Misérables, il avait dévoré l’autobiographie d’Henri Leconte qu’il avait même lue une deuxième fois, tant l’ouvrage lui paraissait fondateur pour l’époque actuelle. Tennistiquement parlant, l’œuvre ne lui avait pas été d’un grand secours, même s’il s’en défendait et cachait soigneusement qu’il n’avait jamais été capable de dépasser le niveau de la quatrième série de ce noble sport de raquette. Non, pour Jean-Baptiste, ce livre était surtout une leçon de vie et de ténacité. Parce qu’il était comme ça, Jean-Baptiste, fougueux, obstiné, empli d’une énergie débordante, mais aussi parfois sujet au découragement. Dans les moments les plus pénibles de sa vie professionnelle, la leçon de vie du champion l’avait inspiré et lui avait permis de se tirer habilement des mauvais pas.
Plus qu’habilement même, avec une dextérité confondante, je dois l’avouer. Admirative, je l’ai toujours été. Comment mon Jean-Baptiste à moi, mon ouistiti, un surnom dont je l’avais affublé autrefois, lors de notre première rencontre, comment ce petit bonhomme plein d’ardeur, mais parfois simpliste, a-t-il pu atteindre une telle opulence ?
Question que je ressasse en errant, une coupe à la main, sur ce gazon dense et taillé de la veille, épais comme une mousse onctueuse qui amortit chacun de mes pas, cerné de rosiers, de bégonias, d’hortensias de mille couleurs, oubliant que cet immense jardin se trouve au cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, tout simplement. On dit que ces lieux, ce parc et la somptueuse demeure qui le complète, ont inspiré Victor Hugo. C’est là que Jean Valjean se serait un soir réfugié. C’est peut-être ce détail qui l’a fait craquer pour l’ensemble, mon J.-B. Te fais pas de bile, Émile, il a dû dire à son banquier : « Cette maison est pour moi. C’est celle de Jean Valjean. Je paierai le prix qu’il faudra. » Le banquier en question a dû lui prêter la somme requise, quasi certain d’être facilement remboursé par l’as de la finance que Jean-Baptiste avait la réputation d’être devenu. Et il n’a pas été déçu, le banquier. Il a très vite récupéré son argent et dûment empoché les intérêts. Relax, Max.
Je poursuis ma flânerie. Cette fin juin nous offre enfin, après cet affreux printemps, l’occasion de croire encore à la saison. Les fleurs sont ouvertes, le soleil brille généreusement et donne des reflets dorés aux feuilles, aux branches, aux pâquerettes, comme aux chevelures et à la peau hâlée des convives. Il ne fait pas trop chaud, une légère brise venant rafraîchir délicatement mes épaules dénudées. Je porte une robe blanche en coton, assez échancrée sur l’avant et qui tombe à mi-cuisse. Tout à l’heure, à l’église, je ne me sentais pas très à l’aise dans cette tenue, mais maintenant j’ai l’impression d’être en parfaite harmonie avec les autres invités, tous vêtus de blanc, conformément à la demande expresse de Caroline, la femme de Jean-Baptiste. Pour cette messe du bout de l’an, qui a précédé la réception et le cocktail, elle avait explicitement demandé que tous les invités fussent habillés exclusivement de blanc. Et tout le monde a joué le jeu. De loin en loin, on aperçoit tel ou tel visage que l’on croit reconnaître. On s’est déjà rencontré, c’est sûr. On avait peut-être dîné ensemble chez Caroline et Jean-Baptiste, il y a quelques années, va savoir ! On s’est revu à l’enterrement, un an déjà. Mais on n’arrive plus à mettre un nom ou un prénom sur cette figure familière. On se contente d’un petit signe de la main, au loin, d’un sourire figé, d’un relèvement furtif de sourcils, et on passe son chemin.
Le champagne est très frais, il se laisse boire sans effort. La bulle est fine, elle chatouille à peine la langue au passage. Ma coupe est encore vide, je me presse d’aller me faire resservir à l’un des buffets. Hasard ou pas, je ne le saurai jamais, ma route croise celle de Caroline qui pile en me voyant involontairement foncer sur elle. Je m’arrête aussi. Nous sommes là, face à face, à moins d’un mètre l’une de l’autre. Elle me fusille du regard. Je ne me dégonfle pas : je lui tiens tête. Qu’elle aille au diable avec toutes les rumeurs qu’elle s’amuse à diffuser sur moi ! Si elle est tellement convaincue que c’est moi la coupable, elle n’a qu’à le prouver. Bon courage, ma cocotte.
Nous sommes rejointes par d’autres invités qui n’ont pas encore eu l’occasion de la saluer et qui, pour la plupart, me marcheraient sur les pieds pour être les premiers de la file à lui donner la chaleureuse accolade de circonstance. En un clin d’œil, l’expression de Caroline, discrètement hargneuse, se mue en une charmante figure, accueillante, souriante. Sa chevelure blonde ondule sous l’effet d’un léger coup de vent. Ses paupières vibrent délicatement pour protéger ses yeux bleu azur. De sa gorge s’échappe un rire haut perché. Elle salue, elle embrasse à tour de lèvres. Comment vas-tu ? Tu es si mignonne d’être venue de si loin ! Et Hubert, quelles sont les nouvelles ? Il est un peu mieux ces temps-ci ? Tant mieux ! Écoute, oui, de mon côté, je ne me laisse pas abattre, tu me connais. Je fais front. Et puis, il y a les enfants, on n’a pas le droit de se laisser aller.
Philosophe avec ça, Caroline. Elle force l’admiration. Même la mienne. Je dois bien reconnaître qu’elle porte merveilleusement sa cinquantaine naissante. Hors les mèches qui soutiennent quelque peu sa blondeur, tout est naturel chez elle. Les hanches, les fesses, le ventre et la peau de son visage ont bien résisté à l’usure du temps, et sans l’aide de la chirurgie, j’en suis à peu près sûre. Si ce n’avait pas été le cas, si Caroline avait fait appel à la médecine pour arranger les contours de sa délicate silhouette, Jean-Baptiste me l’aurait raconté, certainement. Jean-Baptiste me confiait tout, ne me cachait rien. Enfin presque. Le « presque » est d’importance, bien sûr.
Toujours est-il qu’elle me fiche des complexes, Caroline. Ce n’est pas nouveau. Je n’ai jamais aimé me trouver à ses côtés dans les cocktails, à souffrir de la comparaison que je lisais dans le regard des mâles qui nous déshabillaient. Avec mes dix centimètres de moins et mes cinq kilos de plus qu’elle, je me suis toujours sentie mal à l’aise à son contact. Évidemment, j’avais pour moi la situation, la carrière, le statut. Elle n’était qu’une femme entretenue. J’étais pédégère. Mieux que ça, j’étais entrepreneuse. J’avais, il y a longtemps, monté une start-up, bien avant que le mot même existât. La petite entreprise avait grandi en même temps que je vieillissais et je m’étais retrouvée à la tête d’une multinationale cotée en Bourse. Dans le gotha parisien, on se félicitait de m’avoir à dîner. Chaque fois qu’elle était invitée aussi, je serrais les dents. Bien qu’elle ne pût se vanter d’aucune réussite professionnelle, n’ayant pratiquement jamais travaillé de sa vie, elle jouissait de tout ce qui me manquait. L’aisance, le sourire, l’allure. Sa conversation savait être variée, drôle. On lui enviait ses deux jolies têtes blondes, un garçon et une fille, des jumeaux merveilleusement doués pour les arts et le sport – équitation et flûte traversière pour l’une, escrime et piano pour l’autre –, et toujours premiers des meilleures écoles privées de la capitale.
J’avais beau dépenser des millions chez Chanel et Prada, je me sentais toujours pataude, mal à l’aise. Je m’enfilais cinq ou six coupes à l’apéro, je finissais les bouteilles à table et je refusais rarement un petit digestif. Quand un certain degré d’alcoolémie parvenait à vaincre ma timidité, j’alignais une ou deux blagues de caserne qui, si elles faisaient rire, mettaient souvent mes hôtes dans l’embarras. On me réinvitait quand même, parce que m’avoir à la maison, c’était chic. Éventuellement, cela permettait aussi d’alimenter la conversation du dîner suivant. Mais quoi qu’il advînt, quels que fussent les mille artifices que je déployais pour me fondre dans leur monde, imiter leur gestuelle, hausser le timbre de ma voix rauque, je restais la plouc de service. On admirait ma gouaille, mes talents de manager, mon énergie, ma résistance à toute épreuve, mais, sitôt que je tournais les talons, on se moquait de la grossière vieille fille que j’étais restée, de ma démarche de bûcheron, de mes mains calleuses, de ma descente de pinard.
Les années ont passé ; je ne me suis pas habituée. La grâce naturelle de Caroline, son port de tête, sa sveltesse, la cambrure de ses reins me blessent, encore aujourd’hui, beaucoup plus douloureusement que ses regards assassins.
Une fois passées les embrassades avec tous les convives, qui m’ont presque piétinée pour se jeter dans les bras de Caro, l’hôtesse se tourne à nouveau vers moi.
— Comment est-ce que tu vas, toi, ma chérie ? Tu as eu la gentillesse de respecter la couleur de la robe, comme je l’avais demandé, c’est adorable de ta part, surtout toi qui n’aimes pas t’habiller, hein ?
Prends ça dans les gencives. Moi qui me démène depuis tant d’années pour m’arranger comme je peux, je n’aimerais pas « m’habiller » ? Et puis quoi encore ? Caroline a toujours eu ça en elle, ce truc des filles que je n’ai jamais su maîtriser, cette aptitude à démolir l’autre avec des mots doux.
Elle me serre dans ses bras, me jette son parfum sous le nez, m’assure au creux de l’oreille que Jean-Baptiste aurait voulu que je sois là aujourd’hui, elle en est certaine. Elle ne doute pas que, de là où il est, il nous observe et il est heureux de nous voir réunies. Je me sens obligée de poser mes mains sur ses épaules et d’approuver en opinant du chef, jusqu’à ce qu’elle me décolle enfin. Un photographe de circonstance immortalise l’instant par un premier flash. Nous tournons la tête vers lui. Il mitraille. Nous nous retrouverons sûrement demain en couverture de quelque gazette de quartier ou sur le site Internet de la mairie du 7e. Caroline n’appréciera pas. C’est beaucoup moins en vogue de nos jours, beaucoup moins classe, de s’afficher à mes côtés. Moins swag, comme diraient les enfants de Caroline. Dans la dernière année avant la mort de Jean-Baptiste, déjà, on ne m’invitait presque plus nulle part. Mais depuis, c’est encore pire, bien entendu. Trop d’encre a coulé autour de cette affaire, personne n’est plus sûr de rien. Il n’est pas question d’accuser qui que ce soit sans preuve, mais tout de même, il n’y a pas de feu sans fumée, comme aurait dit Jean-Baptiste. Parce qu’il faut bien reconnaître que, s’il faisait preuve d’une certaine adresse, voire d’inventivité, pour les rimes percutantes du type « pas de lézard, Gérard » ou « t’inquiète, Arlette », JB maîtrisait mal l’art de l’aphorisme. Les proverbes tronqués, mélangés ou inversés n’avaient aucun secret pour lui.
Mais Jean-Baptiste ne m’a jamais laissée tomber, lui, au moins. Dans les pires moments, il a toujours été là. Quelle que fût l’heure du jour ou de la nuit, il décrochait quand j’appelais, ne comptait pas son temps pour m’écouter me plaindre, n’a jamais renié notre amitié devant quiconque. Au moins jusqu’à ce que nous nous fâchions. Mais même après, il s’est abstenu de médire sur mon compte. Tandis qu’ici, dans cette garden-party donnée en l’honneur de sa mémoire, je vois bien que je suis persona non grata. Les mêmes qui, il y a quelques années, m’auraient juré fidélité éternelle se souviennent à peine de m’avoir rencontrée. Il n’y a plus guère que cette tigresse de Caroline pour me faire son cinéma. J’abrège les amabilités pour l’interroger sur ce qui nous préoccupe :
— Comment avance l’enquête, Caroline ? Les flics te tiennent au courant régulièrement ou ils ne te disent rien ?
Je l’aurais violemment giflée, elle n’aurait sans doute pas plus mal réagi. Elle se raidit brusquement, ne peut retenir un mouvement de recul, à peine perceptible mais qui ne m’échappe pas, roule des yeux de tous côtés pour essayer de repérer si nous sommes observées. Personne à moins de trois ou quatre mètres de nous ; elle souffle. Mais elle ne se détend pas pour autant. Si nous n’étions entourées d’une foule de témoins, je crois qu’elle m’étranglerait. Dieu merci, il est peu probable qu’elle cède ici, et en public, à sa pulsion. Elle garde le sourire.
— Oh ! ma chérie, tu sais comme ils sont ! L’administration, l’administration. Ils ont beau être flics, ils n’en restent pas moins des fonctionnaires. Et ce n’est pas à toi que je vais l’apprendre, après tout ce que tu as subi, ma pauvre petite chatte, ces gens ne brillent ni par leur énergie ni par leur inventivité. On se demande s’ils veulent vraiment découvrir la vérité et le coupable ou seulement cocher des cases pour clore le dossier au plus vite. J’en ai ras la casquette, je peux te dire.
Pour mimer la visière de la casquette en question, elle a barré son front d’un geste sec de sa main tendue. À mes risques et périls, j’insiste :
— Rien ? Ils n’ont rien ? Pas la moindre piste ? C’est tout de même pas ordinaire ! On ne tue pas les gens comme ça, sans mobile…
— Évidemment ! Je suis cent pour cent d’accord avec toi. Derrière un crime, il y a un criminel. Et cet assassin ne peut pas avoir agi sans motif.
— À moins qu’il s’agisse d’un détraqué…
— Oh ! je t’en prie, tu ne vas pas t’y mettre, toi aussi ?
Un détraqué, tu penses… Pas assez détraqué pour n’avoir laissé aucune empreinte, aucune trace, et avoir su détaler sans abandonner un seul indice, à part ce maudit téléphone qui n’a mené nulle part. Voyons !
Resserrant ses lèvres vers l’avant, elle lève les yeux au ciel, marquant son exaspération. Est-ce que par hasard je la prendrais pas pour une conne ? Parce que, si c’est le cas, autant le dire tout de suite ici, devant tout le monde. Chacun pourra en tirer les conclusions qu’il voudra.
Moi, comme une imbécile, je baisse la tête. Je ne sais pas quoi lui répondre, à la chipie. Bien sûr que ma réflexion est idiote. Un dingo n’aurait jamais agi de la sorte, dissimulé avec un soin méthodique et presque professionnel le moindre indice, quoi que ce soit qui puisse mener à une piste, hormis l’iPhone de Jean-Baptiste. Si son portable contenant tous ses mails et messages depuis plusieurs années est resté bien en évidence sur la table basse, c’est que l’assassin l’a voulu, c’est manifeste. La police mettrait la main dessus et, en l’absence de tout autre élément à sa disposition, s’en servirait pour essayer de reconstituer ce qui a pu le conduire à cette fin tragique. Tout cela est calculé, rien n’a été laissé au hasard, ce ne peut être l’œuvre d’un malade mental en état de démence : mon hypothèse est stupide.
Mais, qu’elle le veuille ou non, la belle Caro, il est au moins tout aussi certain que, si le téléphone a été laissé là pour qu’on le trouve si facilement, c’est dans le but précis de me faire accuser. Qu’elle réfléchisse une seconde plutôt que de s’entêter : si « sa chérie », comme elle m’appelle, sa « petite chatte », sa « jolie » Sylvie (comme si elle en croyait un mot), si moi donc j’avais froidement empoisonné Jean-Baptiste, puis soigneusement effacé toutes les traces de mon passage, est-ce que j’aurais vraiment pu oublier le portable sur la table basse ? Cet engin a gardé l’histoire de tous nos échanges épistolo-numériques. Grâce à un très long historique, on a pu constater qu’au fil des jours, notre correspondance s’est nettement intensifiée. Jusqu’à notre dispute et au silence qui s’est ensuivi. Cette saloperie de téléphone a fait de moi la suspecte numéro 1 de cette affaire jusqu’à ce que je puisse enfin présenter un alibi en béton armé ! Elle sait bien que je ne suis pas assez naïve pour avoir laissé l’appareil sur place avant de quitter les lieux. Elle a le droit me prendre pour Machiavel si ça lui chante, mais pas pour la dernière des amatrices de crime passionnel mal ficelé. Franchement, ça ne colle pas.
Depuis que nous faisons du sur-place au milieu de la pelouse, elle et moi, sous le regard en coin de plusieurs convives qui n’osent pas nous interrompre, nous sommes progressivement envahies par une chaleur devenue pesante. Le soleil me tape sur le front, que je sens perler sous le fond de teint. Mes aisselles sont humides. J’écarte les bras pour éviter de tacher ma robe d’une auréole inélégante, mais je sens bien que j’ai l’air encore plus lourdaude que d’habitude dans cette position qui doit être ridicule. Caroline ne manque pas de lancer des coups d’œil appuyés vers l’intérieur de mes bras, scrutant ma robe que j’imagine déjà maculée. Puis son expression change à nouveau subitement, ses sourcils remontent, ses cils vibrent comme de légères ailes de papillon.
Elle a aperçu Manuel derrière moi, lui qui fut mon employé et notre ami. Il a réussi à se recaser dans une entreprise d’import-export de matériel de plomberie, qui a le vent en poupe. Il s’en est presque sorti, ce salopard. Je me demande bien comment il a fait pour se faire embaucher, affublé de son passé de syndicaliste mal léché.
Caroline s’écrie :
— Manuel, tu es un amour d’être venu ! Viens donc m’embrasser. Tu es magnifique !
Magnifique, pour Manuel qui a maintenant perdu autant de cheveux qu’il a pris de bide, ou à peu près, je ne suis pas sûre que ce soit très approprié. Il s’approche en affichant un sourire jovial qui ne lui ressemble guère. Son arrivée me donne l’occasion de faire un pas de côté, de me diriger vers le buffet avant qu’il ne rejoigne Caroline ; j’en profite pour me dégourdir les jambes et agiter un peu d’air frais autour de moi. Quand nos routes se croisent, Manuel ne prend pas le temps de s’arrêter. Tournant à peine la tête dans ma direction sans quitter la grande blonde des yeux, il broie mon épaule dénudée de sa grosse paluche, en un geste d’affection feinte. Je ne lui en veux même pas de se jeter dans les bras de Caroline, pas plus que de tout le reste, en tout cas. Je ne me souvenais pas qu’ils se connaissaient si bien, à vrai dire. Il a sans doute le droit de la saluer gentiment, mais je lui garde un chien de ma chienne, au grand costaud. Qu’il ne s’imagine pas que j’ai pardonné.
J’en profite pour m’éclipser. Franchement, je crois qu’elle est aussi soulagée que moi de me voir m’éloigner. Si nos tête-à-tête me font indubitablement transpirer, j’imagine que ce n’est pas, pour elle, une partie de plaisir non plus.
Au loin, elle me fait un petit au revoir en repliant délicatement ses doigts fins sur la paume de sa main. Je lui réponds avec le même code. Mais qui a dit que j’allais quitter aussi vite cette charmante sauterie ? Elle serait bien contente que je me tire illico, sans doute, que je débarrasse la pelouse labourée par mes escarpins. Mais je compte bien profiter au maximum de cette journée d’été. Depuis le sixième étage de mon minable deux-pièces, je n’ai guère l’occasion de goûter la nature verdoyante. Je vais promener mon regard sur les hortensias et les géraniums, humer le parfum des rosiers grimpants, lancer des œillades espiègles à tous ces gens que j’ai si longtemps côtoyés et qui ne me reconnaissent plus.
Tout autour du jardin, des haut-parleurs discrets ont été disposés de manière à diffuser, au cours de la journée, les musiques préférées de Jean-Baptiste. C’est à croire qu’elle l’aimait vraiment, Caroline. J’ai toujours pensé que ce mariage était une alliance de raison entre deux êtres d’origine sociale différente que rapprochaient la réussite financière de l’un et le savoir-vivre de l’autre. Aujourd’hui, cependant, je me prends à douter. Cette cérémonie à l’église en grande pompe, cet Adagio du Concerto en ré mineur de Marcello, qui a plongé l’assemblée dans les larmes, l’organisation de ce cocktail en l’honneur de la mémoire de JB, la diffusion de ces musiques qui, effectivement, nous le rappellent tant à chaque étape de sa vie, toute cette journée voulue et organisée par Caroline me porte à soupçonner qu’elle tenait sincèrement à lui. Peut-être, finalement. Peut-être qu’après toutes ces années passées côte à côte, ils avaient fini par éprouver une véritable affection l’un pour l’autre, et, qui sait, même de l’amour. Il est des mariages qui usent les sentiments, les broient, les transforment en une indifférence teintée d’exaspération, de haine toute simple parfois. Il en est d’autres sans doute qui, au fil du temps, finissent par créer une tendresse qui n’existait pas au commencement. C’est ce qui a dû leur arriver.
Pour ce qui me concerne, je n’ai jamais eu à me poser ce genre de question, je ne me suis jamais mariée. Oh ! j’ai bien fréquenté quelques garçons, je veux dire d’autres hommes que Jean-Baptiste. J’ai même couché avec quelques-uns…, je veux dire – encore – en dehors de Jean-Baptiste, et ça n’a pas toujours été désagréable. Quelquefois même, ce fut très plaisant. Oui, oui, très. Depuis mes dix-sept ans, j’ai de bons souvenirs dans des lits, sur des bateaux, dans des hôtels parfois. Pas si souvent, au bout du compte. Mais je n’ai jamais aimé un homme, enfin un autre homme, suffisamment pour lui faire un enfant. Ou lui demander de m’en faire un. Ou lui en coller un dans le dos. Ou en faire un toute seule, comme dans la chanson.
D’ailleurs, la musique évoque à cet instant même la période Jean-Jacques Goldman de Jean-Baptiste. Derrière chaque bosquet, une enceinte nous assure que « la musique est bonne » ou qu’« il suffira d’un signe ». Les eighties. Jean-Baptiste avait la vingtaine, la pêche, la patate, toute la vie devant lui, une étincelle de malice qui perçait dans ses yeux noir de jais, les cheveux mi-longs et une frange qui lui cachait le front, à l’instar de son idole, le grand JJG. Il portait des Stan Smith, un Lee Cooper très serré et des T-shirts moulant son torse maigre, à l’effigie d’AC/DC, des Scorpions, et bien sûr le plus souvent de Jean-Jacques. Il jouait maladroitement de la guitare électrique sursaturée en trépignant et en balançant les épaules, déployant assez d’énergie toutefois pour tomber les filles en fin de soirée. Dans ce domaine, d’ailleurs, il n’était pas très difficile. Il prenait ce qui passait. On n’avait pas encore inventé le sida en 1984. Il nous restait deux ou trois ans pour se le choper sans le savoir, mais on l’ignorait et c’était cool.
La première fois que j’ai vu JB, c’était chez une copine du cours de biochimie de Jussieu, l’université dans laquelle nous étudiions à l’époque. Nous étions en deuxième année et partagions les mêmes travaux dirigés. Nous nous fréquentions depuis nos débuts à la fac, et nous nous entendions assez pour qu’elle m’invite à sa soirée d’anniversaire, c’était le 20 octobre, je m’en souviens comme si j’y étais. Elle avait fait la connaissance de Jean-Baptiste en cours de probas et m’en parlait souvent. Un garçon très doué, pour les probas du moins, parce que, pour le reste, on ne savait pas encore. « Et puis super marrant. Il parle fort, interrompt le prof sans arrêt, mais je te jure, il nous fait hurler de rire. On n’entend que lui. »
Elle l’avait donc invité aussi. Nous nous étions déjà enfilé quelques tequilas et nous agitions nos bras sur la Toute première fois de Jeanne Mas quand il est entré. Un ouistiti, il n’y avait pas d’autre mot ! Il était flanqué de deux grands escogriffes à l’air timide qui le suivaient partout, un pas en arrière, tandis qu’il fendait la foule des danseurs, et surtout des danseuses, de sa démarche nerveuse en sautillant, tapotant la joue de telle fille qu’il croisait, embrassant l’autre dans le cou, alternant les clins d’œil et les sourires taquins.
Il s’était arrêté à ma hauteur. Ses deux sbires s’étaient figés derrière lui, en attendant un signe du leader pour décider de l’attitude à adopter. JB m’avait déshabillée du regard, s’était attardé sur les bourrelets tandis que je redoublais d’énergie pour balancer frénétiquement les épaules, poing levé, en attirant à moi une corde imaginaire à laquelle je me hissais virtuellement. J’affichais mon indifférence comme on porte une décoration. Je n’allais pas me laisser impressionner par ce petit Napoléon en herbe.
Cependant, les palpitations que je ressentais au fond de ma poitrine trahissaient ce que je ne m’étais pas encore avoué. Je ne le connaissais pas encore, je n’étais même plus très sûre de son prénom, mais – je m’en rends compte aujourd’hui après tant d’années –, au moment où ses yeux innocents, tout à la fois naïfs et arrogants, se sont posés sur mon déhanchement maladroit, j’étais déjà amoureuse de lui.
Sans avoir manqué de faire remplir à nouveau ma coupe, je me suis ensuite éloignée du buffet et de la troupe qui s’y entassait. Je longe désormais le mur d’enceinte. Au loin, Caroline et Manuel sont encore en grande discussion. Elle doit lui dire des trucs un peu secrets parce qu’à chaque fois qu’elle parle, il tourne la tête et approche son oreille de sa bouche, ce qui laisse supposer qu’elle chuchote. Il lui répond par un haussement d’épaules et une moue dubitative. Moi, je ne suis pas dupe. Elle continue de l’endoctriner ; il résiste. C’est moi qui ai tué Jean-Baptiste, elle en est sûre et certaine, elle n’en démordra pas. Elle ne me le dira jamais ouvertement, mais elle ne rompra pas le contact avec moi. Elle continuera de me fréquenter aussi longtemps qu’il faudra pour obtenir la vérité, c’est-à-dire concrètement sa vérité. Elle sait bien qu’il y a cette histoire d’alibi, mais elle le trouve un peu facile. Alors que tous les maigres indices ne conduisent qu’à moi, que chaque étape de l’enquête me désigne évidemment, il suffirait d’un témoignage, fût-il solide et étayé par des preuves irréfutables, pour me disculper. Elle rigole, oui ! J’ai cependant l’agréable impression qu’elle ne parvient pas à convaincre Manuel qui continue d’opposer une fin de non-recevoir à ses arguments.
Je décide de détourner mon regard de ces deux-là. Je ne vais pas passer la journée à me demander ce qu’ils peuvent bien se raconter. Ce qu’en pense Caroline ? Qu’elle aille au diable, tiens ! Je reprends ma déambulation. La douce brise de tout à l’heure s’est à nouveau levée ; je me sens plus fraîche. Ici ou là, j’entends qu’on parle anglais. Ce sont les anciens collègues de Jean-Baptiste. Ceux de la City, pas seulement. Il y a aussi ceux de Mayfair, de St James, en général plus civilisés. Parfois plus cruels. Ils sont venus en blanc, eux aussi, conformément aux instructions de Caroline. Ils se sont pointés avec leur femme, pour ceux qui en ont une, et certains même avec leurs enfants, roux pour la plupart, il faut bien l’avouer. Les Anglais ne se mélangent pas aux autres groupes ; non qu’ils soient particulièrement misanthropes, mais, globalement, ils ne parlent pas la langue d’ici. Par conséquent, ils restent entre eux. Je perçois quelques bribes de leur discussion en m’approchant d’eux, mais c’est très furtif, car la conversation s’interrompt sitôt qu’on m’aperçoit de trop près. Je m’arrête devant le groupe. L’un me sourit timidement ; l’autre baisse les yeux ; le troisième concentre son attention sur une rose dont il admire chaque pétale, avant de l’arracher pour l’installer à sa boutonnière. Tous sont horriblement gênés. Je savoure l’instant. Je pourrais achever ici ma vengeance, les gifler au vu et au su de leurs épouses et de leur descendance, afin que chaque petit bout de chou garde ce jour bien ancré dans sa mémoire et que le souvenir de ce soufflet les conduise tôt ou tard à se demander qui était vraiment leur gentil papa et ce qu’il a bien pu faire pour mériter une telle humiliation publique. Je pourrais, oui, qui m’en empêcherait ? Qui oserait se défendre ou répliquer ? Assurément personne, et pourtant je m’abstiens. Ça ne servirait à rien, à présent.
Je les observe brièvement tous les trois. Ils ont un air bizarre, un air qui ne me paraît pas naturel et qui me chiffonne. Comme s’ils attendaient quelque chose, qu’on vienne les délivrer. Mais personne ne bouge ; la troupe se fait plus dense autour des buffets au fur et à mesure que s’accumulent les brochettes de crevettes, les cassolettes de risotto aux truffes, les timbales de fregola, les toasts de foie gras. Les ventres parlent, plus personne ne se soucie de nous. Nul ne se préoccupera de soulager ces pauvres British de ma présence affreusement importune.
C’est inutile de toute façon, je les délivre moi-même. Sans un mot, je passe mon chemin et j’opère une volte rapide vers un maître d’hôtel en possession des gougères dont je raffole. Après tout, j’ai bien le droit de m’empiffrer, moi aussi ; j’ai été invitée comme les autres.
La journée s’étire, douce, malgré tout. Une fois les estomacs remplis et les esprits enivrés, les langues finissent par se délier. On m’adresse la parole, on plaisante même un peu, tandis que s’enchaînent Queen et les Stones tout au long de l’après-midi. Le soleil s’abaisse, s’épaissit, rougit : bientôt, c’est l’heure de se quitter.
Avant de partir, je retourne embrasser Caroline. À ma grande surprise, elle déploie largement ses bras et me donne une vigoureuse accolade. Virile, presque. Puis elle m’accompagne jusqu’à la porte.
À très bientôt, ma chérie. Juste devant l’hôtel particulier s’est ostée, à cheval sur le trottoir, une fourgonnette de police. Moi, naïvement, je m’imagine qu’elle est là pour assurer la sécurité du quartier en général, truffé de ministères et d’ambassades. Jamais je n’aurais soupçonné qu’elle était là pour moi.
Ce n’est que lorsqu’un type en civil m’alpague en me tirant fermement par le bras que je comprends la situation. Premier réflexe, idiot d’ailleurs : me retourner vers Caroline. Je ne suis pas déçue : elle m’adresse le même petit geste d’adieu que tout à l’heure. Ses doigts fins se replient sur sa petite main. Au revoir, « ma chérie ». Adieu. Elle ne peut rien pour moi. Elle ne bougera pas le petit doigt qui est de toute façon occupé, avec les autres, à me faire bye-bye.
Je me retourne vers le flic, interrogative. Il est assez jeune, enfin plus jeune que moi au moins, assez baraqué son T-shirt blanc moule ses pectoraux entretenus –, très brun, la raie de ses cheveux lisses sur le côté. Ses épais sourcils lui donnent un air bonhomme. Il me domine d’une bonne tête, mais il ne me fait pas vraiment peur. J’en ai maté des plus costauds que lui. M’agitant sa carte barrée des couleurs de la République sous le nez, il me déclare d’un ton solennel :
— Vous êtes bien madame Sylvie Mansart ?
— Oui, c’est moi, et alors ?
— Madame Sylvie Mansart, vous êtes en état d’arrestation.
— Allons bon ! Et pourquoi ça ?
— Vous êtes convoquée dans le cadre de la réouverture de l’enquête sur le meurtre de M. Jean-Baptiste Debord et placée en garde à vue.
Rien que l’expression – garde à vue – me rappelle le film. Garde à vue : un huis clos haletant dans un commissariat de Normandie. Ventura contre Serrault. Gallien contre Martinaud. Guy Marchand, violent et con, en embuscade ; Romy Schneider, resplendissante mais énigmatique, en arrière-plan. Impossible de me souvenir de la fin. Serrault est-il innocenté ? Le serai-je aussi ? Je ne connais pas mon destin. Qui connaît le sien ?
Je n’ai pas l’intention de me laisser faire ; ni une ni deux, je lui oppose mon argument massue :
— Mais enfin, vous faites erreur ! J’ai un alibi !
— Justement, madame, il vient de tomber. Veuillez me suivre.
Les Ménuires, vacances de Noël 1989
Jean-Baptiste avait quitté la fac de sciences pour s’en aller étudier la comptabilité, le marketing et la finance dans quelque école dite de commerce, une drôle d’appellation, d’ailleurs, quand on y pense. Mais cet éloignement de fait, tandis que je poursuivais mes études à Pierre-et-Marie-Curie, ne nous avait pas réellement séparés. Lui et moi partagions encore une très large bande de potes avec lesquels nous partions régulièrement en virée ou en vacances. On était huit, dix, quinze, cela dépendait. On ne roulait pas sur l’or, dans l’ensemble, mais on se démerdait pour financer des locations saisonnières à la mer ou à la montagne. JB, dont les parents avaient un peu d’aisance, à l’opposé de la plupart des familles des membres du groupe, était souvent le plus à flot d’entre nous. Il lui arrivait de compléter l’enveloppe de sa poche quand nous ne parvenions pas à boucler le budget du fameux pot commun, qui ne manquait jamais de faire l’objet de discussions animées, voire de violentes engueulades. Il comptait, additionnait, divisait de tête – déjà, à l’époque, il aimait l’argent, indéniablement – et parvenait presque toujours à réconcilier tout le monde.
Nous nous entassions à quatre ou six dans des chambres pour deux, nous dormions comme nous pouvions les uns sur les autres, nous nous mélangions, filles et garçons. Moi, j’essayais de me débrouiller discrètement pour me retrouver blottie contre le ouistiti, mais la bête était volage et les autres filles de la bande s’attachaient à ne pas passer leur tour.
Comme Jean-Baptiste contribuait un peu plus que les autres, il estimait, et nous en étions tous, au fond, tacitement d’accord, que ses désirs avaient une valeur un peu plus importante que la moyenne. Non que le groupe fût absolument obligé de s’y conformer, mais, de fait, le groupe s’y conformait systématiquement. Ce Noël-là, notre leader avait choisi les Ménuires pour les sports d’hiver. Voilà plusieurs années, d’ailleurs, qu’il m’avait initiée à la pratique du ski, un sport trop bourgeois pour mes parents et surtout bien trop cher pour que notre famille pût se l’offrir. Étudiante, je finançais ma part grâce aux petits boulots que j’occupais à côté de la fac, qui consistaient essentiellement en baby-sittings et en cours particuliers. De temps à autre aussi, je posais nue dans des ateliers d’artistes. Les professeurs de dessin appréciaient mes rondeurs. Je n’étais pas pudique. Bref, il m’avait fallu attendre de rencontrer Jean-Baptiste pour découvrir les pentes enneigées.
Enneigées, pas toujours. Il y avait eu des années sans. Ce mois de décembre 1989 était encore pire que celui de l’année précédente, qui avait déjà été si pauvre en précipitations neigeuses. On n’en était pas encore à la catastrophe des hivers 1911-1912 et 1963-1964, qui n’avaient presque pas vu un flocon de toute la saison, mais on n’en était pas loin. Pour nous, groupe de jeunes fauchés comme les blés, c’était bien pire ; on avait inutilement englouti nos économies dans ces vacances à la montagne alors que la pratique du ski s’avérait impossible. Depuis notre superbe duplex de cinquante-deux mètres carrés, prévu pour dix, douze personnes, mais que nous avions investi à quinze, nous avions passé la semaine à guetter l’éventualité qu’un nuage salvateur fût capable de déposer cet or blanc que nous étions venus chercher. Que nenni, le nuage ne vint pas. Un soleil radieux se dressait quotidiennement au-dessus des sommets et faisait consciencieusement reculer les maigres plaques de neige usée, laissées là par les premières chutes de l’automne qui ne s’étaient pas renouvelées. Même le glacier de Val-Thorens montrait des signes de faiblesse.
De mon côté, j’avais commencé une thèse de biologie sur l’évolution bactérienne symbiotique en milieu aquatique. À force de manipulations, j’avais fait une découverte étonnante, tout à fait fortuitement. Je ne savais pas encore ce que je pourrais en faire ; ce séjour allait m’en donner l’occasion.
Nous avions fait la grasse mat’. La soirée de la veille avait été arrosée et enfumée. Il n’y avait pas que sur les pistes qu’on trouvait de l’herbe, les placards en formica du F4 en étaient aussi bourrés. Inutile de s’extirper du lit pour pester, la journée entière, contre cette incompréhensible météo qui donnait à penser que les saisons n’étaient plus ce qu’elles avaient été. Couchés vers cinq heures, les plus matinaux soulevèrent une paupière vers midi. Manuel, le plus téméraire, osa même tirer le rideau, laissant entrer la lumière du jour. Il n’en eut pas du regret : il dut faire face à une onde de grognements et d’insultes si intense qu’il se sentit obligé de refermer aussitôt.
Mais Jean-Baptiste s’était levé, lui aussi. Nous nous retrouvâmes tous les trois dans la kitchenette, à faire chauffer du café en chuchotant. On avait mal au crâne et une seule envie : retourner roupiller. Mais j’insistai. Il fallait sortir, se dégourdir les jambes, respirer le bon air des montagnes. À défaut de neige, nous avions la chance d’avoir du soleil, ce serait dommage de ne pas au moins profiter de ça, non ?
Banco ! Nous chaussâmes nos godillots et nous nous élançâmes sur les sentiers des Trois-Vallées, eux derrière et moi devant. Je n’étais pas mécontente, je peux l’avouer ici, d’être accompagnée par deux beaux mecs, quoique d’un genre différent, l’un et l’autre. Au fur et à mesure que nous prenions de l’altitude, nous rencontrions de plus en plus de plaques de neige agglomérée survivant encore à ce début d’hiver qui semblait vouloir s’achever avant même d’avoir commencé. Chaque fois, je m’arrêtais longuement devant ces masses blanchâtres restées à l’ombre. Elles ruisselaient doucement. Si la météo ne se décidait pas à changer, elles allaient finir par disparaître. Je m’accroupis et, à mains nues, je brassai cet or blanc qui avait perdu son éclat. Mes deux hommes m’observaient les bras croisés, ouvertement agacés par mon manège. Ils m’invectivaient chacun à leur tour : « Qu’est-ce que tu fabriques ? On n’est pas sortis pour te regarder masser la neige comme de la farine ! Tu crois que c’est comme ça que tu vas la faire tomber ? Avec des incantations ? Qu’est-ce que tu marmonnes entre tes dents, là ? On ne comprend rien. »
Ils s’adressaient à moi, mais ne se parlaient pas entre eux. Manuel et Jean-Baptiste, ce n’était pas exactement le grand amour. Ils se toléraient, ça s’arrêtait là. JB n’aimait pas qu’on lui disputât sa place de leader. Manuel en avait vu d’autres et ne se laissait pas dicter sa loi. Les deux mâles dominants du groupe se jaugeaient, s’observaient, mais ils évitaient le conflit frontal : l’un d’entre eux, au moins, n’y aurait pas survécu.
C’était moi qui avais présenté Manuel aux autres membres de la bande. Nous étions dans la même classe au cours préparatoire de l’école communale. Il était très brun, frisé, un peu plus grand que la moyenne, et arborait un joli pull rayé bleu, rouge et vert, surdimensionné, sans doute tricoté par maman ou mamie, à moins que ce ne fût la maman d’un autre et qu’elle eût eu le malheur de l’oublier sur un siège de métro. Les yeux chocolat de Manuel surplombaient ses pommettes bombées. Il lui manquait les quatre dents de devant ; j’en avais conclu aussitôt qu’il était très en avance pour son âge. Le parcours scolaire qui suivit cette première rencontre ne devait malheureusement pas confirmer ce diagnostic. Il était simplement, déjà, un peu en retard scolairement. Mais dans la cour de récré, il avait eu tôt fait de s’imposer comme le patron du lieu. De sa voix éraillée qui avait un timbre déjà viril, il organisait les parties de billes et n’hésitait pas à se battre dans le triple but de rétablir l’ordre, de réparer ce qu’il estimait être une injustice flagrante ou une tricherie éhontée et de rappeler que son autorité ne souffrait aucune contestation. Souvent, il terminait la récréation au coin, dans le préau ou dans le bureau du directeur. Cela ne le dissuadait en rien de recommencer. Les années passant, Manuel devint un vrai caïd. Et un vrai copain pour moi. Jusqu’à ce qu’il finît par décrocher vraiment et qu’on lui imposât le redoublement de la septième, nous étions inséparables. Déjà à l’époque, et ça n’a pas beaucoup changé depuis, je n’appréciais guère la compagnie des autres filles. Je me plaisais beaucoup plus au milieu de parties de foot, aux commandes de vaisseaux spatiaux chimériques ou au triple galop dans le Grand Canyon à la poursuite des Indiens, plutôt que devant les berceaux et dînettes imaginaires des petites filles. Souvent, j’étais le bras droit de Manuel. Je ne me serais jamais permis de lui disputer le siège suprême. Parfois, j’étais l’adversaire. Notre amitié survécut à la séparation d’une, puis de deux, puis de trois classes, et encore, à la puberté, à la divergence radicale de nos parcours quand Manuel quitta définitivement le collège tandis que je me hissais vers les études supérieures. Avant de se lancer dans la vie active et d’embrasser la splendide carrière d’ouvrier spécialisé qui s’ouvrait à lui, Manuel s’essaya à la castagne, la vraie, dans la rue, au trafic de shit, à quelques menus larcins, au vol de voitures. Deux mois de prison ferme et la paire de gifles que j’étais venue lui administrer à sa sortie le convainquirent de rentrer dans le rang. Il errait désormais d’intérims en intérims, livreur un jour, manutentionnaire un autre. Il avait tout de même gardé le sens du commerce et s’était trouvé être le partenaire idéal du groupe pour nos achats de marijuana, cannabis et autre beuh. À force de rencontres et de moments de partage conique, il avait fini par s’intégrer à la bande et par se joindre à nous pour nos virées en vacances. Les autres l’avaient d’abord vu d’un mauvais œil, mais ne rechignaient finalement pas à fréquenter une canaille. Les filles, surtout, appréciaient sa compagnie rugueuse, tandis que les garçons s’en méfiaient plus volontiers et, au fond, en avaient peur. Jean-Baptiste, quant à lui, tolérait la présence de Manuel au sein de l’attelage tant qu’il ne manifestait pas l’envie d’en tenir les rênes.
Nous continuions d’avancer. Au-dessus de deux mille mètres d’altitude, la végétation se faisait plus rare. Sapins et mélèzes avaient cédé la place à une vague pelouse alpine rocailleuse. Ici ou là, on croisait même quelques edelweiss qui avaient oublié de faner. Mes acolytes me suivaient avec peine, mais ils seraient morts sur place plutôt que de reconnaître qu’ils étaient plus fatigués que moi. Je m’arrêtai à la prochaine tache blanche et je recommençai. Je brassai.
— Bon, dis, Sylvie, tu vas continuer ce cirque encore longtemps ?
C’est Jean-Baptiste qui avait craqué le premier. Il avait soif et envie de vomir à cause des excès de la veille. Mais il n’avouait pas. Il protestait. Manuel approuvait, en opinant du chef, les récriminations de Jean-Baptiste. Je leur devais une explication. J’allais leur confier mon secret. J’en brûlais d’envie, de toute manière.
— O. K., les garçons, comme vous ne pensez jamais à rien, je suis obligée d’avoir une tête pour trois. Et je suis la seule, bien sûr, à avoir pris une gourde d’eau dans mon sac à dos. Asseyons-nous. Je vais vous en faire profiter et, comme ça, je vais vous expliquer en quoi consiste mon « cirque », comme tu dis, Jean-Baptiste. Et ça n’a rien à voir avec Bouglione, tu peux me croire. Pourtant, il va y avoir du spectacle. La neige, matériau composite formé de glace, d’air, et parfois d’eau sous forme liquide quand la température est supérieure à zéro, est une merveille de la nature. Le Créateur a voulu que cet agrégat de cristaux de glace, composé de flocons si variés, étoiles, aiguilles, plaquettes, colonnes, tous dotés de cette merveilleuse symétrie hexagonale, ce matériau aux étonnantes propriétés protéiformes, souffre par ailleurs d’un inconvénient majeur : il fond. Oui, la neige fond quand la température est au-dessus de zéro. Elle peut même se sublimer directement sous forme de vapeur d’eau sans passer par l’état liquide pour peu que le rayonnement solaire soit assez puissant. Pour exploiter cet or blanc qui nous fait tant défaut cet hiver, nous avons besoin chaque année de nouvelles précipitations et d’assez de froid.
— Sylvie, j’étais peut-être pas un champion à l’école, mais là, tu as l’air de me prendre pour un débile mental, tu abuses. Je sais que la neige fond quand il ne gèle pas ! Où tu veux en venir ? m’interrompit Manuel.