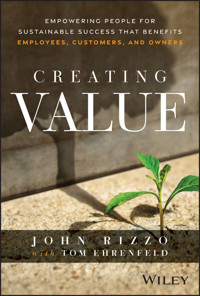Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Avenir à reconsidérer pour le système éducatif en Wallonie et à Bruxelles ?
Depuis plusieurs années, les classements internationaux placent l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles en piètre posture malgré l’argent investi et une somme de bonnes volontés. La faute à qui ? Aux politiques ? Aux profs ? À l’administration ? Aux parents ? Aux élèves ? À la crise ?
Après avoir consacré de nombreuses années de sa vie à l’enseignement de l’informatique, John Rizzo a décidé de dédier l’essentiel de son temps à l’étude des arcanes du système scolaire belge. Au fil de ses recherches, il a rencontré les acteurs clés de notre système éducatif, formé des demandeurs d’emploi et a fini au cœur des classes, comme instituteur au service d’une panoplie d’écoles wallonnes et bruxelloises en tous genres. En se demandant comment redonner aux futurs adultes un avenir réjouissant, ses lectures, ses rencontres et son expérience lui ont permis de dégager quelques pistes de compréhension.
Ce livre raconte son parcours à la recherche de réponses. Le déclin de l’école est-il inéluctable ? Doit-elle être réformée ? Faut-il repartir de zéro et bâtir un système adapté aux besoins modernes et aux nouveaux modes de communication ? En somme, faut-il sauver l’école ?
John Rizzo, à l'aide d'interrogations raisonnées et de preuves à l'appui, propose ici de reconsidérer l'avenir de l'école en Wallonie et en région bruxelloise.
EXTRAIT
1978-2010 Mixité naturelle
J’ai 6 ans. Malgré les paiements pour le moins erratiques de pension alimentaire par mon père, nous nous en sortons bien. Nous avons même une voiture en état de marche. Cela dit, c’est à pied que je me rends tous les jours à l’école n° 3 de Forest. Un midi, je sors avec mon copain Youcef, en direction de l’appartement familial. Et nous disparaissons. On nous retrouve soudain à 13 h 30…
— John, où étais-tu passé ?! Ta maman te cherche partout !
La gardienne de l’école vient de nous remettre la main dessus. À cette époque, on ne craint pas vraiment les enlèvements d’enfants, mais tout de même. De l’école à chez moi, il n’y a que cinq minutes de marche. En chemin, Youcef et moi avions été attirés par les poubelles remplies de billes d’une entreprise. Nous avions découvert un gisement de billes en aluminium. À force de fouiller les sacs, nous n’avions pas vu passer le temps.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
- « John Rizzo a exercé en intérim le métier d’instituteur dans des écoles wallonnes et bruxelloises. Il va y constater que les méthodes pédagogiques et le système même ont de grosses failles, voire sont carrément inefficaces. Il témoigne de ses expériences et présente ses pistes de solutions dans son livre
Sauver l’école ?. »
(La Libre)
- « Ancien chef d’entreprise, John Rizzo ne pensait pas devenir un jour instituteur. Sa société revendue à un groupe américain, il devient formateur auprès de demandeurs d’emploi. Une reconversion qui l’a conduit à s’interroger en profondeur sur l’efficacité de notre système scolaire et sur les diverses pistes pour le rendre plus performant. Paru aux éditions Ker, son livre
Sauver l’école ? est le fruit de cette réflexion. »
(Le Soir)
A PROPOS DE L'AUTEUR
John Rizzo a fondé, puis dirigé pendant une douzaine d’années une start-up revendue en 2011 à une grande entreprise américaine. Depuis lors, il se consacre à plein-temps à l’étude des dynamiques qui sous-tendent l’enseignement en Belgique.
Pour en découvrir plus sur son projet, rendez-vous ici :
http://johnrizzo.be/
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’est impossible, dit la FiertéC’est risqué, dit l’ExpérienceC’est sans issue, dit la RaisonEssayons, murmure le Cœur
Anonyme
La tradition veut que l’on dédicace un livre à ceux qui ont aidé à le réaliser.
Mes meilleurs alliés dans ce voyage sont les profs courageux, les pédagogues d’exception, les éducateurs empathiques, les bénévoles dévoués et les directeurs inspirants qui en ont marre de la médiocrité. Contre vents et marées, chacun sur leur navire, ils espèrent trouver un meilleur port.
Puisse ce récit leur donner quelques idées et une pincée d’espoir.
PARTIE 1 : L’HISTOIRE
Introduction
Comment se passe le recrutement, Christine ?
— Sur une cinquantaine de CV, j’en ai retenu quinze.
— Tu les as déjà appelés ?
— Oui. Il y en a quatre qui me semblent vraiment intéressants. J’essaie de les placer dans ton planning de la semaine prochaine. Tout se passe bien.
Non, tout ne se passe pas bien. Disons plutôt que tout se déroule comme d’habitude. Cinquante CV, quinze présélectionnés sur papier, quatre interviews. Les chiffres varient selon les périodes, les fonctions et les secteurs, mais je suis certain que tous les patrons se retrouvent dans ces chiffres. Ils sont mauvais. Alors que ma région étouffe sous le chômage, pourquoi mon office manager juge-t-elle que quarante-six candidats sur cinquante — soit 92 % — ne valent même pas la peine que je les rencontre ?
Sont-ils mauvais ? Dans le jargon des ressources humaines, on leur dira que « votre profil ne convient pas tout à fait à la fonction, on vous écrira si une autre fonction se libère ». C’est ça…
Ces quarante-six candidats immédiatement évincés sont probablement en colère. Voire, pire, résignés. Ce n’est certainement pas la première fois « qu’on leur écrira ». Ils ne se doutent pas que je suis aussi déçu qu’eux. Qu’est-ce qui a pu se passer depuis leur naissance pour qu’aujourd’hui, je les traite ainsi ?
Pâtes au menu et plus personne au rebut : l’école de la réussite est en marche. La société et le marché de l’emploi sélectionneront ensuite ces jeunes, et de façon impitoyable. [...] En avant, camarades, c’est la chute finale !
Frank Andriat, professeur de françaisLes Profs au feu et l’école au milieu
J’ai voulu comprendre. Tenter une enquête au sein de notre système scolaire pour en déceler les failles, détecter le ou les endroits où, concrètement, le bât blesse. C’est une aventure qui m’a amené à quitter mon entreprise et à intégrer moi-même une salle de classe. Une aventure humaine qui se poursuit aujourd’hui, au quotidien. Avec toujours en tête ces mêmes questions : notre système scolaire est-il efficace ? Et dans le cas contraire, que peut-on y faire ? Et enfin, à quoi pourrait bien ressembler notre système scolaire dans trente ans ?
Chapitre 1 : Le berceau
1978-2010
Mixité naturelle
J’ai 6 ans. Malgré les paiements pour le moins erratiques de pension alimentaire par mon père, nous nous en sortons bien. Nous avons même une voiture en état de marche. Cela dit, c’est à pied que je me rends tous les jours à l’école n° 3 de Forest. Un midi, je sors avec mon copain Youcef, en direction de l’appartement familial. Et nous disparaissons. On nous retrouve soudain à 13 h 30…
— John, où étais-tu passé ?! Ta maman te cherche partout !
La gardienne de l’école vient de nous remettre la main dessus. À cette époque, on ne craint pas vraiment les enlèvements d’enfants, mais tout de même. De l’école à chez moi, il n’y a que cinq minutes de marche. En chemin, Youcef et moi avions été attirés par les poubelles remplies de billes d’une entreprise. Nous avions découvert un gisement de billes en aluminium. À force de fouiller les sacs, nous n’avions pas vu passer le temps.
L’école que je fréquentais accueillait des étrangers dans une proportion d’environ 20 %, selon mes souvenirs. Cela semblait naturel. C’étaient des camarades ordinaires. Sauf Youcef, que j’aidais lorsqu’il s’agissait de planquer les tranches de rôti de porc dans nos poches, à la cantine. Lui, c’était mon pote !
Ils viennent souvent de Roumanie, Pologne ou Slovénie. Leurs facultés d’adaptation et d’apprentissage du français sont exceptionnelles. Contrairement à leurs parents…
Odile Bourgeois, directrice de l’école fondamentale n° 3 de ForestÀ l’école sans connaître la langue,Le Soir, 20 mars 2013
Un jour, en classe, la maîtresse nous donne un tas de réglettes Cuisenaire en bois, multicolores :
— Tenez, les enfants, soyez créatifs. Faites-moi une jolie construction !
J’étais content. J’avais tort. Vous comprendrez bientôt pourquoi…
L’autodidacte
— Je veux un Atari 800XL !
J’ai 12 ans, bientôt la fin des examens de décembre. Cumulées aux oboles de saint Nicolas et du père Noël, mes économies me permettront bientôt d’acheter mon premier ordinateur à la Maxitec du GB1 de Waterloo. En superpromo à 10 000 francs belges — une somme folle pour l’époque et le gamin que je suis —, l’ordinateur engloutira jusqu’à mon dernier sou. Le grand jour venu, hors de question d’y ajouter une cartouche de jeu, affichée à 3 000 francs. Ce n’est pas grave, je sais qu’un langage de programmation est inclus dans la machine et même si tout cela est encore un peu mystérieux pour moi, j’ai les vacances de Noël pour apprendre. Le mode d’emploi ne comporte que cinq ou six pages en français. C’est frustrant, mais quelle joie lorsque j’arrive à un premier résultat !
Quelques jours plus tard, l’affaire est entendue : je serai informaticien. Les années suivantes voient s’enchaîner les jobs étudiants destinés à financer les ordinateurs et autres périphériques plus coûteux les uns que les autres.
Seuls les bons professeurs forment les bons autodidactes.
Jean-François Revel, philosopheLe Voleur dans la maison vide, Mémoires
Le moniteur
J’ai 16 ans, j’entre dans le local polyvalent de la mutualité qui m’a engagé. Des parents sont déjà là. Avec une certaine timidité, j’annonce aux personnes présentes :
— Bonjour, je suis le moniteur d’informatique.
C’est la première fois qu’on me confie tout un groupe, d’enfants qui plus est. Je suis loin de comprendre les responsabilités que cela implique. Fort de mon apprentissage autodidacte sur mon Atari 800XL, j’enseigne ce que j’ai découvert au cours des quatre dernières années : la programmation.
Il est clair qu’aujourd’hui, confronté au même genre de mission, je m’y prendrais tout à fait autrement. En trente ans, des méthodes d’apprentissage ludiques de la programmation ont fait leur apparition, si bien qu’un formateur de 1988 serait totalement déboussolé dans une classe d’aujourd’hui. Et pas tant à cause de l’évolution de la technologie que des progrès pédagogiques. Je me demande si le professeur de français de ma jeunesse serait perdu, lui aussi…
L’école est perçue par les jeunes comme datant du XXe siècle. Si on réveille Hibernatus2, qu’on le mette dans une école pour ne pas le choquer.
André Delacharlerie, expert en systèmes d’informationConférence Innov@MIC, 18 juin 2012
L’administration des écoles
À la rentrée suivante, j’entre en dernière année de secondaire et je fais la connaissance de mon nouveau professeur de mathématiques. C’est une rencontre décisive. Comme moi, il est mordu d’informatique. Il consacre l’essentiel de son temps libre au développement d’un logiciel de gestion des bulletins et des absences scolaires qui connaît un certain succès dans les écoles de la région. Nos discussions sont agitées, intenses, et se prolongent systématiquement. En apparence, ce sont des débats d’informaticien : nous parlons d’algorithmes et d’optimisation. Mais en réalité, nous disséquons le fonctionnement du système scolaire.
C’est un projet qui se révélera particulièrement important dans ma formation et qui prendra de l’ampleur, nous le verrons dans quelques pages.
Enseignants impliqués
En sortant de l’école, je me suis assez logiquement inscrit à l’université, en informatique. Lors de ma licence (on dirait master aujourd’hui), mes camarades du cercle étudiant ont eu deux bonnes idées : mettre sur pied un spectacle de miss t-shirt mouillé et organiser un concours de programmation pour les élèves de l’enseignement secondaire. Plus attiré par ce dernier, je m’y investis à fond. Je suis séduit par cette formule d’apprentissage qui place l’objectif en priorité et laisse toute liberté sur la manière de l’atteindre plutôt que d’imposer aux élèves de « rester assis et d’écouter ». J’apprends à dénicher des sponsors, à réaliser des affiches et même à passer — maladroitement — à la radio. Mais surtout, je fais la connaissance d’enseignants passionnés qui ont consacré de nombreuses heures hors du cadre horaire à aider et à encourager leurs élèves dans cet univers encore méconnu. De nombreux adolescents se sont ainsi perfectionnés en programmation grâce à ce concours. Et parmi ces brillants élèves, il y a Nicolas B., qui deviendra mon associé quelques années plus tard.
Maîtrise de carrière
Mon diplôme en poche, j’ai été engagé par IBM. J’étais particulièrement fier, à l’époque, d’être embauché par le géant du secteur. C’est tout à fait comparable au statut actuel d’Apple — qui était alors moribond — ou de Google, qui n’existait pas encore. Embauché, donc, mais pour quoi faire ?
Lorsque l’équipe informatique d’une entreprise ne trouve pas de solution à un problème, elle appelle le centre de support. Chez IBM, ce centre couvre les deux lignes de machines qui ont fait sa gloire et sa fortune : l’AS/400 et le Mainframe. Mon premier jour commence par ces phrases :
Chef AS/400 : On va le mettre où ? AS/400 ou Mainframe ?
Chef Mainframe : Aucune idée. Il ne connaît ni l’un ni l’autre.
John : Si je puis me permettre, je préférerais…
Chef AS/400 : Cela ne dépend pas de vous, désolé.
À 22 ans, j’avais beau avoir déjà dix ans d’expérience informatique derrière moi, on me poussait d’un coup dans la grande profondeur avant de m’avoir appris à nager. Ce n’est que grâce à mes collègues que j’ai, laborieusement, compris les détails de l’AS/400 et pu me rendre utile aux clients qui nous appelaient. Pendant deux ans, j’ai également appris le néerlandais, sans pour autant m’éclairer sur les blagues racontées en limbourgeois à la machine à café et auxquelles je ne comprends toujours rien. Par ailleurs, d’un point de vue pédagogique, j’ai appris à aider des clients techniquement plus expérimentés et plus compétents que moi. Bilan : il ne faut pas forcément être un puits de science pour aider quelqu’un à progresser. J’en reparlerai plus tard. Au terme de cette période, une envie : prendre ma carrière en main.
— Chef, j’ai discuté avec le responsable des formations AS/400 à notre centre de La Hulpe.
— Mmmmouais ?
— Cela me motiverait beaucoup d’y donner cours. Je ferai en sorte que cela ne perturbe pas trop mon travail au centre de support.
J’ai de la chance : mon responsable se laisse convaincre et quelques mois plus tard, je suis Lead Instructor à temps plein du centre international de La Hulpe pour l’AS/400. C’est le job de mes rêves. Mes étudiants sont les informaticiens de nos clients. IBM a offert une formation à certains d’entre eux lorsque leur entreprise a acheté une nouvelle machine, d’autres profitent des jours de formation auxquels ils ont droit chaque année, au même titre que leur voiture de fonction et leur téléphone portable.
Deviens ce que tu es.
Friedrich Nietzsche, philosopheAinsi parlait Zarathoustra
Première start-up : les écoles
Dans l’intervalle, je suis resté en contact étroit avec mon ancien professeur de mathématiques. Et c’est le moment que je choisis pour investir à la fois du temps et des moyens dans la conception d’un logiciel de gestion intégrée des absences, des bulletins, des inscriptions et des horaires à destination des écoles. J’engage des étudiants en informatique pour m’aider pendant les vacances. Tout ce que je gagne chez IBM y passe. En quête de clients, je prospecte les écoles, je discute avec de nombreux éducateurs, secrétaires et horairistes. Derrière des apparences rébarbatives et procédurières, le problème est aussi complexe que fascinant.
Dans une école, tout est lié. Inutile d’élaborer les horaires de cours tant qu’on ne sait pas quel élève sera inscrit dans quelle option. De même, pour réaliser des prédictions correctes, il faudrait idéalement disposer des bulletins en avril (afin d’établir les probabilités de redoublement) et des listes d’absence (décrochage). Pour ne rien arranger, l’élaboration des horaires dépend également des inscriptions, en temps réel.
Après en avoir usé les bancs, c’est donc sous l’angle administratif que j’ai abordé l’école. J’étais à mille lieues d’envisager une implication différente dans ce milieu. J’allais découvrir, plusieurs années plus tard, que l’ensemble des procédures qui régissent une école est bien plus lié à la pédagogie que je ne le pensais à ce moment-là.
Cependant, à l’époque, la réalité économique étouffe le projet dans l’œuf. Rassembler l’ensemble des données nécessaires impliquait d’installer un réseau et un serveur dans chaque établissement, ce qui entraînait, outre un budget considérable, une complexité technique difficilement abordable par une école. Il fallait donc prévoir un informaticien, ce qui n’était pas justifiable financièrement pour l’immense majorité. Au mieux, on proposait un enseignant volontaire, qui bidouillait ce qu’il pouvait.
Le projet, pour être honnête, était irréaliste. Il nous manquait tout simplement Internet pour installer un tel logiciel dans un réseau d’écoles. Une plateforme moderne, qui n’aurait pas nécessité l’installation de techniques onéreuses. À l’époque, toutefois, je ne voulais pas l’admettre. Ce seront des professeurs de Solvay qui, à l’occasion de mes cours du soir en gestion d’entreprise, me convaincront de jeter le gant en 1998. Première entreprise, premier échec.
Deuxième start-up : les banques
Loin d’être découragé, à 26 ans, je quitte IBM et fonde ma deuxième entreprise. Mon échec avec les écoles et leur manque récurrent de budget m’ont convaincu de travailler là où se trouve l’argent : les banques, les compagnies d’assurances, l’industrie, etc.
J’ai désormais un associé, Nicolas B., un des élèves rencontrés dans le cadre du concours de programmation que j’avais jadis organisé. En 1999, nous développons une société qui, à son climax, emploiera une vingtaine de personnes. Dans un premier temps, nous y proposons des formations de perfectionnement en informatique et vivons toutes les étapes d’une PME lancée à pleins gaz : les recrutements, les licenciements, les contrats gagnés, les coups bas des concurrents, les business angels (investisseurs), la peur de ne pas pouvoir payer les salaires en fin de mois, les conférences à Las Vegas, les conseils d’administration houleux, les barbecues improvisés et les grands projets…
En 2004, nous amorçons une mutation fondamentale. De société de services, nous devenons une société de produit. Autrement dit, nous cessons de vendre des formations mais nous développons un site Internet destiné à enseigner la programmation de manière autonome. Ce changement permet déjà de comprendre l’approche que j’adopterai dix ans plus tard comme instituteur. En réalité, toute l’idée a germé au retour d’un voyage professionnel à San Francisco. J’en parle à mon associé :
— Penses-tu que nous vendons des cours de qualité ?
— Ben… oui, les clients qui assistent à nos cours sont contents !
— Mais quelle part de ce qu’on raconte retiennent-ils ?
— Ça, c’est autre chose. Si tu veux dire qu’après être venus s’asseoir trois jours devant un prof, ils ne se souviennent pas du quart six semaines plus tard…
— Et si on leur vendait un résultat ?
— Une garantie que leurs employés auraient appris quelque chose ?!
— On leur vend la réussite d’un examen.
— Et si l’employé n’en fiche pas une, on rembourse ?
— Tu crois qu’il oserait ne rien faire ? Imagine la scène : « Chef, j’ai encore raté l’examen du centre de formation que dix collègues ont réussi le mois dernier. Pourtant, j’ai beaucoup étudié, je vous le promets. C’est juste que je suis débile… Vous me gardez ? »
— Dit comme ça…
Les années suivantes, nous consacrons une large part de notre énergie à développer JavaBlackBelt.com, une plateforme d’examens en ligne. Une fois le site lancé, jusqu’à 100 000 utilisateurs viendront gratuitement y créer et passer des examens pour programmeurs Java.
Le développement de ce site est le fruit d’un parti pris pédagogique : l’objectif devient la priorité. Le client se retrouve confronté à une série d’examens qu’il doit réussir. À lui de déterminer ce qui lui convient le mieux pour y arriver. Un cours classique ? Un livre et trois jours d’étude en solitaire à la maison ? Des discussions régulières avec un collègue ? Nous l’aidons volontiers, mais la décision lui appartient. Il devient responsable, il devient l’acteur principal de sa formation.
Comme instituteur, confronté aux progrès décevants de mes élèves, j’appliquerai la même méthode : les objectifs avant tout et rendre aux enfants la responsabilité de les atteindre.
1 Département multimédia du « Carrefour » de l’époque.
2 Personnage réveillé après 65 ans de congélation, dans un film avec Louis de Funès.
Août-novembre 2010
Le blues
JavaBlackBelt.com fut un succès de foule quasi immédiat. Mais avec le temps, il s’essouffle commercialement et la crise n’arrange rien. Afin de donner un nouveau souffle au projet, nous souhaitons établir un partenariat avec une équipe de vendeurs en contact avec les Chief Learning Officers des principales sociétés mondiales. En somme, nous cherchons à conquérir de nouveaux marchés, mais ce genre de partenaire miracle ne court pas les rues.
Un peu découragé, je décide de prendre deux semaines de farniente avec mon épouse et mes trois enfants. Je déconnecte totalement du travail et, histoire de m’occuper en vacances, j’imprime sur un coup de tête une série d’analyses de la situation politique belge de l’époque. En rentrant de vacances, je suis incollable sur les pensions, les Flamands et les malades. Parmi les documents parcourus, il y a le rapport rédigé par McKinsey en 2007 à propos des meilleurs systèmes d’enseignement. Je m’éclate. En combinant ce que j’y découvre avec ce que je connais de l’enseignement pour adultes, je griffonne ma description de l’école idéale. Jusqu’à présent, toute ma carrière a été focalisée sur l’acquisition de la connaissance. Ne pourrais-je pas mettre à profit ce que j’ai développé avec les adultes pour les enfants ? Enthousiaste, je reprends contact avec Guy, un ami préfet auquel j’avais proposé mon logiciel de gestion quelques années plus tôt.
Ouvrir une école ?
Nous nous revoyons dans un restaurant situé à quelques encablures des bâtiments de l’administration de l’Enseignement où Guy officie désormais comme inspecteur. Les questions se bousculent dans ma tête. Je me rends compte qu’outre les aspects purement administratifs, que je maîtrise, la réalité de notre système scolaire m’échappe. Mes idées sont du domaine de la théorie, voire de l’utopie. Pourtant, Guy semble intéressé par mon école idéale. À tel point qu’il me propose un nouveau lunch avec un de ses amis. Il s’agit d’Alain, un homme influent dans le milieu scolaire à Bruxelles. Et lui non plus ne trouve pas mes idées totalement idiotes.
— Tu n’envisages pas de fonder une école où tu mettrais tout cela en pratique ?
— Ce serait intéressant, mais cela me demanderait un investissement total.
— En effet.
— Une grosse école diplôme une centaine d’élèves par an. En ouvrant une école, j’aide au mieux mille personnes en dix ans.
— C’est déjà pas mal, non ?
— Non. Je suis un informaticien. Là où tu vois des gens, je vois des systèmes, des causes et des effets. Je me demande si avec la même énergie et les mêmes idées, je ne pourrais pas aider infiniment plus de monde.
À l’heure de rédiger ces lignes, je ne suis toujours pas convaincu d’avoir eu raison. Je me dis encore souvent que ma contribution maximale au système scolaire se limitera peut-être à aider une seule école.
Fais ta valise !
Quelques semaines après ces deux rendez-vous passionnants, je reçois un coup de téléphone d’un de mes deux associés, Nicolas M. :
— John, fais ta valise, j’ai deux tickets pour New Delhi. De là, on continuera vers Rochester pour rencontrer Paul, le CEO (PDG) d’Element K. On sera rentrés avant Noël.
L’idée de Nicolas est de passer d’abord en Inde pour rencontrer des clients potentiels de JavaBlackBelt.com. Sur place, j’apprends que 70 000 nouveaux développeurs Java sont formés chaque année dans le pays. Les chiffres donnent le vertige. Là-bas, lorsqu’une société engage un programmeur fraîchement sorti de l’université, elle finance d’abord six mois de formation afin de le perfectionner dans un langage. Le système éducatif des adultes en Inde est aux antipodes du nôtre. Là où nous espérons former des gens en une petite semaine, à dix personnes dans une même salle, ils sont là-bas plusieurs centaines, éparpillés sur de nombreux sites à travers le pays, à étudier pendant des mois.
Après l’Inde, nous rejoignons le CEO d’Element K, une société d’e-learning qui emploie 500 personnes, à Rochester, dans l’État de New York. À l’américaine, il y va franco : il souhaite racheter à la fois notre savoir-faire et notre site. L’ambiance a de quoi intimider : lorsque nous pénétrons dans la salle de réunion, les yeux de l’état-major de la société se tournent vers nous. Une dizaine de CxO, vice-présidents et autres directeurs nous accueillent. Plus tard, nous apprendrons qu’une réunion au sommet d’une telle durée n’avait plus eu lieu depuis des années. Paul nous donne une journée pour les convaincre de la valeur de notre entreprise. Un peu impressionné, j’entame ma présentation.
— Notre site permet la construction collaborative de cours et d’examens.
Element K crée des tonnes de cours sous forme de livres et de sites Web truffés de mini-jeux et de vidéos. L’élaboration de chaque cours nécessite un nombre astronomique de jours-hommes et des fortunes dépensées en prestations d’auteurs-experts. Leur intérêt pour notre entreprise n’a rien d’étonnant : chez nous, c’est une communauté bénévole qui rédige les cours ! Et c’est d’autant plus intéressant pour des cours concernant des technologies en évolution perpétuelle. Wikipedia a inventé la machine à créer des encyclopédies. Avons-nous, mon associé et moi, inventé la machine à créer des cours et des examens ? Verrons-nous un jour ce modèle dans nos écoles : d’un clic, l’élève propose une amélioration au manuel scolaire qu’il utilise ? Ou pire : quelques élèves et leur enseignant proposent un nouveau chapitre… Ou bien, hérésie totale : des parents contribuent à la rédaction du CEB3 !
C’est signé !
Il faut croire que je me suis montré convaincant : Element K ne tarde guère à racheter JavaBlackBelt.com. Son idée est de nous faire grandir et d’acquérir de nouvelles parts de marché. Ils nous voient un peu comme leur nouvelle arme secrète. Le contrat de rachat m’oblige à collaborer encore trois ans avec eux. J’aime beaucoup Element K, son énergie, son esprit, ses valeurs.
Parmi mes activités, je dois marier ma manière de rédiger un cours avec la leur. Alors que ma méthode est artisanale, agile, et rassemble de nombreux contributeurs via Internet, la leur tient de la lourde chaîne de production partiellement délocalisée à Chennai, en Inde.
Malgré la cadence, cette expérience reste l’une des plus belles de ma vie professionnelle.
3 Certificat d’Études de Base : examen organisé en fin d’enseignement primaire par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Octobre 2011
Paul has been fired4
Les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons.
attribué à Lénine
Six mois plus tard, un vilain jour d’octobre, je reçois un mail intitulé « You better know what happens down here… ». C’est la lettre de démission du grand patron, Paul.
Je le vois encore au Dinosaur Bar-B-Que de Rochester me raconter comment, ces quinze dernières années, il a fait grandir cette société qui est rentable, où il fait bon vivre et où des gens compétents peuvent se féliciter d’être restés fidèles au poste depuis dix ans. En ce mois d’octobre, tout bascule. Leur concurrent vient de les acheter et débarque dans les bureaux. Les occupants sont assoiffés de sang. Les jours suivants, l’acquéreur s’occupe prioritairement des employés, qui attendent fiévreusement d’être fixés sur leur sort. De mon côté, je ne suis officiellement qu’un sous-traitant. Ils décideront plus tard du sort à réserver à mon projet. Il s’agit certainement du cadet de leurs soucis, d’autant qu’un de nos objectifs était de leur grignoter des parts de marché. Avec ce rachat, ils maîtrisent 98 % du marché, autant dire que je suis devenu moins que négligeable à leurs yeux.
Confiance
Sans grande surprise, l’acquéreur hostile d’Element K abandonne mon projet et me libère de mes obligations. J’ai beau m’y attendre, c’est un choc. Le dernier lien avec mon bébé est rompu. Alors qu’instinctivement, j’ai déjà l’intuition de ce que je souhaite accomplir dans l’immédiat, mon épouse ne dissimule pas son inquiétude :
— Que vas-tu faire, maintenant ?
— J’aimerais prendre deux ou trois mois pour étudier notre système scolaire.
— Et que feras-tu du résultat de tes recherches ?
— Je n’en sais rien. Je sens que je dois le faire, c’est tout.
Être entrepreneur, c’est souvent se jeter à l’eau sans savoir où ni comment nager. Bien entendu, mon épouse aurait préféré me savoir tranquillement installé dans un rôle de consultant, mais elle décide de me soutenir dans mon projet. Je lui annonce que je change de métier pour raser gratis et elle ne tente pas de me dissuader. Elle sourit et m’embrasse.
Qu’ai-je fait pour mériter une telle confiance ? Il faudra qu’elle me le rappelle si un de nos enfants nous annonce un jour qu’il arrête ses études pour partir sauver une espèce rare de dindon en Corée du Nord. En attendant ce jour funeste, je prends donc la décision de consacrer mon temps à comprendre le monde de l’enseignement en Belgique. Et, je l’espère, à l’aider un peu. Où et comment ? Aucune idée.
4 Paul a été viré.
Chapitre 2 : L’effort des chômeurs
Comment le chômage est-il réparti chez nous ? Est-il lié au niveau de qualification de nos jeunes ? Faut-il encore organiser des examens d’entrée ? Et pour quelles études ? Quel est le rôle de l’enseignant dans une classe ? Quelle est l’importance du sens de l’effort ? Ces questions, en apparence disparates, reflètent une réflexion globale autour d’un phénomène aussi complexe que fondamental. Éléments de réponse.
Lectures
Nouvel an 2012. Pour moi, c’est le grand jour. Je suis seul à la maison, au calme, libéré de mes obligations indiennes et américaines. J’ai envie de foncer, de descendre sur le terrain, dans les écoles. C’est prématuré, mais je suis impatient. Prématuré, car agir de la sorte reviendrait à me plonger dans une réalité complexe sans grille d’analyse, sans en saisir les clés. Bref, sans profiter de l’expérience des experts qui ont étudié le système scolaire avant moi, dans les livres ou sur le terrain. Je décide donc de me plonger avant tout dans ces témoignages publiés depuis de nombreuses années par les nombreux spécialistes qui ont passé leur carrière au sein de notre système scolaire. J’ai de la chance : ils ont écrit des bibliothèques entières.
J’ai pris l’habitude, par mes études et mon travail, de digérer de grandes quantités de matière en peu de temps et, après avoir fait un rapide état de la question, j’estime qu’un mois de lecture à temps plein me suffira à faire le tour de la question. En plus des livres, je tente d’organiser aussi souvent que possible un lunch avec un acteur de l’enseignement à même de m’éclairer sur les questions que les livres ne suffisent pas à résoudre.
Le philanthrope
Jean est grand et mince. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café bruxellois. Cet octogénaire francophone de Flandre s’exprime avec autant d’énergie qu’un jeune humoriste. Très vite, notre conversation se centre sur le chômage. Afin de me faire comprendre son point de vue sur la question, il me raconte son histoire :
— Après la guerre, j’ai repris l’entreprise familiale avec ma mère. J’étais très jeune, mais nous avons réussi à la sauver.
— Et maintenant, tout va bien ?
— L’usine tourne bien, mais ce n’est pas facile. Ces dernières années, nous avons résisté aux délocalisations en nous spécialisant dans le lin haut de gamme. Mais nous sommes une exception : tout le secteur textile s’est évaporé en Flandre. À ce propos, sais-tu pourquoi notre pays est un champion de productivité par ouvrier ?
— Parce que les ouvriers belges travaillent plus vite et plus fort que ceux des autres pays ?
— Pas vraiment ! Lorsqu’une entreprise doit augmenter sa production, elle a parfois le choix entre engager un ouvrier ou acheter une machine pour faire le boulot. Chez nous, les coûts salariaux sont à ce point élevés que, la plupart du temps, on évite de recruter. Résultat : moins d’ouvriers par tonne produite, ce qui fait croire que l’ouvrier belge est un champion de la productivité.
— Résultat : le chômage explose…
— Penses-tu ! Dans le patelin où se situe mon usine, en Flandre occidentale, le taux de chômage des hommes est de 4 %. Impossible de trouver de la main-d’œuvre qualifiée. Pour remplacer les départs, nous faisons venir des étrangers. Rien que chez nous, il y a treize nationalités, du Cambodge au Kosovo. Ils sont compétents, ils apprennent le flamand en six mois, puis ils font venir leur famille. Nous avons toutes les raisons de les garder.
— Et vous n’avez pas pensé aux Wallons ?
— On a essayé. Surtout quand on a vu les taux de chômage : dans le Hainaut, le chômage des jeunes frôle les 20 %. Nous étions persuadés qu’à peine l’offre d’emploi publiée, ils se rueraient sur l’occasion. La Wallonie n’est qu’à trois quarts d’heure en voiture de chez nous. Cela n’a pas donné de bons résultats. Trop loin pour eux, nous a-t-on dit. Quand ils apprennent ça, nos ouvriers flamands enragent, ils finissent par voter N-VA.
— C’est pour cela que tu t’intéresses à l’enseignement ?
— Si on veut changer les mentalités, il faut commencer par les enfants. Après, j’ai peur que ce soit trop tard.
J’ai eu beau lire des dizaines d’études à ce sujet, apprendre de première main que certaines régions francophones concentrent 20 % de demandeurs d’emploi me semble effroyable. Autant je conçois que 5 % de la population active puisse avoir besoin d’aide suite à des accidents, des aléas inévitables, autant 20 % me semble totalement déraisonnable. Quel cataclysme a pu amener une telle masse de mes compatriotes à se retrouver sans emploi ? Qu’est-ce qui est arrivé à cette région jadis troisième puissance économique mondiale ? À ces questions fondamentales, certains trouvent des réponses immédiates, qui sonnent de manière simpliste à mes oreilles :
Je vais poser une question qui est taboue dans ce pays. Il y a en Belgique un demi-million de sans-emploi. À votre avis, combien d’entre eux cherchent réellement un travail ?5
Bart De Wever, homme politiqueWie goed CV heeft, vindt hoe dan ook werk, Het Laatste Nieuws, 19 mai 2014
Jean fait partie de ces patrons au sens noble du terme : pas un directeur voyou tentant de maximiser son bonus et celui de ses actionnaires à la veille de la débâcle. Il gère sur le long terme. Un entrepreneur sociétal avant l’heure, en quelque sorte.
Depuis notre première discussion, Jean m’a régulièrement présenté à des acteurs clés de différents domaines et introduit dans des milieux passionnants. Nous nous téléphonons une fois par semaine pour faire le point sur nos trouvailles et nos idées. Un vrai travail d’équipe qui m’aide à dépasser un peu la solitude du Don Quichotte utopiste que je suis.
Une sélection pas très naturelle
Un mois de lecture, avais-je prévu, et voilà quatre mois que je dévore. Je ne cerne toujours pas ce sujet qui ne cesse de se complexifier au fur et à mesure que je le découvre. C’est un peu comme la physique quantique ou la théorie de la relativité : dès qu’on pense l’avoir intégrée, on se rend compte qu’on n’a encore rien compris du tout. Alors que j’avais décidé de me focaliser sur l’enseignement, sur l’école, je me concentre à présent sur ce problème de taux de chômage, car j’ai l’intuition qu’il est intimement lié à l’enseignement.
Comme parfois dans la vie, le ciel me fait alors un signe sous la forme d’un coup de fil du Forem, pour qui mon entreprise avait déjà travaillé par le passé. On me propose d’animer une formation de six mois à temps plein pour demandeurs d’emploi. L’objectif : inculquer à une douzaine de chômeurs une connaissance opérationnelle de la programmation Java, ma spécialité. C’est une aubaine, l’occasion de comprendre leur parcours de l’intérieur, de voir si, comme je le subodore, c’est dans leur formation de base, dans leur enfance, que se situe l’origine de leur difficulté à s’intégrer sur le marché de l’emploi.
Je suis donc invité à me rendre dans un centre de compétence du Forem. Avant la formation à proprement parler, on m’a demandé de participer au jury de sélection, avec le directeur du centre de formation et une coordinatrice. Au moment de mettre en place une formation longue, le Forem rencontre chaque candidat pendant une vingtaine de minutes. Dans le cas qui nous occupe, à savoir une formation d’informatique de haut niveau, il y a déjà eu une présélection afin de ne retenir que les candidats qui ont au moins les bases de programmation nécessaires. Il nous reste vingt personnes à rencontrer pour douze places disponibles. Ce sont tous des volontaires, des gens motivés et personnellement, je préférerais les prendre tous, mais ce n’est pas possible, me dit-on. En deux jours, la sélection est bouclée. Et dans le cadre de mes recherches, les candidats non retenus ont bien des choses à m’apprendre :
— Donc, Monsieur, vous avez arrêté vos études en quatrième professionnelle à 18 ans. Votre dernier diplôme en date est le CEB (diplôme d’études primaires). Maintenant, vous en avez 29 et en onze ans, vous avez travaillé deux mois, c’est bien cela ?
— Ben oui, j’étais fainéant, je préférais glander. Mais maintenant que j’ai une femme et une fille d’un an et demi, c’est fini, je veux me reprendre en main.
— Qu’est-ce qui nous dit que vous n’allez pas abandonner la formation après deux mois ?
— Parce que cette fois-ci, je suis motivé, je vous jure.
Autre exemple :
— Vous avez un diplôme d’électricien qualifié, vous devriez trouver un emploi sans trop de difficulté.
— Oui, mais je n’ai plus envie de faire ça. J’ai envie de changer. Je veux faire de l’informatique. Je suis supermotivé par l’informatique maintenant.
— Pourquoi ne pas être venu plus tôt suivre une formation chez nous alors ?
— Je ne savais pas que vous existiez.
— Nous vous avons pourtant rencontré pour une autre sélection, il y a deux ans.
— Ah oui, j’avais oublié. Je ne savais pas que vous faisiez d’autres formations en fait.
Et en élevant un peu le niveau de diplôme :
— Depuis votre première année de graduat en informatique, il y a dix ans, vous n’avez jamais exercé dans ce domaine ?
— Non, en effet. J’ai fait des petits boulots dans la vente, puis du helpdesk.
— Et pourquoi voulez-vous refaire de l’informatique maintenant ?
— Parce que ça a toujours été ma passion.
— Avez-vous fait de l’informatique depuis dix ans, chez vous ? Vous reste-t-il des souvenirs techniques de vos études sur lesquels je pourrais vous interroger ?
— Sincèrement, non, je ne me souviens plus, c’est trop loin, et je n’en ai pas refait. Mais je vais m’y remettre, vous allez voir !
D’autres encore se racontent des histoires. Ils déclarent sereinement ne pas en faire assez et promettent sans rire que, quand ils s’y mettront, tout ira pour le mieux. Les rois des menteurs sont malheureux.
Roland Soyeurt, écrivainLe Chagrin des profs
Soyons clairs, je ne me moque pas. La plupart des candidats rencontrés ont l’air sincèrement malheureux de leur situation, à mille lieues du cynisme qu’on serait tenté de leur prêter en me lisant. En les voyant, en les écoutant, une question me taraude : comment en sont-ils arrivés là ? Question d’environnement familial ? D’éducation ? Pur manque de chance ? En tout cas, leur malheur me touche et je consacre les six mois suivants à leur enseigner ma spécialité avec cet espoir qu’ils deviennent, enfin, capables de trouver l’emploi dont ils rêvent.
PISA
Au fil de mes lectures, un mot revient, comme une ritournelle : PISA. Derrière cet acronyme se cache un test standardisé de lecture et de calcul administré aux jeunes de 15 ans. Considéré comme universel, il est aujourd’hui utilisé dans soixante-cinq pays. C’est ainsi que, chaque année, un baromètre des résultats PISA est publié, indiquant où chaque État se situe, sur une échelle de 0 à 1 000 points. En Belgique, petit raffinement : une ligne est consacrée aux résultats de la Fédération Wallonie-Bruxelles et une autre à ceux de la Communauté flamande. Au Sud, depuis plus de dix ans, nous nous maintenons environ à 480 points, c’est-à-dire légèrement en dessous de la moyenne mondiale, logiquement située à 500 points. Est-ce grave ? Y a-t-il un lien entre le score PISA et le taux de chômage ?
La conclusion est tentante : si les élèves sont en difficulté scolaire à 15 ans, il y a de fortes chances pour qu’ils traînent ces difficultés jusqu’au moment où ils se mettront en quête d’un emploi. Doit-on invariablement pousser ces jeunes vers les études supérieures ? Doit-on les encourager à décrocher le plus haut diplôme possible ? Et dans ce cas, pourquoi ne pas subsidier massivement les étudiants en difficulté et supprimer par la suite les examens d’entrée tels que ceux qui ouvrent — ou plutôt ferment — les portes des écoles d’ingénieur et des facultés de médecine ? De telles actions favorisant l’accès aux études supérieures auraient-elles une chance de diminuer le taux de chômage qui mine le Sud de la Belgique ?
La part des travailleurs hautement qualifiés a considérablement augmenté en Région bruxelloise sur les deux dernières décennies (+18,8 % entre 1989 et 2012) tandis que celle des travailleurs à faible qualification n’a eu de cesse de diminuer (-17,6 %).
Stéphane Thys (et al.), Observatoire bruxellois de l’emploiLe marché de l’emploi en Région Bruxelles-Capitale, état des lieux 2012
Formation filtrée
Première question : y a-t-il de l’emploi dans le domaine que je m’apprête à explorer avec mes étudiants ? Après quelques minutes de surf sur les principaux sites d’offres d’emploi, force est de constater que les jobs ne manquent pas. Dans le cas qui me préoccupe, la plupart des places vacantes se trouvent en Flandre et à Bruxelles. Les annonces sont claires : on exige systématiquement un bachelier en informatique. Pour trouver un emploi, mes candidats doivent donc être prêts à se déplacer assez loin, maîtriser le néerlandais ou l’anglais et être titulaires d’un diplôme universitaire. Être capable de programmer ne suffit pas, tant s’en faut.
Nous n’allons pas sélectionner des étudiants qui n’auraient aucune chance dès le départ de trouver un emploi sur ce marché très fermé et exigeant. Je ne peux pas seulement questionner leur aptitude à programmer. Mon premier souci est de savoir s’ils ont le permis de conduire et s’ils parlent le néerlandais. S’il leur manque un de ces deux atouts majeurs, ils doivent avoir des arguments massifs pour compenser, comme un diplôme universitaire ou une expérience préalable. S’ils sont unilingues et sans permis, cela n’a plus de sens de les intégrer à la formation.
Il n’y a pas si longtemps, j’étais plutôt favorable à la suppression des examens d’entrée aux études supérieures. C’était ma solution simpliste pour y pousser un maximum d’étudiants. On cite toujours l’exemple d’Einstein qui était un cancre à l’école. Appliquer des épreuves formatées pour décider qui a le droit d’étudier ou non me semblait le meilleur moyen de se priver d’esprits brillants. L’expérience m’a poussé à changer mon fusil d’épaule. Pire : aujourd’hui, je participe au filtrage des étudiants. Et je conseille à ceux qui ne sont pas sélectionnés de s’investir dans l’apprentissage du néerlandais ou, à défaut, de viser une formation moins ambitieuse.
Un midi, je discute de ce cas de conscience avec Jean Hindriks, un professeur d’économie publique et politique à l’université de Louvain.
— J’ai le sentiment que de manière générale, on tend à supprimer les examens d’entrée. J’ai encore entendu récemment qu’un ministre proposait d’abandonner la sélection à l’entrée pour les ingénieurs civils en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pourtant, la tendance est inverse dans le cadre des formations que je donne au Forem…
— Tu as raison pour les examens d’entrée. D’ailleurs, la Flandre l’a déjà fait en 2003. Le pays manque d’ingénieurs, et c’est la meilleure solution qu’ils ont trouvée pour susciter des vocations. L’objectif des universités, c’est de diplômer un maximum de jeunes. Au Forem, tu as un objectif très différent : tu veux qu’ils aient tous un emploi dans les six mois. Mais attention, la solution qu’ils ont adoptée dans les universités n’a rien d’une panacée : le taux d’échec est énorme. Sur dix étudiants à l’entrée, il y en a quatre qui réussissent leur première année. Je suppose que sur tes douze demandeurs d’emploi, tu vises un peu mieux que 40 % de mises à l’emploi… Depuis qu’elle a supprimé ses examens d’entrée, la Flandre n’a pas diplômé plus d’étudiants en polytech. Par contre, le nombre d’inscriptions a explosé, et le taux d’échec avec. Le résultat global, c’est que les coûts pour tout le monde ont explosé : pour les universités, qui doivent prévoir plus de professeurs, et pour les étudiants, qui sont plus nombreux à échouer et sont noyés dans la masse. Ce n’est certainement pas en supprimant les examens d’entrée qu’on fera baisser le taux de chômage.
La session de janvier, le baptême du feu des quelque 17 000 étudiants qui viennent d’entrer à l’université, est une catastrophe pour beaucoup d’entre eux. Seuls 10 % des étudiants réussissent avec au moins 10/20 dans chacun des cours.
Trop d’échecs en première année d’unif ? « De mauvaises méthodes de travail en sont souvent la cause. », Le Soir, 14 mars 2014
Sélection finnoise
Chaque année, les médias francophones se font un plaisir de citer la Finlande pour son excellent score PISA de 529 points (2012). On décortique depuis plus de dix ans les facteurs qui donneraient aux Scandinaves cette longueur d’avance impressionnante. Au hit-parade, on retrouve une formation identique commune jusqu’à 16 ans6, le non-usage du redoublement et la remédiation immédiate7.
Qu’on ne s’y trompe pas, nous ne sommes pas les seuls à nous pâmer devant les exploits du pays des Mille Lacs. La littérature internationale évoque régulièrement la Finlande dans ses conclusions et de nombreux pays ont envoyé force délégations sur place afin d’analyser les pratiques éducatives du cru. De manière générale, c’est la sélection drastique des enseignants qui ressort de toutes ces études. Sur cent candidats, seuls dix sont simplement admis à entamer les études nécessaires pour devenir prof. Que ce soit chez les aspirants médecins ou les aspirants profs, il semble bien que la sélection, les filtrages et les examens d’entrée soient généralement vecteurs de qualité.
Les meilleurs systèmes scolaires incitent les personnes les plus compétentes à devenir enseignant.
Sir Michael Barber (et al.), expert en systèmes éducationnelsLes Clés du succès des systèmes scolaires les plus performants
Walter le libraire
Parmi les étudiants qui ont eu la chance d’intégrer une des formations que j’ai animées pour le Forem, il y avait un ancien libraire, Walter, âgé d’une bonne trentaine d’années. Tombé en faillite après avoir vu sa rue fermée pour travaux pendant un an, il n’avait aucun bagage en programmation avant d’entamer sa formation. Il a été sélectionné suite à des résultats hors du commun aux tests de logique : là où les autres atteignaient péniblement la moyenne, il avait fait le maximum. Outre cela, l’homme dégage une aura de crédibilité telle que nous sommes persuadés qu’il a toutes ses chances de trouver un emploi après la formation.
Au troisième jour d’instruction, Walter manifeste des signes de découragement. Il ne comprend pas le cours, me dit-il, il lui manque les bases. Il ne le dit pas, mais il laisse entendre qu’il n’est pas à sa place dans cette formation. Pour moi, hors de question de le laisser tomber, j’ai du temps à lui consacrer. Comme ils sont deux à peiner, j’organise un cours particulier pour eux dans la salle d’à côté. Ensemble, nous voyons les bases. Je vais vite, je les fais tous deux travailler dur et je constate à leurs questions et à leur production qu’ils suivent.
Après le week-end, le directeur du centre vient me voir avec Walter qui manifeste à nouveau sa volonté d’arrêter. Ensemble, nous le convainquons péniblement de continuer au moins deux semaines avant de déclarer forfait, et je poursuis mes cours particuliers. Avant midi, à la fin d’un exercice, il abandonne à nouveau :
— Je comprends la solution, mais je ne l’aurais pas trouvée tout seul et ça m’énerve.
Parce que je suis convaincu de son potentiel, je tente un dernier plaidoyer mais rien n’y fait : il s’en va.
Les enseignants « enragent » bien entendu de voir quelques-uns de leurs élèves aux qualités indéniables, notamment en sciences, opter pour une autre voie sous prétexte qu’elle leur demandera moins d’efforts.
Bruno Descroix, professeur de mathématiquesDemain les profs
Depuis ma première rencontre avec lui, lors du jury de sélection, Walter m’est toujours apparu comme quelqu’un d’équilibré, de courageux et de travailleur. Tout l’opposé du fraudeur fainéant et assisté. Pourquoi abandonne-t-il ? Pourquoi n’ai-je pas réussi à le convaincre de continuer alors qu’il avait selon moi toutes les chances de décrocher un job à la fin de la formation ? Pour une fois, je suis vraiment découragé. Plus que cela, je suis en colère : combien de temps Walter restera-t-il parmi les 20 % de chômeurs de son patelin, maintenant qu’il a abandonné ? L’effort est-il une valeur, chez nous ? Peut-on instruire les gens malgré eux ?
Discussion de patrons
C’est à cette époque que je retrouve Jean ainsi que deux patrons d’entreprise au cours d’un déjeuner à Bruxelles. Les patrons nous expliquent l’environnement dans lequel ils évoluent.
— L’industrie, en Belgique, ne représente plus que 13 % de l’activité économique. Du coup, on a beau vouloir embaucher, nous avons de moins en moins de place pour des gens faiblement qualifiés. C’est désolant pour les élèves qui sortent de l’enseignement technique, mais tous les emplois industriels ont déménagé dans le Sud de l’Europe et en Asie. On ne reviendra pas en arrière.
— Tiens… Pourtant, j’ai entendu récemment que le secteur industriel suisse représentait encore 22 % du PIB de la confédération.
— Avec leur secteur bancaire ? Tu dois te tromper, c’est un pays massivement tertiaire. Ils n’ont même pas de port ! Et je ne parle pas des montagnes. 22 %, tu es sûr ?
— Oui, mais c’est de l’industrie de précision, avec des ouvriers très qualifiés.
— Pourtant, les salaires suisses ne sont pas franchement faibles. Tu me dis qu’ils ont moins délocalisé que nous alors que leur main-d’œuvre est plus chère ?!
— D’un autre côté, ils ont beaucoup plus d’argent que nous. Tu ne peux pas comparer la dette nationale suisse à la dette belge !
— Je ne pense pas que cela suffise à expliquer la situation. En Belgique aussi, il y a de l’argent, on nous parle tout le temps de notre taux d’épargne astronomique. Ce qui manque, par contre, ce sont des projets viables ainsi que des gens compétents et motivés pour les réaliser.
La Belgique serait le 3e pays le plus riche au monde en termes de patrimoine net par habitant.
Le Soir, 23 septembre 2014
— On en revient à l’enseignement : c’est l’école qui forme des gens compétents et motivés, porteurs de projets. Mais alors, pourquoi la situation est-elle meilleure en Suisse qu’en Belgique ? Comment arrivent-ils à maintenir le chômage des jeunes sous la barre des 3 % alors que chez eux, l’enseignement n’est obligatoire que jusqu’à 16 ans ?
— Ils poursuivent leur apprentissage en entreprise, comme en Allemagne. Les patrons suisses hésitent moins que nous à investir dans l’embauche de personnel, car les jeunes de 16 ans n’ont pas un salaire complet en début de carrière. Tout cela a contribué à encourager chez les travailleurs suisses un sens du travail bien fait et de l’effort. Ce n’est pas compliqué : des dizaines de milliers de Français traversent tous les jours la frontière pour fuir le paradis des 35 heures et travailler dans l’enfer helvète des 42 heures/semaine. Récemment, les Suisses ont organisé un référendum pour savoir s’il convenait d’imiter leurs voisins ou de garder leur régime des 42 heures. Le peuple a voté pour le maintien de la cadence, surtout en temps de crise.
Étudiants trop sages
Il fait beau dehors et je m’ennuie affreusement dans ma classe de demandeurs d’emploi qui apprennent à programmer. Ils sont chacun affairés devant leur écran. Je me lève pour voir où ils en sont. Ils lisent, ils programment, ils relisent, ils reprogramment.
Je m’arrête derrière deux d’entre eux et me rends compte qu’ils sont occupés au même exercice. Je sais à quel point le travail d’équipe est fondamental dans le milieu de la programmation, c’est l’occasion parfaite : « Vous êtes tellement silencieux, vous devriez travailler en équipe sur cet exercice ». Ils acquiescent discrètement et continuent chacun dans leur coin. Qu’est-ce que je m’ennuie ! Mais en même temps, à les voir concentrés et motivés comme cela depuis des semaines et, surtout, à voir leurs progrès, je ne comprends pas pourquoi l’école n’a pas réussi à les amener tous les douze en maths sup avec 90 % au bulletin.
Comme souvent, afin de stimuler l’autonomie, le Forem a inséré quelques journées sans instructeur dans cette formation. Hier, ils étaient seuls en classe. En une journée sans moi, ils devraient avoir accumulé des problèmes à résoudre, des questions. Ou au moins l’envie de me montrer leurs progrès. Mais non, rien. Je m’ennuie tellement à les regarder travailler seuls que je suis tenté d’improviser une leçon magistrale. Cela aurait le mérite de m’occuper, d’autant que j’adore m’écouter parler. L’idée ne me plaît cependant qu’à moitié : je ne peux tout de même pas les empêcher d’avancer simplement parce que je m’ennuie. Je décide finalement d’un compromis : « L’un d’entre vous désire-t-il que j’explique une leçon, n’importe laquelle ? Je le ferai avec plaisir. » Ils se retournent tous, me regardent avec un sourire bienveillant, presque avec commisération, mais visiblement, cela n’intéresse personne. Ils sont occupés.
La plus grande plainte des élèves, dans le monde entier, est « mes profs ne font que parler, parler et parler ».
Marc Prensky, conférencierFrom Digital Natives to Digital Wisdom, conférence, Paris, 5 avril 2012
En réalité, c’est de ma faute : je leur ai donné une série de vidéos dans lesquelles j’explique la plupart des leçons. Et ils sont quelques-uns, au moment où je les interromps, à les regarder, casque sur les oreilles. Les paroles d’un pédagogue français, Célestin Freinet, découvertes au gré de mes lectures, résonnent plus que jamais : « Organisez le travail, vous aurez la discipline. » Ils travaillent, c’est le principal, mais je m’ennuie. Et je me pose une autre question : qu’est-ce qui m’empêcherait d’avoir une classe de cent étudiants ?
École mutuelle d’adultes
Je remarque que mes étudiants s’expliquent régulièrement des concepts l’un à l’autre. Ce système d’entraide spontané, couplé à mes vidéos, suffirait-il à me rendre inutile ? Secrètement, j’espère me tromper. Réclameraient-ils ma présence s’ils étaient livrés à eux-mêmes pour de bon ?